|
Bienvenue chez les Briellois |
BRIELLES |
Retour page d'accueil Retour Canton d'Argentré-du-Plessis
La commune
de Brielles ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BRIELLES
Brielles vient, semble-t-il, de l'ange Gabriel.
Dès 1087 Brielles existait comme paroisse, et à cette époque l'évêque de Rennes Sylvestre confirma le don de son église, « ecclesiam parochiae que vocatur Brielles », aux Bénédictins de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers. La cure de Brielles fut pendant un certain temps unie au prieuré de ce nom, mais elle en était distraite aux siècles derniers, quoique l'abbé de Saint-Serge conservât toujours le droit de présenter le recteur. Ce dernier jouissait en 1646 de 500 livres de rente, d'après un Rolle ms. de l'évêché de Rennes (Pouillé de Rennes).
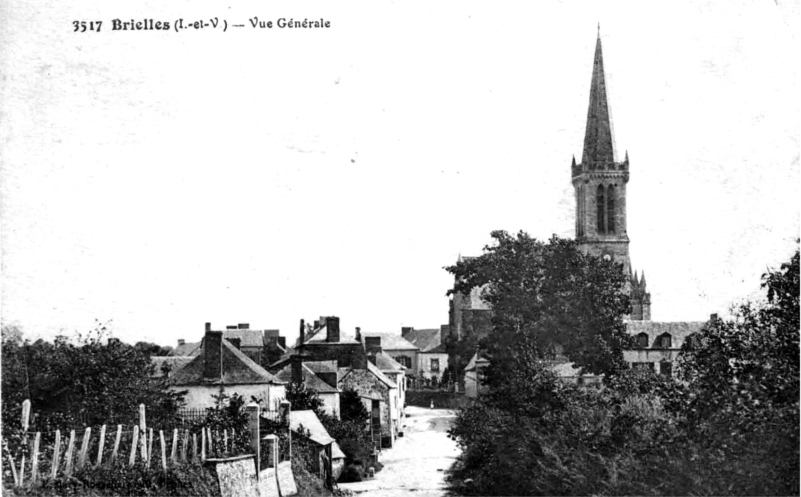
La paroisse de Brielles dépendait autrefois de la Châtellenie du Désert et de l’ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : Brielles (en 1087), ecclesia de Briellis (en 1516).
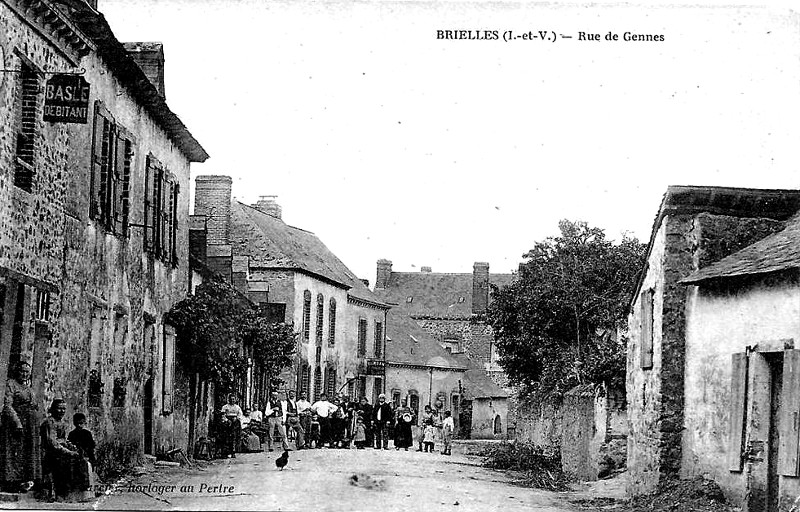
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Brielles : Michel Cordon (il prêta serment à l'abbé de l'abbaye Saint-Serge le 7 octobre 1305), Jean Placier (en 1601 et en 1605), Vincent Le Maczon (en 1609 et en 1626), Pierre Placier (en 1615 ?), Pierre Régnault (en 1618 ?), Jean Catin (1626-1638), Jean Gilbert (1638-1651), Jean Le Maistre (1652-1659), Gilles Hévin (1659-1675), Julien Poirier (1675-1682), Vincent Poirier (1683-1717), Guillaume Le Chartier (1717-1742), Jean Bouscher (1742-1755), Thomas Colliez (1756-1757), Jean-François Corbin (1757-1765), Pierre-Claude Raymondet (1766-1767), Germain Cordé (1767-1789), François-Mathurin Georgin (1803-1837), Jean-Baptiste Guet (1837-1871), Joseph Lorent (à partir de 1871), ....
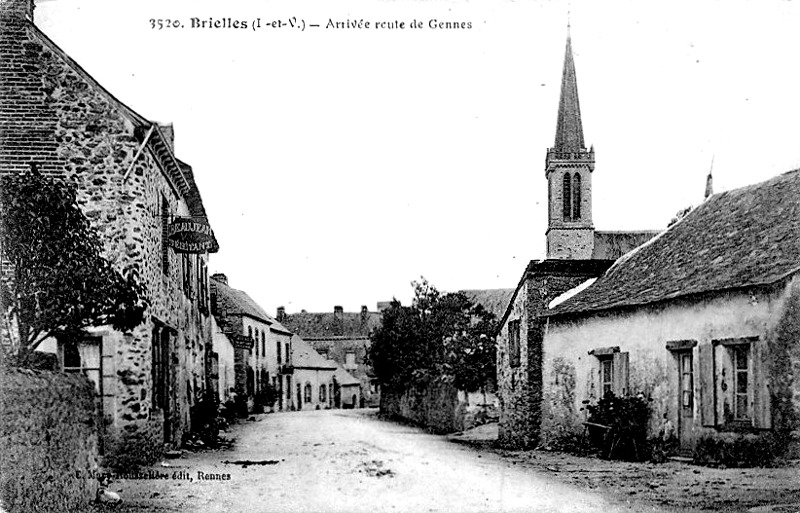
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances de Brielles en 1789
".
"
Le
cahier de doléances de Brielles en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de BRIELLES
![]() l'église
de la Sainte-Trinité (1859-1862). Dédiée à la Sainte Trinité, l'église
de Brielles a été reconstruite complètement au milieu du XIXème siècle
par M. Mellet, architecte. La première pierre en fut bénite le 22 novembre
1859. C'est une simple croix, de style ogival flamboyant, décorée
d'autels, stalles et chaires en bois sculpté, oeuvre de M. Hérault. On y
conserve une relique insigne de sainte Anastasie, dont une partie a été déposée
dans un corps de cire. On prétend qu'elle fut donnée par le cardinal
Robert Guibé. Ce qui paraît certain, c'est qu'en 1508 elle était déjà vénérée
à Brielles. En 1661 fut érigée dans cette paroisse la confrérie de la
Sainte-Trinité et de Sainte-Anastasie, à laquelle le pape Alexandre VII
accorda de nombreuses indulgences. La confrérie du Rosaire y fut aussi établie
le 27 août 1605. La confrérie du Saint-Sacrement ne date que de 1728 et
fut enrichie d'indulgences par le pape Benoît XIII. Toutes ces confréries
subsistent encore à la fin du XIXème siècle. Le retable du maître-autel date de 1862. L’autel de sainte
Anastasie date de 1864-1865. Le recteur Vincent Le Maczon (décédé le 10
janvier 1626 et inhumé le 12 au pied du maître-autel, fonda, par testament
du 8 janvier 1621, trois messes par semaine en son église et légua 800
écus à la fabrique et aux pauvres ;
l'église
de la Sainte-Trinité (1859-1862). Dédiée à la Sainte Trinité, l'église
de Brielles a été reconstruite complètement au milieu du XIXème siècle
par M. Mellet, architecte. La première pierre en fut bénite le 22 novembre
1859. C'est une simple croix, de style ogival flamboyant, décorée
d'autels, stalles et chaires en bois sculpté, oeuvre de M. Hérault. On y
conserve une relique insigne de sainte Anastasie, dont une partie a été déposée
dans un corps de cire. On prétend qu'elle fut donnée par le cardinal
Robert Guibé. Ce qui paraît certain, c'est qu'en 1508 elle était déjà vénérée
à Brielles. En 1661 fut érigée dans cette paroisse la confrérie de la
Sainte-Trinité et de Sainte-Anastasie, à laquelle le pape Alexandre VII
accorda de nombreuses indulgences. La confrérie du Rosaire y fut aussi établie
le 27 août 1605. La confrérie du Saint-Sacrement ne date que de 1728 et
fut enrichie d'indulgences par le pape Benoît XIII. Toutes ces confréries
subsistent encore à la fin du XIXème siècle. Le retable du maître-autel date de 1862. L’autel de sainte
Anastasie date de 1864-1865. Le recteur Vincent Le Maczon (décédé le 10
janvier 1626 et inhumé le 12 au pied du maître-autel, fonda, par testament
du 8 janvier 1621, trois messes par semaine en son église et légua 800
écus à la fabrique et aux pauvres ;

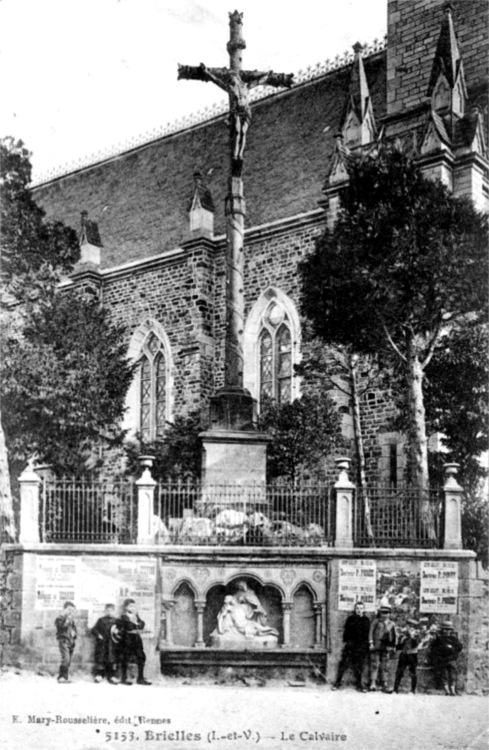
![]() l'ancien
prieuré Notre-Dame, aujourd'hui disparu. « D'azur à une Nostre-Dame
d'or ». « Dans la première moitié du XIème siècle, l'église et la
cure de Brielles, ainsi que les droits en dépendant, étaient partagés
plus ou moins inégalement entre trois possesseurs. D'abord le prêtre qui
desservait la paroisse ; il s'appelait Orri ; puis un laïque, Hamelin, qui
devait être le principal seigneur de la paroisse, car dans un acte du
prieuré de Gennes il est désigné sous le nom d'Hamelin de Brielles ;
enfin, un autre laïque nommé Godefroy, qui semble avoir été un cousin
d'Hamelin (M. de la Borderie, Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 147).
Orri avait un fils appelé Tébaud et un frère nommé Ernaud ; il confia
son fils à ce dernier, et Ernaud le conduisit à Saint-Serge d'Angers pour
l'y faire admettre au nombre des moines. Orri donna en cette circonstance à
l'abbaye la cure de Brielles avec toutes ses dépendances et tous ses
droits, un verger et une pâture au-dessous du presbytère, et un trait de dîme,
« totum presbyteratum et virgultum et herbagium subtus monasterium et
tractum decimae » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge d'Angers). Cette
donation fut aussitôt approuvée par l'évêque et le Chapitre de Rennes.
Peu après, Hamelin de Brielles, lui aussi, se fit moine à Saint-Serge
d'Angers ; à cette occasion, et du consentement de son fils Tesson, il
donna à ce monastère tout ce qu'il avait dans les dîmes et les offrandes
de l'église de Brielles, sa part dans les revenus du cimetière, le dixième
de la dîme de son domaine et la dîme de ses moulins. Enfin, Godefroy lui-même
et son fils Buteman étant venus à leur tour visiter l'abbaye de
Saint-Serge, lui cédèrent également tous les droits perçus par eux dans
l'église de Brielles et une autre part du cimetière, et en outre ils lui
donnèrent un pré et le dixième de la dîme de leur terre. L'acte qui
contient toutes ces donations n'est pas daté, mais celui qui relate
l'approbation de l'évêque de Rennes, Sylvestre, est expressément daté du
21 février 1087. La donation d'Orri, la première des trois, est donc du
commencement de cette année ou de la fin de 1086 (M. de la Borderie,
Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 149). Un peu plus tard, en 1108, l'évêque
Marbode confirma les moines de Saint-Serge dans la possession de l'église
de Brielles. Ainsi fut définitivement créé le prieuré de ce nom, fondé
dans l'origine pour trois moines (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, I, 516). Deux siècles plus tard, le 11 janvier 1300, Gilles, évêque
de Rennes, étant venu à Brielles au cours d'une tournée pastorale, eut à
s'occuper de l'état des prieurés de Saint-Serge situés dans cette contrée
de son diocèse. Il y en avait là trois, en effet, ramassés dans un petit
coin, à une lieue à peine l'un de l'autre : Brielles, Gennes et
Saint-Laurent de Goulias. Chacun de ces trois petits bénéfices ne pouvait
plus nourrir qu'un moine, à grande peine encore, surtout celui de Goulias.
Néanmoins, le service divin et (à Brielles et à Gennes) le ministère
paroissial y furent d'abord pendant longtemps convenablement par chacun des
moines qu'y envoyait l'abbaye de Saint-Serge. Mais comme il était arrivé
ailleurs que l'isolement de ces moines, dispersés un par un dans de petits
monastères, avait donné lieu à des abus, un jour vint où les Conciles
interdirent cette pratique et prescrivirent de ne jamais mettre moins de
deux moines par prieuré. En 1231, cette règle avait été appliquée dans
la province de Tours, et l'abbé de Saint-Serge avait alors retiré des
trois prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent de Goulias le moine
placé dans chacun d'eux ; puis il avait réuni au domaine de l'abbaye les
biens de ces trois prieurés, y mettant pour continuer le service divin
trois prêtres séculiers gagés par lui. « Ceux-ci, en vrais
mercenaires, ne songeaient qu'à alléger leur besogne, sans s'inquiéter
autrement des intérêts spirituels et temporels dont ils avaient charge.
Cet état de choses se prolongea, toujours empirant, sous l'administration
de cinq abbés, et lors de la visite de l'évêque Gilles à Brielles, il
durait depuis près de soixante-dix ans ». Le résultat se devine sans
peine : le culte était fort mal entretenu, les édifices destinés au culte
ne l'étaient pas du tout et tombaient en ruine ; le mal voulait un prompt
remède. L'évêque manda à Brielles Jean Rebours, abbé de Saint-Serge, et
de son consentement, après s'être convaincu que les revenus des trois bénéfices
mis ensemble suffisaient tout juste à l'entretien de deux personnes, il
unit les prieurés de Gennes et de Saint-Laurent de Goulias au prieuré de
Brielles, et il décida qu'en ce dernier lieu résideraient à l'avenir deux
moines, chargés de desservir les paroisses ainsi que la chapelle de
Saint-Laurent. Il est à remarquer que l'évêque confia formellement aux
moines eux-mêmes le ministère paroissial à Brielles et à Gennes, sans
leur prescrire de se substituer pour cet office des vicaires perpétuels, prêtres
séculiers. En effet, bien que la discipline générale des Conciles interdît
aux moines les exercés fonctions curiales, elle leur en permettait
l'exercice là où l'évêque diocésain le jugeait à propos. Toutefois, le
prieuré de Brielles ne demeura pas uni à la cure de ce nom et il tomba en
commende dans les derniers siècles ; mais ce bénéfice se composa jusqu'à
la Révolution des trois anciens prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent
de Goulias. Lorsque François de Rochechouart en fut nommé titulaire en
1734, il prit possession, le 7 septembre, des églises paroissiales de
Brielles et de Gennes, de la chapelle priorale de Saint-Laurent de Goulias
et du manoir prioral de même nom, qui tombait en ruines. Le dernier prieur,
René Briand, affermait en 1788 son bénéfice 1 100 livres, plus l'acquit
de toutes les charges ; or, celles-ci étaient nombreuses : il fallait payer
430 livres de décimes, — 600 livres d'honoraires au chapelain de
Saint-Laurent, — la portion congrue du recteur et des deux vicaires de
Gennes, — des rentes à l'abbé de Saint-Serge, à celui de la Roë, à
l'abbesse de Saint-Georges, au seigneur de Gennes, au Petit-Séminaire de
Rennes, au chapelain des Quatre-Evangélistes de Rennes, etc .; — il
devait, de plus, faire dire trois messes par semaine en l'église de
Brielles, autant en celle de Gennes et autant en la chapelle de
Saint-Laurent ; — il lui fallait, enfin, entretenir les chanceaux de ces
trois édifices. Les revenus du prieuré consistaient surtout en dîmes dans
les paroisses de Brielles et de Gennes ; il y avait aussi un petit domaine
proche consistant en un logis prioral ruiné au siècle dernier, en un
jardin et en quelques pièces de terre. Le tout était estimé en 1790
valoir 2 642 livres de rente ; mais comme les charges atteignaient le
chiffre de 1 587 livres 6 sols, il ne demeurait que 1 054 livres 14 sols de
revenu net au prieur de Brielles. A la fin du XIXème siècle il ne reste de
ce bénéfice qu'une maison insignifiante voisine du bourg et appelée
encore le Prieuré. Liste des prieurs de Brielles : — Guy Daumair, prêtre
du diocèse de Saint-Malo, prieur commendataire, vers 1530. — François
Goguet, simple clerc, résigna en 1701. — Pierre Carnet, prêtre de Paris,
docteur en théologie, fut pourvu le 22 mai 1701 ; décédé vers 1734. —
François de Rochechouart-Faudras, clerc de Toulouse, prit possession le 7
septembre 1734 ; décédé vers 1756. — Jean-Baptiste Bardon de Ségonzac,
vicaire général de Périgueux, prit possession le 5 avril 1756 ; décédé
en 1778. — René Briand, clerc de Vannes, né à Peillac, fils de
Guillaume Briand et de Perrine Boyer, prit possession le 24 mars 1779. En
1790 il habitait Paris ; ce fut le dernier prieur (Pouillé de Rennes) ;
l'ancien
prieuré Notre-Dame, aujourd'hui disparu. « D'azur à une Nostre-Dame
d'or ». « Dans la première moitié du XIème siècle, l'église et la
cure de Brielles, ainsi que les droits en dépendant, étaient partagés
plus ou moins inégalement entre trois possesseurs. D'abord le prêtre qui
desservait la paroisse ; il s'appelait Orri ; puis un laïque, Hamelin, qui
devait être le principal seigneur de la paroisse, car dans un acte du
prieuré de Gennes il est désigné sous le nom d'Hamelin de Brielles ;
enfin, un autre laïque nommé Godefroy, qui semble avoir été un cousin
d'Hamelin (M. de la Borderie, Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 147).
Orri avait un fils appelé Tébaud et un frère nommé Ernaud ; il confia
son fils à ce dernier, et Ernaud le conduisit à Saint-Serge d'Angers pour
l'y faire admettre au nombre des moines. Orri donna en cette circonstance à
l'abbaye la cure de Brielles avec toutes ses dépendances et tous ses
droits, un verger et une pâture au-dessous du presbytère, et un trait de dîme,
« totum presbyteratum et virgultum et herbagium subtus monasterium et
tractum decimae » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Serge d'Angers). Cette
donation fut aussitôt approuvée par l'évêque et le Chapitre de Rennes.
Peu après, Hamelin de Brielles, lui aussi, se fit moine à Saint-Serge
d'Angers ; à cette occasion, et du consentement de son fils Tesson, il
donna à ce monastère tout ce qu'il avait dans les dîmes et les offrandes
de l'église de Brielles, sa part dans les revenus du cimetière, le dixième
de la dîme de son domaine et la dîme de ses moulins. Enfin, Godefroy lui-même
et son fils Buteman étant venus à leur tour visiter l'abbaye de
Saint-Serge, lui cédèrent également tous les droits perçus par eux dans
l'église de Brielles et une autre part du cimetière, et en outre ils lui
donnèrent un pré et le dixième de la dîme de leur terre. L'acte qui
contient toutes ces donations n'est pas daté, mais celui qui relate
l'approbation de l'évêque de Rennes, Sylvestre, est expressément daté du
21 février 1087. La donation d'Orri, la première des trois, est donc du
commencement de cette année ou de la fin de 1086 (M. de la Borderie,
Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 149). Un peu plus tard, en 1108, l'évêque
Marbode confirma les moines de Saint-Serge dans la possession de l'église
de Brielles. Ainsi fut définitivement créé le prieuré de ce nom, fondé
dans l'origine pour trois moines (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, I, 516). Deux siècles plus tard, le 11 janvier 1300, Gilles, évêque
de Rennes, étant venu à Brielles au cours d'une tournée pastorale, eut à
s'occuper de l'état des prieurés de Saint-Serge situés dans cette contrée
de son diocèse. Il y en avait là trois, en effet, ramassés dans un petit
coin, à une lieue à peine l'un de l'autre : Brielles, Gennes et
Saint-Laurent de Goulias. Chacun de ces trois petits bénéfices ne pouvait
plus nourrir qu'un moine, à grande peine encore, surtout celui de Goulias.
Néanmoins, le service divin et (à Brielles et à Gennes) le ministère
paroissial y furent d'abord pendant longtemps convenablement par chacun des
moines qu'y envoyait l'abbaye de Saint-Serge. Mais comme il était arrivé
ailleurs que l'isolement de ces moines, dispersés un par un dans de petits
monastères, avait donné lieu à des abus, un jour vint où les Conciles
interdirent cette pratique et prescrivirent de ne jamais mettre moins de
deux moines par prieuré. En 1231, cette règle avait été appliquée dans
la province de Tours, et l'abbé de Saint-Serge avait alors retiré des
trois prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent de Goulias le moine
placé dans chacun d'eux ; puis il avait réuni au domaine de l'abbaye les
biens de ces trois prieurés, y mettant pour continuer le service divin
trois prêtres séculiers gagés par lui. « Ceux-ci, en vrais
mercenaires, ne songeaient qu'à alléger leur besogne, sans s'inquiéter
autrement des intérêts spirituels et temporels dont ils avaient charge.
Cet état de choses se prolongea, toujours empirant, sous l'administration
de cinq abbés, et lors de la visite de l'évêque Gilles à Brielles, il
durait depuis près de soixante-dix ans ». Le résultat se devine sans
peine : le culte était fort mal entretenu, les édifices destinés au culte
ne l'étaient pas du tout et tombaient en ruine ; le mal voulait un prompt
remède. L'évêque manda à Brielles Jean Rebours, abbé de Saint-Serge, et
de son consentement, après s'être convaincu que les revenus des trois bénéfices
mis ensemble suffisaient tout juste à l'entretien de deux personnes, il
unit les prieurés de Gennes et de Saint-Laurent de Goulias au prieuré de
Brielles, et il décida qu'en ce dernier lieu résideraient à l'avenir deux
moines, chargés de desservir les paroisses ainsi que la chapelle de
Saint-Laurent. Il est à remarquer que l'évêque confia formellement aux
moines eux-mêmes le ministère paroissial à Brielles et à Gennes, sans
leur prescrire de se substituer pour cet office des vicaires perpétuels, prêtres
séculiers. En effet, bien que la discipline générale des Conciles interdît
aux moines les exercés fonctions curiales, elle leur en permettait
l'exercice là où l'évêque diocésain le jugeait à propos. Toutefois, le
prieuré de Brielles ne demeura pas uni à la cure de ce nom et il tomba en
commende dans les derniers siècles ; mais ce bénéfice se composa jusqu'à
la Révolution des trois anciens prieurés de Brielles, Gennes et Saint-Laurent
de Goulias. Lorsque François de Rochechouart en fut nommé titulaire en
1734, il prit possession, le 7 septembre, des églises paroissiales de
Brielles et de Gennes, de la chapelle priorale de Saint-Laurent de Goulias
et du manoir prioral de même nom, qui tombait en ruines. Le dernier prieur,
René Briand, affermait en 1788 son bénéfice 1 100 livres, plus l'acquit
de toutes les charges ; or, celles-ci étaient nombreuses : il fallait payer
430 livres de décimes, — 600 livres d'honoraires au chapelain de
Saint-Laurent, — la portion congrue du recteur et des deux vicaires de
Gennes, — des rentes à l'abbé de Saint-Serge, à celui de la Roë, à
l'abbesse de Saint-Georges, au seigneur de Gennes, au Petit-Séminaire de
Rennes, au chapelain des Quatre-Evangélistes de Rennes, etc .; — il
devait, de plus, faire dire trois messes par semaine en l'église de
Brielles, autant en celle de Gennes et autant en la chapelle de
Saint-Laurent ; — il lui fallait, enfin, entretenir les chanceaux de ces
trois édifices. Les revenus du prieuré consistaient surtout en dîmes dans
les paroisses de Brielles et de Gennes ; il y avait aussi un petit domaine
proche consistant en un logis prioral ruiné au siècle dernier, en un
jardin et en quelques pièces de terre. Le tout était estimé en 1790
valoir 2 642 livres de rente ; mais comme les charges atteignaient le
chiffre de 1 587 livres 6 sols, il ne demeurait que 1 054 livres 14 sols de
revenu net au prieur de Brielles. A la fin du XIXème siècle il ne reste de
ce bénéfice qu'une maison insignifiante voisine du bourg et appelée
encore le Prieuré. Liste des prieurs de Brielles : — Guy Daumair, prêtre
du diocèse de Saint-Malo, prieur commendataire, vers 1530. — François
Goguet, simple clerc, résigna en 1701. — Pierre Carnet, prêtre de Paris,
docteur en théologie, fut pourvu le 22 mai 1701 ; décédé vers 1734. —
François de Rochechouart-Faudras, clerc de Toulouse, prit possession le 7
septembre 1734 ; décédé vers 1756. — Jean-Baptiste Bardon de Ségonzac,
vicaire général de Périgueux, prit possession le 5 avril 1756 ; décédé
en 1778. — René Briand, clerc de Vannes, né à Peillac, fils de
Guillaume Briand et de Perrine Boyer, prit possession le 24 mars 1779. En
1790 il habitait Paris ; ce fut le dernier prieur (Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancienne
chapelle priorale. Le prieuré de Brielles étant jadis dédié à
Notre-Dame, il est probable qu'il existait près du logis prioral une
chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Mais depuis bien des siècles ce sanctuaire a disparu ;
l'ancienne
chapelle priorale. Le prieuré de Brielles étant jadis dédié à
Notre-Dame, il est probable qu'il existait près du logis prioral une
chapelle dédiée à la Sainte Vierge. Mais depuis bien des siècles ce sanctuaire a disparu ;
![]() l'ancienne
chapelle du Bon Dieu de Pitié, située dans le cimetière et aujourd'hui démolie.
On appelait ainsi un petit sanctuaire tout voisin de l'église, avec
laquelle cependant il ne communiquait pas, qui a été rasé en même temps
que la vieille église. Il est fait mention en 1632 de cette chapelle, «
sise dans le cimetière » (Pouillé de Rennes) ;
l'ancienne
chapelle du Bon Dieu de Pitié, située dans le cimetière et aujourd'hui démolie.
On appelait ainsi un petit sanctuaire tout voisin de l'église, avec
laquelle cependant il ne communiquait pas, qui a été rasé en même temps
que la vieille église. Il est fait mention en 1632 de cette chapelle, «
sise dans le cimetière » (Pouillé de Rennes) ;
![]() la
croix de chemin (XV-XVIème siècle), située au lieu-dit « La Gorgetière » ;
la
croix de chemin (XV-XVIème siècle), située au lieu-dit « La Gorgetière » ;
![]() la
maison (XVI-XIX-XXème siècle), située au lieu-dit « Brinbeau » ;
la
maison (XVI-XIX-XXème siècle), située au lieu-dit « Brinbeau » ;
![]() 5 ou
6 étangs sur lesquels sont des moulins (selon Ogée) ;
5 ou
6 étangs sur lesquels sont des moulins (selon Ogée) ;
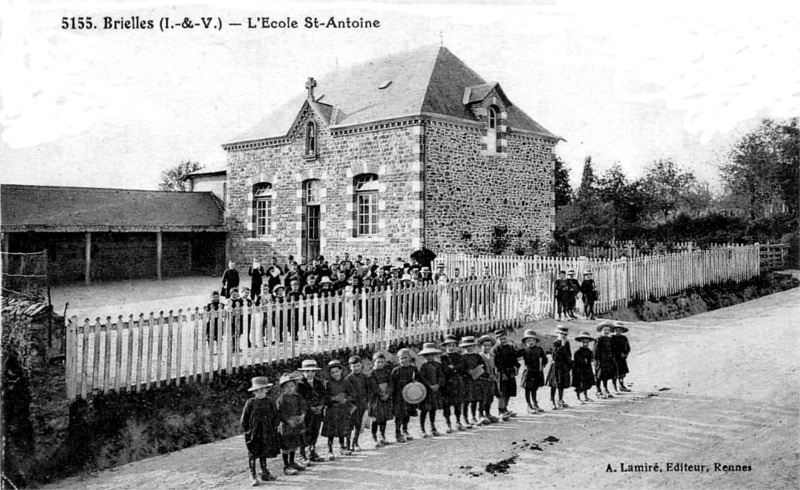
A signaler aussi :
![]() l'ancien
manoir du Haut-Charil. Propriété successive des familles Charil (en 1500) et Béchu (à la fin du XVIIème siècle) ;
l'ancien
manoir du Haut-Charil. Propriété successive des familles Charil (en 1500) et Béchu (à la fin du XVIIème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir de la Haie du Perron. Il possédait un droit de haute justice.
Propriété successive des familles Espinay (en 1553) et Foucault, sieurs de la Bigotière (en 1730 et 1767) ;
l'ancien
manoir de la Haie du Perron. Il possédait un droit de haute justice.
Propriété successive des familles Espinay (en 1553) et Foucault, sieurs de la Bigotière (en 1730 et 1767) ;
![]() l'ancien
manoir du Gravé ;
l'ancien
manoir du Gravé ;
![]() l'ancien
manoir de la Bertrie. Propriété de la famille de Fontenailles en 1428 et en 1553 ;
l'ancien
manoir de la Bertrie. Propriété de la famille de Fontenailles en 1428 et en 1553 ;
![]() l'ancien
manoir de la Motte. Il avait une motte et un droit de haute justice.
Propriété successive des familles Neufville, Sévigné (en 1462), du Gué
(vers 1542), la Marzelière (vers 1567 et en 1604), Rubin, seigneurs de la Grimaudière (en 1750) ;
l'ancien
manoir de la Motte. Il avait une motte et un droit de haute justice.
Propriété successive des familles Neufville, Sévigné (en 1462), du Gué
(vers 1542), la Marzelière (vers 1567 et en 1604), Rubin, seigneurs de la Grimaudière (en 1750) ;
![]() l'ancien
manoir du Châtelet de Brielles. Propriété successive des familles Rabaud
(en 1352), Sévigné (vers 1355), du Gué (vers 1542), la Marzelière (vers
1567), Volvire (vers 1635), Aiguillon (en 1676), Morel, seigneurs de la
Motte de Gennes (en 1679 et 1789) ;
l'ancien
manoir du Châtelet de Brielles. Propriété successive des familles Rabaud
(en 1352), Sévigné (vers 1355), du Gué (vers 1542), la Marzelière (vers
1567), Volvire (vers 1635), Aiguillon (en 1676), Morel, seigneurs de la
Motte de Gennes (en 1679 et 1789) ;
![]() l'ancien
manoir des Loges. Propriété de la famille Couaisnon en 1513 ;
l'ancien
manoir des Loges. Propriété de la famille Couaisnon en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Petit-Rocher ;
l'ancien
manoir du Petit-Rocher ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de BRIELLES
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Bryelles".
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.