|
Bienvenue chez les Jansonnais |
LA CHAPELLE-JANSON |
Retour page d'accueil Retour Canton de Fougères
La commune de
La Chapelle-Janson ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA CHAPELLE-JANSON
La Chapelle-Janson tire son nom du fondateur de la paroisse au XIème siècle, le chevalier Gençon ou Jançon.
C'est au XIème siècle que remonte l'existence de la paroisse de la Chapelle-Janson. En effet, l'église ("capella Jançon"), fondée par le chevalier Gençon (ou Jançon) au XIème siècle, est donnée vers 1032 à l'abbaye Saint-Georges de Rennes (abbatia Sancti Georgii) par la vicomtesse Roïanteline (veuve du vicomte Eudon). Cette église est citée dans l'acte de fondation de l'abbaye Saint-Georges de Rennes.

Cette abbaye fonde à La Chapelle-Janson, un prieuré de bénédictines. Le Prieuré possédait jadis un droit de haute justice avec un cep et un collier dans le bourg de la Chapelle-Janson, ainsi que des fourches patibulaires à quatre piliers. Les Templiers y possèdent aussi, au village de la Templerie, une maison dont la chapelle va subsister jusqu'en 1793. Voici l'aveu de l'abbaye Saint-Georges rendu au Roi en 1665 par Magdelaine de la Fayette, abbesse de Saint-Georges : " Les dictes dames ont et leur apartiennent, en la paroisse de la Chapelle Janson, un fief et bailliage apellé le bailliage de la Chapelle, à cause duquel elles ont droit de haulte, moienne et basse justice et punition de crimes ; mesme y a, dans le bourg, un sep et collier qui est de la dicte jurisdiction en laquelle elles ont droit d’avoir officiers, scavoir : séneschal, alloué et procureur d’office, et un greffier, un sergent général et nombre de notaires, quelle jurisdiction s’exerce dans le bourg de la Chapelle Janson, et y a exercice ordinaire de quinze jours en quinze jours ; et vont et sortissent en icelle les contredicts et apellations des jugemens donnés es jurisdictions de la Creveure et Monframery cy après mentionnés, de laquelle sont hommes et vassaux dame Renée Constantin, dame du Bois Febvrier, à cause de la terre et seigneurie de la Crevure et dépendance d’icelle ; — Messire René du Bois le Hou, seigneur du dict lieu ; — et Messire … sieur du Bois Guy, à cause des fiefs du Refoul, en la dicte parroisse de la Chapelle Janson, fief de la Rivaye, fief de Lousche, fief de la Vacherie, fief de la Pommeraye, fief de la Jumelaye et de la Planche, la métairie de la Lande et de la Rablaye, les fiefs de la Motte Digné, quelles terres st seigneuries estantes dans la Chapelle Janson sont tenues de la dicte dame noblement à debvoir de rentes, foy, hominage et rachapt, et plusieurs autres seigneurs, hommes et vassaux à pareil debvoir et autres. Ont les dictes dames droit d’espaves, gallois, deshérances, confiscations, successions de bastartz et tous autres droitz apartenant à haulte, basse et moienne justice, fourches à quatre pilliers et autres droicts. Le roolle du quel bailliage se monte à quatre livres monnoie de rente propre chacun an. Item les dictes dames sont fondatrices et patronnes de l’église et cimetière de la dicte parroisse de la Chapelle Janson et de la Chapelle des Temples, fillette de la dicte parroisse, et ont en icelles armoiryes, escussons et touttes prééminances et prérogatives en la dicte église ; dans laquelle parroisse y a aussy un prieuré, nommé le prieuré de la Chapelle Janson, membre despendant de la dicte abbaye, possédé en tiltre par une religieuse d’icelle ; le temporel duquel consiste en maisons, courts, jardins, herbergements, moullin, estang, terres arables et non arables, et en prez, dixmes, oblations et rentes qui sont deues à la dicte prieure sur le moulin du Plessis, apartenant au seigneur de Larchat. Et finalement tout ce qui peut apartenir aus dictes dames et couvent en la Chapelle Janson, avecq touttes leurs apartenances et dépendances ".
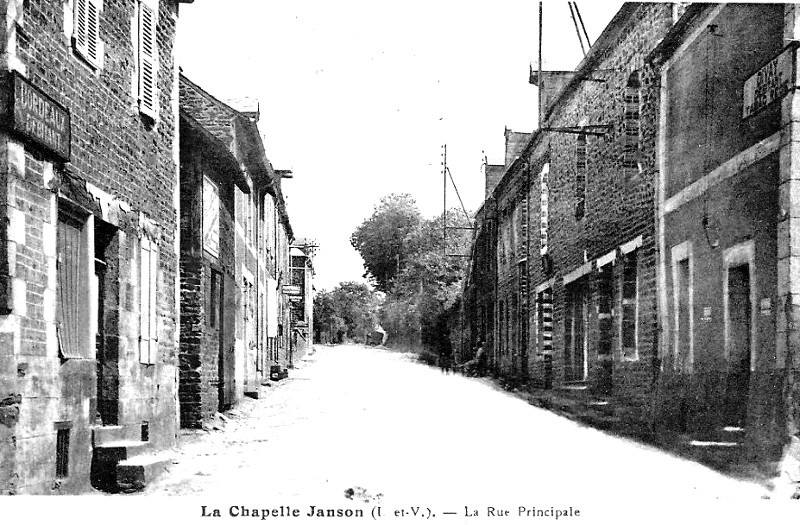
Le Pouillé de Rennes précise que l'église et vraisemblablement la paroisse de La Chapelle-Janson existaient dès le commencement du XIème siècle, puisque la première abbesse de Saint-Georges en reçut le don vers 1032. Ce fut la vicomtesse Roianteline qui assura aux Bénédictines la possession de La Chapelle-Janson et de toutes ses dépendances. Mais l'on se demande comment cette dame se trouvait maîtresse de cette église. Les uns croient qu'elle lui venait de la succession de son mari, le vicomte Eudon ; d'autres pensent qu'elle appartenait en réalité à une dame de la maison de Fougères, religieuse au couvent de Chavagne, fondé par la vicomtesse, puis entrée avec celle-ci à l'abbaye de Saint-Georges. D'après cette dernière opinion, Roianteline n'eût fait que confirmer à Saint-Georges le don de cette dame de Fougères. Quoi qu'il en soit, les religieuses de Saint-Georges fondèrent à la suite de cette donation l'important prieuré de La Chapelle-Janson. Le recteur de La Chapelle-Janson, appelé longtemps simplement chapelain par l'abbesse de Saint-Georges, avait droit de le présenter à l'évêque. En 1790, le recteur, M. Malle, déclara que les revenus de sa cure montaient à 2822 livres, à savoir : pourpris, 20 livres ; le tiers des dîmes grosses et novales, 2650 livres ; le tiers des dimereaux de la Templerie et de la Lande, 152 livres. Mais il avait, par contre, bien des charges, entre autres la pension de deux vicaires, les décimes, etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).
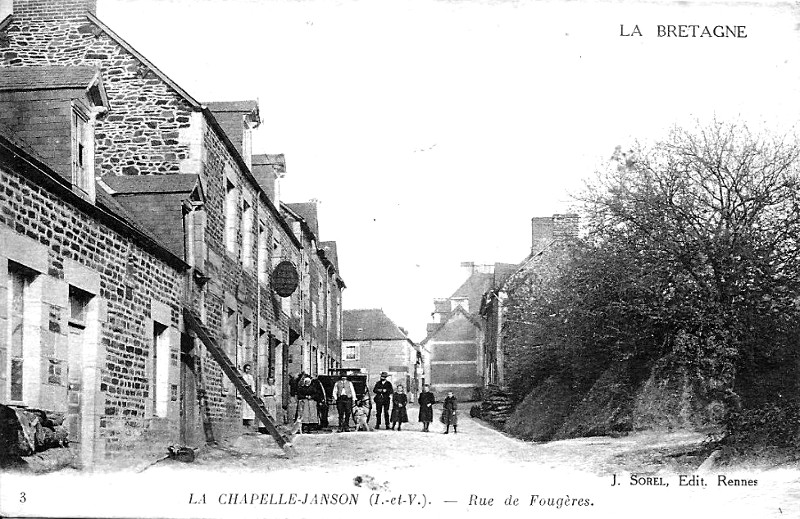
On rencontre les appellations suivantes : Capella Gençon (au XIème siècle), capella Janson (au XIIIème siècle), Capella Janczon (en 1516).
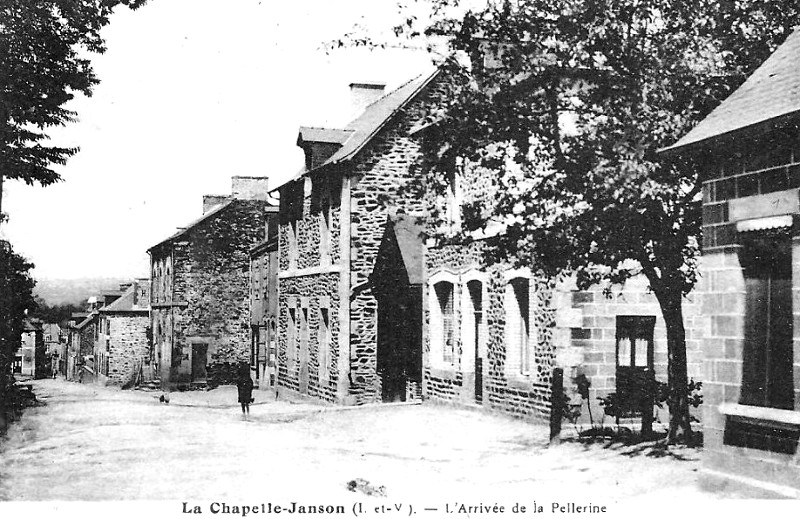
Note 1 : Par acte du 30 septembre 1788, Renée Bertereau fonda une rente de 80 livres « pour le salaire d'une maîtresse d'école au village de la Templerie, en la paroisse de la Chapelle-Janson » ; elle se réserva le soin de faire elle-même l'école durant sa vie, et elle remplissait ces modestes fonctions quand arriva la Révolution (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).
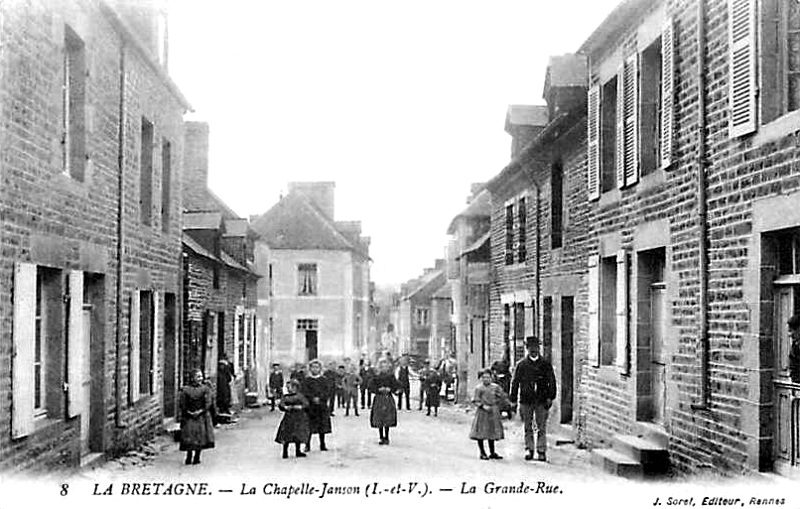
Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de La Chapelle-Janson : Geffroy et Robert (il paraissent comme témoins dans une charte du XIIème siècle : « Gauffridus et Robertus sacerdotes de Capella »). Pierre de Grigane (il résigna en 1436 pour obtenir la chapellenie de Montmuran). Pierre Henry (il fut pourvu le 20 mars 1436). Guillaume Picot (décédé en 1464). Jean Jan (il fut pourvu le 13 novembre 1464, mais Jean Papin lui disputa le bénéfice). Jean de la Piguelaye (chanoine de Rennes et doyen de Fougères, décédé en 1531). Jean du Chastellier (en 1532). Guillaume Le Breton (il fut présenté par l'abbesse de Saint-Georges pour remplacer le précédent en juillet 1532). Jean Pépin (il résigna en 1604). René Vénier (prêtre de Rennes, il fut pourvu le 29 novembre 1604). René Brillet (il résigna le 2 juillet 1612). Etienne Pavé (il fit quelques acquisitions pour sa fabrique en 1624 ; décédé en 1637). Jean Robert (il fit en 1640 une déclaration des biens de son église et permuta l'année d'après avec le suivant). Julien Bérel (précédemment recteur de Martigné, il prit possession le 15 décembre 1641, puis résigna vers 1667 en faveur de son frère, qui suit). Bertrand Bérel (il fit au roi la déclaration de son presbytère le 21 mars 1680 ; décédé le 24 octobre 1685). Michel Duclos (il fut présenté par l'abbesse de Saint-Georges le 25 octobre 1685 ; décédé le 23 mai 1688). René Crespel (présenté par l'abbesse le 29 mai 1688, fut pourvu le 31 et prit possession le 6 juin ; il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : de gueules à trois tours d'argent, 2, 1, et résigna en 1709). Charles de la Jaille (prêtre du Mans, il fut pourvu le 8 février 1709 et prit possession le 10 ; décédé en 1722). Julien-François Le Grand (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 23 novembre 1722 et résigna dès l'année suivante). Louis Brisson (prêtre de Nantes, pourvu le 6 décembre 1723, résigna en 1726 en faveur du suivant). Joseph Maillard (frère du poète Des Forges-Maillard, prêtre de Nantes, pourvu en 1726, il résigna en 1770, moyennant 400 livres de pension). René-Mathurin Malle (il fut pourvu le 24 septembre 1770 et gouverna jusqu'à la Révolution ; il fut réinstallé en 1803 et mourut ou se démit en 1806). Pierre Jambin (1806, décédé en 1826). Jean Jégu (1827-1834). Joseph Fourmond (1834, décédé en 1864). François Boutevilain (1864-1876). Jean-Marie David (1876-1882). Célestin Samson (à partir de 1882),....
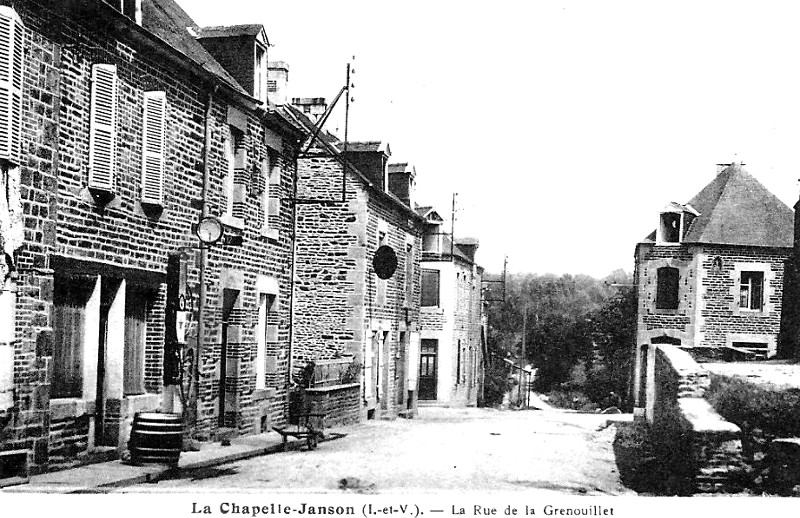
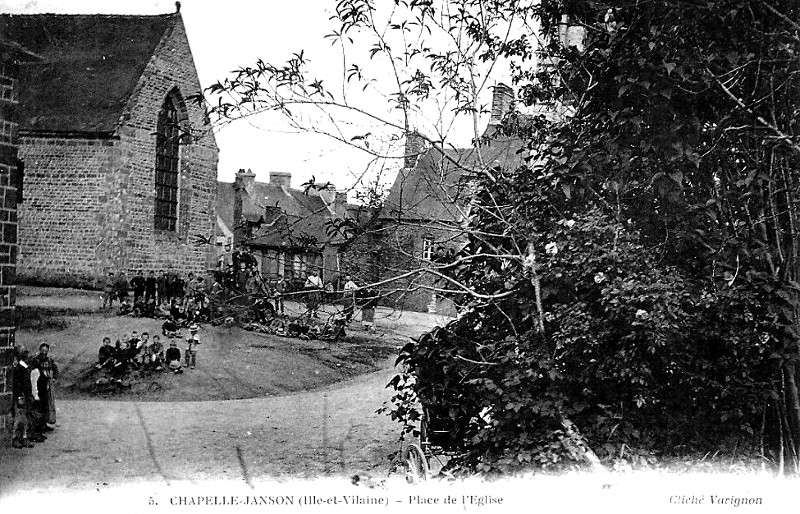
Voir
![]() "
Origines
de la paroisse de La Chapelle-Janson ".
"
Origines
de la paroisse de La Chapelle-Janson ".
![]()
PATRIMOINE de LA CHAPELLE-JANSON
![]() l'église
Saint-Lézin (XVème siècle). Réaménagée et modifiée au XVIème et au XVIIème siècles.
Dédiée à saint Lezin, évêque d'Angers, l'église de
La Chapelle-Janson a la forme d'une croix et est en partie l'oeuvre du
XVIème siècle. Le chevet droit, avec sa belle fenêtre flamboyante, est antérieur à 1552, puisque son vitrail porte
cette date ; le transept du Nord, orné aussi d'une grande baie de
style ogival fleuri, a été terminé en 1552 ; celui du Sud ne
l'a été qu'en 1641 ; mais, de ce côté, deux jolies portes, richement
décorées de sculptures, rappellent aussi le style flamboyant : l'une d'elles, en arc Tudor, a son tympan rempli par
les instruments de la Passion, la couronne d'épines, le
marteau, les clous et la lance, le tout surmonté d'un coeur placé au sommet de l'accolade. La sacristie, sur laquelle on
lit la date 1629, est une ancienne chantrerie ou peut-être une vieille
chapelle seigneuriale, communiquant avec le choeur au moyen
d'une arcade aujourd'hui murée. Enfin, la façade et la porte
occidentales portent le millésime 1777. Il
y avait jadis en cette église de nombreuses fondations dont
les revenus atteignaient en 1790 plus de 500 livres ; de plus,
la fabrique avait, à la même époque, 471 livres de rente ; enfin, la
confrérie du Rosaire y était érigée. Mais
la gloire de La Chapelle-Janson, c'étaient ses splendides
verrières ; il en reste encore de beaux débris dont il nous faut
parler. Nous ne décrirons point toutefois ces vitraux dans tous leurs
détails, M. Maupillé l'ayant déjà fait avec beaucoup d'exactitude (Voir
Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères, 52) ; signalons seulement les principales scènes
qu'ils représentent. La maîtresse vitre, dans la grande fenêtre du chevet, malheureusement
fort endommagée, renferme : l'Annonciation ; —
la Sainte Vierge et l'enfant Jésus avec un ange qui offre la
croix au divin Enfant et un glaive transperçant le coeur de sa
sainte Mère ; — le prophète Elie recevant d'un ange le pain
mystique, symbole de l'eucharistie ; — saint Lezin, patron
de la paroisse, bénissant une jeune dame richement parée,
vraisemblablement la donatrice du vitrail ; — Job sur son
fumier, — et le sacrifice d'Abraham. On y voit aussi les débris d'une inscription commémorative où se trouve le nom
de Robert Claude ............. de Plédren et la date 1552. Enfin, trois écussons sont au haut de la vitre ;
ceux des deux côtés sont semblables : d'argent au lion coupé de gueules et de sinople,
armé d'or, qui est d'Espinay (nota : on
se demande pourquoi ces écussons d'Espinay ; trois hypothèses sont permises : la
famille d'Espinay était alliée aux seigneurs de Montframmery ; — Philippe d'Espinay,
abbesse de Saint•Georges en 1572, avait peut-être été
prieure de La Chapelle-Janson ; - enfin, le peintre verrier a pu confondre
les armes d'Espinay avec celles des sires de Montframmery, qui portaient d'argent
au léopard de sinople) ; celui du milieu est écartelé
mi-parti de gueules à la fasce d'hermines, qui est de la Chapelle, et d'azur
à la fasce d'argent accompagnée de trois molettes de gueules, qui est
Ferré. Ce dernier blason est celui de Robert Claude de la Chapelle,
seigneur de Plédren, mari de Charlotte Ferré, et jouissant à La Chapelle-Janson
de prééminences authentiquement reconnues par acte de 1533. La verrière
du transept septentrional semble avoir été consacrée à la Sainte Vierge
: on y distingue Marie tenant l'enfant Jésus sur ses genoux, puis le Trépassement,
et enfin l'Assomption de Notre-Dame. Plusieurs autres personnages sont aussi
représentés dans cette vitre, notamment une abbesse et un chanoine, et un
seigneur de Beaucé avec sa femme, l'un et l'autre présentés par leurs
saints patrons ; leurs armes, d'argent à l'aigle de sable, becquée et
membrée de gueules, au bâton brochant, qui est de Beaucé,
apparaissent près d'eux. L'écusson des sires d'Espinay se retrouve également
au sommet de cette vitre. La seigneurie de Montframmery avait à La Chapelle-Janson
des droits honorifiques ; elle appartenait au XVIème siècle à la famille
de Beaucé. Aussi voit-on encore dans d'autres parties de cette église,
notamment à la voûte du transept du Sud, les armoiries d'Eustache de Lys,
mari de Françoise de Beaucé, dame de Montframmery : de gueules à la
fasce d'argent chargée de quatre hermines de sable et surmontée de deux
fleurs de lys d'argent, qui est de Lys. Quant à la litre, dont on
retrouve des vestiges à l'extérieur de l'église, les armoiries en sont
complètement effacées. Terminons en signalant une cuve baptismale de la
fin du XIVème siècle, en granit, et divisée en deux compartiments
octogones dont les faces sont décorées d'arcatures trilobées ; — et un
bénitier qui, provenant de l'ancienne chapelle de la Templerie, semble
appartenir à la période romane : c'est une colonne monocylindrique de
granit creusée en cuvette à sa partie supérieure (Pouillé de Rennes).
En résumé l'église actuelle comprend une nef à chevet droit et un transept. Le
pignon ouest porte la date de 1777. Le croisillon sud est daté de 1641. Le
chevet (XVIème siècle) est percé d'une fenêtre flamboyante à deux
meneaux. Le croisillon nord date de 1552. A l'intérieur, la fenêtre du
chevet renferme un beau vitrail daté de 1552 et figurant l'Annonciation,
la Vierge et l'Enfant-Jésus, Elie, saint Lézin
évêque d'Angers (592-608) et patron de la paroisse de La Chapelle-Janson, Job
et le Sacrifice d'Abraham : cette vitre porte les armes de la famille
d'Espinay et on y voit aussi l'écusson écartelé de Robert de la Chapelle
seigneur de Plédren et de Charlotte Ferré, son épouse. Le transept
présente trois arcs brisés : celui du nord est daté de 1556 et celui du
sud est datée de 1641. On voit sous l'arcade sud plusieurs écussons
couronnés d'Eustache du Lys, époux de Françoise de Beaucé dame de
Montframmery au début du XVIIème siècle. La verrière du croisillon nord,
datée de 1558, figure la Mort et le Couronnement de la Vierge. Les fonts
doubles et octogonaux datent du XIV-XVème siècle. La sacristie, datée de
1629, est une ancienne chapelle seigneuriale ou chantrerie ;
l'église
Saint-Lézin (XVème siècle). Réaménagée et modifiée au XVIème et au XVIIème siècles.
Dédiée à saint Lezin, évêque d'Angers, l'église de
La Chapelle-Janson a la forme d'une croix et est en partie l'oeuvre du
XVIème siècle. Le chevet droit, avec sa belle fenêtre flamboyante, est antérieur à 1552, puisque son vitrail porte
cette date ; le transept du Nord, orné aussi d'une grande baie de
style ogival fleuri, a été terminé en 1552 ; celui du Sud ne
l'a été qu'en 1641 ; mais, de ce côté, deux jolies portes, richement
décorées de sculptures, rappellent aussi le style flamboyant : l'une d'elles, en arc Tudor, a son tympan rempli par
les instruments de la Passion, la couronne d'épines, le
marteau, les clous et la lance, le tout surmonté d'un coeur placé au sommet de l'accolade. La sacristie, sur laquelle on
lit la date 1629, est une ancienne chantrerie ou peut-être une vieille
chapelle seigneuriale, communiquant avec le choeur au moyen
d'une arcade aujourd'hui murée. Enfin, la façade et la porte
occidentales portent le millésime 1777. Il
y avait jadis en cette église de nombreuses fondations dont
les revenus atteignaient en 1790 plus de 500 livres ; de plus,
la fabrique avait, à la même époque, 471 livres de rente ; enfin, la
confrérie du Rosaire y était érigée. Mais
la gloire de La Chapelle-Janson, c'étaient ses splendides
verrières ; il en reste encore de beaux débris dont il nous faut
parler. Nous ne décrirons point toutefois ces vitraux dans tous leurs
détails, M. Maupillé l'ayant déjà fait avec beaucoup d'exactitude (Voir
Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères, 52) ; signalons seulement les principales scènes
qu'ils représentent. La maîtresse vitre, dans la grande fenêtre du chevet, malheureusement
fort endommagée, renferme : l'Annonciation ; —
la Sainte Vierge et l'enfant Jésus avec un ange qui offre la
croix au divin Enfant et un glaive transperçant le coeur de sa
sainte Mère ; — le prophète Elie recevant d'un ange le pain
mystique, symbole de l'eucharistie ; — saint Lezin, patron
de la paroisse, bénissant une jeune dame richement parée,
vraisemblablement la donatrice du vitrail ; — Job sur son
fumier, — et le sacrifice d'Abraham. On y voit aussi les débris d'une inscription commémorative où se trouve le nom
de Robert Claude ............. de Plédren et la date 1552. Enfin, trois écussons sont au haut de la vitre ;
ceux des deux côtés sont semblables : d'argent au lion coupé de gueules et de sinople,
armé d'or, qui est d'Espinay (nota : on
se demande pourquoi ces écussons d'Espinay ; trois hypothèses sont permises : la
famille d'Espinay était alliée aux seigneurs de Montframmery ; — Philippe d'Espinay,
abbesse de Saint•Georges en 1572, avait peut-être été
prieure de La Chapelle-Janson ; - enfin, le peintre verrier a pu confondre
les armes d'Espinay avec celles des sires de Montframmery, qui portaient d'argent
au léopard de sinople) ; celui du milieu est écartelé
mi-parti de gueules à la fasce d'hermines, qui est de la Chapelle, et d'azur
à la fasce d'argent accompagnée de trois molettes de gueules, qui est
Ferré. Ce dernier blason est celui de Robert Claude de la Chapelle,
seigneur de Plédren, mari de Charlotte Ferré, et jouissant à La Chapelle-Janson
de prééminences authentiquement reconnues par acte de 1533. La verrière
du transept septentrional semble avoir été consacrée à la Sainte Vierge
: on y distingue Marie tenant l'enfant Jésus sur ses genoux, puis le Trépassement,
et enfin l'Assomption de Notre-Dame. Plusieurs autres personnages sont aussi
représentés dans cette vitre, notamment une abbesse et un chanoine, et un
seigneur de Beaucé avec sa femme, l'un et l'autre présentés par leurs
saints patrons ; leurs armes, d'argent à l'aigle de sable, becquée et
membrée de gueules, au bâton brochant, qui est de Beaucé,
apparaissent près d'eux. L'écusson des sires d'Espinay se retrouve également
au sommet de cette vitre. La seigneurie de Montframmery avait à La Chapelle-Janson
des droits honorifiques ; elle appartenait au XVIème siècle à la famille
de Beaucé. Aussi voit-on encore dans d'autres parties de cette église,
notamment à la voûte du transept du Sud, les armoiries d'Eustache de Lys,
mari de Françoise de Beaucé, dame de Montframmery : de gueules à la
fasce d'argent chargée de quatre hermines de sable et surmontée de deux
fleurs de lys d'argent, qui est de Lys. Quant à la litre, dont on
retrouve des vestiges à l'extérieur de l'église, les armoiries en sont
complètement effacées. Terminons en signalant une cuve baptismale de la
fin du XIVème siècle, en granit, et divisée en deux compartiments
octogones dont les faces sont décorées d'arcatures trilobées ; — et un
bénitier qui, provenant de l'ancienne chapelle de la Templerie, semble
appartenir à la période romane : c'est une colonne monocylindrique de
granit creusée en cuvette à sa partie supérieure (Pouillé de Rennes).
En résumé l'église actuelle comprend une nef à chevet droit et un transept. Le
pignon ouest porte la date de 1777. Le croisillon sud est daté de 1641. Le
chevet (XVIème siècle) est percé d'une fenêtre flamboyante à deux
meneaux. Le croisillon nord date de 1552. A l'intérieur, la fenêtre du
chevet renferme un beau vitrail daté de 1552 et figurant l'Annonciation,
la Vierge et l'Enfant-Jésus, Elie, saint Lézin
évêque d'Angers (592-608) et patron de la paroisse de La Chapelle-Janson, Job
et le Sacrifice d'Abraham : cette vitre porte les armes de la famille
d'Espinay et on y voit aussi l'écusson écartelé de Robert de la Chapelle
seigneur de Plédren et de Charlotte Ferré, son épouse. Le transept
présente trois arcs brisés : celui du nord est daté de 1556 et celui du
sud est datée de 1641. On voit sous l'arcade sud plusieurs écussons
couronnés d'Eustache du Lys, époux de Françoise de Beaucé dame de
Montframmery au début du XVIIème siècle. La verrière du croisillon nord,
datée de 1558, figure la Mort et le Couronnement de la Vierge. Les fonts
doubles et octogonaux datent du XIV-XVème siècle. La sacristie, datée de
1629, est une ancienne chapelle seigneuriale ou chantrerie ;

![]() l'ancien
prieuré Saint-Lezin de la Chapelle-Janson, aujourd'hui disparu et jadis
membre de l'abbaye de Saint-Georges. « D'azur à une église d'argent »
(Armorial général ms. de 1698). Peu de temps après la fondation de
l'abbaye de Saint-Georges (en 1032), une noble dame appelée la vicomtesse
Roianteline, que l'on regarde généralement comme la veuve du vicomte Eudon,
ayant réuni à Saint-Georges une petite communauté de femmes fondée par
elle primitivement à Chavagne, donna à l'abbaye, entre autres domaines, l'église
de la Chapelle-Janson avec toutes ses dépendances, « Capellam Gencon
cum omnibus appendiciis suis, sine calumpnia alicujus hominis »
(Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, 109). Par suite de cette donation,
les Bénédictines de Saint-Georges fondèrent à la Chapelle-Janson un
important prieuré, auquel elles subordonnèrent la cure, réduite par là-même
à la condition d'un vicariat perpétuel dont l'abbesse eut la présentation.
Au XIIème siècle, ces religieuses possédaient à la Chapelle-Janson
d'assez nombreuses rentes sur les habitants, plus 15 sols de mangier
; — la dîme des moulins de Choisel, de Jugant et de Marchant ; — le
tiers de deux portions de la dîme de Flandrine (nota : Adèle, surnommée
Flandrine, avait donné vers le même temps la sixième portion du moulin de
la Chapelle — voir Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 151) ; — la dîme
de la Ruelle, que donna Geffroy Le Bastard ; — deux parts de l'oblation et
de la dîme du milieu de la censie de la Ville-du-Bois ; — deux portions
des oblations de l'église ; — la présentation du chapelain ou vicaire
perpétuel (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 159). Au commencement du
siècle suivant, des difficultés survenues entre l'abbesse de Saint-Georges
et le recteur ou chapelain de la Chapelle-Janson furent aplanies par un règlement
fait, à la demande des parties, par Pierre de Dinan, évêque de Rennes, règlement
qui fut suivi jusqu'à l'époque de la Révolution. Dans le partage des
revenus des terres et des dîmes qui appartenaient à l'église ou qui
pourraient lui appartenir par la suite, à quelque titre que ce fût, les
deux tiers furent attribués à l'abbesse et l'autre tiers au chapelain. La
même règle fut appliquée aux oblations faites à l'église, tant aux
jours de fêtes qu'aux jours ordinaires, à l'exception de celles qui étaient
faites le jour des Morts et à l'occasion des sépultures ; le chapelain
seul avait droit à ces dernières oblations, et en général à tous les
droits et produits casuels des offices des Morts. Relativement aux dîmes,
l'évêque statua qu'au temps de la moisson elles seraient toutes transportées
à la grange du prieuré, où se ferait le partage du grain et de la paille
; puis que celle-ci serait fermée à deux clefs, dont l'une serait remise
au chapelain, l'autre aux religieuses ou à leur représentant, de sorte
qu'une des parties intéressées ne pût pas y entrer sans l'autre (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine). Quelque positifs qu'aient été les
titres de l'abbaye de Saint-Georges, ses droits sur la Chapelle-Janson ne
laissèrent pas de lui être plus d'une fois contestés. Les anciens
documents nous ont conservé les traces de deux contestations, entre autres,
qu'elle eut à soutenir. La première, en 1522, contre Mme Alizon de
Pontbellanger, abbesse de Saint-Sulpice, qui éleva quelques prétentions
sur le prieuré en faveur de son abbaye, prétentions, du reste, auxquelles
elle ne semble pas avoir donné de suite ; la seconde, en 1635, contre M.
Robert, recteur, qui osa disputer le bénéfice à sa patronne. Mais le Présidial
d'abord, par une sentence du 24 mai 1635, et le Parlement ensuite, par arrêt
du 20 juillet suivant, firent bonne justice de ses prétentions et confirmèrent
l'abbaye de Saint-Georges dans la possession pleine et entière de tous les
droits qu'elle avait jusqu'alors exercés (M. Maupillé, Notices historiques
sur le canton de Fougère, 49). Au XVIIème siècle, le prieuré de la
Chapelle-Janson consistait en trois petites maisons, celle du moulin
comprise, situées au bourg ; — trois petits jardins et trois pièces de
terre, le tout contenant 7 journaux ; — un petit étang, nommé la
Grenouillais ; — un moulin à eau ; — un emplacement où était jadis un
four banal ; — les deux tiers des dîmes ; — les deux tiers des
oblations ; — une rente sur le moulin du Plessix, appartenant au seigneur
de Larchapt ; — les droits de fondation et patronage « de l'église et
cimetière de ladite paroisse de la Chapelle-Janson et de la chapelle des
Temples, fillette de ladite paroisse, avec armoiries, escussons et toutes prééminences
et prérogatives en lesdites églises » ; — « un droit de
bouteillage sur les vins et breuvages qui se vendent audit bourg et
paroisse, à raison de deux pots par pipe » ; — un fief et bailliage
appelé le bailliage de la Chapelle, « avec haute, moyenne et basse
justice, cep et collier dans le bourg, fourches à quatre piliers en dehors,
droit d'avoir officiers, scavoir séneschal, alloué, etc., quelle
juridiction s'exerce dans le bourg de la Chapelle-Janson et y a exercice
ordinaire de quinze jours en quinze jours » ; — enfin, les droits
ordinaires d'épaves, gallois, déshérances, etc. (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 263). La juridiction seigneuriale
du prieuré de la Chapelle-Janson ne relevait que du Présidial, auquel ses
appels étaient portés directement. Les fiefs qui en dépendaient étaient
nombreux et quelques-uns d'une très-grande importance : ainsi les deux
grandes seigneuries de la Créveure et du Plessix-Gâtinel, — et de
Montframmery et des Temples relevaient du prieuré à devoir de lods et
ventes et de rachat seulement. Mais treize autres fiefs en relevaient entièrement,
savoir : le Refoul, — la Griponnière, — la Basse-Caillère, — la
Rivais, — la Jumelais, — le Clairay, — la Ville-du-Bois, — le
Plantis, — la Chénardrie, — la Vacherie, — la Rablais, — la Planche
— et l'Euche. Le prieuré avait, en outre, des droits sur les moulins de
Choisel et de Gravelet, ainsi que sur le fief de la Pommerais et une partie
du bois de la Cochonnière (Notices historiques sur le canton de Fougères,
57). En 1790, l'abbaye de Saint-Georges affermait ses deux tiers de dîmes
de la Chapelle-Janson 4200 livres ; elle avait alors, depuis environ trente
ans, afféagé pour une rente de 130 livres les maisons, moulin et terres de
l'ancien prieuré (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). A
cette époque, en effet, le prieuré de la Chapelle-Janson n'existait plus.
Des lettres patentes du roi de 1714 avaient permis l'extinction de ce bénéfice
et sa réunion à la mense conventuelle de l'abbaye de Saint-Georges.
Aujourd'hui, une maison située dans le bourg, proche l'église, et appelée
le Portail, est le dernier vestige du manoir prioral de la Chapelle. Liste
des prieures : — Soeur Robine de Champaigné acheta une rente
constituée de 20 sols le 4 novembre 1450. — Soeur Catherine Milon,
décédée vers 1482. — Soeur Julienne Payen, pourvue par l'abbesse Olive
de Quélen, prit possession le 12 mars 1482. — Soeur Roberte Buisson,
prieure, devint abbesse de Saint-Georges en 1520 ; décédée l'année
suivante, le 25 juillet. — Soeur Guillemette de Lesmays vit sa nomination
contestée par Alizon de Pontbellanger, abbesse de Saint-Sulpice, qui réclamait
le prieuré (1522). — Soeur Jehanne Doré soutint en 1540 un procès
contre Françoise Boschier, qui lui disputait également le prieuré ; elle
resta maîtresse de ce bénéfice, qu'elle ne résigna qu'en 1554 en faveur
de la suivante. — Soeur Marie de Kermeno, pourvue en 1554, résigna en
1557. — Soeur Cécile Vallée, pourvue par le Pape le 7 décembre 1557,
vit soeur Françoise de Préauvé lui contester ses droits et parvint
toutefois, en 1559, à rester maîtresse du bénéfice. — Soeur Jacquemine
de Bordes, prieure en 1612, se démit en 1624. — Soeur Jeanne de la Villéon
prit possession le 27 octobre 1624 et résigna en 1643. — Soeur Elisabeth
de la Villéon fut pourvue au mois de septembre 1643 et résigna vers 1676.
— Soeur Jacquette de Becdelièvre du Bouexic fut pourvue en 1676. —
Soeur Pétronille de Becdelièvre résigna vers 1693. — Soeur Françoise
de Keraly, pourvue en 1693, vit l'extinction du prieuré de la Chapelle-Janson,
décrétée en 1714, mais conserva toutefois, â sa vie durant, la
jouissance de ce bénéfice (abbé Guillotin de Corson).
l'ancien
prieuré Saint-Lezin de la Chapelle-Janson, aujourd'hui disparu et jadis
membre de l'abbaye de Saint-Georges. « D'azur à une église d'argent »
(Armorial général ms. de 1698). Peu de temps après la fondation de
l'abbaye de Saint-Georges (en 1032), une noble dame appelée la vicomtesse
Roianteline, que l'on regarde généralement comme la veuve du vicomte Eudon,
ayant réuni à Saint-Georges une petite communauté de femmes fondée par
elle primitivement à Chavagne, donna à l'abbaye, entre autres domaines, l'église
de la Chapelle-Janson avec toutes ses dépendances, « Capellam Gencon
cum omnibus appendiciis suis, sine calumpnia alicujus hominis »
(Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, 109). Par suite de cette donation,
les Bénédictines de Saint-Georges fondèrent à la Chapelle-Janson un
important prieuré, auquel elles subordonnèrent la cure, réduite par là-même
à la condition d'un vicariat perpétuel dont l'abbesse eut la présentation.
Au XIIème siècle, ces religieuses possédaient à la Chapelle-Janson
d'assez nombreuses rentes sur les habitants, plus 15 sols de mangier
; — la dîme des moulins de Choisel, de Jugant et de Marchant ; — le
tiers de deux portions de la dîme de Flandrine (nota : Adèle, surnommée
Flandrine, avait donné vers le même temps la sixième portion du moulin de
la Chapelle — voir Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 151) ; — la dîme
de la Ruelle, que donna Geffroy Le Bastard ; — deux parts de l'oblation et
de la dîme du milieu de la censie de la Ville-du-Bois ; — deux portions
des oblations de l'église ; — la présentation du chapelain ou vicaire
perpétuel (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 159). Au commencement du
siècle suivant, des difficultés survenues entre l'abbesse de Saint-Georges
et le recteur ou chapelain de la Chapelle-Janson furent aplanies par un règlement
fait, à la demande des parties, par Pierre de Dinan, évêque de Rennes, règlement
qui fut suivi jusqu'à l'époque de la Révolution. Dans le partage des
revenus des terres et des dîmes qui appartenaient à l'église ou qui
pourraient lui appartenir par la suite, à quelque titre que ce fût, les
deux tiers furent attribués à l'abbesse et l'autre tiers au chapelain. La
même règle fut appliquée aux oblations faites à l'église, tant aux
jours de fêtes qu'aux jours ordinaires, à l'exception de celles qui étaient
faites le jour des Morts et à l'occasion des sépultures ; le chapelain
seul avait droit à ces dernières oblations, et en général à tous les
droits et produits casuels des offices des Morts. Relativement aux dîmes,
l'évêque statua qu'au temps de la moisson elles seraient toutes transportées
à la grange du prieuré, où se ferait le partage du grain et de la paille
; puis que celle-ci serait fermée à deux clefs, dont l'une serait remise
au chapelain, l'autre aux religieuses ou à leur représentant, de sorte
qu'une des parties intéressées ne pût pas y entrer sans l'autre (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine). Quelque positifs qu'aient été les
titres de l'abbaye de Saint-Georges, ses droits sur la Chapelle-Janson ne
laissèrent pas de lui être plus d'une fois contestés. Les anciens
documents nous ont conservé les traces de deux contestations, entre autres,
qu'elle eut à soutenir. La première, en 1522, contre Mme Alizon de
Pontbellanger, abbesse de Saint-Sulpice, qui éleva quelques prétentions
sur le prieuré en faveur de son abbaye, prétentions, du reste, auxquelles
elle ne semble pas avoir donné de suite ; la seconde, en 1635, contre M.
Robert, recteur, qui osa disputer le bénéfice à sa patronne. Mais le Présidial
d'abord, par une sentence du 24 mai 1635, et le Parlement ensuite, par arrêt
du 20 juillet suivant, firent bonne justice de ses prétentions et confirmèrent
l'abbaye de Saint-Georges dans la possession pleine et entière de tous les
droits qu'elle avait jusqu'alors exercés (M. Maupillé, Notices historiques
sur le canton de Fougère, 49). Au XVIIème siècle, le prieuré de la
Chapelle-Janson consistait en trois petites maisons, celle du moulin
comprise, situées au bourg ; — trois petits jardins et trois pièces de
terre, le tout contenant 7 journaux ; — un petit étang, nommé la
Grenouillais ; — un moulin à eau ; — un emplacement où était jadis un
four banal ; — les deux tiers des dîmes ; — les deux tiers des
oblations ; — une rente sur le moulin du Plessix, appartenant au seigneur
de Larchapt ; — les droits de fondation et patronage « de l'église et
cimetière de ladite paroisse de la Chapelle-Janson et de la chapelle des
Temples, fillette de ladite paroisse, avec armoiries, escussons et toutes prééminences
et prérogatives en lesdites églises » ; — « un droit de
bouteillage sur les vins et breuvages qui se vendent audit bourg et
paroisse, à raison de deux pots par pipe » ; — un fief et bailliage
appelé le bailliage de la Chapelle, « avec haute, moyenne et basse
justice, cep et collier dans le bourg, fourches à quatre piliers en dehors,
droit d'avoir officiers, scavoir séneschal, alloué, etc., quelle
juridiction s'exerce dans le bourg de la Chapelle-Janson et y a exercice
ordinaire de quinze jours en quinze jours » ; — enfin, les droits
ordinaires d'épaves, gallois, déshérances, etc. (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 263). La juridiction seigneuriale
du prieuré de la Chapelle-Janson ne relevait que du Présidial, auquel ses
appels étaient portés directement. Les fiefs qui en dépendaient étaient
nombreux et quelques-uns d'une très-grande importance : ainsi les deux
grandes seigneuries de la Créveure et du Plessix-Gâtinel, — et de
Montframmery et des Temples relevaient du prieuré à devoir de lods et
ventes et de rachat seulement. Mais treize autres fiefs en relevaient entièrement,
savoir : le Refoul, — la Griponnière, — la Basse-Caillère, — la
Rivais, — la Jumelais, — le Clairay, — la Ville-du-Bois, — le
Plantis, — la Chénardrie, — la Vacherie, — la Rablais, — la Planche
— et l'Euche. Le prieuré avait, en outre, des droits sur les moulins de
Choisel et de Gravelet, ainsi que sur le fief de la Pommerais et une partie
du bois de la Cochonnière (Notices historiques sur le canton de Fougères,
57). En 1790, l'abbaye de Saint-Georges affermait ses deux tiers de dîmes
de la Chapelle-Janson 4200 livres ; elle avait alors, depuis environ trente
ans, afféagé pour une rente de 130 livres les maisons, moulin et terres de
l'ancien prieuré (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). A
cette époque, en effet, le prieuré de la Chapelle-Janson n'existait plus.
Des lettres patentes du roi de 1714 avaient permis l'extinction de ce bénéfice
et sa réunion à la mense conventuelle de l'abbaye de Saint-Georges.
Aujourd'hui, une maison située dans le bourg, proche l'église, et appelée
le Portail, est le dernier vestige du manoir prioral de la Chapelle. Liste
des prieures : — Soeur Robine de Champaigné acheta une rente
constituée de 20 sols le 4 novembre 1450. — Soeur Catherine Milon,
décédée vers 1482. — Soeur Julienne Payen, pourvue par l'abbesse Olive
de Quélen, prit possession le 12 mars 1482. — Soeur Roberte Buisson,
prieure, devint abbesse de Saint-Georges en 1520 ; décédée l'année
suivante, le 25 juillet. — Soeur Guillemette de Lesmays vit sa nomination
contestée par Alizon de Pontbellanger, abbesse de Saint-Sulpice, qui réclamait
le prieuré (1522). — Soeur Jehanne Doré soutint en 1540 un procès
contre Françoise Boschier, qui lui disputait également le prieuré ; elle
resta maîtresse de ce bénéfice, qu'elle ne résigna qu'en 1554 en faveur
de la suivante. — Soeur Marie de Kermeno, pourvue en 1554, résigna en
1557. — Soeur Cécile Vallée, pourvue par le Pape le 7 décembre 1557,
vit soeur Françoise de Préauvé lui contester ses droits et parvint
toutefois, en 1559, à rester maîtresse du bénéfice. — Soeur Jacquemine
de Bordes, prieure en 1612, se démit en 1624. — Soeur Jeanne de la Villéon
prit possession le 27 octobre 1624 et résigna en 1643. — Soeur Elisabeth
de la Villéon fut pourvue au mois de septembre 1643 et résigna vers 1676.
— Soeur Jacquette de Becdelièvre du Bouexic fut pourvue en 1676. —
Soeur Pétronille de Becdelièvre résigna vers 1693. — Soeur Françoise
de Keraly, pourvue en 1693, vit l'extinction du prieuré de la Chapelle-Janson,
décrétée en 1714, mais conserva toutefois, â sa vie durant, la
jouissance de ce bénéfice (abbé Guillotin de Corson).
![]() la
Maison du Portail, située près de l'église. Il s'agit des vestiges de
l'ancien Prieuré ;
la
Maison du Portail, située près de l'église. Il s'agit des vestiges de
l'ancien Prieuré ;
![]() le
manoir de La Lande (XVIème siècle). Il possédait jadis une chapelle privée
mentionnée dans le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723).
Propriété de la famille le Porc, puis de la famille de la Villegontier
vers 1529 et en 1646 ;
le
manoir de La Lande (XVIème siècle). Il possédait jadis une chapelle privée
mentionnée dans le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723).
Propriété de la famille le Porc, puis de la famille de la Villegontier
vers 1529 et en 1646 ;
![]() le
manoir de Montfromerie ou Montframmery (XVIIème siècle).
Il possédait jadis une chapelle privée. La chapelle de Montframmery (ou
Montframery), avoisinant le manoir de même nom, avait été fondée par les
seigneurs du lieu de deux messes par semaine, dont une le dimanche. En 1720
on y desservait aussi une fondation primitivement faite en la chapelle de la
Templerie, et Renée Morazin, dame de Montframmery, présenta, le 13 avril,
Michel Vigeon pour être pourvu de cette double chapellenie (Registre des
insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). Propriété successive des
familles de la Bouëxière (en 1413), de Beaucé (vers 1476), de Lys (vers
1633), Gouyon seigneurs de Miniac (en 1654), de Gaulay (en 1673), le Séneschal,
de Gaulay, le Coq, Prioul sieurs de la Lande-Guérin, Logeois sieurs de
Bintin (en 1779) ;
le
manoir de Montfromerie ou Montframmery (XVIIème siècle).
Il possédait jadis une chapelle privée. La chapelle de Montframmery (ou
Montframery), avoisinant le manoir de même nom, avait été fondée par les
seigneurs du lieu de deux messes par semaine, dont une le dimanche. En 1720
on y desservait aussi une fondation primitivement faite en la chapelle de la
Templerie, et Renée Morazin, dame de Montframmery, présenta, le 13 avril,
Michel Vigeon pour être pourvu de cette double chapellenie (Registre des
insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). Propriété successive des
familles de la Bouëxière (en 1413), de Beaucé (vers 1476), de Lys (vers
1633), Gouyon seigneurs de Miniac (en 1654), de Gaulay (en 1673), le Séneschal,
de Gaulay, le Coq, Prioul sieurs de la Lande-Guérin, Logeois sieurs de
Bintin (en 1779) ;
![]() le
manoir de Refour (XVIIème siècle) ;
le
manoir de Refour (XVIIème siècle) ;
![]() le
four à pain, situé à La Touche ;
le
four à pain, situé à La Touche ;
![]() la
fontaine Saint-Lézin (XXème siècle) située au bourg de La Chapelle-Janson ;
la
fontaine Saint-Lézin (XXème siècle) située au bourg de La Chapelle-Janson ;
![]() le
puits, situé au lieu-dit La Ville-Bois ;
le
puits, situé au lieu-dit La Ville-Bois ;
![]() 5 moulins
à eau dont le moulin de Mombrault, du bourg, de Montfromerie, de Choisel et de Gravelay ;
5 moulins
à eau dont le moulin de Mombrault, du bourg, de Montfromerie, de Choisel et de Gravelay ;
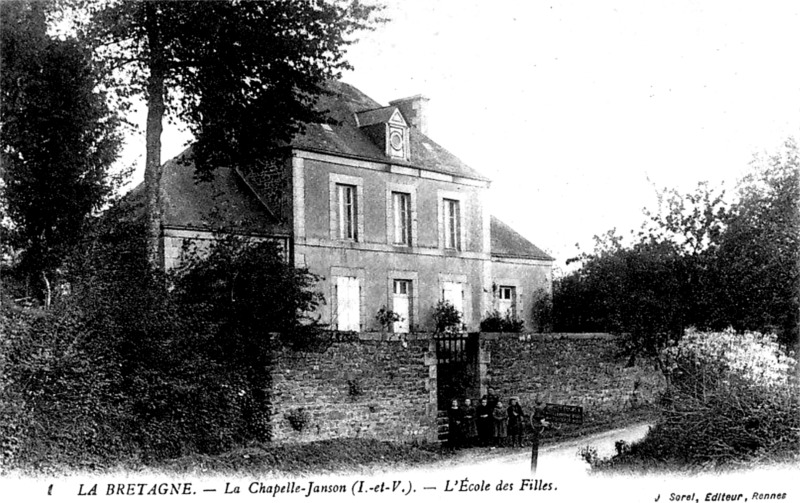
A signaler aussi :
![]() l'ancienne
voie romaine de Jublains à Corseul, appelée Chemin Chasles ou Chemin
Charles ;
l'ancienne
voie romaine de Jublains à Corseul, appelée Chemin Chasles ou Chemin
Charles ;
![]() les
retranchements situés au village de la Coëtfordière ;
les
retranchements situés au village de la Coëtfordière ;
![]() les
retranchements de terre situés au Plessis-Gâtinet ;
les
retranchements de terre situés au Plessis-Gâtinet ;
![]() l'ancien
manoir de Gambret, situé route de la Bazouge-du-Désert ;
l'ancien
manoir de Gambret, situé route de la Bazouge-du-Désert ;
![]() l'ancien
manoir de Beaulot, situé route de Larchamp ;
l'ancien
manoir de Beaulot, situé route de Larchamp ;
![]() l'ancien
manoir de Beaulieu ;
l'ancien
manoir de Beaulieu ;
![]() l'ancien
manoir de Langevinière ou de l'Angevinière, situé route de Fleurigné à
la Pellerine. Propriété successive des familles du Bois-le-Houx, Daulnières
(en 1513), du Bois-le-Houx (en 1545). Il reste entre les mains des seigneurs
du Bois-le-Houx en Luitré jusqu'en 1789 ;
l'ancien
manoir de Langevinière ou de l'Angevinière, situé route de Fleurigné à
la Pellerine. Propriété successive des familles du Bois-le-Houx, Daulnières
(en 1513), du Bois-le-Houx (en 1545). Il reste entre les mains des seigneurs
du Bois-le-Houx en Luitré jusqu'en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir du Temple ou de la Templerie, situé route de Fleurigné à la
Pellerine. Propriété de la Commanderie du Temple de la Guerche, il est
vendu au XVIème siècle au seigneur de Montframmery. Il possédait jadis
une chapelle privée devenue frairienne et démolie en 1793. Le manoir était
la propriété de la famille Logeais seigneurs de Bintin en 1779 ;
l'ancien
manoir du Temple ou de la Templerie, situé route de Fleurigné à la
Pellerine. Propriété de la Commanderie du Temple de la Guerche, il est
vendu au XVIème siècle au seigneur de Montframmery. Il possédait jadis
une chapelle privée devenue frairienne et démolie en 1793. Le manoir était
la propriété de la famille Logeais seigneurs de Bintin en 1779 ;
![]() l'ancienne
chapelle de la Templerie, dépendant jadis du Temple de la Guerche. Le
membre de la Violette s'étendait dans les paroisses
du Châtellier, de la Chapelle-Janson (Ille-et-Vilaine) et de Fougères,
« consistant en fief, juridiction, dixme, rentes, chapelles, etc. » (Déclaration du
Temple de la Guerche en 1681). Mais au XVIème siècle, un commandeur de la
Guerche vendit aux de Beaucé, seigneurs de Montframery (ou Montframmery), son
manoir des Temples, appelé aussi la Templerie, sis en la Chapelle-Janson, ainsi
que son fief de la Templerie et son droit de tenir foire et marché
au bourg de la Templerie ; il ne conserva que les deux tiers des dîmes
cueillies autour de ce bourg. On appelait ainsi un
village de la Chapelle-Janson, dans lequel se trouvait une chapelle. A l'origine, cette chapelle appartenait certainement aux
Templiers, mais dans la suite des temps elle devint frairienne,
et en 1677 on la qualifiait de « fillette de la ChapelleJanson ».
Aussi, à cette dernière époque, l'abbesse de Saint-Georges
de Rennes y avait-elle les droits de fondation et de
patronage à cause de son prieuré de la Chapelle-Janson. En 1793,
la chapelle de la Templerie était dans un état de vétusté et
de délabrement tel, qu'il y avait danger à y entrer. On profita, pour la démolir, de l'occasion qu'offrait un élargissement de la
route, devenu nécessaire. Elle avait, suivant le procès-verbal dressé
alors, 16 mètres de long sur 6 mètres de large (Maupillé, Notices
historiques sur les paroisses des cantons de Fougères, 57). Quant
à la Violette, qui donnait son nom à tout ce membre de la commanderie, c'était et c'est encore un village de la paroisse
du Châtellier (nota : Le village de la Violette, situé sur les confins du Châtellier, de Poilley et
de Villamée, est partagé entre ces trois paroisses, mais la chapelle
Saint-Denis, aujourd'hui rasée, s'élevait dans la première). Il s'y trouvait autrefois une chapelle dédiée à
saint Denis, mais les chevaliers durent aliéner de bonne heure ce domaine,
dont il ne reste que le nom dans leur histoire (nota : Au XVIIIème siècle, le
dire de Montframery se disait seigneur des Temples et de la Violette). Enfin,
du même membre de la Violette dépendaient encore, à l'origine, la
chapelle du Petit-Saint-Nicolas et la maison voisine,
sises l'une et l'autre dans la ville même de Fougères, au bas de
la rue de l'Aumaillerie. Mais M. Maupillé croit que cette chapelle
fut annexée à l'Hôtel-Dieu de Fougères aussitôt après la
destruction de l'Ordre du Temple (Maupillé, Histoire de Fougères, 182) ;
l'ancienne
chapelle de la Templerie, dépendant jadis du Temple de la Guerche. Le
membre de la Violette s'étendait dans les paroisses
du Châtellier, de la Chapelle-Janson (Ille-et-Vilaine) et de Fougères,
« consistant en fief, juridiction, dixme, rentes, chapelles, etc. » (Déclaration du
Temple de la Guerche en 1681). Mais au XVIème siècle, un commandeur de la
Guerche vendit aux de Beaucé, seigneurs de Montframery (ou Montframmery), son
manoir des Temples, appelé aussi la Templerie, sis en la Chapelle-Janson, ainsi
que son fief de la Templerie et son droit de tenir foire et marché
au bourg de la Templerie ; il ne conserva que les deux tiers des dîmes
cueillies autour de ce bourg. On appelait ainsi un
village de la Chapelle-Janson, dans lequel se trouvait une chapelle. A l'origine, cette chapelle appartenait certainement aux
Templiers, mais dans la suite des temps elle devint frairienne,
et en 1677 on la qualifiait de « fillette de la ChapelleJanson ».
Aussi, à cette dernière époque, l'abbesse de Saint-Georges
de Rennes y avait-elle les droits de fondation et de
patronage à cause de son prieuré de la Chapelle-Janson. En 1793,
la chapelle de la Templerie était dans un état de vétusté et
de délabrement tel, qu'il y avait danger à y entrer. On profita, pour la démolir, de l'occasion qu'offrait un élargissement de la
route, devenu nécessaire. Elle avait, suivant le procès-verbal dressé
alors, 16 mètres de long sur 6 mètres de large (Maupillé, Notices
historiques sur les paroisses des cantons de Fougères, 57). Quant
à la Violette, qui donnait son nom à tout ce membre de la commanderie, c'était et c'est encore un village de la paroisse
du Châtellier (nota : Le village de la Violette, situé sur les confins du Châtellier, de Poilley et
de Villamée, est partagé entre ces trois paroisses, mais la chapelle
Saint-Denis, aujourd'hui rasée, s'élevait dans la première). Il s'y trouvait autrefois une chapelle dédiée à
saint Denis, mais les chevaliers durent aliéner de bonne heure ce domaine,
dont il ne reste que le nom dans leur histoire (nota : Au XVIIIème siècle, le
dire de Montframery se disait seigneur des Temples et de la Violette). Enfin,
du même membre de la Violette dépendaient encore, à l'origine, la
chapelle du Petit-Saint-Nicolas et la maison voisine,
sises l'une et l'autre dans la ville même de Fougères, au bas de
la rue de l'Aumaillerie. Mais M. Maupillé croit que cette chapelle
fut annexée à l'Hôtel-Dieu de Fougères aussitôt après la
destruction de l'Ordre du Temple (Maupillé, Histoire de Fougères, 182) ;
![]() l'ancien
manoir de la Crevière, situé route de Fleurigné à la Pellerine. Propriété
successive des familles de Gougues, le Porc seigneurs de Larchapt (en 1513),
de Langan seigneurs du Boisfévrier (en 1584). Il reste entre les mains des
seigneurs du Boisfévrier en Fleurigné jusqu'en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Crevière, situé route de Fleurigné à la Pellerine. Propriété
successive des familles de Gougues, le Porc seigneurs de Larchapt (en 1513),
de Langan seigneurs du Boisfévrier (en 1584). Il reste entre les mains des
seigneurs du Boisfévrier en Fleurigné jusqu'en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Coëtfordière, situé au village de la Coëtfordière. Propriété
de la famille de la Bouëxière seigneurs des Haries (en 1476), de la
famille du Bois-le-Houx (en 1513), puis des seigneurs du Bois-le-Houx jusqu'en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Coëtfordière, situé au village de la Coëtfordière. Propriété
de la famille de la Bouëxière seigneurs des Haries (en 1476), de la
famille du Bois-le-Houx (en 1513), puis des seigneurs du Bois-le-Houx jusqu'en 1789 ;

![]()
ANCIENNE NOBLESSE de LA CHAPELLE-JANSON
Les principales juridictions seigneuriales étaient celles du Prieuré, de Montfromery, du Bois-Février, du Bois-le-Houx, etc... L'abbesse de Saint-Georges avait droit de Haute Justice dans les fiefs du prieuré.
Voir
![]() "
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de La Chapelle-Janson ".
"
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de La Chapelle-Janson ".
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "La Chapelle Genczon" :
- Claude de Beaucé : "Claude de Beaucé seigneur de Beaucé [Note : Manoir de Beaucé, en Melesse] se présente monté et armé en estat d'archer. Et vériffie sa déclaracion cy davant baillée à monseigneur le séneschal estre véritable. Et qu'il avoit en fyé noble environ deux cens dix livres de rente noble. Et a faict le serment.".
(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.