|
Bienvenue chez les Chérullais |
CHERRUEIX |
Retour page d'accueil Retour Canton de Dol-de-Bretagne
La commune de
Cherrueix ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de CHERRUEIX
Cherrueix vient du gallo-romain "Cherrue" (charrue).
Cherrueix est un démembrement du Marais de Dol. La paroisse de Cherrueix existe en 1181. Il s'agit d'une paroisse de l'ancien évêché de Dol. Des pêcheries étaient attestées à Cherrueix dès le XIème siècle.
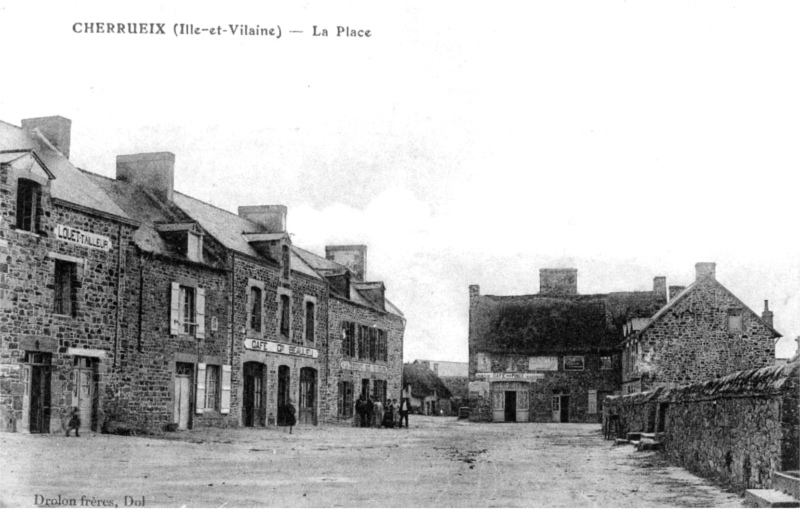
Rien de plus incertain que l'origine de la paroisse de Cherrueix. Nous lisons seulement ce qui suit dans l'Histoire de Bretagne, par dom Lobineau, p. 90 : « En l'an 1029, Robert, duc de Normandie, déclara la guerre au duc de Bretagne Alain, et vint bastir le fort de Charruées près de l'embouchure de la rivière de Coaisnon, pour tenir en respect tout le pays de Dol qu'il venoit de ravager, après quoi il s'en retourna en Normandie, fort content de cette insulte. Alain entra l'année suivante en armes dans le comté d'Avranches, dans le dessein de se venger ; mais au lieu de s'attacher d'abord à détruire le nouveau fort, il se contenta de brusler et de ravager les campagnes sans garder aucunes mesures. Nigelle et Alvred le géant, qui estoient dans la place avec de bonnes troupes, ne perdirent pas l'occasion d'attaquer les Bretons pendant qu'ils estoient debandez et chargez de butin, et en firent un très-grand carnage ». Peut-être ce château, — dont Ogée signale encore les ruines en 1778, — donna-t-il naissance à la paroisse de Cherrueix et à la famille du même nom. Toujours est-il qu'en 1181 l'enquête pour le recouvrement des biens de l'archevêque de Dol nous apprend ce qui suit : Even, prêtre de Cherrueix, et six anciens de la paroisse « de Charruiers : Evenus presbyter et sex legales antiqui hommes jurati », affirmèrent que les prairies et pâtures, depuis la Calandière jusqu'à Maupol, « a Calendaria usque Maupol », appartenaient à l'archevêque. Ils ajoutèrent que Lesblac, les verdières depuis le Couasnon jusqu'à la mer, le champ de Troussebœuf, la pêcherie de Cherrueix et la terre de Moarec étaient également à ce prélat. Il est aussi fait mention dans cet acte de Guillaume, fils de Urfoen de Cherrueix, « Will. filius Urfoeni de Charruiers », qui devait être le principal vassal du prélat, dont il avait reçu les verdières signalées à l'instant (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 684). C'est le premier membre que nous connaissions de la famille de Cherrueix, représentée au XIVème siècle par Olivier de Cherrueix, et en 1513 par Rolland et Gilles de Cherrueix, possédant alors en Cherrueix l'un le manoir de l'Aumône, l'autre celui de la Jugandière. Ce nom de l'Aumône donné à la terre seigneuriale de Cherrueix mérite d'être signalé : les terres appelées aumônes, au moyen-âge, étaient toujours des propriétés d'Eglise, offertes à Dieu par piété. Il est vraisemblable que le manoir de l'Aumône, en Cherrueix, dut avoir, lui aussi, une origine religieuse, puis fut sécularisé comme tant d'autres terres. Mais qui le posséda tout d'abord? Etait-ce l'évêque de Dol ou le recteur de Cherrueix, l'abbé de la Vieuville, qui avait encore un fief dans la paroisse en 1682, ou le commandeur de la Guerche, possédant à la même époque quelques droits féodaux à Cherrueix? Personne ne le saura probablement, car pendant bien des siècles les sires de Cherrueix d'abord, puis la famille Uguet, possédèrent ce manoir. En 1790, M. Langevin, recteur de Cherrueix, déclara que son bénéfice, à la présentation de l'ordinaire, valait 1.790 livres, mais avait 539 livres de charges. Voici l'état de ses revenus : le presbytère, un jardin, un verger et deux journaux de terre, 150 livres ; — la moitié d'un trait de dîme, dont le seigneur de l'Aumône possède l'autre moitié, 800 livres ; — dîmes vertes, 500 livres ; — dîmes des agneaux, 60 livres ; — tiers du revenu de l'obiterie, 280 livres (Archives du district de Dol et Pouillé de Rennes).
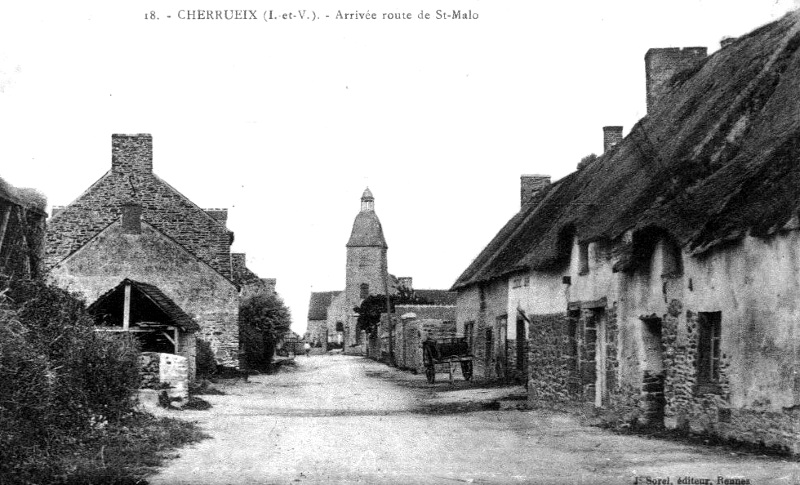
La paroisse de Cherrueix a probablement été érigée en succursale en 1802 : elle est desservie en 1802 par Gille Marie de Saint-Marcan, décédé à Cherrueix le 19 janvier 1814.

En 1860, il y a dans la commune de Cherrueix, six confréries : celles du Saint-Rosaire et du Saint-Scapulaire érigées par Mgr Delesquen, celles de la Propagation de la Foi et de la Sainte-Enfance, celles des Filles du Sacré-Coeur qui sont alors an nombre de 25 et celle de l'Adoration perpétuelle.

On rencontre les appellations suivantes : Charruiers (en 1181), Cherrueys (au XIVème siècle).
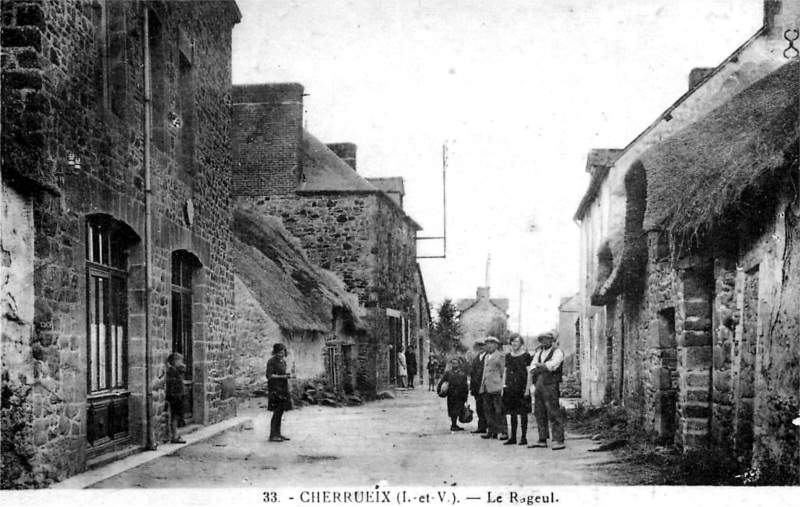
Note 1 : liste non exhaustive des maires de la commune de Cherrueix : Julien Plainfossé (janvier 1792 à 1816), François Ganier (1816 à 1843), Victor Daumer (1843 à 1848), Gilles Ganier (1848 à 1850), François Richard (1850 à 1875), Laurent Couapel (1876 à 1888), Marie Ganier (1888 à 1894), Placide Delépine (1894-1908), Alfred Lecompte (1908 à 1928), François Lemonnier (1928 à 1942), Théophile Blin (1942 à 1961), Louis Le Sénéchal (1961 à 1969), Louis Lecompte (1969 à 1983), Remi Gendrot (1983 à 1995), Louis Dory (1995 à 2001), ....
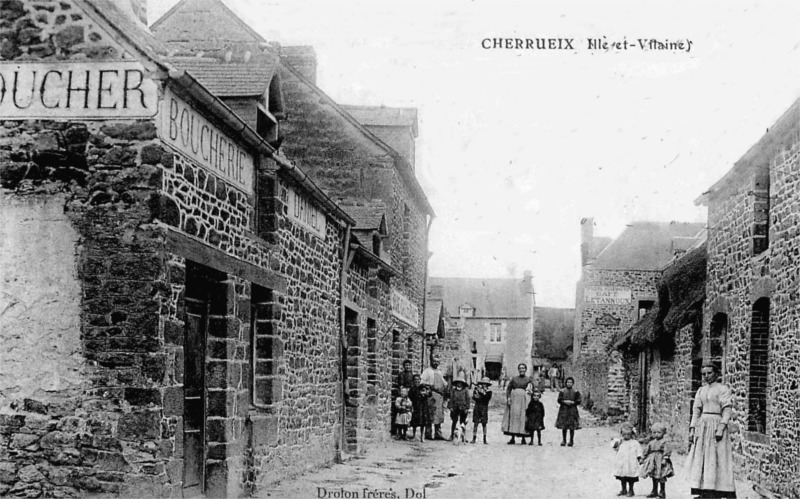
Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Cherrueix : Even (en 1181). Julien Taillebois (décédé vers 1612). Guillaume Rogier (il remplaça le précédent en 1612). Louis de Callac (il résigna vers 1644). Michel Le Gouverneur (prêtre de Saint-Malo, il fut pourvu le 19 novembre 1644). N... (il fit enregistrer en 1698 ses armoiries : d'azur à un calice d'or). François Lefeuvre (décédé vers 1721). Louis de Blondel (prêtre de Dol, bachelier en Sorbonne, il fut pourvu par l'évêque le 29 mars 1721 et prit possession le 21 avril ; il eut à combattre Joseph-Hyacinthe Pinvisic, prêtre de Cornouailles, qui se fit pourvoir à Rome, obtint un visa de l'archevêque de Tours et prit lui-même possession en 1721. Louis de Blondel se maintint toutefois à Cherrueix, devint promoteur de l'officialité diocésaine et résigna le 6 avril 1728 en faveur du suivant). François-Louis Chatton (prêtre de Saint-Brieuc, pourvu en cour de Rome, prit possession le 4 juillet 1728 et permuta dix ans plus tard avec le suivant). Joseph de la Vallée (précédemment recteur de Pleudihen, il fut nommé le 19 juin 1738 et prit possession le lendemain ; il résigna le 4 janvier 1752 en faveur du suivant, se réservant 500 livres de pension). François Bouassier (il reçut son visa le 6 mars 1752 et prit possession le 10 du même mois ; décédé en 1766). Julien Racine (prêtre de Dol, il fut pourvu à Rome et prit possession le 12 mars 1766 ; il permuta dès le 15 décembre avec le suivant). Louis-Thomas Le Bouyère (prêtre d'Avranches, précédemment recteur de Trémeheuc, prit possession le 11 mars 1767 ; décédé en 1771). Antoine Coulombel (prêtre de Dol et vicaire à Saint-Broladre, il fut pourvu le 20 août 1771 et permuta en 1780 avec le suivant). Raoul-Pierre Huet (précédemment recteur de Saint-Léonard, il prit possession le 26 octobre 1780 ; décédé en 1784). François-Olivier Langevin (prêtre de Dol et vicaire à Miniac-Morvan, il fut pourvu le 19 avril 1784 et prit possession le 7 mai ; il gouverna jusqu'au moment de la Révolution). Michel-Antoine de Vienne (en 1803). N... Egault (1803-1804). Gilles Marie (1804-1844). Servan Lévêque (1814-1821). Mathurin Daumer (1821-1852) . Guillaume Lainé (à partir de 1852), .... Pierre Ferron (jusqu'en 1903).... Jarry (de 1919 à 1927). Daux. Tizon (de 1928 à 1930). François Leboul (de 1930 à 1933). Regnault (de 1938 à 1946) Bérel (en 1946), .... En 1860, il existe dans la paroisse de Cherrueix 18 fondations reconnues par des titres légaux, qui rapportent une somme annuelle de 140 F. Plusieurs autres fondation existaient avant la Révolution, mais elles ont été, pour la plus part, transportées à l'hospice de Dol.
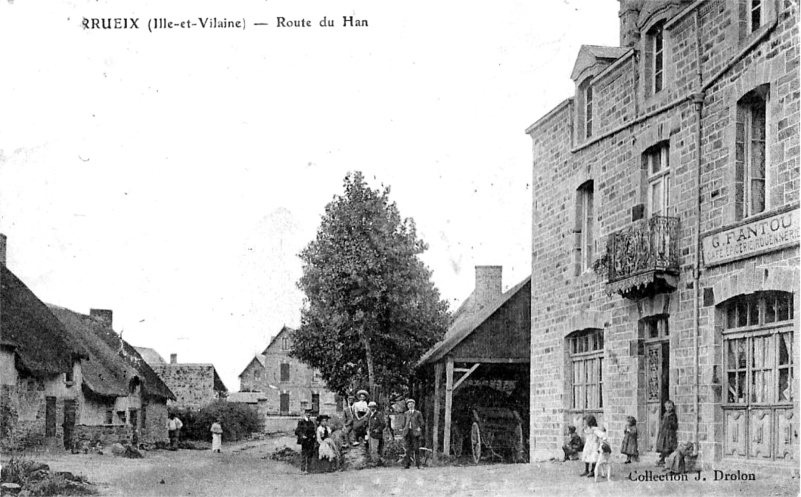
Voir aussi
![]() "
Cahier
de doléances de Cherrueix en 1789
".
"
Cahier
de doléances de Cherrueix en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de CHERRUEIX
![]() l'église
Notre-Dame (XI-XIV-XVIème siècle-1838). Elle a de longueur 28 mètres, de
largeur 4, 66 mètres et de hauteur 10,30 mètres. Elle se compose d'une nef à
chevet droit et d'un transept. La porte d'entrée est flanquée de deux
colonnes. Le mur nord présente deux fenêtres en meurtrières et des
contreforts plats du XIème siècle. La fenêtre le la
sacristie date du XIVème siècle : elle pourrait appartenir à l'ancienne
chapelle prohibitive des seigneurs des Sallets. La nef date du XI-XIVème siècle. Les
arcades en arc brisé de la nef datent du XVIème siècle. Les chapelles de
la Vierge et de Sainte Anne datent du XVI-XVIIème siècle, époque à
laquelle appartient aussi le choeur actuel, le mur sud de la nef et le
clocher. Il y a trois autels fixes et de bois peints. Le confessionnal date de 1827.
Les stalles datent de 1843. Le retable du transept nord date de 1841. Le chemin de Croix est
érigé le 14 avril 1839. Un nouveau chemin de croix est bénit le 21
juillet 1890. Les bancs de l'église datent de 1891 (oeuvre de Henry et
Prioul du bourg de Cherrueix). Au bas de l'église est une tour bâtie en
1830, d'une hauteur de 24 mètres : elle est terminée par une lanterne et
surmontée d'une croix, et elle renferme trois cloches : la 1ère (bénite
le 22 janvier 1939) pèse 659 kg, la 2ème (bénite le 14 octobre 1838,
marraine : Mme de Méhereuc, marquise de Saint-Pierre) pèse 501 kg, et la
3ème (bénite le 2 mai 1848) pèse 320 kg. A noter que ces dernières
cloches remplacent trois cloches qui avaient été baptisées le 13 octobre
1762 : Jacquette Agédic Perrine (poids 1367 kg, et témoins : Pierre
Baptiste Uguet, comte de l'Aumône, seigneur et fondateur de la paroisse de
Cherrueix et Jacquette Agédic de Rahier, comtesse de Noyan), Sophie
Charlotte (poids 951 kg, et témoins : Charles Anne de Saint-Genis,
chevalier Bayoux des Hommeaux, et Sophie Goyon, comtesse de Goyon de
Beaufort) et Marie Françoise (poids 688 kg, et témoins : François Denis
Beaudoin, seigneur de Gouillon, et Marie Jeanne Henry de Beauchamps,
comtesse de l'Aumône). Une mission prêchée par des Capucins du couvent de
la Vicomté a lieu du 14 janvier au 4 février 1923. Une autre mission,
prêchée par les frères Eudistes se tient en 1933. Une mission prêchée
par les frères Rédemptionniste a lieu du 12 octobre au 2 novembre 1947.
Une mission prêchée par trois missionnaires de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle a lieu du 6 au 24 janvier 1960. L'abbé Delépine, prêtre et
originaire de Cherrueix, fait rénover l'église en 1922. En novembre et
décembre 1931, on restaure la voûte de la chapelle Sainte-Anne. Des
restaurations ont lieu aussi en 1932 (clocher, statue située à la grande
porte, consolidation des murs de la tribune, ...). Les vitraux représentant
des marins et des laboureurs datent du XIXème siècle. Restauration des vitraux
en 1970. En 1975, la "vieille sacristie" est convertie en chapelle
pour les messes de la semaine. Inauguration du nouvel orgue le 29 juillet
1978. Une réfection de la voûte de l'église a lieu en mars 1984. Au
XVIIIème siècle, le seigneur de l'Aumône était considéré comme
seigneur fondateur de la paroisse, mais le marquis de Châteauneuf était
seigneur supérieur et avait dans l'église de Cherrueix droit de
prééminences, d'écussons et de ceinture (Archives du château de
Châteauneuf). A noter que le nouveau cimetière est ouvert le 17 février 1925 et que la première
personne à y être enterrée est la veuve de Louis Bourgain décédée à
la Croix Galliot. A signaler aussi, qu'en 1885, la commune de Cherrueix
aurait obtenu une relique de "la vraie croix" ;
l'église
Notre-Dame (XI-XIV-XVIème siècle-1838). Elle a de longueur 28 mètres, de
largeur 4, 66 mètres et de hauteur 10,30 mètres. Elle se compose d'une nef à
chevet droit et d'un transept. La porte d'entrée est flanquée de deux
colonnes. Le mur nord présente deux fenêtres en meurtrières et des
contreforts plats du XIème siècle. La fenêtre le la
sacristie date du XIVème siècle : elle pourrait appartenir à l'ancienne
chapelle prohibitive des seigneurs des Sallets. La nef date du XI-XIVème siècle. Les
arcades en arc brisé de la nef datent du XVIème siècle. Les chapelles de
la Vierge et de Sainte Anne datent du XVI-XVIIème siècle, époque à
laquelle appartient aussi le choeur actuel, le mur sud de la nef et le
clocher. Il y a trois autels fixes et de bois peints. Le confessionnal date de 1827.
Les stalles datent de 1843. Le retable du transept nord date de 1841. Le chemin de Croix est
érigé le 14 avril 1839. Un nouveau chemin de croix est bénit le 21
juillet 1890. Les bancs de l'église datent de 1891 (oeuvre de Henry et
Prioul du bourg de Cherrueix). Au bas de l'église est une tour bâtie en
1830, d'une hauteur de 24 mètres : elle est terminée par une lanterne et
surmontée d'une croix, et elle renferme trois cloches : la 1ère (bénite
le 22 janvier 1939) pèse 659 kg, la 2ème (bénite le 14 octobre 1838,
marraine : Mme de Méhereuc, marquise de Saint-Pierre) pèse 501 kg, et la
3ème (bénite le 2 mai 1848) pèse 320 kg. A noter que ces dernières
cloches remplacent trois cloches qui avaient été baptisées le 13 octobre
1762 : Jacquette Agédic Perrine (poids 1367 kg, et témoins : Pierre
Baptiste Uguet, comte de l'Aumône, seigneur et fondateur de la paroisse de
Cherrueix et Jacquette Agédic de Rahier, comtesse de Noyan), Sophie
Charlotte (poids 951 kg, et témoins : Charles Anne de Saint-Genis,
chevalier Bayoux des Hommeaux, et Sophie Goyon, comtesse de Goyon de
Beaufort) et Marie Françoise (poids 688 kg, et témoins : François Denis
Beaudoin, seigneur de Gouillon, et Marie Jeanne Henry de Beauchamps,
comtesse de l'Aumône). Une mission prêchée par des Capucins du couvent de
la Vicomté a lieu du 14 janvier au 4 février 1923. Une autre mission,
prêchée par les frères Eudistes se tient en 1933. Une mission prêchée
par les frères Rédemptionniste a lieu du 12 octobre au 2 novembre 1947.
Une mission prêchée par trois missionnaires de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle a lieu du 6 au 24 janvier 1960. L'abbé Delépine, prêtre et
originaire de Cherrueix, fait rénover l'église en 1922. En novembre et
décembre 1931, on restaure la voûte de la chapelle Sainte-Anne. Des
restaurations ont lieu aussi en 1932 (clocher, statue située à la grande
porte, consolidation des murs de la tribune, ...). Les vitraux représentant
des marins et des laboureurs datent du XIXème siècle. Restauration des vitraux
en 1970. En 1975, la "vieille sacristie" est convertie en chapelle
pour les messes de la semaine. Inauguration du nouvel orgue le 29 juillet
1978. Une réfection de la voûte de l'église a lieu en mars 1984. Au
XVIIIème siècle, le seigneur de l'Aumône était considéré comme
seigneur fondateur de la paroisse, mais le marquis de Châteauneuf était
seigneur supérieur et avait dans l'église de Cherrueix droit de
prééminences, d'écussons et de ceinture (Archives du château de
Châteauneuf). A noter que le nouveau cimetière est ouvert le 17 février 1925 et que la première
personne à y être enterrée est la veuve de Louis Bourgain décédée à
la Croix Galliot. A signaler aussi, qu'en 1885, la commune de Cherrueix
aurait obtenu une relique de "la vraie croix" ;
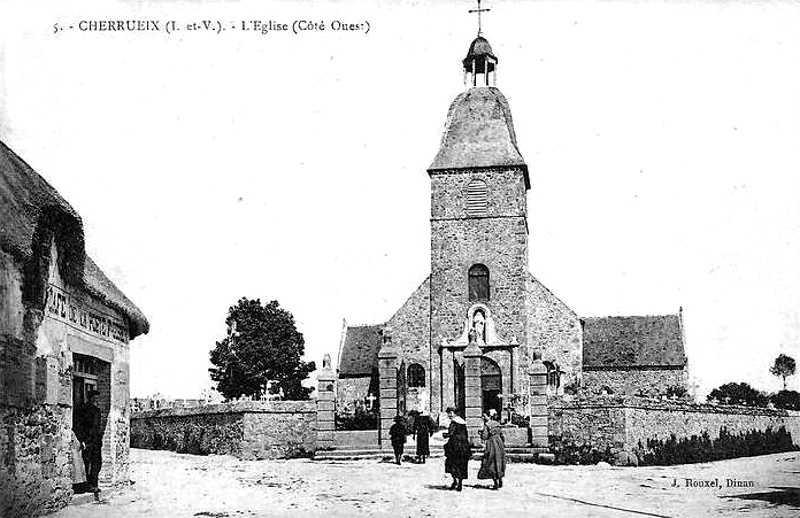
![]() l'ancienne
Chapelle Saint-Julien des Ardents, située jadis au bord de la mer. Elle est
mentionnée en 1722 ;
l'ancienne
Chapelle Saint-Julien des Ardents, située jadis au bord de la mer. Elle est
mentionnée en 1722 ;
![]() l'ancienne
Chapelle de la Rigaudais ou de la Régaudais, située route de Baguer-Pican
et aujourd'hui disparue ;
l'ancienne
Chapelle de la Rigaudais ou de la Régaudais, située route de Baguer-Pican
et aujourd'hui disparue ;
![]() le
calvaire du cimetière, inauguré le 22 janvier 1933. Ce calvaire coûta 9810 F ;
le
calvaire du cimetière, inauguré le 22 janvier 1933. Ce calvaire coûta 9810 F ;
![]() la
croix de la Larronière (époque mérovingienne) ;
la
croix de la Larronière (époque mérovingienne) ;
![]() la
croix armoriée, située près du Village du Han ;
la
croix armoriée, située près du Village du Han ;
![]() la
croix du Bois-Robin (XIXème siècle) ;
la
croix du Bois-Robin (XIXème siècle) ;
![]() la
"Croix du Pape" ou croix du Marais, située à l'embranchement de
la route du Marais et celle de Dol (XIXème siècle). La croix du Marais est
bénite le 29 janvier 1888 ;
la
"Croix du Pape" ou croix du Marais, située à l'embranchement de
la route du Marais et celle de Dol (XIXème siècle). La croix du Marais est
bénite le 29 janvier 1888 ;
![]() le
manoir de l'aumône ou l'Aumosne (1614). Propriété successive
des familles Uguet seigneurs de Cherrueix (en 1460), de Cherrueix (en 1513),
Franchet (au XVIème siècle), Uguet (au XVIIIème siècle) ;
le
manoir de l'aumône ou l'Aumosne (1614). Propriété successive
des familles Uguet seigneurs de Cherrueix (en 1460), de Cherrueix (en 1513),
Franchet (au XVIème siècle), Uguet (au XVIIIème siècle) ;
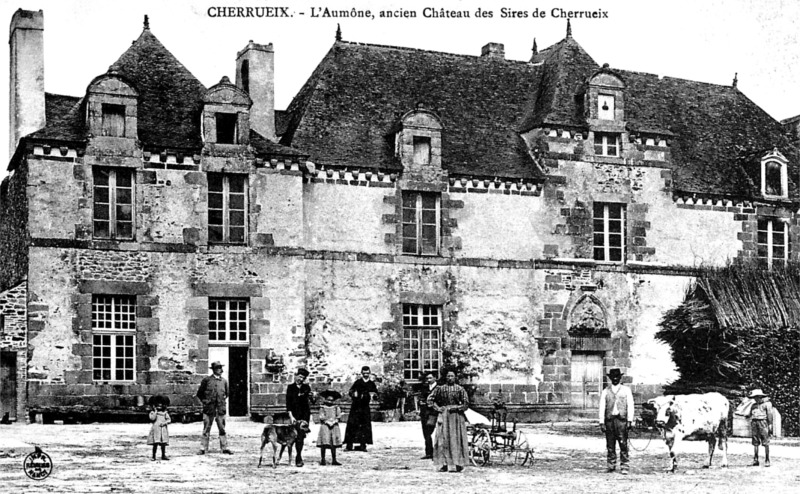
![]() la
maison du Vieux-Presbytère. Elle conserve une tourelle. La bénédiction du
nouveau presbytère a lieu le 12 septembre 1885 (la première pierre est
posée le 13 mai 1883) ;
la
maison du Vieux-Presbytère. Elle conserve une tourelle. La bénédiction du
nouveau presbytère a lieu le 12 septembre 1885 (la première pierre est
posée le 13 mai 1883) ;
![]() 7 moulins
à vent du XVIIIème siècle (d'après le cadastre de 1812), tous situés
(à l'exception de celui de la Mettrie) sur la digue : de la Mettrie
(propriété de Jean Maillard en 1822, puis de Joseph Landier, de la famille
Seneschal à partir de 1839, et démoli en 1849), à Petite Masse ou
Laronnière (édifié en 1827 par Pierre Pinçon ou Pinson, propriété de
la famille Tréhel à partir de 1835), Neuf (propriété de Gilles Filleul
en 1822, de la famille Montsimet à partir de 1853, et démoli en 1886), de la Grande
Pâture (propriété de Jean Trescan en 1822, Jean Delépine en 1875, de la
famille Letannoux à partir de 1908),
du Calvaire ou Rageul (propriété de Jean Auvray en 1822, de Gilles Filleul
en 1827, et démoli en 1827), des Carrées ou Croissy (propriété de Joseph
Chauchard en 1822, de la famille Deméheureuc en 1856, et démoli en 1856), des Grandes
Grèves (propriété de la famille Lebourgeois en 1822, Julien Le Saint à
partir de 1859, et démoli en 1874). 5 moulins étaient encore
exploités avant 1918 : les moulins Pinson ou Pavillon (au lieu-dit la
Laronnière), la Colimacière ou Saline (édifié par Francis Boulanger en
1827, et propriété de la famille Flaux en 1908), les Mondrins (au lieu-dit aux
moulins, édifié en 1839, propriété de Victor Daumer en 1840 et de la
famille Letannoux à partir de 1856),
Haute-Rue (au lieu-dit Sainte-Anne, édifié en 1840 par Vincent Guilloux);
7 moulins
à vent du XVIIIème siècle (d'après le cadastre de 1812), tous situés
(à l'exception de celui de la Mettrie) sur la digue : de la Mettrie
(propriété de Jean Maillard en 1822, puis de Joseph Landier, de la famille
Seneschal à partir de 1839, et démoli en 1849), à Petite Masse ou
Laronnière (édifié en 1827 par Pierre Pinçon ou Pinson, propriété de
la famille Tréhel à partir de 1835), Neuf (propriété de Gilles Filleul
en 1822, de la famille Montsimet à partir de 1853, et démoli en 1886), de la Grande
Pâture (propriété de Jean Trescan en 1822, Jean Delépine en 1875, de la
famille Letannoux à partir de 1908),
du Calvaire ou Rageul (propriété de Jean Auvray en 1822, de Gilles Filleul
en 1827, et démoli en 1827), des Carrées ou Croissy (propriété de Joseph
Chauchard en 1822, de la famille Deméheureuc en 1856, et démoli en 1856), des Grandes
Grèves (propriété de la famille Lebourgeois en 1822, Julien Le Saint à
partir de 1859, et démoli en 1874). 5 moulins étaient encore
exploités avant 1918 : les moulins Pinson ou Pavillon (au lieu-dit la
Laronnière), la Colimacière ou Saline (édifié par Francis Boulanger en
1827, et propriété de la famille Flaux en 1908), les Mondrins (au lieu-dit aux
moulins, édifié en 1839, propriété de Victor Daumer en 1840 et de la
famille Letannoux à partir de 1856),
Haute-Rue (au lieu-dit Sainte-Anne, édifié en 1840 par Vincent Guilloux);

A signaler aussi :
![]() le
pont du bec à l'âne (XVIIIème siècle) ;
le
pont du bec à l'âne (XVIIIème siècle) ;
![]() le
puits (XIXème siècle), situé rue des Han ;
le
puits (XIXème siècle), situé rue des Han ;
![]() la
cale de Hain (XIXème siècle) ;
la
cale de Hain (XIXème siècle) ;
![]() le
canal de la Banche (XIXème siècle) ;
le
canal de la Banche (XIXème siècle) ;
![]() la
statue Notre-Dame de la Garde, inaugurée le 19 août 1888 et située sur la digue ;
la
statue Notre-Dame de la Garde, inaugurée le 19 août 1888 et située sur la digue ;
![]() le
monument aux Morts, béni le 24 avril 1921. Il représente une oeuvre de J. Bouché ;
le
monument aux Morts, béni le 24 avril 1921. Il représente une oeuvre de J. Bouché ;
![]() l'ancien
manoir de la Fontaine. Propriété de la famille Eon en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Fontaine. Propriété de la famille Eon en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Pichardière. Propriété de la famille du Han en 1513, puis
d'Anne le Queu épouse de Jean du Breil seigneur des Hommeaux en 1635 et de
la famille Uguet seigneurs de l'Aumosne au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Pichardière. Propriété de la famille du Han en 1513, puis
d'Anne le Queu épouse de Jean du Breil seigneur des Hommeaux en 1635 et de
la famille Uguet seigneurs de l'Aumosne au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de la Gelière, situé route de Saint-Broladre ;
l'ancien
manoir de la Gelière, situé route de Saint-Broladre ;
![]() l'ancien
manoir de la Verdière, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille de Bonne-Fontaine en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Verdière, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille de Bonne-Fontaine en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir des Carrées, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la
famille Porcon en 1513, puis de la famille Uguet au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir des Carrées, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la
famille Porcon en 1513, puis de la famille Uguet au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de l'Essais, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille Porcon en 1513 ;
l'ancien
manoir de l'Essais, situé route de Saint-Broladre. Propriété de la famille Porcon en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir des Vergers, situé route de Baguer-Pican ;
l'ancien
manoir des Vergers, situé route de Baguer-Pican ;
![]() l'ancien
manoir de la Rouaudaye, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Eon en 1480 et 1513 ;
l'ancien
manoir de la Rouaudaye, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Eon en 1480 et 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Bacillié, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Renaud en 1480 et 1513 ;
l'ancien
manoir de Bacillié, situé route de Baguer-Pican. Propriété de la famille Renaud en 1480 et 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Vaujour ou de Vaujoyeux, situé route de Baguer-Pican. Propriété
de la famille le Gallois seigneur du Fédeuc en 1513 ;
l'ancien
manoir de Vaujour ou de Vaujoyeux, situé route de Baguer-Pican. Propriété
de la famille le Gallois seigneur du Fédeuc en 1513 ;
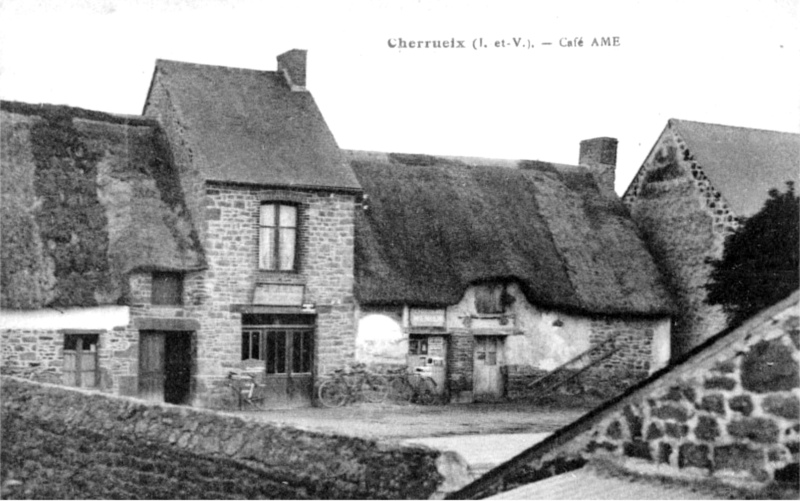
![]() l'ancien
manoir de la Banche, situé route de Mont-Dol ;
l'ancien
manoir de la Banche, situé route de Mont-Dol ;
![]() l'ancien
logis de Rageul, situé route du Vivier-sur-Mer ;
l'ancien
logis de Rageul, situé route du Vivier-sur-Mer ;
![]() l'ancien
manoir du Bois-Robin, situé route du Vivier-sur-Mer. Propriété de la
famille Prod'homme, puis de la famille le Sage en 1513 ;
l'ancien
manoir du Bois-Robin, situé route du Vivier-sur-Mer. Propriété de la
famille Prod'homme, puis de la famille le Sage en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir des Sallets, situé route du Vivier-sur-Mer ;
l'ancien
manoir des Sallets, situé route du Vivier-sur-Mer ;
![]() l'ancien
manoir de la Mettrie ou de la Metterie-Taillefer, situé route du
Vivier-sur-Mer. Il possédait autrefois une chapelle privée et dédiée à Saint-Julien. Propriété de
la famille de Taillefer en 1480 et 1513, puis de la famille le Saige en 1727 et en
1765. En 1513, Jean de Taillefer possédait le manoir de la Mettrie, appelé
parfois la Mettrie-Taillefer ; la famille Le Saige en devint ensuite propriétaire
et présenta par suite le chapelain chargé du service d'une chapelle fondée
près de ce manoir. En 1727, Jacques Le Saige, seigneur de la Villesbrunes,
tuteur de Pierre Le Saige, sieur de la Mettrie, encore mineur, présenta
pour chapelain Michel Joucquan, prêtre de Montdol, en place de Vincent Hébert,
décédé. Vinrent ensuite les chapelains Joseph Paumier (1736), Charles
Laborde (1746), François Juhel (1749) et Joseph Gervy (1765), présentés
successivement par Pierre Le Saige, seigneur de la Mettrie, Agnès Gouyon,
sa femme, et leurs enfants (Registre des insinuations ecclésiastiques de
l'évêché de Dol et Pouillé de Rennes). Plusieurs prêtres, assurant le service de la chapellenie de la
Mettrie, sont mentionnés : Vincent Hébert (de 1721 à 1727), Michel
Joucquan (en 1727), Joseph Paumier (de 1736 à 1746), Charles Laborde (de
l'ancien
manoir de la Mettrie ou de la Metterie-Taillefer, situé route du
Vivier-sur-Mer. Il possédait autrefois une chapelle privée et dédiée à Saint-Julien. Propriété de
la famille de Taillefer en 1480 et 1513, puis de la famille le Saige en 1727 et en
1765. En 1513, Jean de Taillefer possédait le manoir de la Mettrie, appelé
parfois la Mettrie-Taillefer ; la famille Le Saige en devint ensuite propriétaire
et présenta par suite le chapelain chargé du service d'une chapelle fondée
près de ce manoir. En 1727, Jacques Le Saige, seigneur de la Villesbrunes,
tuteur de Pierre Le Saige, sieur de la Mettrie, encore mineur, présenta
pour chapelain Michel Joucquan, prêtre de Montdol, en place de Vincent Hébert,
décédé. Vinrent ensuite les chapelains Joseph Paumier (1736), Charles
Laborde (1746), François Juhel (1749) et Joseph Gervy (1765), présentés
successivement par Pierre Le Saige, seigneur de la Mettrie, Agnès Gouyon,
sa femme, et leurs enfants (Registre des insinuations ecclésiastiques de
l'évêché de Dol et Pouillé de Rennes). Plusieurs prêtres, assurant le service de la chapellenie de la
Mettrie, sont mentionnés : Vincent Hébert (de 1721 à 1727), Michel
Joucquan (en 1727), Joseph Paumier (de 1736 à 1746), Charles Laborde (de
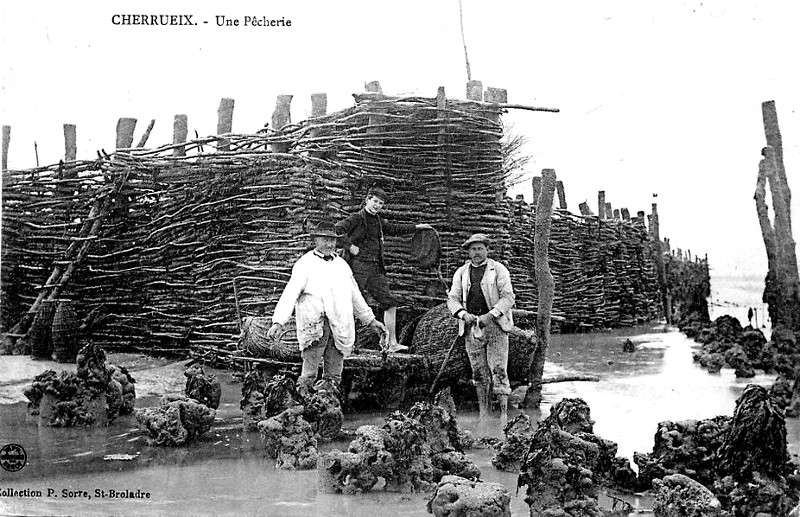
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de CHERRUEIX
Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 8 nobles de Cherrueix :
![]() Jehan
DE CHERRUEIX de Laumone (160 livres de revenu) : comparaît revêtu de sa robe ;
Jehan
DE CHERRUEIX de Laumone (160 livres de revenu) : comparaît revêtu de sa robe ;
![]() Guillaume
DE CHERRUEIX de la Métairie (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;
Guillaume
DE CHERRUEIX de la Métairie (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;
![]() Macé
DE LA MOTTE, remplacé par son fils Pierre, tient hôtellerie et maison
publique en le Vivier : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
Macé
DE LA MOTTE, remplacé par son fils Pierre, tient hôtellerie et maison
publique en le Vivier : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
![]() Maître
Alain DE TAILLEFER de Métairie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
Maître
Alain DE TAILLEFER de Métairie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
![]() Geoffroy
EON de Rouauldaie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;
Geoffroy
EON de Rouauldaie (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en arbalétrier ;
![]() Jehan
LE BOUTIER (30 livres de revenu) : défaillant ;
Jehan
LE BOUTIER (30 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Bertrand
REGNAUD de Bazille : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
Bertrand
REGNAUD de Bazille : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
![]() les
héritiers Gi. Simon : défaillants ;
les
héritiers Gi. Simon : défaillants ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513, sont mentionnées à Cherrueix les personnes et maisons nobles suivantes :
![]() Bertrand
Budes, gentilhomme des parties de Lamballe, possède le manoir de la Guiberdière ;
Bertrand
Budes, gentilhomme des parties de Lamballe, possède le manoir de la Guiberdière ;
![]() Jeanne
Prud'homme, damoiselle, femme de Guillaume Le Saige, homme de bas état,
possède le manoir de Boays-Robin qui fut à Pierre Prud'homme, noble homme ;
Jeanne
Prud'homme, damoiselle, femme de Guillaume Le Saige, homme de bas état,
possède le manoir de Boays-Robin qui fut à Pierre Prud'homme, noble homme ;
![]() Noble
homme François du Han possède le manoir de la Pichardière dans lequel
depuis soixante ans l'on a veu demeurer Marguerite Le Petit, damoiselle,
mère du père dudit François, et après Gilles du Han ;
Noble
homme François du Han possède le manoir de la Pichardière dans lequel
depuis soixante ans l'on a veu demeurer Marguerite Le Petit, damoiselle,
mère du père dudit François, et après Gilles du Han ;
![]() Simon
de Bonnefontaine et Perrine du Breil, sa femme, possèdent la métairie
des Ruoltz, laquelle fut à Guillaume Le Bourdelays, noble homme, et après
luy, à Jeanne Le Bourdelays, damoiselle, laquelle Jeanne fut mariée à
Geffroy Licorgnen, roturier, idem la métairie de la Verdière ;
Simon
de Bonnefontaine et Perrine du Breil, sa femme, possèdent la métairie
des Ruoltz, laquelle fut à Guillaume Le Bourdelays, noble homme, et après
luy, à Jeanne Le Bourdelays, damoiselle, laquelle Jeanne fut mariée à
Geffroy Licorgnen, roturier, idem la métairie de la Verdière ;
![]() Philippes
Eon, damoiselle, possède la maison de la Fontaine ;
Philippes
Eon, damoiselle, possède la maison de la Fontaine ;
![]() François
de la Barre possède la métairie de la Salle ;
François
de la Barre possède la métairie de la Salle ;
![]() Guillaume
Boutier et Jeanne du Rouvre possèdent la métairie de Neufdic ;
Guillaume
Boutier et Jeanne du Rouvre possèdent la métairie de Neufdic ;
![]() Jean
de Taillefer, homme noble, senechal de Dol, et Jeanne Troullon,
damoiselle, sa compaigne, possèdent le manoir de la Méterie ;
Jean
de Taillefer, homme noble, senechal de Dol, et Jeanne Troullon,
damoiselle, sa compaigne, possèdent le manoir de la Méterie ;
![]() Jean
Eon, fils de Geoffroy Eon, noble homme, possède le manoir de la
Rouauldaye avec la maison de Bienvient ;
Jean
Eon, fils de Geoffroy Eon, noble homme, possède le manoir de la
Rouauldaye avec la maison de Bienvient ;
![]() Noble
homme Gilles de Porcon possède le manoir des Carrées et de Lessay ;
Noble
homme Gilles de Porcon possède le manoir des Carrées et de Lessay ;
![]() Rolland
de Cherrueix tient le manoir de Laumosne ;
Rolland
de Cherrueix tient le manoir de Laumosne ;
![]() Guillemette
Le Gallays, fille de Jean Le Gallays, sieur du Fedeuc, possède le manoir de Vaujoyeux ;
Guillemette
Le Gallays, fille de Jean Le Gallays, sieur du Fedeuc, possède le manoir de Vaujoyeux ;
![]() Etienne
Boutier, gentilhomme, tient le manoir de la Rivière ;
Etienne
Boutier, gentilhomme, tient le manoir de la Rivière ;
![]() Gilles
Renaud, fils de Nicolas, tient le manoir de Bacillé (ou Baziglié) ;
Gilles
Renaud, fils de Nicolas, tient le manoir de Bacillé (ou Baziglié) ;
![]() Simonne
Le Mesle, native d'auprès de Dinan, femme autrefois de Pierre Faverel qui dit estre noble ;
Simonne
Le Mesle, native d'auprès de Dinan, femme autrefois de Pierre Faverel qui dit estre noble ;
![]() Olivier
Eon, noble homme, jouveigneur de la Rouauldaye, possède la métairie des Crouez-Chemins ;
Olivier
Eon, noble homme, jouveigneur de la Rouauldaye, possède la métairie des Crouez-Chemins ;
![]() Jehan
le Voyer, qui est noble homme et néanmoins va journellement à la charrue ;
Jehan
le Voyer, qui est noble homme et néanmoins va journellement à la charrue ;
![]() Jehan
de Vaujoyeux, sieur de la Ville-Guillaume, noble homme, possède terres en roture ;
Jehan
de Vaujoyeux, sieur de la Ville-Guillaume, noble homme, possède terres en roture ;
![]() Gilles
de Cherrueix, sieur de la Jugandière, noble homme, tient terres en roture ;
Gilles
de Cherrueix, sieur de la Jugandière, noble homme, tient terres en roture ;
![]() Olivier
Le Fils Hus, noble homme ;
Olivier
Le Fils Hus, noble homme ;
![]() Guillaume
Le Gallays, sieur de Chantelou (et de Montdol).
Guillaume
Le Gallays, sieur de Chantelou (et de Montdol).
© Copyright - Tous droits réservés.