|
Bienvenue ! |
LE CHATEAU DE MONTMURAN |
Retour page d'accueil Retour page "Ville des Iffs"
Le 19 mai 1743 mourait à Paris dame Renée-Françoise de Coëtquen, comtesse de Mornay, dame seigneure de Montmuran.
Françoise-Renée de Coëtquen, fille de Henri-Pélage dit comte de Coëtquen et marquis de la Marzelière et de dame Françoise Belin, naquit à Saint-Malo où elle fut ondoyée le 9 mai 1670. Son père, fils cadet de Malo marquis de Coëtquen et comte de Combourg, gouverneur de Saint-Malo et gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, avait acquis en 1665, par retrait lignager, la châtellenie de Montmuran et Tinténiac, vendue tout d'abord, en 1662, par sa parente, Henriette de Coligny, arrière-petite-fille de l'amiral Gaspard, seigneur de Montmuran par son mariage en 1547 avec Charlotte de Laval, héritière de la seigneurie, et alors femme de Thomas Hamilton, comte de Hadington, à Messire Gilles Huchet, seigneur de la Bédoyère, pour la somme de 273,000 liv.
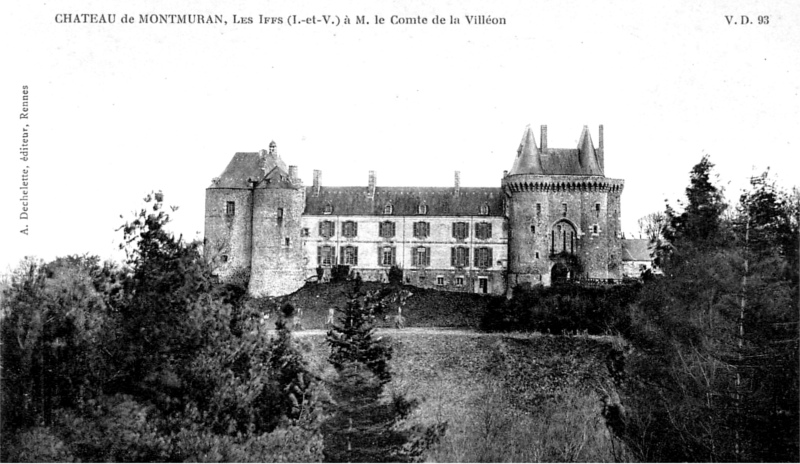
Trois ans après son acquisition, haut et puissant Henri-Pélage de Coëtquen, le nouveau seigneur, épousa le 22 octobre 1668, dans la chapelle de son château de Montmuran [Note : Registres paroissiaux des Iffs], demoiselle Guillemette Belin, dame de la Havardière, fille aînée de Jean Belin, sieur de la Maisonneuve, et de dame Germaine de Saint-Georges, fils lui-même de Antoine et de Julienne Fretté, sa première femme, et petit-fils de Jean Belin et de Jeanne de la Haye. Elle était née à Saint-Malo le 9 mai 1633, et eut une sœur cadette, Marie Belin, mariée avant-elle à François Le Marant, sieur de Saint-Eutrope [Note : Registres paroissiaux de Saint-Malo].
Le 27 septembre 1685, ayant à peine quinze ans, Françoise-Renée de Coëtquen épousait Henri-Charles de Mornay, colonel du régiment de Béarn en 1684, capitaine du château de Saint-Germain-en-Laye par survivance de son père, aide de camp de M. le Dauphin, tué au siège de Menheim le 9 septembre 1688, fils aîné de messire Henri de Mornay, marquis de Montchevreuil, sieur de Vaudampierre, chevalier des Ordres du Roi, gouverneur et capitaine du château de Saint-Germain-en-Laye par provisions du 30 août 1685, ci-devant gouverneur de Louis de Bourbon, comte de Vermandois, et de Louis-Antoine de Bourbon, comte du Maine, et de dame Marguerite d'Orsay [Note : La Chesnaye des Bois].
Françoise-Renée de Coëtquen eut une sœur cadette, née au château de Montmuran le 5 octobre 1674, et ondoyée le 27 [Note : Reg. par. des Iffs], qui mourut jeune ; et un frère, Malo-Jean-Baptiste, né à Saint-Malo le 22 janvier 1676 et, nommé le 21 novembre 1682 par son grand-père, Jean Belin, sieur de la Maisonneuve [Note : Reg. par. de Saint-Malo].
Malo-Jean-Baptiste, comte de Coëtquen, seigneur de Montmuran, marquis de la Marzelière, baron du Frettay, de Poligné et du Vauruffier, vicomte de Rougé après son père, décédé le 15 novembre 1677, ne vécut que peu d'années et mourut dans le Hainaut, pendant la guerre contre la Hollande, en mai 1693, à l'âge de 17 ans, laissant sa sœur, la comtesse de Mornay, unique héritière des grands biens de leurs père et mère.
La comtesse de Mornay elle-même n'eut point d'héritiers directs. Veuve à 18 ans, dans le court espace de temps qu'avait duré son mariage, elle n'avait point eu d'enfants et, fidèle au souvenir de son mari, n'avait point songé, pendant les 55 ans qu'elle lui survécut, à contracter une nouvelle alliance. Lors donc qu'elle décéda à Paris à l'âge de 72 ans, il ne se trouva que des héritiers collatéraux pour recueillir sa succession.
Le nombre de ces collatéraux et peut-être de légataires, dont, par parenthèse, parmi ceux que nous connaissons, bien peu semblent appartenir à la noblesse, mais presque tous à des familles de marins, se trouva tel qu'il nécessita la division de l'héritage en un nombre considérable de lots, et qu'ainsi que nous le verrons dans la vente de l'importante seigneurie de Tinténiac et de Montmuran, il y eut au moins trente-deux parts.
A cause de cette grande division la seigneurie ne put être vendue en bloc, et il fut nécessaire de passer plusieurs contrats avec un ou plusieurs héritiers, suivant que céux-ci étaient disposés à vendre. Il y eut plusieurs acquéreurs, mais le principal fut M. Joseph-Marie-Anne de la Motte, seigneur du Bois-Tomelin, qui, par contrat du 17 juillet 1750, devint possesseur de la plus grande partie
[Note : Joseph-Marie-Anne de la Motte appartenait à une branche
cadette des La Motte de la Motte-Rouge, juveigneurs de la maison de Dinan. Il
naquit à Saint-Malo en 1713, de Pierre de la Motte, seigneur de la Villeagan, et
de dame Marie Servanne de Miniac, fille de Charles de Miniac, sieur de la
Ville-ès-Nouveaux, et de dame Servanne Le Clavier de Miniac. Le 13 janvier 1773
il eut l'honneur de présider, par intérim, les Etats de Bretagne tenus à Rennes.
Un an après son acquisition de Montmuran, le nouveau seigneur prit femme, et le
12 septembre 1751 furent publiés dans l'église des Iffs les bans de son mariage
avec demoiselle Marie-Anne de Vion, fille de Messire René de Vion, chevalier,
seigneur de Tessancourt, Maisoncelles, Carrière, Gros-Rouvray et autres lieux,
et de dame Marguerite de la Salle.
Le mariage de Joseph-Marie-Anne de la
Motte demeura stérile, mais il avait trois frères plus jeunes que lui et une
sœur, Marie-Jeanne, qui fut mariée à René-Jacques Lesaige de la Villesbrune.
De ces trois frères, Pierre-Jean, seigneur de Lesnage et de Bonnefontaine, né en
1715 et mort en 1779, avait épousé demoiselle Anne-Thérèse du Fresne du
Colombier, sans enfants, et François-Vincent, sieur du Boisleraut, n'eut point
d'alliance. Seul, Julien-François, sieur de Beaumanoir, Trans et autres lieux,
né en 1721 à la Martinique, où il commanda la Compagnie du Port-Margot, député
aux Etats en 1766, s'était marié en 1749 avec demoiselle Marie-Michelle
Bousleau, dont il eut trois fils et deux filles. La dernière, Marie-Julienne,
née au château de Montmuran le 18 juin 1766 et nommée le lendemain par Messire
Pierre-Jean-Martial, son frère, et Marie-Jeanne de la Motte, dame de la
Villesbrune, sa tante, épousa M. Gabriel-Julien-Jacques-Louis de la Forest
d'Armaillé, dont ne vinrent que deux filles, mariées l'une, Julie, en 1805, à M.
Louis de Lorgeril, et l'autre, Louise, en 1825, à M. le comte Alexandre de
Palys. La fille aînée, Josephe-Marie-Anne de la Motte, née au Cap-Français le 12
novembre 1755, devint, le 21 juillet 1772, femme de
Jacques-René-Jean-Baptiste-Artur de la Villarmoys.
Des trois fils, l'aîné,
Jean-François de la Motte, mourut en 1779, à 17 ans, sous-lieutenant au Régiment
de Cuirassiers du Roi, sous le nom de chevalier de Montmuran, et René, le
troisième, lieutenant de vaisseau, fut tué en 1795 par les Républicains au
combat d'Elven.
Pierre-Jean-Martial de la Motte, le second fils, capitaine au
Régiment royal de Bourgogne-Cavalerie, puis, en émigration, au Régiment du
Dresnay, le seul qui survécut au seigneur de Montmuran, devint son héritier, et,
quoique le château et la terre, confisqués, eussent été vendus nationalement le
13 juillet 1794, un an avant le décès de M. Joseph. Marie-Anne de la Motte, leur
propriétaire, émigré à Jersey, où il mourut à l'âge de 82 ans, le 18 novembre
1795, porta jusqu'à sa mort, en 1823, le titre de marquis de Montmuran.
Après
le décès de Germain-Pierre-Georges de Lanjamet en 1786, il en avait épousé la
veuve, dame Charlotte de Guibert, mais n'en eut point d'enfants et, avec lui,
s'éteignit la branche des La Motte-Rouge de Montmuran. (Une partie de cette note
a été tirée de l'ouvrage « les Dinan » de Mme la comtesse de la
Motte-Rouge)].
Cinq semaines plus tard, le nouveau seigneur chargeait son procureur-fiscal de remplir les dernières formalités qui devaient le rendre définitivement propriétaire, et celui-ci faisait appeler un notaire de la juridiction royale de Hédé et un notaire de la juridiction de Saint-Georges à Tinténiac pour rédiger le procès-verbal suivant de la prise de possession qui occupa onze jours, du 31 août pour finir le 26 septembre :
« Par devant Maitre Boursin, notaire royal à Hédé, et Jan Baptiste Regnard, notaire de la juridiction de St Georges à Tinténiac... » Prise de possession « par Me André Julien Boudet, Pr fiscal de la juridiction de Tinténiac et Montmuran, procureur spécial de Messire Joseph Marie Anne de la Motte, Chevalier, seigneur du Bois-Tomelin et autres lieux, acquéreur de la terre et seigneurie du Comté de Tinténiac et Montmuran... » d'avec « dame Marie Pégasse et noble homme René Pégasse [Note : On trouve dans le Nobiliaire de P. de Courcy une famille Pégasse, sieur du Plessix, au ressort de Quimperlé, portant : d'azur à une bécasse d'or, accompagnée de trois étoiles de même, qui ne figure pas à la réformation de 1668. On connaît, outre ceux qui sont mentionnés ici, demoiselle Louise Pégasse, femme de noble homme Jean Le Couriault, seigneur de Kertudal, vivant en 1650, et demoiselle Jeanne-Marie Pégasse, mariée à Messire Joseph Corentin de Cléguenec, Chevalier, seigneur de Meslien et de Kermadehoué, dont une fille, Marie de Cléguenec, épousa : 1° le 7 novembre 1707, à Cléguer. près de Lorient, Messire Joseph-Yves, Chevalier, Comte de Robecq, Premier Capitaine général garde-côtes de Port-Louis, et 2° le 14 janvier 1721, Messire Philippe du Grez de Mont-Saint-Père. Enseigne des vaisseaux du Roi], sieur de Beauvallon, son mari, demoiselle Françoise Regnard [Note : De la famille de Jean-Baptiste Regnard, l'un des notaires rédacteurs de l'acte de prise de possession], veuve du sieur Olivier-Dupré, dame Hélène Céleste du Minihy et noble homme Louis Loisel [Note : Noble homme Louis Louaisel ou Loisel, Capitaine sur un des bâtiments des cinq grosses fermes du Roi, et demoiselle Hélène-Céleste Le Minihy de la Ville-Carmel habitaient Saint-Servan. Ils eurent une fille, nommée Charlotte-Pélagie, baptisée le 1er août 1740, qu'ils marièrent à Jean-Vincent Sanguinet, et qui mourut le 1er novembre 1782. (Reg. par. de Saint-Malo). En juillet 1769, Hélène-Céleste Le Minihy, devenue veuve, se remaría avec Jean-Joseph Sanguinet] son mary, demoiselles Hélène et Marie Sanguinet, et demoiselle Laurence Girard de Kerenflech, épouse et procuratrice générale du sieur Pierre André de Sanguinet, attendu son absence aux Indes Orientales, aux fins du contrat du 7 juillet dernier, au rapport de Hullard et Gendron, notaires royaux à St- Malo ».
[Note :
Les Sanguinet ne sont pas mentionnés dans le Nobiliaire de P.
de Courcy. C'était une famille de marins, que nous trouvons à Lorient, au milieu
du XVIIIème siècle, au service de la Compagnie des Indes. François de Sanguinet
épousa, à Saint-Malo, le 6 juillet 1723, Julienne Guyon, née le 8 septembre
1695, fille de Guillaume Guyon, Capitaine de la Françoise, qui périt
avec tout son équipage, dans le naufrage de son navire, perdu corps et biens, en
revenant de Terre-Neuve, et de Françoise Buisson.
Ce François, Pierre-André,
Jean-Joseph Sanguinet, ces deux derniers capitaines snr les vaisseaux de la
Compagnie des Indes, les demoiselles Hélène et Marie que nous trouvons ici,
sont, vraisemblablement, frères et sœurs.
C'est, probablement, de François que vint
Jean-Vincent qui dut naître à Saint-Servan, mari de Charlotte-Pélagie Loisel,
ci-dessus.
Noble Pierre André, dit Chevalier dans la dispense de bans obtenue
pour son mariage, épousa, en mai 1749, demoiselle Laurence-Renée Gillard de
Keranflec’h, née vers 1730, de Mathieu ou Mathurin-Joseph Gillard de
Keranflec’h, Receveur général des Devoirs, Lieutenant général de la côte, et de
dame Marie-Hyacinthe Louvart de Pontigny.
Cette demoiselle Laurence-Renée
Gillard avait eu trois sœurs: Marie-Guyonne-Vincente qui épousa, le 24 mars
1751, François-Julien Querangal de Kerascouët, Lieutenant des vaisseaux de la
Compagnie des Indes, fils de Maurice de Querangal, sieur de la Ville Héry ;
demoiselle Claudine-Françoise, mariée, le 15 avril 1751 à François Bonnefin,
Directeur des Devoirs à Lorient, et Marie-Thérèse-Gabrielle, née en 1732, épouse
de Messire Pierre-Joseph de Becdelièvre, dont vint Laurence de Becdelièvre,
mariée en 1780 à Messire Joseph-Claude de Derval, seigneur de la Haye-Eder,
Coëtbily, etc.
La famille Gillard, venue du Maine en Bretagne où elle
possédait dans l'évêché de Léon les terres de Keranflec’h et de Larc’hantel,
portait : de gueules à deux clefs d'argent en sautoir, la garde en haut.
Pierre-André de Sanguinet eut de Louise-Renée Gillard un fils, Pierre, baptisé à
Lorient le 11 mai 1762. C'est à ce mariage que doit être encore,
vraisemblabfement, attribuées Marthe-Françoise et Louise Petronille de Sanguinet
qui épousèrent, la première, le 12 septembre 1785, Messire Cesar-Phœbus-Joseph
de Filley de la Barre et, la seconde, en mars 1787, Toussaint-Blaize Cozet.
Jean-Joseph de Sanguinet, marié en 1731 à demoiselle Suzanne Pignolet, en eut
une fille, Jeanne-Perrine Fortunée, femme, le 17 décembre 1754, de
Antoine-Jacques Fraboulet, sieur de Kerorgan, officier sur les vaisseaux de la
Compagnie des Indes.
Devenu veuf, Jean-Joseph de Sanguinet se remaria en 1769
avec dame Hélène-Céleste du Minihy, veuve de noble homme Louis Loisel.
La première partie, peu intéressante, consiste dans la visite faite par Elle Berthault, maçon, René Corvaisier, charpentier, et Guillaume Gautier, couvreur, amenés « pour dire leur avis sur le sujet des indigences et réparations nécessaires audit château ». Cet état de lieu ne nous apprend rien ou très peu de choses sur le château.
On voit d'abord « à l'entrée du portal un long pont dormant et au bout d'iceluy un petit pont-levis, ledit pont dormant supporté par deux piliers de pierre contenant de longueur trente-quatre pieds et treize de largeur, le grand et le petit pont-levis avec la herse qui les soutient ».
On mentionne aussi, mais sans les décrire « la grande écurie, la chambre au-dessus..., la chambre au-dessus de la boulangerie, la boulangerie, la remise à coté…, les deux petites escuries joignant l'escalier de la chapelle..., l'appartement servant de cuisine, l'office à côté avec l'escalier descendant à la cave..., la chambre au-dessus de la cuisine, nommée la Sallette, chambre à côté, l'antichambre sur ladite Sallette..., la seconde chambre au-dessus du portal appellée la chambre des Evesques et sur cette chambre deux autres petites ».
Dans la grosse tour, « la chambre de Madame de la Marzelière ».
« Le colombier bâti de pierres, voûté, sans couverture, petite tour joignant les remises,... la tour appellée le Donjon... ».
« En la pocession duquel château, de ses dépendances, coulombier, bois du Parc, rabinnes, pâtis, terres vaines et vagues, vallons, bois, prés, moulins, étangs et couailles, nous avons mis et induit ledit sieur Boudet, qui l'a prise et acceptée pour et au nom de mondit seigneur de la Motte du Bois Tomelin et de ses associés... Scavoir, dans ledit château fait feu, fumée, bu, mangé, ouvert et fermé les portes et fenestres des appartements d'icelluy et fait sur les autres terres et dépandances tous actes et formalités requises... ».
Le lendemain les notaires quittent le château et s'en vont, avec le procureur de M. de la Motte, dans les paroisses voisines rapporter procès-verbal des « marques, escussons et droits honorifiques » qui se trouvent dans les églises dont le seigneur de Tinténiac et Montmuran est Supérieur et Fondateur [Note : Ce procès-verbal présente d'autant plus d'intérêt que, depuis l'époque où il a été rédigé, l'état des lieux s'est considérablement modifié, que les verrières ont subi de grands changements, qu'un grand nombre d'écussons n'existent plus, que les bancs armoriés ont été enlevés, que l'église de Saint-Meloir des Bois a été désaffectée à la Révolution, que l'ancienne église de la Chapelle-Chaussée a été reconstruite en 1830, enfin que celle de Tinténiac vient de disparaître à son tour avec tous ses vitraux et son curieux porche du XIVème siècle, pour faire place à une construction nouvelle].
LES IFFS.
« Et avenant le mardy,
premier jour de septembre mil sept cent cinquante, nous sommes transportés dans
l'église paroissialle des Iffs de laquelle la dite terre et seigneurie du comté
de Tinténiac et Montmuran est Seigneure Supérieure, Fondatrice et Patronne, à la
porte de laquelle Nous avons trouvé vénérable et discrept prestre missire Pierre
Quelavoine, Recteur d'icelle et de Sainct-Brieuc des Iffs, en compagnie duquel
nous y avons entré pour rapporter proces-verbal des marques et escussons et
droits honorifiques y estant dépandants de lad. terre, ce que faisant après led. sieur Boudet
aud. nom, led. sieur recteur, nousdits nottaires et autres personnes présentes,
avons fait généflection au devant du principal autel et du sacraire de ladite
Eglise, avons remarqué :
Scavoir :
A la maîtresse vitre et principalle du
grand autel, au bas d'icelle, aux deux meneaux de lad. vitre, deux escussons
d'armoiries, le premier portant un escu de Laval, d'or à la croix de gueules
chargée de cinq coquilles d'argent, cantonnée de seize alerions d'azur, ledit
escusson orné du collier de l'Ordre de Saint-Michel et d'une couronne de Duc
au-dessus.
Le second escusson escartelé, au premier, de France, au second et troisiesme, à un mesme escu de Laval ci-devant spécifié, au quatriesme, d'azur, à trois fleurs de lys d'or traversées d'une bande eschellée [Note : Eschellé n'appartient pas à la langue du blason. Le notaire, Me Boursin, a voulu dire, sans doute, échiqueté. Une bande échiquetée, ou plutôt componée, comme est celle-ci, peut, en effet, ressembler à une échelle] d'argent et de gueules, et sur le tout, de gueules à un lion d'argent, orné de pareil collier et couronne [Note : Cet écusson qui était celui de Guy XVI de Laval se lisait : Ecartelé au 1er, de France; au 2e et 3e de Laval-Montmorency ; au 4e de d'Evreux ; sur le tout, de Vitré. Lors du mariage de Jeanne de Laval, en 1424, avec Louis de Bourbon, Comte de Vendôme, il avait été stipulé dans le contrat passé à Rennes le 24 août, que le deuxième fils issu de cette union serait tenu, si sa mère devenait plus tard, par le décès de ses mère et aïeule et de ses frères, hérittère principale de sa maison, de porter le nom de Laval avec le cri et les armes écartelées de celles de France. Quoi que Jeanne de Laval n'eut eu qu'un fils qui continua la lignée de Vendôme dont devaient sortir les rois de Navarre et Henri IV, c'est, sans doute, pour perpétuer le souvenir de cette illustre alliance, que Guy XVI plaçait les fleurs de lys de France au premier canton de ses armes].
Dans la chapelle du costé de l'Evangile, proche dud. grand autel, apellée la Chapelle de Laval ou des seigneurs de Tinteniac et Montmuran, en la maîtresse vitre de lad. chapelle, au dessus de l'autel d'icelle, un autre escusson de Laval semblable au précédent, orné du mesme collier et couronne.
En la chapelle St Yves, du costé de l'Epitre, il y a trois vitres en chascunes desquelles il y a un escusson des mesmes armes que ci-dessus.
Dans la costalle de lad. Eglise, du costé de l'Evangile, au dessus de la porte de la Sacristie, un escusson en relief de taille portant, suivant les couleurs y appliquées, de gueules à trois fasces d'argent au bâton d'azur, qui sont les mesmes armes de Tinteniac [Note : Le rédacteur, soit que l'éloignement ou l'état des couleurs ne lui permit pas de bien voir, soit, plutôt, que sa science héraldique laissât à désirer, commet ici nue petite erreur qu'il répétera dans tout le cours de son procès-verbal. Les armes anciennes de Tinteniac étaient : d'argent à 3 jumelles d'azur, à la cotice de gueules brochant].
Dans la nef de lad. Eglise, en la chapelle du Rosaire, en la vitre de lad. chapelle sont, en haut d'icelle, deux autres semblables escussons de Laval et, au-dessous, un autre escusson portant Couesquen [Note : Bandé d'argent et de gueules de six pièces].
Sur le pilier du bas de la voûte de lad. Chapelle est un autre escusson en peinture desd. armes de Tinteniac.
Dans l'autre chapelle, avis la précédante, du costé de l'épitre, avons veu dans la vitre d'icelle cinq semblables escussons de Laval et de leurs alliances, de mesme façon et ornements de collier et couronne que ceux ci-dessus mentionnés en la vitre principalle de lad. Eglise.
En la vitre du bas de l'Eglise, au dessous du clocher il n'y a plus d'escusson.
Et, en cet endroit, le sieur Boudet aud. nom, a sommé le Sr Recteur, suivant les ordres de mondit Seigneur de la Motte du Bois Tomelin, de faire à l'avenir pour lui, en qualité de propriétaire de lad. terre et comté de Tinteniac, les prières nominalles au prosne de la Grand Messe, tant comme supérieur fondateur que patron de lad. Eglise, ce qu'il a promis de faire, connaissant pour tel ......
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE.
Missire François Sevegrand, prêtre curé, en l'absence du Recteur, fait ouvrir l'Eglise ou « ... nous avons remarqué en premier lieu que, dans la grande et maitresse vitre au-dessus du grand autel, il n'y a aucun escusson ny marques aparantes, ny lieux pour en pouvoir placer, d'autant que lad. vitre est toute employée en verre de couleurs représentant l'histoire de la Mort et Passion de Nostre Seigneur.
Avons veu dans une petite vitre du costé de l'Epitre assé proche dud. grand autel, au haut de laquelle est un escusson armoyé des mesures armes de Laval, d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent, cantonnée de seize alterions d'azur.
Au joignant dud. autel, du costé de l'Evangile, hors le sanctuaire, avons aussy veu un petit banc à queue et acoudouërs cy-devant non marqué d'aucunes armes, auquel on a mis depuis peu les armes de Monsr de Bégasson [Note : D'argent à une bécasse de gueules], ainsi que nous l’a déclaré led. Sieur Sevegrand, ptre, et le Sieur Boudet nous a déclaré que ce banc a esté acordé par les enciens seigneurs de Tinteniac et Montmuran.
En la chapelle appellée de St Etienne, sittuée au costé de l'Evangile, avons remarqué en la vitre d'icelle deux autres semblables escussons des armes de Laval ; en tout laquelle Eglise n'y a autres escussons ny armes que celles cy-dessus, fors une ceinture ou listre funèbre commandée en haut de lad. Eglise depuis peu de temps, armoyée des armes de la Bourdonnaye de Blossac [Note : De gueules à trois bourdons d'argent, en pal. Les la Bourdonnaye de Blossac prétendaient aux droits de supériorité et de fondation dans les églises de Saint-Brieuc des Iffs et de la Chapelle-Chaussée, à cause de la terre du Chatellier, en cette dernière paroisse, ainsi que le constate l'acte d'acquisition de cette terre, le 8 février 1695, par Messire Regnaud de la Bourdonnaye, sieur de Blossac, d'avec les héritiers de Thibault Le Mintier, seigneur de Carmené, la Crozille, Bon Espoir, le Chatellier, etc... (Minutes Boursin)] et qui a esté posée de la part des seigneurs. de Tinteniac et Montmuran, ainsy que nous l'ont dit lesd. sieurs Sevegrand et Boudet, attendu qu'ils sont seuls Seigneurs supérieurs et fondateurs de lad. Eglise et cimetière d'icelle.
CARDROC.
La porte ouverte par « noble et discrept prêtre Missire Charles Ferron de la Ferronais du Quengo et de la Forest » [Note : Charles Ferron fut baptisé, dans l'église des Iffs, le 21 novembre 1701. Il était fils d'Ecuyer Charles Ferron, seigneur de la Forest et de dame Henriette Françoise Ravart, dame de Trésoleil, sa seconde femme. Il fut pourvu du rectorat de Cardroc le 10 septembre 1732 et y mourut le 13 avril 1755] recteur de la paroisse... « avons remarqué que dans le coeur, chapelle et nef de lad. Eglise, il n'y a aucunes marques, escussons d'armoiries, banc ny autres choses, led. sieur Recteur nous ayant atesté qu'il a toujours entendu dire que les seigneurs de Tinteniac et Montmuran sont seuls et véritables seigneurs supérieurs et fondateurs de lad. Eglise.
Au pied du marchepied du grand autel, du costé de l'Evangile, est une tombe figurée d'une femme autour de laquelle sont gravées plusieurs lettres goticques, lesquelles ne se peuvent présentement lire [Note : Cette pierre qui représente une dame noble du XVème siècle a été enlevée de sa place pour être employée dans le dallage. Tous les paroissiens doivent passer par dessus pour se rendre à leurs bancs. Déjà bien uséé, lorsque nous l'avons vue, il y a une quinzaine d'années, il serait vivement à désirer que la Société Archéologique qui recueille avec tant de soins tous les monuments anciens qu'elle découvre, put aussi sauver d'une perte inévitable et imminente, cette figure rare et curieuse], laquelle tombe aparamant est dépandante de lad. Terre et seigneurie de Tinteniac et Montmuran.
Sorty de lad. Eglise avons veu, faisant le circuit du cimetière, un escusson en relief au dessus du couronnement de la grande Porte de lad. Eglise sur une pierre de tuffau portant un aigle déployé et couronné qui sont les armes des seigneurs de Chatillon de Colligny, ci devant propriétaires de lad. terre et seigneurie de Tinteniac et Montmuran » [Note : De gueules à l'aigle éployé d'argent, becqué, membré et couronné d'azur].
LA BAUSSAINE.
« Vénérable et discrept ptre missire Jan Baptiste Aougstin, sr Recteur de lad. paroisse.. » conduisant les visiteurs, « avons remarqué dans plusieurs vitres de lad. église plusieurs escussons d'armoiries de lad. terre et comté de Tinteniac et des alliances d'icelle, comme Sicile [Note : Semé de France, au lambel de gueules à trois pendants. Guy XVII de Laval, seigneur de Tinteniac et Montmuran, avait épousé en premières noces Charlotte d'Aragon, princesse de Tarente, fille de Frederic d'Aragon, roi de Naples et de Sicile et d'Ysabeau de Beaux].
Au bas de la grande et maîtresse vitre au-dessus dudi. grand autel est un grand escusson écartelé au premier, des armes de Laval portant d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent, cantonnée de seize allerions d'azur, au second et troisième, deux escus desd. armes de Tinteniac portant de gueules à trois fasces d'argent, au baston d'azur en bande ; en toute laquelle vitre n'y a aucuns autres escussons ny marques, lad. vitre estant remplie de verre peint représentant l'histoire de la Mort et de la Passion de Nostre Seigneur.
En la chapelle de Saint-Pierre, du costé de l’Evangile, n'y a plus aucuns escussons ny seinture, mais, au pilier sous la voûte de lad. chapelle, à l'entrée d'icelle, est encore un escusson en peinture des armes de Tinteniac, au pied de laquelle voûte et joignant le sanctuaire, est un banc clos portant les armes de Tinteniac et de Couesquen.
Dans la chapelle du costé de l"épitre appellée la Chapelle du Scapulaire est un escusson des armes de Tinteniac seulement, environ le millieu.
Dans la seconde chapelle du costé de l'Evangile avons remarqué au bas de la vitre, deux escussons des mesmes armes de Tinteniac.
Dans la troisiesme chapelle, du mesme costé de l'Evangile, appellée la chapelle Sainte-Anne, avons pareillement remarqué deux escussons au bas de la vitre d'icelle, portant les mesmes armes de Tinteniac.
Dans la dernière vitre du mesme costé, joignant les fonds, avons remarqué un escusson portant un aigle déployé qu'on nous a dit entre les armes de Colligny et nous n'avons remarqué dans lad. Eglise aucunes autres armes que celle ci-dessus.
Sorty de lad. église, après avoir fait le circuit d'icelle et du cimetière, avons aussi veu un autre grand escusson en pierre, escartelé comme les précédents des armes de Laval et de Tinteniac, placé au dessus de la grande porte et vitre de lad. église …. ».
TRIMER.
En l'absence de missire Jan Lesguer, curé de Trimer, missire Godefroy Anne, prêtre de la paroisse, introduit dans l'église les notaires qui, après « avoir fait le circuit de lad.. église par le dedans et du cimetière, monté dans le clocher, ont vu sur les deux cloches les armes de Tinteniac ».
SAINT-DOMINEUC.
Conduits par « vénérable et discrept prestre Jan Thomas Durand » recteur de la paroisse, après avoir induit le Sr Boudet en possession des droits de Supériorité et de Fondation et droits honorifiques dans l'église « étant sortis avons remarqué un pilier de bois en forme de sauvegarde planté dans led. cimetière, armoyé au chef autour d'icelluy de cinq écussons, l'un, des armes de France, deux, des armes de France et de Navarre, les deux autres de Chatillon et de Laval, les tous presque pouris et cassés, un des costés dud. pilier, icelluy vers le Nord, n'ayant plus d'écusson, ayant les tous estés attachés avec des clous aud. pilier... ».
TINTENIAC.
A Tinteniac, les Recteur et Curé sont absents ; c'est « vénérable et discrept prestre missire François Guillois » de lad. paroisse, qui ouvre les portes.
« Entrés dans la sacristie qui est à présent au derrière du grand autel, led. autel estant enciennement au dessous et au joignant de la grande vitre de la sacristie, qui est la principalle et maitresse vitre de lad. église, lequel autel a esté depuis environ mil six cent soixante trois ou soixante quatre transféré, par la permission du seigneur lors de Tinteniac et Montmuran, à l'entrée de la voûte de lad. sacristie, au, haut de laquelle principalle vitre avons remarqué un encien escusson des armoiries de Laval portant d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d’argent, cantonnée de seize allérions d'azur, en laquelle maitresse vitre n'y a aucuns autres ecussons ny marques.
Dans la muraille faisant la séparation de lad. sacristie et de la Trésorerie, dans laquelle Trésorerie estait enciennement la chapelle des seigneurs de Tinteniac et Montmuran, du costé de l’épitre, avons remarqué un escusson en bosse sur une pierre de tuffeau derrière la boisure portant de gueules à trois fasces d'argent, au baton d'azur en bande qui sont les armes de Tinteniac.
Sorty de la sacristie et rentré dans lad. Église avons remarqué en la croixée et aille du coeur, du costé de l'évangile, un écusson en haut de la vitre d'icelle desdites armes de Laval portant d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent cantonnée de seize allerions d'azur.
En l'autre aille de la croixée du costé de l’épitre sont trois autres écussons semblables au précédent placés de rang au bas de la vitre sans aucuns autres escussons ny marques.
Au costé de l'autel de laquelle croixée vers l'Evangille est un escusson en relief de pierre de taille, placé en la muraille, portant les armes du Comté de Tinteniac.
Au couronnement estant au dessus du tableau du grand autel est un escusson portant les armes des Couesquen. Sous la voûte de laquelle croixée du costé de l'épitre est un grand et encien banc de bois avec accoudouër, queue et siège clos et fermé, sur l'accoudouër duquel banc sont marqués en relief trois escussons d'armoiries, le premier, des armes de lad. Comté de Tinteniac cy-devant mentionnée, le second, portant un aigle déployé et couronné, le troisième, d'alliance, party au premier, dud. aigle et le second, un escu plein sans marque, au bas duquel au raz du pavé est une figure en bosse portant un escusson à son costé de Tinteniac, Chatillon et Laval, lad. figure, sur une pierre tombale.
Dans le couronnement de l'autel de la Sainte Vierge, au dessus de son image, est un escusson portant les armes de Couesquen, feu Monsieur le Marquis de la Marzelière de Couesquen ayant été propriétaire de lad. terre de Tinteniac et Montmuran.
Dans le restant des autres vittres n'y avons veu aucuns escussons, la grande vitre qui est sur la grande porte du bas de la nef ayant esté faite de neuf depuis quelques temps.
Sortis de lad. église par une porte qui a son issue sur le Chapitreau joignant le cimetière du costé de l’épitre, avons aussi remarqué au dessus d'une autre porte étant au proche, par lacpielle on entre dans lad. nef, un autre escusson en pierre et relief sur le couronnement de lad. porte, party au premier, dud. aigle et, au second, lesd. armes de Tinteniac.
Au pignon vers Occident de lad. église, au dessus de la grande vitre, en dehors, avons aussy veu un encien escusson en pierre de taille portant lesd. armes de Laval et, au dessous de lad. vitre, proche et au dessus de la grande porte, un autre escusson aussy en relief de pierre marqué et party au premier, desdittes armes de Laval et, au second, de celles de Tinteniac.
Faisant le circuit de lad. église avons remarqué au dessus de la fenestre de la Trézorerie ouvrant sur le cimetière un escusson en relief sur une pierre de tuffeau portant lesdites armes de Tinteniac.
Passé de quoy, nous nous sommes aussy transportés aux prisons de lad. terre et Comté de Tinteniac sittuées en lad. ville de Tinteniac assé proche du cimetière de lad. église, auxquelles est demeurant comme geôlier Jean Harans ; le logement desquelles prisons est composé d'une haute salle, une basse fosse ou cachot, une chambre criminelle, chambres et greniers au dessus servant de demeure aud. un jardin au derrière et une cour au devant et, du costé dud. logement, fermant d'une grande et petite porte au milieu.
Dudit lieu nous sommes transportés en l'Auditoire de lad. Seigneurie et Comté, qui est sous doublage, garny au haut d'icelluy de sièges et bancs pour les Officiers exerçants de lad. jurisdiction et autour d'icelluy garny de baraceaux de bois et terrasses.
Sur l'une des filières dud. Auditoire, du costé du midy, est en relief un escusson portant le mesme aigle que cy-dessus et sur l'autre filière, de l'autre costé, un autre escusson desdites armes de Tinteniac.
A la halle scittuée au milieu de lad. ville de Tinteniac, à costé de laquelle vers Orient est un emplacement servant pour exposer en vente, le jour et marché de lad. Comté, les blasteries, lequel joint aux maisons dud. sieur Boudet et d'0llivier et Jeanne Œillet.
Dudit lieu nous sommes transportés dans une chapelle appellée la Magdeleine de Tinteniac scittuée en lad. paroisse de Tinteniac, proche la ville, sur le grand chemin conduisant de Rennes à St-Malo en la présentation du seigneur du Comté de Tinteniac... ».
SAINT-MÉL0IR-DES-BOIS ou SAINT-MELEUC.
Note : Très petite et très pauvre paroisse de l'évêché de Dol enclavée dans celui de Saint-Malo qui fut supprimée en 1803 et partagée d'abord entre les paroisses de Québriac et de Bazouges-sous-Hédé, puis, quelques années plus tard, entièrement rattachée à Tinteniac.
Reçu par « vénérable et discrept ptre missire Mathurin Héry » sieur Recteur de la paroisse... « avons, en premier lieu, remarqué et veu sur le hault de la principalle porte et entrée de lad. église, par le dehors, au-dessous du chapitreau un encien escusson en relief sur une pierre de taille armoyé des armes de Tinténiac qui nous a paru aussi encien que le bastiment de lad. église et, rentrés en icelle nous n'avons remarqué autres armoiries que celles mentionnées dans la prise de possession du 26 avril 1662 qui ont estés gravées sans droit et usurpées par les propriétaires de la Guéhardière, contre lesquelles mondit Seigneur de la Motte du Bois Tomelin proteste de se pourvoir par les voyes de droit comme estant seul seigneur supérieur et fondateur ....... ».
Note : Le seigneur de la Gouarière ou Gorière
prétendait droit de fondation en l'église de Saint-Meloir en raison de sa terre
de la Gouairière et particulièrement du fief appelé de Saint-Meloir ou
Saint-Meleuc et de la Touche dans lequel était bâtie l'église et où se trouvait
le cimetière. Il justifiait par actes de « sept vingt ans » (la terre et le fief
appartenaient alors à Thebault Piedevache, 1520) ses droits à la possession «
d'écusson dans la principale vitre au-dessus du maître-autel, prières nominales,
banc à queue dans le chanceau, écussons, etc.., » malgré les protestations du
seigneur de la Guéhardière agissant dans l'intérêt des seigneurs de Tinténiac —
alors Thomas Hamilton et Henriette de Coligny, sa femme, — se disant supérieurs
et fondateurs de l'église. Il y eut à ce sujet entre Charles du Fournet, sieur
de la Guéhardière d'une part, et Pierre de Vaucouleurs, sieur de la Ville-André
et de la Gouairière et Germaine Joubin, sa femme, d'autre part, un procès où
furent produites les pièces suivantes :
1° Lettres patentes du roi de France
et duc de Bretagne, données à Nantes le 2 juillet 1524 à Ec. Bonabes de
Lespinay, propriétaire des maisons de la Guéhardière et de la Ville-Aleix.
2°
Extrait de l'aveu présenté au seigneur de Laval et de Tinténiac par Gilles de
Lespinay le 4 août 1542.
3° Aveu rendu le 4 février 1614 à la Seigneurie de
Tinteniac par Ec. Guillaume du Fournet, sieur de la Guéhardière « des maisons,
terres, fiefs y mentionnés et droict de banc et enfeu prohibitif avec… armoiryes
tant en viltres que relevées en pierre aux portes et posts de l'église de
Saint-Meleuc. ».
4° Autre aveu du 5 dudit mois et an.
5° Autre aveu au 3
décembre 1642 rendu au roi pour les maisons, terres et héritages, fiefs et
juridiction tombés en rachat par le décès ; en date du 18 mars 1625, de
demoiselle Marguerite de Saint-Pern, femme d'écuyer Charles Gouyon, sieur de la
Mordelière.
6° Extrait de partage du 15 juin 1637, de la succession de
demoiselle Marguerite de Saint-Pern et de défunt Amaury Gouyon, sieur de
Campeneuc, son fils aîné, entre Ec. Gilles Joubin, sieur du Plessis et Hélye de
la Haye, sieur de Lesnouen, mary de demoiselle Hélène Gouyon, auquel les «
prééminences y mentionnées en l'église de Saint-Meloir sont rapportées entre
dépendantes de la maison de la Gorière ».
7° Une déclaration du 15
janvier 1638 des choses tombées en rachat par le décès dudit Amaury Gouyon,
faite par led. Joubin, père et garde naturel de ses enfants de Gabrielle de la
Haye vivante sa femme, héritière, « en laquelle est employée lad. maison de la
Gorière, avec lesd. prééminences en l'église de Saint-Melleuc ».
8° Acte
d'accord et partage du 15 mai 1651 entre Ec. Gervais Joubin, sieur du Plessix et
demoiselle Geneviève Joubin, sa sœur.
9° Acte du 21 mai 1518 par le sieur de
la Gorière (Thebaut Piedevache fils de Gilles), par le sieur Official de Dol.
10° Aveu du 18 juin 1630 présenté à la seigneurie de la Gorière par Ec.
Guillaume du Fournet, sieur de la Guéhardière. (Registres du greffe de la
Sénéchaussée de Hédé, n° 64. Arch. départementales d'Ille-et-Vilaine)
Pour
terminer ce procès et faire cesser toute discussion, Charles du Fournet acheta
par contrat du 1er mai 1655 de Pierre de Vaucouleurs les fiefs et bailliages de
Saint-Méloir et de la Touche « ayant moyenne et basse justice, avec tous les
droits qui en dépendaient, » dont, devenu propriétaire, il voulut jouir à son
tour.
Cela ne faisait point l'affaire de messire Jean-Gilles Huchet, sieur de
la Bédoyère qui, le 2 mars 1662, venait d'acquérir la seigneurie de Tinténiac
et, le 19 novembre de la même année, eut lieu une transaction entre lui et
écuyer Jean Botherel, sieur de la Prioulaye agissant pour Charles du Fournet,
son gendre, dans laquelle il fut convenu ce qui suit : que le sieur de la
Prioulaye reconnaît « sans contestation le droit de Supériorité au seigneur de
Tinténiac, comme seigneur supérieur du fief.., que celui-ci pourra mettre telles
armes, bancs et lizières qu'il voudra au-dessus des siennes, sans toutefois
baisser ni remuer de place les siennes, comme aussi il ait le premier les
prières nominales ». En revanche le sieur de la Prioulaye aura, comme seigneur
de la Guéhardière, par suite de son achat des fiefs ci-dessus d'avec le seigneur
de la Gouarière, « les bancs qu'il a dans lad. église, l'un dans le chanceau du
côté de l'Evangile, l'autre, dans la nef avis l'autel Notre-Dame, sauf à lui
faire baisser le ballustre jusqu'au banc du. sieur de la Guéhardière pour placer
un banc en tel lieu qu'il lui plaira en dedans dud. balustre ; que les écussons
du sieur de la Guéhardiére qui sont dans la principale vitre y demeureront
pareillement, sauf celui qui est au-dessous du crucifix qui sera baissé pour
faire place à ceux que le sieur de la Bédoyère voudra placer comme Seigneur
supérieur ; que les écussons du sieur de la Guéhardière sur la petite porte de
l'église et dans la vitre au proche y resteront et que, là où le seigneur de
Tinténiac mettrait une lizière funèbre par dedans et par dehors comme Seigneur
supérieur, le seigneur de la Guéhardière en fera aposter une au-dessous comme
Seigneur fondateur ; qu'en cette même qualité il aura les prières nominales et
autres droits accoutumés après le Seigneur supérieur ».
Cette convention ne
fut-elle pas exécutée et le seigneur de la Guéhardière continuait-il à empiéter
sur les droits de celui de Montmuran, ou M. de la Motte, après sa nouvelle
aquisition, voulut-il les faire reconnaître à nouveau,
toujours est-il que, le 10 juin 1760, il faisait renouveler devant Me Boursin,
notaire, cette même convention de 1662 par messire Josselin-Joseph Chauchart,
sieur du Mottay d'Argantel, mari de dame Anne Claire Rogon, propriétaire de la
Guéhardière. (Minutes Boursin).
Après avoir ainsi pris possession de ces églises, et fait reconnaître les droits honorifiques qui y sont dus à la seigneurie de Tinténiac, des presbitères et des terres et landes qui en dépendent, le sieur André Boudet s'en va à Dingé, avec ses notaires mettre en possession du bailliage des Vaux messire François de Vaucouleurs, sieur de la Ville-André, associé, pour ce bailliage, dans l'acquêts fait de la terre et seigneurie de Montmuran par M. de la Motte, d'avec « les héritiers en l'estoc maternel de Madame la comtesse de Mornay ».
Malgré cette prise de possession de la seigneurie de Tinténiac et Montmuran, il semble que M. de la Motte ne possédait pas tout, ce qui explique le peu de détails qui nous ont été donnés sur le château et qu'il lui en manquait encore, une certaine partie. En effet, il existait encore un autre héritier pour une trente-deuxième partie de la succession avec lequel il n'avait pu traiter.
Soit que ce personnage, officier au service de la Compagnie des Indes, fût en mer en juillet 1750 lors de la première vente, soit qu'il n'ait pas trouvé suffisantes les propositions qu'on lui faisait, soit toute autre raison, ce ne fut que deux ans plus tard, par le contrat suivant passé devant Me Boursin, que le seigneur de Montmuran compléta son acquisition.
Vente « le 17 juin 1752 par noble homme Jan-Joseph de Sanguinet, capitaine de vaisseaux de la Compagnie des Indes, héritier collatéral pour la 32ème partie dans la succession de feue dame Françoise-Renée de Couesquen, dame Comtesse de Mornay... à Messire Joseph-Marie-Anne de la Motte, seigneur du Bois-Tomelin et ses associés, de la 32ème partie de la terre et seigneurie de Tinteniac et Montmuran dépendant de lad. succession... comprenant... le château de Montmuran, fuie, colombier, chapelle, jardins, bois taillis, de haute futaie, fiefs, moulins, étangs, prés, garennes, gallois, terres vagues et vaines, halles, prisons, droits de poids et mesure ès marchés, droit de ceps et colliers, ensemble de boutiques, dixmes, de pesche et générallement de tous les domaines, terres et seigneurerie, justice et juridictions, patronage, prééminences d'église, droits utiles et honorifiques en dépendant... y compris la portion des meubles et ornements de la Chapelle... titres et archives... qu'il s'arrange au sujet des titres avec les seigneurs des fiefs prétendant en deshérence par rapport à l'estoc vacquant de Germaine de St-Georges, ayeulle maternelle de ladite Comtesse de Mornay... moyennant la somme de sept mille cent quatre-vingt-sept livres dix sols de principal et deux rentes viagères, l'une de 100 livres à la dame d'Arieux, Relig. à Fougères, et l'autre de 300 livres à la demoiselle Hélène Ché ».
Les associés de M. Joseph-Marie de la Motte étaient, ainsi qu'il ressort du contrat suivant passé en 1751 devant le même Me Boursin, notaire royal a Hédé, Etienne Gaude de la Vieuville [Note : Messire Etienne-Auguste Baude, marquis de la Vieuville, comte de Châteauneuf, baron du Guemadeuc, seigneur de Saint-Père, de Tréal, de Trémigon, etc., gouverneur du fort de Châteauneuf (1791), colonel d'infanterie, lieutenant aux Gardes, chevalier de Saint-Louis, né à Saint-Malo le 9 mars 1713, était fils de Henri Baude et de dame Pelagie-Céleste Picot. Il se maria deux fois : la première, à Saint-Thual en 1755, avec demoiselle Anne-Andrée Baude, sa nièce, âgée de quatorze ans, née en 1741 à Lanvallay, fille de Messire Joseph Baude et Marie Palavicino, qui mourut à Saint-Malo le 3 janvier 1756 et fut inhumée à Châteauneuf ; et la seconde, en 1758, avec demoiselle Françoise-Joséphine Butler, née à Lorient, fille d'écuyer Richard Butler et Marie-Françoise Duvelaër] et François-Joseph Guy de Vaucouleurs, seigneur de la Ville-André, qui achetaient ensemble un huitième de la terre de Montmuran :
« Messire Etienne-Auguste Baude de la Vieuville, chevalier, marquis de Châteauneuf, Colonel d'Infanterie, Lieutenant au Régiment des Gardes françaises, Chev. de l'ordre royal et militaire de St-Louis, acquéreur pour lui et ses associés de la huitième partie par indivis au total de la terre de Tinteniac et Montmuran avec les droits utiles et honorifiques, ensemble toutes ses appartenances, circonstances, annexes et dépendances… d'avec le sieur Charles Lhéritier et dame Catherine-Marie-Anne de Coulon, son épouse, tant en leur nom que comme procureurs de missire Jean-François Voisin, prêtre de l'Oratoire et le sieur Chevalier de la Villeneuve de Languedoc, héritiers pour un huitième de la succession indivise de feue clame Françoise-Renée de Couesquen, dame comtesse de Mornay ».
Note : François-Joseph Guy de Vaucouleurs, sieur de la
Ville-André, la Boullaye-Ferrière, Chamballan, le Bois-Geffroy, etc., chef de
nom et armes, fils de René de Vaucouleurs et de dame Jeanne de Québriac, fut
baptisé le 17 juillet 1714, six ans après la mort de son père, âgé de vingt ans
et quelques mois, par Missire Jacques Follenay de Cremeur, recteur de Saint-Jean
de Lamballe, dans l'église de Dingé où il eut pour parrain et marraine Missire
Guy de la Haye, recteur de Plouasne et demoiselle Joseph-Anne de Vaucouleurs, sa
tante. Le 30 novembre 1728 il épousa, au château de Montis, paroisse de Valette,
évêché de Nantes, demoiselle Madeleine-Félicité Barrin, fille mineure de défunt
Messire François Barrin, chevalier, marquis de la Guerche, seigneur de Pecheuil,
baron de Parcé, etc., et de dame Marie-Toussainie Cheuvreul, demeurant au
château de la Guerche, paroisse de Saint-Aubin de Luigné, diocèse d'Angers. Nous
connaissons de ce mariage de 1729 à 1738 cinq enfants, dont deux filles
seulement, Marie-Anne-Félicité et Jeanne Cajetane, nées en 1735 et 1736,
vécurent et eurent des alliances.
La première fut mariée le 26 août 1762, dans
la chapelle de la Cité, en la paroisse de Saint-Etienne de Rennes, à Messire
Jean-François de Quifistre, seigneur de Bavalan, Trenouar, Brays, Pradouays...,
etc., fils de messire Jean-François de Quifistre et de dame Gilonne-Joseph
Charpentier. Elle mourut en 1790 et fut inhumée le 27 avril dans la chapelle des
Carmes de Vannes.
La seconde épousa, le 27 novembre 1764, Messire
Jean-Baptiste-Louis Le Roy, fils unique de Jean-Baptiste-Marie Le Roy, seigneur
de Macey, Noyant, la Brumanière, etc., et de dame Marie-Louise-Elisabeth Le
Champenois, de la paroisse de Macey, évêché d'Avranches.
Note : Nous ne savons d'où vient ce Jean-François Voisin, prêtre de l'Oratoire. Nous connaissons en 1775, à Lorient, un Pierre Voisin, sieur de la Serbelle, caissier des édifices de la Compagnie des Indes, marié à demoiselle Rose-Blancbe-Sébastiane Mathieu de Merville de Saint-Remy. Peut-être serait-il de la même famille que les Sanguinet, aussi de Lorient, et c'est, vraisemblablement, comme allié de la comtesse du Mornay par sa grand-mère, Germaine de Saint-Georges, qu'il obtint le bénéfice du Prieuré, de la Madeleine à la nomination des seigneurs de Montmuran, où nous le trouvons dès 1714, bien jeune, n'étant pas encore prêtre, mais simple clerc tonsuré, qu'il possède encore en 1761 et dont il afferme, par devant maître Faisant, notaire de la juridiction du Plessis-Bonenfant en Saint-Domineuc, pour 460 liv. payables chaque année en deux termes, savoir Pâques et Madeleine, les dîmes qui en dépendaient dans les paroisses de Plouasne et de Longaulnay.
L'acquêt de Messire Baude de la Vieuville se compose des trois fiefs et bailliages de Blanchefeix ou des Vaux en la paroisse de Combour, de la Carrée, en Châteauneuf et de Laval en celle de la Fresnais.
Le seigneur de la Ville-André prit le bailliage des Vaux en Dingé et M. de la Motte de Montmuran, le surplus du huitième indivis qu'on ne nous fait point connaître.
Lorsque M. de la Motte en eut finit avec les héritiers de la comtesse de Mornay et qu'il eut reconstitué la seigneurie de Tinteniac et Montmuran à peu près aussi complète que lors du décès de son ancienne propriétaire, il dut, à titre de nouveau possesseur, présenter un aveu au Roi. Cet aveu, nous ne l'avons point, mais quelques années plus tard, en 1763, il en fit rédiger un autre par Me Boursin, dont nous extrayons ce qui suit, qui nous énumère tous les droits attachés à la seigneurie :
« Le moulin à eau de Rouillon, paroisse de Saint-Meloir...
Un fief et bailliage nommé le fief de Vaux aux paroisses de Bazouges et Saint-Meloir, partie néanmoins d'iceluy enclavé dans la paroisse de Tinteniac, lequel vaut de rente annuelle, par deniers, seize livres huit sols monnoie et, par avoine grosse à la ruche, mesure de Tinteniac composée de trois raseaux par boisseau, pesant en bon froment soixante quatorze à soixante quinze livres, poids de marc, trante et un boisseàux neuf godets et demi et, par poules, deux poules et demie, lesquelles rentes soit deues solidairement par les vassaux et tenanciers des terres roturières ou relevant roturièrement. De ce bailliage sont hommes et sujets le sieur de Blossac pour cause de partie de sa terre du Boisorcan et fief de Ligandière [Note : Messire Jacques Regnault de la Bourdonnaye de Blossac avait acquis des héritiers de Messire Thebault Le Mintier de Carmené, en même temps que la seigneurie du Chatellier, les terres de la Crozille, Bon-Espoir, et le Boisorcan] ; le sieur de Bourgon [Note : Messire Julien-François de la Corbinaye, chevalier, seigneur comte de Bourgon, Conseiller au Parlement, marié à Tinteniac le 19 mars 1729 avec demoiselle Renée-Charlotte de Rabasté, fille aînée de messire Joseph-François, seigneur de la Pommeraye et de la Besnelaye, et de dame Renée Bonnier de la Coquerie] pour trois fiefs nommés Lisambardière, la Bellangeraie et fief Bouvet ; la dame Rogon, veuve du sieur d'Argantel [Note : Claire-Anne Rogon, née le 30 novembre 1734, à Saint-Meloir des Bois, fille d'ecuyer Joseph-Marc-Louis-Auguste Rogon, seigneur de la Motte et de dame Jeanne Henry, dame de la Guéhardière, mariée à Messire Josselin-Joseph Chauchart, chevalier, seigneur du Mottay d'Argantel. Après la mort de son mari, arrivée vers 1762, Claire-Anne Rogon prit, en secondes noces, en 1765, ecuyer Pierre-François-Alexandre Boulleuc, capitaine d'infanterie, dont elle eut au moins trois enfants. Elle mourut aux Vallées, en Saint-Helen, le 5 février 1785], pour sa terre et fief de la Guéhardière ; la dame des Tuslaie [Note : Dame Cajetane Louise de Rabasté, née à Paris, le 25 juin 1701, sœu aînée de la dame de Bourgon, épouse de Messire Louis Tranchant, seigneur do la Tuslaye] pour sa terre de la Couaspelaye et autres.
S'excuse led. seigneur advouant d'emploier au présent le bailliage de Vaux en Combourg, autrement de Blandefas, attendu le retrait qu'a exercé sur luy. M. le duc de Duras, en vertu de lettres de prélation ; n'emploie pareillement le bailliage de la Carrée, en Châteauneuf, acquis par le sieur Baude de la Vieuville, à titre de son associé, semblablement le bailliage de Laval, en la Fresnais, acquis par le sieur Baude de Saint-Père, à pareil titre ; même le bailliage de Vaux, en Guipel, acquis à pareil titre d'associé par le sieur de Vaucouleurs.
A cause desquelles choses cy-dessus déclarées et du restant de ladite terre et seigneurie de Tinteniac mouvant de l'abbaye de Saint-Georges à Rennes, led. seigneur de Montmuran a tout ferme droit de haute, basse et moyenne justice qui s'exerce en la ville de Tinteniac, droit d'établir en icelle Sénéchal, Alloué, Lieutenant, Procureur fiscal et Procureurs ad lites, Greffier, Sergents généraux et particuliers, Forestiers et Gardes-bois, droit de Menée au Présidial de Rennes, alternativement avec la juridiction de Saint-Georges, ce qui caractérise le titre de Châtellenie ancienne dont la terre de Tinteniac a esté de tout temps décorée, droit d'épaves, déshérences, batardises, communs, terres vaines et vagues, ceps, post et collier, fourches patibulaires, halle dans la ville de Tinteniac, plusieurs foires et marché au mercrecly de chaque semaine ou se perçoit coutume au profit de l'avouant, mesme droit de mesure et apprecy des grains, droit de bouteillage sur tous les vendants vin, cidre, eau-de-vie ou autres breuvages dans l'étendue de la seigneurie à raison d'un pôt par fust, droit de fondation aux églises des Iffs, Cardroc, la Baussaine, Trimer, Saint-Domineuc, La Chapelle-Chaussée, Tinteniac et Saint-Meleuc, avec tous autres droits appartenant à seigneur haut-justicier ... ».
« Déclare ledit seigneur de Montmuran que le tout cy-dessus relève prochement et noblement du Domaine du Roy à Rennes, sous le ressort du Présidial de Rennes, à devoir de foy, hommage, lods et vente et rachat quand le cas y échoit, sans rente... lesdites choses luy venues par l'acquisition qu'il en a fait d'avec les héritiers de la dame comtesse de Mornay aux fins de divers contrats relatifs à celui du 7 juillet 1750 fait à Saint-Malo… et déjà exhibé à la Chambre lors de la foy et hommage qu'il a faits ... ».
Pour terminer ce que nous avons à dire sur le château et la seigneurie de Montmuran, nous donnerons encore quelques actes concernant les propriétaires et quelques notes relatives à la chapelle du château et à l'église des Iffs, relevés dans les registres de cette paroisse :
1668. — « Le vingt
deuxiesme jour du mois d'octobre mille six cens soixante et huict, hault et
puissant messire Henry Pélagie de Couesquen, seigneur marquis de la Marzelière,
comte de Combour, etc…, fils de hault et puissant seigneur Malo de Couesquen et
de dame Françoise de la Marselière, son espouse et compaigne, et damoiselle
Guillemette Belin, dame de la Havardière, fille de noble homme Jan Belin,
seigneur de la Maisonneufve et de damoiselle Germaine de St-Georges, son espouse
et compaigne, ont esté conjoints en mariage au château de Montmuran, paroisse des
Iffs, évêché de St-Malo, par paroles de présents en face de Notre Mère Ste
Église par noble et discret pbre Missire Yves Lesquen, sieur des Salles,
chanoine de l'église cathédrale de St-Malo en présences desdits seigneurs de
Couesquen et Belin, pères desdits mariés, de noble homme Christophle de
St-Georges, sieur de la Grande Maison, oncle maternel de ladite dame de la
Marselière, du sieur de Hindré, cousin paternel et de Messire Mathurin de
Rosmadec, chevalier et seigneur baron de Gaël, Messire René Cousturié, seigneur
de la Jaronne [Note : De la Garenne, paroisse de Soudan],
conseiller en la cour de parlement de ce pais et de moy,
Jacques Cochery, pbre Recteur des Iffs et St-Brieuc et de plusieurs autres
messieurs qui ont esté présents ausdites cérémonies et qui ont signé, et ce, aux
fins des permissions des sieurs Vicaire perpétuel de l'église cathédrale de
St-Malo et du sieur Recteur de Combour, demeurées vers ledit Sr des Salles,
lesdits jour et an que dessus ».
Suivent les signatures.
Baptême, 1674. — « Du jeudi cinquième octobre mille six cens soissante et quatorze, environ une heure après midi, acoucha heureusement au château de Montmuran situé dans la paroisse des Iffs, diocèse de St-Malo, d'une fille, haute et puissante Dame Guillemette Belin, espouse de haut et puissant Seigneur Messire Henri Pélage de Couesquen, marquis de la Marzelière... etc., qui a été baptisée dans la chapelle dudit Château par moy, Jacques Cochery, prêtre Recteur de ladite paroisse des Iffs, Notaire apostolique, non nommée, en ayant obtenu permission du sieur Vicaire général du Seigneur Evesque de St-Malo, ledit batême fut le samedi vingt septyème dudit mois d'octobre, environ midi, aux presances dudit Seigneur marquis de la Marzelière, Missire Charles Desiancles, prêtre, chapelain desdits seigneur et dame, les demoiselles sage-femme, nourrice et plusieurs autres aussi présentes ledit jour vingt septyème octobre 1674 ».
Décès, 1677. — « Haut et paissant Seigneur Henry Pélage de Quaquen, en son vivant marquis de la Marzelière, conte de Tinteniac et Montmuran, est décédé en son chasteau de Montmuran le 15 novembre ; ses entrailles furent enterrées en la Chapelle de St-Touain (St-Ouen) [Note : Patron de l'église des Iffs]. Son cors fut levé du chasteau par vénérable et discret ptre messire François du Plaissis, Recteur de Tinténiac et apporté à l'église….. ; son cors fut levé de l'église des Iffs par le même Recteur et aporté à Dinan et fut enterré en l'église des Jacobins ou assistèrent les Recteurs de Tinténiac, St-Domineuc, la Baussaine, Cardroc, les Iffs, St-Méloir, Québriac et plus de six vingt, tant gentilhommes que roturiers, le 10 décembre 1677 ».
Bans de mariage, 1751, 12 septembre. — « Ban du mariage entre Messire Joseph Marie de la Motte, chevalier, seigneur de Tinténiac, Monmuran, du Bois Tomelin et autres lieux, fils de feu Messire Pierre de la Motte, seigneur dudit lieu et de dame Servanne Marie de Miniac, ses père et mère, originaire de la ville et paroisse de St-Malo et domicilié de la paroisse des Iffs d'une part, et damoiselle Marie Anne de Vion, fille de Messire René de Vion, chevalier, seigneur de Tessancourt, Maisoncelles, Carrières, Gros Rouvray et autres lieux et de dame Marie Marguerite de la Salle, originaire de la paroisse du Coudray, diocèse de Sens et domiciliée de la paroisse de St-Paul en la ville de Paris ».
Baptême 1766. — « Demoiselle Marie Julienne de la Motte, de la maison de Dinan, fille légitime de Messire Julien François de la Motte, de la maison de Dinan, chevallier, seigneur de Beaumanoir, Trans et autres lieux et de dame Marie Michelle Bousleau, dame de Beaumanoir, ses père et mère, née d'hier au château de Montmuran, paroisse des Iffs, a esté baptisée en notre église ce jour dix neuffième juin 1766 par moy soussigné Recteur ; a esté parain Messire Pierre Jean Martial de la Motte, de la maison de Dinan, chevalier, seigneur de Beaumanoir, son frèré, et maraine dame Marie Jeanne de la Motte..., dame de la Villesbrune, tante ; ont esté présents Messire Julien François de la Motte..., père de l'enfant, Messire Joseph Marie de la Motte, seigneur de Montmuran et dame Marie Anne de Vion-Téssancourt, dame de Montmuran, dame Guyonne Julienne Le Saige de la Villèsbrune, damoiselle Marie Anne de la Motte..., lesquels tous ont signé, lesdits jour et an ».
Un siècle avant l'acquisition de la seigneurie de Montmuran par Messire Joseph Marie Anne de la Motte, un autre membre de la branche aînée de cette même famille de la Motte-Rouge, Jean de la Motte-Rouge, seigneur de la Garenne, était venu s'établir auprès du château, dans la paroisse des Iffs, où il vécut vingt deux ans, remplissant les fonctions de Sous-fermier des Devoirs. La généalogie des « Dinan » de Mme la comtesse de la Motte-Rouge le mentionne, mais ne s'y arrête pas et ne donne pas toutes ses alliances parce qu'il mourut sans laisser d'enfants à lui survivre de ses trois mariages successif.
Jean de la Motte-Rouge était le second fils de Pierre de la Motte et de dame Renée Thomas, fille de Vincent, sieur de la Villegratien et de Charlotte de la Lande. Il avait deux frères, Antoine, son aîné qui continua la lignée, puis un cadet, Alain, sieur de Saint-Gilles, décédé sans postérité après deux mariages, et une sœur aînée, née en 1620 et morte en 1683, demoiselle Gilette, femme d'abord de François Lambray, sieur de Launay-Barthélemy, puis, en 1652, de Jacques de la Goublaye, sieur de Belestre.
Jean de la Motte-Rouge, né en 1623, épousa demoiselle Anne Goudrel, dame de Launay, fille de Pierre et Christoflette du Liscouët, seigneur et dame de la Courbrie, dont vint un fils mort sans enfants.
Nous ne connaissons pas l'époque de ce mariage, mais le mari devait être bien jeune et l'union fut bien courte, puisqu'il n'avait pas vingt-trois ans lors de ses secondes noces.
Après le décès de Anne Goudrel, Jean se remaría le 11 février 1646, dans la paroisse des Ifs, avec demoiselle Suzanne Robinault, beaucoup plus âgée que lui, veuve de noble homme Thomas Le Franc, sieur de la Forest qu'elle avait épousé vers 1625, dont elle avait eu au moins six enfants et qui était mort deux ans auparavant, en 1644, à l'âge de soixante-douze ans.
Suzanne Robinault, assistant le 25 mars 1642, au baptême d'une cloche de Cardroc, dont son mari est parrain, est dite fille de la Quenvraye, en Betton. Elle serait donc fille de noble homme Guy Robinault, seigneur de la Quenvraye, époux de N..., qui a un fils, Jacques, baptisé à Betton le 117 mai 1601. Elle serait ainsi née au commencement du XVIIème siècle et avait une sœur, demoiselle Léonore, présente au mariage, en 1642, de Marguerite Le Franc, sa fille aînée, nommée en 1631 [Note : Il ne faut pas s'étonner du jeune âge de la mariée, car il semble que c'était une habitude dans la famille. La sœur cadette de Marguerite Le Franc, demoiselle Vincente, nommée en 1634, épouse, 24 juillet 1644, n'ayant pas douze ans, Ec. Sébastien Le Bel, sieur de la Chevalleraye. Ce mariage dût être ratifié et validé par une messe dite le 9 avril 1646], avec Ec. Daniel Le Roy, sieur de Laubanière, Sénéchal de la Chatellenie de Betton. Cette branche des Robinault fut déboutée à la Réformation de 1668.
De ce mariage naquirent deux fils : Jacques, le 15 décembre 1646, nommé le 2 février 1647, veille de sa mort, par haut et puissant messire Charles de Saint-Gilles, seigneur du Plessix-Peronnay et damoiselle Jacqueline Courault, dame des Briands, en présence d'écuyer Pierre de Bocan, sieur du Chesne, écuyer Fiacre Paillevé, sieur des Clos, et de damoiselle Gilette de la Motte, dame du Demaine (?), tante de l'enfant, et René, né le 22 décembre 1647, et nommé le 4 février 1648 par écuyer Guy Courault, sieur de la Ville-Cottète et damoiselle Jeanne de Lanjamet, dame de Miniac, qui ne vécut que deux ans et mourut le 4 septembre 1650.
Suzanne Robinault vécut jusqu'en 1664 et c'est seulement le 15 août qu'elle alla rejoindre ses enfants dans leur tombeau en l'église des Iffs, proche l'autel du Rosaire, du côté de l'Epitre. Jean de la Motte ne resta pas longtemps veuf et, dés l'année suivante, 1665, il convolait en troisième noces avec damoiselle Cyprienne de la Touche, dame du Bocage, de la paroisse, de Saint-Sauveur de Dinan, fille de Louis de la Touche, sieur de la Talvasière et de dame Françoise du Halgouet [Note : Les de la Touche, seigneurs de la Talvasière, en la paroisse de Dolo, évêché de Saint-Brieuc, nobles d’ancienne extraction, portaient ; d'azur à la bande dentelée d'argent accostée vers le chef d'une molette d'or], alors douairière. A la cérémonie assistaient la sœur du marié, clame Gilette, dame de Belestre, puis deux autres de la Motte, messire Bertrand et damoiselle Hélène, dame de la Rivière, qu'on nous dit proches parents de la damoiselle du Bocage, ou peut-être plutôt du marié, et que nous ne trouvons pas dans la généalogie des « Dinan », damoiselle Geneviève Ginguené, dame du Dily, femme d'écuyer Renaud du Rocher, sieur du Dily, et damoiselle Charlotte Courault, dame de la Lande-Davy, sœur de écuyer Guy Courault, sieur de la Ville-Cotètte, parrain en 1648 de René de la Motte.
Ce mariage fut moins heureux encore que les précédents, car il dura à peine un an, et, le 2 février 1666, la dame de la Garenne Motte-Rouge mourait en couches avec son enfant.
Messire Jean de la Motte survécut, peu de temps à sa femme; il décéda à son tour eh 1668, n'ayant encore que quarante-cinq ans, sans laisser d'héritiers de ses trois femmes.
Réparations au château de Montmuran. — Nous Gaspard de Coulligny chevalier de l'ordre, Seigneur de Chastillon sur Loing, Capitayne de Cinquante lances et couronnal général de touttes les bandes de gens de pied francois Certifiions a noz auditeurs de comptes et aultres qui' appartiendra que nous avons Commandé a Phles (Philippes) de Gigon faire délivrer des deniers qui nous sont deubz par Recepueurs de noz seigneuries estans en bretaigne cest asscavoir la somme de Cinquante liures tournois pour faire partie des fraiz quil conuyendra faire au paracheuement du terrier et Reformation que nous auons par cy deuant ordonnez estre faictz en notre Seigneurie de Tintiniac et aultres Cinquante liures tournois pour estre employés aux Réparations des couuertures de notre Chateau de Montmuran et aultres choses y nécessayres qui sont ensemble Cent liures tournois Laquelle somme de C Livres nous voullons estre allouée aud. de Gigon pour les comptes quil nous rendra des deniers quil aura receuz pour nous en nosd. terres de bretaigne, s'il appert suffisamment les choses cy dessus auoir esté faictes. Tesmoing notre seing manuel cy mis A Paris le XXIXème jour de janvier mil cinq cens quarante huict. (1549.) G. DE COULLIGNY.
(Mes Arch.)
La peste, 1584. — « La peste commença en Cardreuc et y fut apportée de Rennes,
qui vint de Nantes, en l'an 1583 et s'espandit par toutes les paroisses
circonvoisines dudit Cardreuc, comme les Iffs, la Chapelle-Chaussée, Miniac,
Bécherel, la Baussaine et continua fort longuement, dont plusieurs et un grand
nombre moururent. Celuy qui m'a escrit ne le dict pas par ouit dire. Qui le mist
icy le 14e jour de janvier 1584. Thebault » [Note : Mathieu Thebaut fut
nommé recteur des Iffs le 2 novembre 1581 et fut remplacé en 1601 par M. de la
Gaudairie, chanoine du Mans].
Cloches. 1596. — Le 31 janvier eut lieu, dans l'église des Iffs, la bénédiction de deux cloches pour le service de la paroisse. La plus grosse fut appelée Marguerite, du nom de dame Marguerite de Tournemine, dame du Bois-Bintin, seconde femme de François Massuel, seigneur de la Bouteillerie, capitaine pendant la Ligue du château de Montmuran qui appartenait alors aux Colligny, nommé chevalie de l'Ordre par Henri IV, mort vers 1597 et dont le fils, René Massuel, sieur de la Bouteillerie, lui succéda dans le commandement du château, représentée par Jeanne Tremaudan, femme, après le décès, en 1594, de Me Julien Denoual, sieur du Gravier, son premier mari, d'écuyer Jean Couppé, sieur des Vignettes. La petite cloche fut nommée Jeanne par écuyer Jean Ginguené, sieur de la Sauvagère et damoiselle Julienne Guézille, épouse de noble homme Bertrand de Cacé.
Cloche de l'église, 18 janvier 1610. — Bénédiction de la petite cloche « du pouays de treize cents ou environ... par Dom Trochet, curé de ce lieu, en présence de missire François Le Clerc, recteur de ladite paroisse, lequel lui donna son nom, accompagné de damoyselle Guillemette Tufin, femme et compagne de noble homme Jean Denoual, sr du Bouays et la nommèrent Françoyse et étaient présents missire François Villeneuve, Rr de Chevaigne, etc ..... ».
Voyage à Rome, 1600. — « Le douziesme jour de septembre mil six centz, l'an du Saint Jubillé, discrept prestre Dom Jan Trochet, pour lors présent curé des Iffs, luy troysyesme a prins chemin et de la parouasse a party affin de à Rome aller et venir. Jan de la Crouez et Guillaume Raignaudais quandeluy sont partiz pour ensemble fère chemin à la volonté de Dieu ; sont allez à Rome, ont visité et, par la Grâce de Dieu, sont retournez en leur églisse ; sont rentrez le mardy dix neufviesme jour, sans mantir, de décembre, l'an présent ».
Image de Saint-Fiacre. — Baptême de Julien Trochet, fils de Jean et Nouelle André, le 9 mai 1608, « et le même jour et an fut l'église des Iffs affestée de plon……., aussi une figure et imaige de Monsieur Saint-Fiacre avec deux Angelots sur le milieu de l'église et fut faict par maistres plombeurs pintiers, Me Robert Lision, de la Ville de Combour et Me Pierre Robert, de la Ville de Dol ».
Prise de possession du Bénéfice. — « L'an mil six cents six Missire Julien Girard a pris possession du bénéfice des Iffs et lui avait précédé Missire François Le Clerc, tous deux Manceaux, et Le Clerc avait entré par résignation d'un appellé Monsieur de la Gaudairie, chanoine du Mans, et led. Girard qui l'a obtenu aussy par résignation le quatorziesme septembre an que dessus. Ledict Girard décéda le 30 Aougt 1639, après une maladie de fièbvre violente et frénétique qui luy prist le jour de la Transfiguration de Notre-Seign., 6 dud. moys et lui succéda Missire Jacques Cochery, pbre originaire de Tintiniac, pour lors secrétaire et aulmosnier de Messire Achilles de Harlay, Seigneur Evesque de St Malo, qui conféra ledict bénéfice audit Cochery, et, en prit possession, le dimanche 4me 7bre dud. an 1639, Monsieur le Vicaire général dudict Seign. Evesque ».
Décès, 1675. — Jacques de Caradeuc, maître d'hotel au château de Montmuran... décédé… inhumé dans la chapelle du...
Tableaux, 1685. — « Ce jour trantième juillet mil six cents quatre vingt cinq, je, qui soussigne, Recteur des Yffs et Sainct-Brieuc, confesse avoir donné quatre tableaux pour servir au grand autel, scavoir, un de nostre Seigneur et l'autre de la Vierge, de plus une Annonciation avec bordure dorée et une Samaritaine. En foy de quoy j'ay signé. Gaultier Rr. Du depuis jay porté et donnè à l'église deux tableaux portant figures d'anges, deux autres petits tableaux pour mettre aux grands chandeliers, deux autres tableaux differans et ay faict faire un pavillon de peinture au grand autel et mis deux chandeliers à demi dorés à deux autels. En foy de quoy jay signé. Gaultier Rr. ».
Vitraux, 1696. — Restauration des vitraux de l'église des Iffs par Jan Couvant, maître Peintre-verrier à Rennes. (Soc. Arch. d'Ille-et-Vilaine, t. XIX, p. 115. Jean Couvant, par Anne Duportal).
Décès, 1700. — Ecuyer Pierre Onet (ou O'Neil), Irlandais, âgé d'environ 17 ans…. dans le chœur de l’Eglise... ; les cérémonies faites par M. Macarty, prêtre Irlandais de la Ville de Hédé…. en présence de haute et puissante dame Madame la marquise de la Marzelière, Mlle Lestang Poilvilain, Mlle La Brosse, M. James, M. Saint-Jan, M. Rambure, etc.
Pèlerinage de S.Fiacre, 1720. — « Cette année, à cause de la grande mortalité causée par la dyssenterie, sont venues processionnellement invocquer Saint-Fiacre les paroisses de Bazouges et Hédé, de Saint-Brieuc, de Cardroc et de la Beaussaine, ce 30 aout 1720, jour du Bienheureux Saint-Fiacre et apportèrent l'infection dans cette paroisse par la grande quantité des valétudinaires ».
Cloche, 1767. — Baptême d'une cloche « nouvellement construite pour le service de la chapelle du château de Montmuran ».
Bénédiction de la chapelle du château, 1770. — « Vu la commission à nous donnée de faire visite de la chapelle nouvellement batie dans l'enceinte du château de Montmuran par Messire Marie-Joseph de la Motte, de la maison de Dinan, chevallier, seigneur de Montmuran, Tinténiac et autres lieux et dame Marianne de Vion de Tessancour, son épouse, au lieu et place d'une autre batie anciennement et depuis peu devenue interdite par raison d'incendie, nous avons descendus en ladite chapelle, l'avons trouvée en bon ordre, garnie d'ornements propres et, d'ailleurs, duement fondée tant pour desservir la fondation de la chapellenie dudit château ; Vu aussi la permission de bénir ladite chapelle, lesdittes commission et permission données par Monseigneur l'Evêque de St Malo, à Rennes, pendant le cours des Etats de la Province de Bretagne le seize du présent mois et an présent signé Antoine Jos. évêque de St Malo. Avons fait la bénédiction de laditte chapelle dédiée à Dieu, au nom et sous l'invocation de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de Jesus Christ, notre Sauveur et avons observé les cérémonies prescrites dans le rituel romain en présence de Madame de Montmuran et plusieurs autres, assisté de Messieurs Joseph Marie Sevin, prêtre curé de la Beaussaine, de Toussaint Marie Duchesne, curé de St Brieuc, de Joseph Brechard, prêtre des Iffs, Jan Dollivet desservant ladite chapelle, prêtre de Cardroc, qui tous ont signé avec nous, ce vingt huit novembre mil sept cent soixante dix ».
Bénédiction de la cloche de la chapelle du château, 1770. — « Je certifie avoir fait la bénédiction de la cloche nouvellement fondue pour servir à la chapelle du château de Montmuran en conséquence de la permission me donnée par Monseigneur l'Evêque de St Malo, en datte à Rennes le vingt quatre novembre 1770, signée Antoine Jos, Evêque de St Malo, et avons fait laditte bénédiction conformément aux cérémonies du rituel Romain ; ladite cloche nommée par Madame de Montmuran qui luy a donné le nom de Marie, assisté par les soussignants, etc... » le même jour que la bénédiction de la chapelle.
Reliques, 1780. — Transport en cérémonie le 20 août 1780, par le clergé des Iffs, de la chapelle de Montmuran où il était venu les chercher, à l'église des Iffs, des reliques de St François de Salles et de Sainte Jeanne Françoise Fremyot de Chantal obtenues par M. le comte et Mme la comtesse de Montmuran. Ces reliques étaient renfermées dans une boite d'ivoire entourée d'un ruban vert et accompagnées de l'authentique de Rennes en date du 20 février 1752.
Enfeu pour Me Louis Le Lièvre, 1636. — Le 18 avril messire Gaspard de Coligny, seigneur de Chatillon, Tinteniac et Montmuran accorde à Ecuyer Louis Le Lièvre, Sénéchal de Hédé, qui venait d'acquérir la terre de la Boscheraye, aux Iffs, le droit de « mettre un banc et d'avoir un enfeu dans l'église des Iffs, dans la chapelle au coté Midi, pour leur servir à entendre le service divin, à lui et à ses successeurs, seigneurs de la Boscheraye, et à être inhumé sous ledit enfeu qui sera à rez de terre, à condition qu'il relèvera pour cela de la seigneurie de Tinteniac et rendra aveu comme il relève et rend aveu pour les autres terres et juridiction de la Boscheraye. » (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine. 9 G, 21).
Il n'existe ni plan (qui, peul-être, ne serait pas difficile à rétablir) ni description du Château de Montmuran. Tout ce que nous savons se résume dans les quelques renseignements trouvés dans le procès-verbal de mise en possession. Ce n'était plus, à cette époque, le château fort des Laval. Toutes les courtines avaient été démolies et il ne restait que quelques tours, celle ou se trouvait l'entrée, et celle au Nord à laquelle s'appuyait l'aile contenant la nouvelle chapelle, reliées entre elles par un bâtiment neuf qui servait à l'habitation. Nous croyons devoir, pour donner une idée de ce qu'il était au moment où il fut confisqué par la Révolution, transcrire ici le procès-verbal, si succinct qu'il soit, qui en fut fait alors :
Procès-verbal d'estimation de la retenue de Montmuran, 15 germinal an II.
« Nous... nous sommes transportés sur le bien national appellé la Retenue de Montmuran, situé dans la municipalité des Iffs et autres, provenant de l'émigré Joseph-Marie de la Motte, cy-devant privilégié, autrement noble, lequel est affermé au citoyen Julien Aubrée pour le prix annuel de 1115 livres.
Batiments d'habitation.
La principale maison ou nouveau
bâtiment consistant dans une cuisine, vestibule, office, sallon, salle, chambre
à coucher, un petit cabinet à côté, une petite chambre au-dessus.
Au premier étage : un corridor, cinq chambres et quatre cabinets, grenier sur le tout.
Cave sous la cuisine, un caveau au bout.
Au bout Nord, à côté de la principale maison, une chapelle, deux chambres au-dessus formant une aile. Cour sablée, une autre cour au-dessous.
Au bout vers Midi de ladite maison, une grande tour avec donjons ; au bout vers Nord une autre grande tour ; dans lesquelles tours il y a plusieurs beaux appartements. Lesquelles tours pourraient, en vertu des decrets, être, en partie, susceptibles de démolition ».
(Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine Q. 96 (n° provisoire) — Communication de M. Parfouru, archiuiste).
Nous ne parlons pas des bâtiments d'exploitation qui existent encore.
A côté de ces tours qui subsistent toujours, on peut reconnaître par le dessèchement, chaque été, des gazons qui la recouvre, au S. E. de celle dite du Midi, l'emplacement d'une troisième rasée jusqu'au sol.
(A. Anne Duportal).
© Copyright - Tous droits réservés.