|
Bienvenue chez les Irodouëriens |
IRODOUER |
Retour page d'accueil Retour Canton de Bécherel
La commune
de Irodouër ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de IRODOUER
Irodouër vient de la famille Irodouër.
Irodouër semble être un démembrement de la paroisse de Miniac. La paroisse d'Irodouër est mentionnée pour la première fois en 1123 sous l'appellation "Irodor". Donoal ou Donoald, évêque d'Alet (Saint-Malo) fait alors don aux moines du couvent de Saint-Melaine de Rennes, de l'église Saint-Pierre d'Irodouër. La paroisse d'Irodouër dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. La maison seigneuriale d'Irodouër était le Plessis-Giffart.
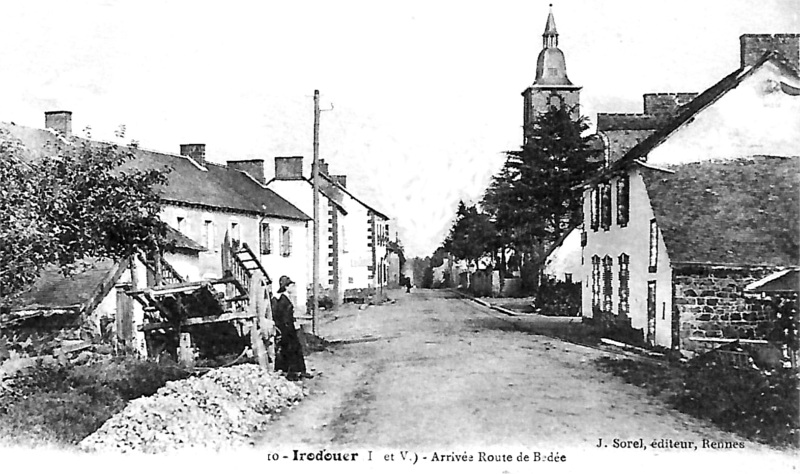
L'an 1123, Donoald, évêque d'Aleth, se trouvant à Rennes, au couvent de Saint-Melaine, donna aux moines de cette abbaye l'église de Saint-Pierre d'Irodouër, « ecclesiam Sancti Petri de Isrodor », sauf tous les droits épiscopaux. Il accorda en même temps à l'abbé de Saint-Melaine le privilège de lui présenter le recteur d'Irodouër, et il investit cet abbé par le livre des Evangiles, sur lequel le prélat et son archidiacre jurèrent de maintenir cette donation (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 169). Plus tard, le pape Luce III confirma, en 1185, Gervais, abbé de Saint-Melaine, dans la possession des églises d'Irodouër, « ecclesias de Irrodor ». Vers le même temps, une contestation s'éleva entre Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, et les Bénédictins de Saint-Melaine, au sujet du recteur ou chapelain d'Irodouër et des revenus de son église ; les parties se soumirent au jugement d'Anger, abbé de Saint-Serge, d'Herbert, archidiacre d'Angers, et de Gilbert, chantre de la même église, qui réglèrent ce qui suit en 1187, à Angers même : L'abbé et les moines de Saint-Melaine, renonçant à la présentation du recteur d'Irodouër, la nomination de celui-ci appartiendra désormais à l'évêque de Saint-Malo et à ses successeurs ; les religieux de Saint-Melaine continueront toutefois de recevoir à Irodouër la part qui leur appartient dans les dîmes et dans les oblations de cette église ; le chapelain ou recteur nouvellement institué prêtera serment devant l'évêque de Saint-Malo et en présence de l'abbé de Saint-Melaine de fournir aux moines ce qui leur est dû à Irodouër (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 185). La portion de dîmes et d'oblations à laquelle avaient droit les religieux de Saint-Melaine n'étant point déterminée dans cet acte, de nouvelles difficultés s'élevèrent à ce sujet ; cette fois, Pierre Giraud et l'abbé de Saint-Melaine prirent pour arbitre Herbert, évêque de Rennes de 1184 à 1198, qui rendit la sentence suivante : Désormais tout chapelain ou recteur pourvu de la cure d'Irodouër devra, avant d'en prendre possession, prêter serment, devant l'évêque de Saint-Malo et l'abbé de Saint-Melaine réunis, de fournir exactement aux moines de Saint-Melaine 3 quartiers de froment à la mesure d'Irodouër, quelle qu'elle soit, livrables à la Nativité de la Vierge, et de leur abandonner la moitié des offrandes faites à Noël et à Pâques dans l'église d'Irodouër (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 185). Les Bénédictins de Saint-Melaine unirent ce qu'ils avaient à Irodouër à leur prieuré de Miniac, et ce dernier établissement ayant été supprimé en 1411, ils abandonnèrent leurs droits au recteur de Miniac, qui recevait encore chaque année, avant la Révolution, 4.8 boisseaux de froment, dus le 2 novembre par le recteur d'Irodouër. Le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) nous apprend qu'à cette époque le recteur d'Irodouër levait un tiers des dîmes de sa paroisse et que les deux autres étaient partagés entre divers gentilshommes. Le recteur Jean Rastel déclara en 1790 cependant qu'il dîmait alors « à la trente-sixième gerbe dans toute sa paroisse, divisée en cinq traits nommés le Val, la Haye, la Chapelle, les Bois-Millon et la Garenne ». Il affermait les trois premiers traits 1 311 livres, et il estimait 900 livres les deux autres traits où il recueillait lui-même; c'était donc un total de 2 211 livres de revenu brut. Mais il avait 834 livres de charges, savoir : 48 boisseaux de froment dus au recteur de Miniac-sous-Bécherel, estimés 226 livres ; décimes et droits synodaux, 133 livres ; pension d'un vicaire, 350 livres , et entretien du chanceau et du presbytère, 125 livres ; de sorte qu'il ne lui restait que 1 377 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29, et Pouillé de Rennes).

Lorsque vers 1152 fut fondée l'abbaye de Montfort, Geoffroy, fils d'Ulric, donna à ce nouveau monastère la terre de la Chapelle, en Irodouër, « in Irrodoir terram Capell » (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 614). Les chanoines réguliers de Montfort avaient encore en 1679 un bailliage dans la paroisse d'Irodouër. C'est peut-être là l'origine des maisons nobles des Chapelles-Valoyses et des Chapelles-Mauvoisin, signalées en Irodouër en 1513. Ces terres tiraient vraisemblablement leur nom d'anciens sanctuaires disparus depuis bien des siècles (Pouillé de Rennes).
On rencontre les appellations suivantes : Isrodor (en 1123), Irrodor (en 1185), Irrodoir (en 1187), Errodoer (en 1250), Yrodouez (en 1513).
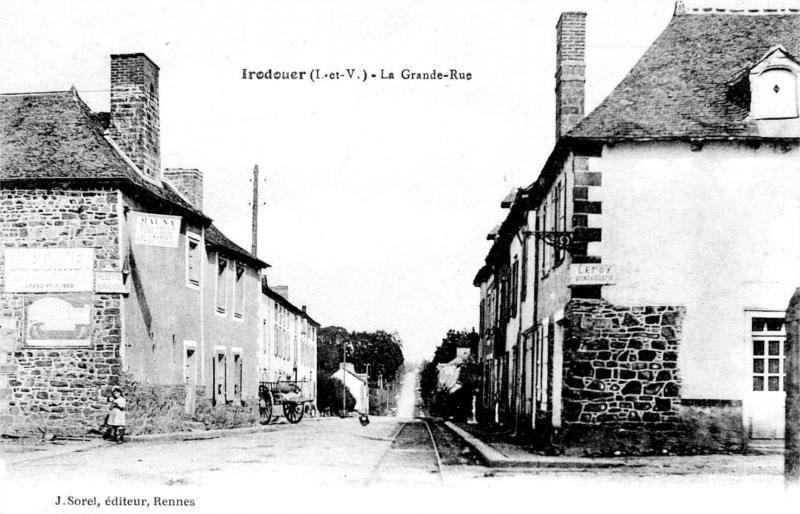
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Irodouër : Geffroy Michel (« Gaufridus Michaelis persona de Errodoer » en 1250). Thomas Faverel (résigna en faveur du suivant). René Le Vayer (prit possession le 22 novembre 1609 ; il fut aussi prieur de la Lande, en Bruc ; décédé vers 1626). Claude Gérault (résigna vers 1627). Jean Breillet (prit possession le 27 juin 1627). René Le Songeur (résigna vers 1634). Jean Le Chapelier (fut pourvu le 21 février 1634). Robert Rousson (prêtre du Mans, résigna en faveur du suivant). Jacques Le Maire (prêtre de Séez, fut pourvu en Cour de Rome et prit possession le 11 novembre 1641). N... de la Fosse (décédé vers 1687). Sébastien-Joseph de Faramus de Trahideuc (chanoine de Saint-Malo, fut pourvu le 26 avril 1687). Georges-Alexis Becdelièvre du Bouëxic, (décédé en 1699). Philippe Thobye (fut pourvu le 9 septembre 1699 ; décédé en 1713). Claude Le Quémener (fut pourvu le 17 juin 1713 ; décédé en 1719). Augustin de la Pommeraye de Kerambar (pourvu le 23 août 1719, était en 1730 syndic du clergé du diocèse ; décédé en 1750). François de la Fosse (fut pourvu le 4 octobre 1750 ; décédé en 1757). Jean Eveillard (fut pourvu le 26 octobre 1757 ; décédé en 1778). Simon Rolland (fut pourvu le 2 mai 1778 ; décédé le 4 mai 1784). Pierre-Marie Launay (pourvu le 23 juin 1784, ne prit point possession). Julien Rastel (pourvu le 8 juillet 1784, gouverna jusqu'à la Révolution, émigra et fut réinstallé en 1803 ; décédé en 1818). Louis Genestay (1818-1860). François Gougeon (1860, décédé en 1870). Frédéric Lefeuvre (1870-1880). Victor Derennes (à partir de 1880), ....
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances d'Irodouër en 1789
".
"
Le
cahier de doléances d'Irodouër en 1789
".

![]()
PATRIMOINE de IRODOUER
![]() l'église
Saint-Pierre (1826-1827), édifiée à l'emplacement de l'ancien sanctuaire
qui datait du Moyen Age : elle conserve un retable à baldaquin. On ne voit
plus rien de l'ancienne église Saint-Pierre d'Irodouër, mentionnée, comme
nous l'avons vu, dès l'an 1123. Elle a été remplacée en 1827 par un
vaste édifice à trois nefs, avec ouvertures en plein cintre. Les seigneurs
de Montfort, de qui relevaient les plus importants manoirs d'Irodouër, étaient
originairement regardés comme seigneurs supérieurs dans l'église d'Irodouër,
et en 1682 M. Ferron de Villandon, seigneur du Quengo, prétendait avoir
acquis leurs droits de « supériorité, fondation et prééminence »
en cette église. Mais, au XVIIIème siècle, M. du Bouëxic de Pinieuc était
réellement le seigneur de la paroisse, à cause de son antique seigneurie
du Plessix-Giffart, à laquelle, dit Du Paz, étaient attachés « les prééminences
en l'église d'Irodouër, les intersignes et écussons en la grande vitre et
autres, lisière et ceinture à l'entour de ladite église, dedans et
dehors, armoiée de leurs armes, avec enfeu prohibitif au chanceau, tombeaux
armoiez de leurs armes, épitaphes et superscrigtions et toutes marques de
supériorité » (Histoire généalogique de Bretagne, 680). La confrérie
du Rosaire était érigée au XVIIIème siècle dans l'église d'Irodouër,
et l'on y desservait un certain nombre de fondations, entre autres celle
d'une messe matinale chaque dimanche. Le maître-autel, oeuvre d'Alexis Commereuc, date de 1844. La chaire date de 1840 ;
l'église
Saint-Pierre (1826-1827), édifiée à l'emplacement de l'ancien sanctuaire
qui datait du Moyen Age : elle conserve un retable à baldaquin. On ne voit
plus rien de l'ancienne église Saint-Pierre d'Irodouër, mentionnée, comme
nous l'avons vu, dès l'an 1123. Elle a été remplacée en 1827 par un
vaste édifice à trois nefs, avec ouvertures en plein cintre. Les seigneurs
de Montfort, de qui relevaient les plus importants manoirs d'Irodouër, étaient
originairement regardés comme seigneurs supérieurs dans l'église d'Irodouër,
et en 1682 M. Ferron de Villandon, seigneur du Quengo, prétendait avoir
acquis leurs droits de « supériorité, fondation et prééminence »
en cette église. Mais, au XVIIIème siècle, M. du Bouëxic de Pinieuc était
réellement le seigneur de la paroisse, à cause de son antique seigneurie
du Plessix-Giffart, à laquelle, dit Du Paz, étaient attachés « les prééminences
en l'église d'Irodouër, les intersignes et écussons en la grande vitre et
autres, lisière et ceinture à l'entour de ladite église, dedans et
dehors, armoiée de leurs armes, avec enfeu prohibitif au chanceau, tombeaux
armoiez de leurs armes, épitaphes et superscrigtions et toutes marques de
supériorité » (Histoire généalogique de Bretagne, 680). La confrérie
du Rosaire était érigée au XVIIIème siècle dans l'église d'Irodouër,
et l'on y desservait un certain nombre de fondations, entre autres celle
d'une messe matinale chaque dimanche. Le maître-autel, oeuvre d'Alexis Commereuc, date de 1844. La chaire date de 1840 ;


![]() la
croix (XIVème siècle), située à Villeneuve ;
la
croix (XIVème siècle), située à Villeneuve ;
![]() la
croix (1862), située au lieu-dit La Cardière ;
la
croix (1862), située au lieu-dit La Cardière ;
![]() le
château du Quengo (XVI-XVIIIème siècle), situé route de Romillé. Assiégé et incendié durant les guerres de la
Ligue, il est reconstruit vers 1830. On y trouve deux écussons du XVIème
siècle aux armes de la famille de la Haye. La chapelle actuelle remplace
une chapelle plus ancienne : la porte d'entrée (XV-XVIème siècle) est
celle de l'ancien manoir de Villeneuve et on y voit les armes de la famille
Fournier, seigneurs de Trélo. Propriété de Bertrand de La Haye en 1480. Propriété successive des familles de la
Haye (en 1513), de Ferron (en 1682 et au XVIIIème siècle), Botherel (XIXème
siècle), du Crest de Lorgerie (au XXème siècle) ;
le
château du Quengo (XVI-XVIIIème siècle), situé route de Romillé. Assiégé et incendié durant les guerres de la
Ligue, il est reconstruit vers 1830. On y trouve deux écussons du XVIème
siècle aux armes de la famille de la Haye. La chapelle actuelle remplace
une chapelle plus ancienne : la porte d'entrée (XV-XVIème siècle) est
celle de l'ancien manoir de Villeneuve et on y voit les armes de la famille
Fournier, seigneurs de Trélo. Propriété de Bertrand de La Haye en 1480. Propriété successive des familles de la
Haye (en 1513), de Ferron (en 1682 et au XVIIIème siècle), Botherel (XIXème
siècle), du Crest de Lorgerie (au XXème siècle) ;

![]() la
chapelle du château de Quengo (XVIIème siècle) ;
la
chapelle du château de Quengo (XVIIème siècle) ;
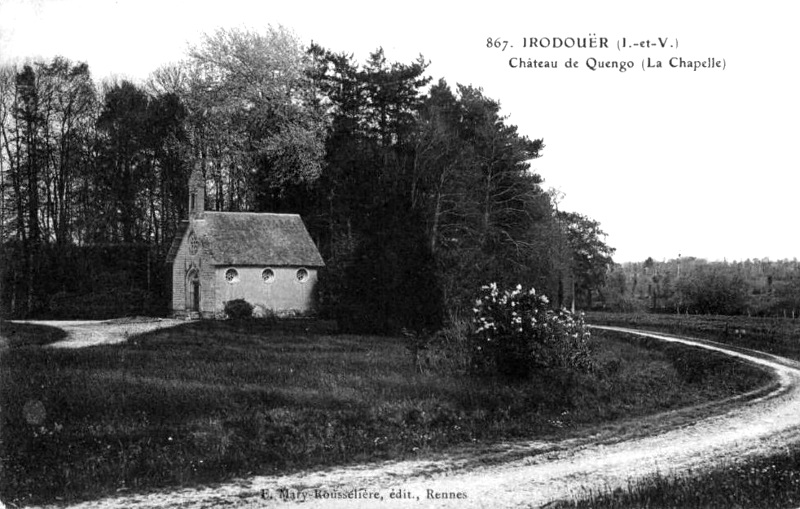
![]() le
château de la Ville-au-Sénéchal (XVIIème siècle), situé route de Bécherel.
Il possédait jadis une chapelle démolie en 1827. La chapelle de la
Ville-au-Sénéchal dépendait de ce manoir, appartenant en 1513 à Pierre
d'Irodouër. En 1774, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-au-Sénéchal,
présenta François Demay pour desservir cette chapellenie, unie alors à
celle de la Ville-Lieu, en place de Julien Poulnay, décédé (Pouillé de Rennes). Il n'a été conservé
qu'un bénitier et une pierre tombale gravée des armes des de la Forest. La Ville-au-Sénéchal
avait un droit de haute justice. Propriété de Guillaume d'Irodouër
en 1480. Propriété successive des familles Irodouër
(en 1513), Martin (en 1645), la Forest (en 1670) ;
le
château de la Ville-au-Sénéchal (XVIIème siècle), situé route de Bécherel.
Il possédait jadis une chapelle démolie en 1827. La chapelle de la
Ville-au-Sénéchal dépendait de ce manoir, appartenant en 1513 à Pierre
d'Irodouër. En 1774, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-au-Sénéchal,
présenta François Demay pour desservir cette chapellenie, unie alors à
celle de la Ville-Lieu, en place de Julien Poulnay, décédé (Pouillé de Rennes). Il n'a été conservé
qu'un bénitier et une pierre tombale gravée des armes des de la Forest. La Ville-au-Sénéchal
avait un droit de haute justice. Propriété de Guillaume d'Irodouër
en 1480. Propriété successive des familles Irodouër
(en 1513), Martin (en 1645), la Forest (en 1670) ;

![]() 5 moulins
dont les moulins à eau du Plessix-Giffard, de la Roche, de Rabaté, de Bouvet, de Quengo ;
5 moulins
dont les moulins à eau du Plessix-Giffard, de la Roche, de Rabaté, de Bouvet, de Quengo ;
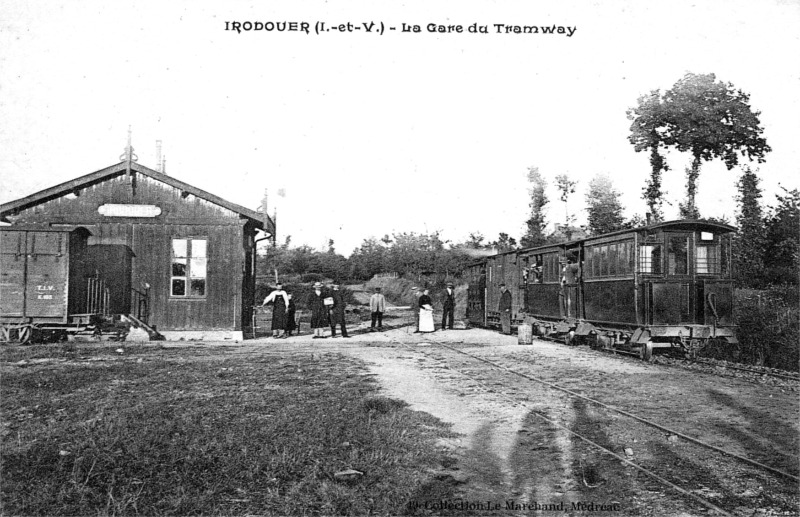
A signaler aussi :
![]() l'ancien
manoir du Plessis-Giffart, situé route de Bécherel. Il avait un droit de
haute justice. Propriété successive des familles Giffart (en 1471), la
Marzelière (en 1513), du Bouëxic (au XVIIIème siècle). Propriété d'Olivier Giffart en 1480 ;
l'ancien
manoir du Plessis-Giffart, situé route de Bécherel. Il avait un droit de
haute justice. Propriété successive des familles Giffart (en 1471), la
Marzelière (en 1513), du Bouëxic (au XVIIIème siècle). Propriété d'Olivier Giffart en 1480 ;
![]() l'ancien
manoir du Pont de Nieul. Propriété de l'abbé de Paille-Levé (Pailvé) au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir du Pont de Nieul. Propriété de l'abbé de Paille-Levé (Pailvé) au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de Rigour. Propriété de la famille la Chapelle, seigneurs de Trégomain en 1513 ;
l'ancien
manoir de Rigour. Propriété de la famille la Chapelle, seigneurs de Trégomain en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Boisjean. Propriété de la famille Ginguené au XIVème siècle ;
l'ancien
manoir du Boisjean. Propriété de la famille Ginguené au XIVème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de la Noë, situé route de Romillé. Propriété de la famille
Urceau, puis des familles Chefdemail et Fourni (en 1513) ;
l'ancien
manoir de la Noë, situé route de Romillé. Propriété de la famille
Urceau, puis des familles Chefdemail et Fourni (en 1513) ;
![]() l'ancien
manoir du Clos-Bossart, situé route de Romillé. Propriété de la famille
Giffart-Mauvoysin en 1513 ;
l'ancien
manoir du Clos-Bossart, situé route de Romillé. Propriété de la famille
Giffart-Mauvoysin en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir des Chapelles-Mauvoysin, situé route de Bédée. Propriété
successive des familles Mauvoysin (en 1513). Les Chapelles-Valoyses, situées
dans le voisinage, appartenaient à la famille Bourgneuf, puis à la famille
Vaucouleur de Lanjamet (en 1513) ;
l'ancien
manoir des Chapelles-Mauvoysin, situé route de Bédée. Propriété
successive des familles Mauvoysin (en 1513). Les Chapelles-Valoyses, situées
dans le voisinage, appartenaient à la famille Bourgneuf, puis à la famille
Vaucouleur de Lanjamet (en 1513) ;
![]() l'ancien
manoir du Breil-Rond, situé route de Bédée. Propriété de la famille
Breil en 1370 et en 1513 ;
l'ancien
manoir du Breil-Rond, situé route de Bédée. Propriété de la famille
Breil en 1370 et en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Chaussonnière, situé route de Bédée. Propriété de la
famille de la Haye en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Chaussonnière, situé route de Bédée. Propriété de la
famille de la Haye en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Frost ou du Frau. Propriété de la famille Frost (en 1460), puis
de la famille Mauvoysin (en 1513) ;
l'ancien
manoir du Frost ou du Frau. Propriété de la famille Frost (en 1460), puis
de la famille Mauvoysin (en 1513) ;
![]() l'ancienne
Chapelle de l'Aubaudière, située route de Bédée. Elle était frairienne.
La chapelle de l'Aubaudière était fondée d'une messe pour tous les
dimanches. En 1790, elle avait 60 livres de rente, consistant en terres
sises autour du village de l'Aubaudière ; ces terres relevaient des
seigneuries du Plessix-Giffart et du Lou à devoir de 30 sols de rente féodale
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29) ;
l'ancienne
Chapelle de l'Aubaudière, située route de Bédée. Elle était frairienne.
La chapelle de l'Aubaudière était fondée d'une messe pour tous les
dimanches. En 1790, elle avait 60 livres de rente, consistant en terres
sises autour du village de l'Aubaudière ; ces terres relevaient des
seigneuries du Plessix-Giffart et du Lou à devoir de 30 sols de rente féodale
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29) ;
![]() l'ancien
manoir de la Ville-Lieu, situé route de Bédée. En 1513, Joachim Le Gac,
fils de Jehan Le Gac, sieur de Pontelain, possédait la maison noble de la
Ville-Lieu. C'est probablement à l'un ou l'autre de ces seigneurs qu'est
due la fondation de la chapellenie de la Ville-Lieu, « fondée, est-il
dit en 1699, de trois messes par semaine, par les seigneurs de Pontelain ».
Dès 1563, en effet, Amaury Blanchet fut pourvu de ce bénéfice en place de
Jean de Burond, décédé ; Pierre Callouet en 1698, et Jean de l'Espinay en
1699, lui succédèrent, ce dernier présenté par Jeanne de la Provoté,
femme de Jacques de l'Espinay, habitant le manoir de Pontelain, en Landujan.
En 1719, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-Lieu, présenta à François
de la Fosse cette chapellenie. En 1790, les deux fondations unies de la
Ville-au-Sénéchal et de la Ville-Lieu valaient 252 livres de rente
(Archives départementales d'Ille-et-Vlaine, 1 V, 29, et Registre des
insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille
le Gac, seigneurs de Pontelain (en 1513) et de la famille la Forest (en 1719) ;
l'ancien
manoir de la Ville-Lieu, situé route de Bédée. En 1513, Joachim Le Gac,
fils de Jehan Le Gac, sieur de Pontelain, possédait la maison noble de la
Ville-Lieu. C'est probablement à l'un ou l'autre de ces seigneurs qu'est
due la fondation de la chapellenie de la Ville-Lieu, « fondée, est-il
dit en 1699, de trois messes par semaine, par les seigneurs de Pontelain ».
Dès 1563, en effet, Amaury Blanchet fut pourvu de ce bénéfice en place de
Jean de Burond, décédé ; Pierre Callouet en 1698, et Jean de l'Espinay en
1699, lui succédèrent, ce dernier présenté par Jeanne de la Provoté,
femme de Jacques de l'Espinay, habitant le manoir de Pontelain, en Landujan.
En 1719, Louis de la Forest, seigneur de la Ville-Lieu, présenta à François
de la Fosse cette chapellenie. En 1790, les deux fondations unies de la
Ville-au-Sénéchal et de la Ville-Lieu valaient 252 livres de rente
(Archives départementales d'Ille-et-Vlaine, 1 V, 29, et Registre des
insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille
le Gac, seigneurs de Pontelain (en 1513) et de la famille la Forest (en 1719) ;
![]() l'ancien
manoir de Villeneuve, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété du
Contôleur de Rennes (en 1513), puis des familles Trogoff (au XVIIIème siècle)
et Ferron (au XIXème siècle) ;
l'ancien
manoir de Villeneuve, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété du
Contôleur de Rennes (en 1513), puis des familles Trogoff (au XVIIIème siècle)
et Ferron (au XIXème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir de l'Hôpital, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété de
la famille Raymond en 1513 ;
l'ancien
manoir de l'Hôpital, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété de
la famille Raymond en 1513 ;
![]() l'ancienne
Chapelle de l'Aubriotière, située route de Montauban-de-Bretagne. La
chapelle de l'Aubriotière, située au village de ce nom, dépendait à
l'origine du prieur de Saint-Lazare de Montfort, mais au XVIIIème siècle
elle était considérée comme frairienne. Elle était desservie en 1790 par
Jean Maudet, qui jouissait d'un revenu de 30 livres pour deux messes
hebdomadaires dues le dimanche et le vendredi. Les terres formant le fonds
de cette chapellenie relevaient toutefois encore de Saint-Lazare à devoir
de 2 livres 12 sols de rente (Pouillé de Rennes) ;
l'ancienne
Chapelle de l'Aubriotière, située route de Montauban-de-Bretagne. La
chapelle de l'Aubriotière, située au village de ce nom, dépendait à
l'origine du prieur de Saint-Lazare de Montfort, mais au XVIIIème siècle
elle était considérée comme frairienne. Elle était desservie en 1790 par
Jean Maudet, qui jouissait d'un revenu de 30 livres pour deux messes
hebdomadaires dues le dimanche et le vendredi. Les terres formant le fonds
de cette chapellenie relevaient toutefois encore de Saint-Lazare à devoir
de 2 livres 12 sols de rente (Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancien
manoir de Bouvet, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite de
Goulaine (en 1513), puis des familles Sesmaisons (en 1566) et Botherel (au XVIIIème siècle) ;
l'ancien
manoir de Bouvet, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite de
Goulaine (en 1513), puis des familles Sesmaisons (en 1566) et Botherel (au XVIIIème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir de la Garenne, situé route de Landujan. Il possédait jadis une
chapelle privée. La chapelle de la Garenne était bâtie auprès du manoir
de ce nom. Par acte du 20 mars 1645, Guy Martin et Julienne de Launay,
seigneur et dame de la Ville-au-Sénéchal et de la Boultrie, y fondèrent
une messe pour tous les dimanches ; cette fondation fut approuvée par l'évêque
le 30 mai 1653. Louis de la Forest, seigneur des Chapelles et de la Ville-au-Sénéchal,
présenta en 1706 Joseph Broc pour la desservir ; mais en 1790 le service de
cette chapellenie, ayant alors 54 livres de rente, se faisait à l'église
(Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Mauvoysin en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Garenne, situé route de Landujan. Il possédait jadis une
chapelle privée. La chapelle de la Garenne était bâtie auprès du manoir
de ce nom. Par acte du 20 mars 1645, Guy Martin et Julienne de Launay,
seigneur et dame de la Ville-au-Sénéchal et de la Boultrie, y fondèrent
une messe pour tous les dimanches ; cette fondation fut approuvée par l'évêque
le 30 mai 1653. Louis de la Forest, seigneur des Chapelles et de la Ville-au-Sénéchal,
présenta en 1706 Joseph Broc pour la desservir ; mais en 1790 le service de
cette chapellenie, ayant alors 54 livres de rente, se faisait à l'église
(Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Mauvoysin en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Launay, situé route de Landjan. Propriété de la famille de
Beaulieu (en 1513) ;
l'ancien
manoir de Launay, situé route de Landjan. Propriété de la famille de
Beaulieu (en 1513) ;
![]() l'ancien
manoir de la Chauverais, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite
de Goulaine, dame de Bouvet (en 1513) ;
l'ancien
manoir de la Chauverais, situé route de Landujan. Propriété de Marguerite
de Goulaine, dame de Bouvet (en 1513) ;
![]() l'ancien
manoir de Carouët, situé route de Landujan. Propriété de la famille de
la Houssaye (en 1513) ;
l'ancien
manoir de Carouët, situé route de Landujan. Propriété de la famille de
la Houssaye (en 1513) ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de IRODOUER
Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 17 nobles de Irodouër :
![]() Guillaume
d'YRODOUER de Villausénéchal (40 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;
Guillaume
d'YRODOUER de Villausénéchal (40 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;
![]() Guillaume
d'YRODOUER de la Palleraye (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
Guillaume
d'YRODOUER de la Palleraye (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
![]() Raoul
d'YRODOUER de la Pruparaye : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
Raoul
d'YRODOUER de la Pruparaye : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
![]() Olivier
DE BRERONT de Breront (120 livres de revenu), capitaine de Combourg en 1484 : défaillant ;
Olivier
DE BRERONT de Breront (120 livres de revenu), capitaine de Combourg en 1484 : défaillant ;
![]() Olivier
DE BRERONT de la Garaine (60 livres de revenu) : défaillant ;
Olivier
DE BRERONT de la Garaine (60 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Bertrand
DE LA HAYE du Quengo (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
Bertrand
DE LA HAYE du Quengo (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
![]() Jehan
DE LA HAYE de la Chaussonnière (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
Jehan
DE LA HAYE de la Chaussonnière (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
![]() Pierre
DE LOURME (10 livre de revenu) : défaillant ;
Pierre
DE LOURME (10 livre de revenu) : défaillant ;
![]() Pierre
DE PARTENAY (20 livres de revenu), notaire en 1473 : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
Pierre
DE PARTENAY (20 livres de revenu), notaire en 1473 : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
![]() Jehan
DE QUEBRIAC des Chapelles (300 livres de revenu) : défaillant ;
Jehan
DE QUEBRIAC des Chapelles (300 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Guyon
DU FROST (160 livres de revenu) : à pied ;
Guyon
DU FROST (160 livres de revenu) : à pied ;
![]() Edouard
FOURNIER (10 livres de revenu) : défaillant ;
Edouard
FOURNIER (10 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Olivier
GIFFART de Plessis-Giffart (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
Olivier
GIFFART de Plessis-Giffart (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
![]() Bertrand
MAUVOISIN (50 livres de revenu) : défaillant ;
Bertrand
MAUVOISIN (50 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Jehan
RESMONT de l'Hôpital (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
Jehan
RESMONT de l'Hôpital (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
![]() Bertrand
THOMAS (15 livres de revenu) : défaillant ;
Bertrand
THOMAS (15 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Jehan
URSEAN de la Noë (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
Jehan
URSEAN de la Noë (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Irodouez (Irodouër) les nobles suivants : - Noble dame Marie de Berneant, veuve de feu Messire Artur de la Marzelière, tient les maison, manoir, terres, etc., du Plessis-Giffart, qu'a possédés led. feu Artur et avant luy Olivier Giffart, noblement et de toute ancienneté, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Pierre d'Irodouez, sieur de la Ville-au-Senechal, possède led. lieu de la Ville-au-Senechal, que possédait feu Guillaume d'Irodouez, prédécesseur dud. Pierre, et n'y sont nulles rotures adjointes, excepté quelques prairies. - Guillaume de la Chapelle et sa femme, sieur et dame de Tregomnain, ont, pour cause d'elle, les maisons, terre et domaine de Rigou, qui a toujours été tenu noblement, et y sont adjointes quelques rotures. - Gilles de Beaulieu, sieur de Beaulieu, tient les maisons, terre et métairie de Launay-de-Blouayes, qui ont toujours été tenues noblement, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Marguerite de Goulainne, dame du lieu de Bonnet, tient la maison, domaine et métairie de la Chameraye et la met. (métairie) dud. lieu de Bonnet, qui ont toujours été tenus et possédés noblement. - Simon de St Pern, sr. de Ligouyer, de la paroisse de St Pern, tient noblement le lieu et métairie de Louaeselière, et y sont environ quatre journaux de roture adjoints ; tient de plus le lieu dit le Clos-Chouannière ; le Clos-au-Couaints, contient environ cinq journaux, qui sont rot. (rotures) et contributifs. - François de Vaucouleur et Gilette de Bourgneuf, sa femme, sieur et dame de Lanjamet, ont, à cause d'elle, les maisons, terres et domaines des Chapelles-Valoyses, qui ont toujours été tenues noblement. - Jehan Mauvoysin et Jeane Tirecocq, sa mère, tiennent les maisons, terres et héritages des Chapelles-Mauvoisin, qui ont toujours été tenues noblement, fors (excepté) quelques rotures que feu Guillaume Mauvoisin, père dudit Jehan, acquit environ cinq journaux de terres roturières et contributives ; ont de plus lesd. Mauvoisin et sa mère les maison, terre et domaine de Clos-Boussart, qui furent autrefois à feu Robert Giffart, et sont nobles d'ancienneté, sans nulle adjonction de roture. - Ont de plus les mêmes, les maison, terre et domaine de la Garenne, noble d'ancienneté, et y sont quelques rotures adjointes par led. défunt. - Jehan du Frots, a les maisons, terres et domaine du lieu du Frots, et la métairie du Hellan, noble et tenues toujours noblement, et n'y a été adjointe aucune acquisition roturière. - Bertrand de la Haye, sieur de Quengou a les maisons, terres et domaines de Quengouz, nobles d'ancienneté, et y sont environ trois journeaux de roture adjoints. - Messire François de Breront, possède le lieu, maison, domaine, manoir, etc., de Breront, noble de toute ancienneté, sans nulle adjonction roturière. - Plus a le lieu et métairie du Clos, noble, fors (excepté) que feu Olivier de Breront et dom Guy de Breront, ses prédécesseurs, ont acquis environ dix journaux de terre contributive. - Pierre Dirodouer, sr. de la Pasleraye, a la maison, terres et domaine dud. lieu, noble d'ancienneté, fors (excepté) que feu Charles d'Irodouer, père de Pierre de présent et feu dom Guillaume d'Yrodouer y ont adjoint quelques acquisitions roturières. - François de la Haye et Marie Guillou, veuve de feu Jehan de la Haye, père dudit François, ont la maison, terres et héritages de la Chaussonnière, et la maison et métairie du Fou, noble d'ancienneté, fors (excepté) quelques héritages rot. (roturières) acquis par ledit défunt et adjoints aux dites terres ; et a de plus led. François deux maisons au bourg, roturières et contributives. - Plus deux autres maisons au village de Lorillaye, contenant environ six journaux. - Bertrand Raysmont, sieur de l'Hopital, a les maisons, terres et domaine dudit lieu de l'Hopital, tenu toujours noblement, et y sont quelques rotures adjointes ; a de plus ledit sieur acquis des hoirs de feue Marie Raysmont, environ douze journaux, et autres héritages roturiers d'autres particuliers qui payaient fouage. - Jouachim Le Gac, fils Jehan Legac, sieur de Pontelan, a les maisons, terres, lieu et met. (métairie) de la Ville-Lieux, tenue et possédée noblement, et n'y sont nulles rotures adjointes, mais a ledit Jehan Legac, sieur de Pontelan, de la paroisse de Landugean, acquis ailleurs quelques rotures. - La maison et terre de Ville-Neuve, appartenant au controlleur de Rennes, et n'y sont nulles rotures adjointes, sauf quelques journeaux. - Jehan Cheff-de-Maill et Robine Urfean, sa femme, et les enfens de Jehan Fournier, comme héritiers de feue Domette Urfean, ont les terres, maison et métairie de Lanoë, noble de toute ancienneté, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Jehan Fournier, l'aîné, fils de feu Jehan Fournier, le jeune, sr. des Roches, est noble et d'extraction de noblesse, et a fait édifier deux maisons et une pièce de terre nommée les Vay..., qui était à noble homme Pierre de Partenay et ne savent si ledit lieu est noble ou non, mais y a joint plusieurs rotures. - Noble damoiselle Perrine de Partenay, mère dudit Fournier, est franche de sa personne, mais a deux maisons au bourg d'Irodouez, et quelques pièces d'héritages roturiers et contributifs. - Grant-Jehan Fournier, qui est noble et exempt et sert aux armes, a une maison nommée le Bignon, auprès du bourg d'Irodouez, et a acquis plusieurs héritages roturiers. - Julien du Partenay, sieur du Pré-Allain, a une maison et hébergement au bourg d'Irodouez, qui fut à Bertrand de la Haye, et est noble et exempte de toute contribution rot. (roturière), et y a adjoint quelques rotures, et est led. de Partenay noble de tous temps. - Pierre de St Gilles, de la paroisse de Roullet, noble personne et extraict de noblesse, franc et exempt, mais a acquis plusieurs rotures contributives. - Jehan Julianne, sieur du Moncel, comme garde des enfans de feu Thomas Julianne, a les maisons, terres et héritages du Frost-de-Bonnet, et y a joint plusieurs rotures dont il n'a rien payé pour ce qu'il disait être noble et exempt. - Raoul le Vayer et ses enfans, a les terres et héritages du lieu de la Peonpatraye, que feu M Raoul d'Irodouez eut et acquit de particuliers contributifs, et est tout roturier. - Jacquete de la Houssaye, fille feu Macé de la Houssaye et de Perrine de Partenay, a la maison, terres, vignes, jardins, etc., de Caurouet (Canrouet), contenant environ sept journaux qui furent à feu Jehan de Lorme, et ne savent si led. lieu est noble ou non. (H. Des Salles).
© Copyright - Tous droits réservés.