|
Bienvenue chez les Janséens |
JANS |
Retour page d'accueil Retour Canton de Derval
La commune
de Jans ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de JANS
Jans vient, semble-t-il, du nom Jehan.
Jans était autrefois le centre d'une importante châtellenie appartenant au duc de Bretagne. En 1294, cette châtellenie a pour seigneur Brient Le Bœuf, sire d'Issé, qui reconnaît alors devoir à cause d'elle 4 livres en derniers d'Ost au duc de Bretagne. Elle est donnée en 1333 par le duc Jean III à Jean de Rougé, sire de Derval (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, IIII, et 1359). Le sire de Jans est fondateur des églises de Jans et de Treffieux.
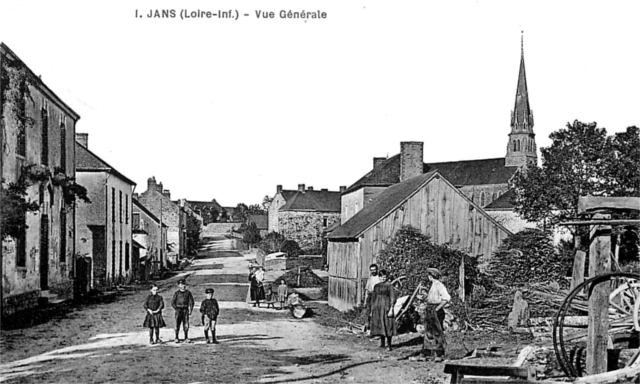
La châtellenie de Jans s'étendait jadis sur 5 paroisses : de Jans à Treffieux, Abbaretz, Nozay et Derval. La châtellenie de Jans est tenue chronologiquement par les familles Le Boeuf, Rieux (par mariage en 1235 de Nicole Le Boeuf et de Geoffroi de Rieux), Ambroise, Bretagne, Laval, Châteaugiron, Rieux, Laval, Montmorency (en 1543) et Bourbon-Condé (en 1632).
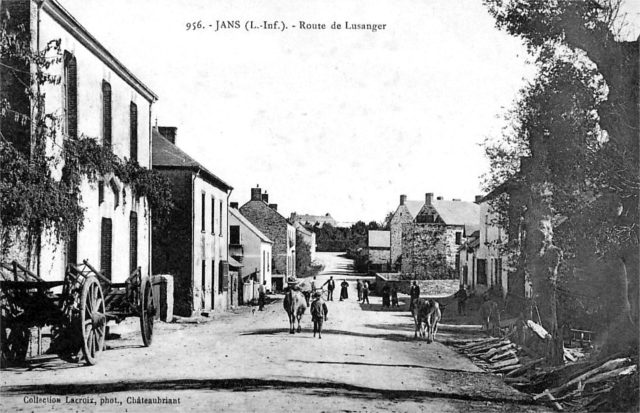
Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de Jans : J. B. Dugast et Auguste Ménard qui ont fait reconstruire l'église. L'abbé Gautier est originaire de Jans.
![]()
PATRIMOINE de JANS
![]() l'église
Saint-Julien et Saint-Dulcien (1868). Cette église remplace une église romane devenue trop petite.
A signaler que " le 12 ou 13 juin 1723, le feu ayant pris dans la
sacristie, a brûlé toute la charpente, les meubles et tous les ornements,
.... " (recteur Joussé). La statue de Saint Mathieu, provenant de la chapelle du Trépas, date du XVème
siècle. La statue de Saint Barthélemy, en bois polychrome et provenant de
la chapelle du Trépas, date du XVIIème siècle. La statue Saint Mathurin,
en bois polychrome et provenant de la chapelle du Trépas, date du XVIIIème
siècle ;
l'église
Saint-Julien et Saint-Dulcien (1868). Cette église remplace une église romane devenue trop petite.
A signaler que " le 12 ou 13 juin 1723, le feu ayant pris dans la
sacristie, a brûlé toute la charpente, les meubles et tous les ornements,
.... " (recteur Joussé). La statue de Saint Mathieu, provenant de la chapelle du Trépas, date du XVème
siècle. La statue de Saint Barthélemy, en bois polychrome et provenant de
la chapelle du Trépas, date du XVIIème siècle. La statue Saint Mathurin,
en bois polychrome et provenant de la chapelle du Trépas, date du XVIIIème
siècle ;
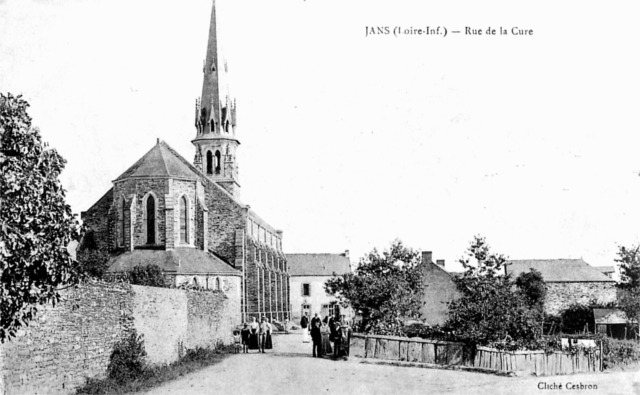
![]() la
chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème siècle), située à
la Trépas et édifiée à l'emplacement d'un édifice primitif dédié à
saint Barthélemy. Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d'après la légende,
les évangélisateurs de Jans (compris alors dans la vaste forêt de
Domnesche). Ces derniers "auraient remonté la rivière du Don en
partant du lac Murin et s'étaient fixés sur les bords de la Cosne, en un
asile devenu la chapelle précitée et où ils furent décapités pour leur
fidélité au christianisme, tout comme saints Donatien et Rogatien de
Nantes". On voit une fontaine à proximité de la chapelle ;
la
chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème siècle), située à
la Trépas et édifiée à l'emplacement d'un édifice primitif dédié à
saint Barthélemy. Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d'après la légende,
les évangélisateurs de Jans (compris alors dans la vaste forêt de
Domnesche). Ces derniers "auraient remonté la rivière du Don en
partant du lac Murin et s'étaient fixés sur les bords de la Cosne, en un
asile devenu la chapelle précitée et où ils furent décapités pour leur
fidélité au christianisme, tout comme saints Donatien et Rogatien de
Nantes". On voit une fontaine à proximité de la chapelle ;
![]() la
croix Pétra, située à Longlé ;
la
croix Pétra, située à Longlé ;
![]() la
croix Morel (XVIIIème siècle), édifiée par la famille Morel ;
la
croix Morel (XVIIIème siècle), édifiée par la famille Morel ;
![]() le
calvaire de Mission (1895-1947), édifié en 1895 et restauré en 1947 ;
le
calvaire de Mission (1895-1947), édifié en 1895 et restauré en 1947 ;
![]() la
maison (vers le XVème siècle) à La Galotière. Il s'agit d'un ancien
relais de poste. Propriété de Jean Sorin en 1427. La léproserie de la
Maillardais dépendait jadis de la seigneurie de Trenoust, à laquelle le
manoir de la Galotière aurait appartenu. Ce manoir possédait jadis sa
propre chapelle. A signaler que la seigneurie de Trenoust (terre et
juridiction) ayant appartenu vers 1427 à Jean Sorrin, appartient en 1603
au sieur Chomard de La Primaudais, puis passe au XIXème siècle aux
demoiselles Chevé de La Motte ;
la
maison (vers le XVème siècle) à La Galotière. Il s'agit d'un ancien
relais de poste. Propriété de Jean Sorin en 1427. La léproserie de la
Maillardais dépendait jadis de la seigneurie de Trenoust, à laquelle le
manoir de la Galotière aurait appartenu. Ce manoir possédait jadis sa
propre chapelle. A signaler que la seigneurie de Trenoust (terre et
juridiction) ayant appartenu vers 1427 à Jean Sorrin, appartient en 1603
au sieur Chomard de La Primaudais, puis passe au XIXème siècle aux
demoiselles Chevé de La Motte ;
![]() l'ancien
manoir des Thénaudais (vers le XVème siècle). Propriété de Gilles Prévost
au XVème siècle ;
l'ancien
manoir des Thénaudais (vers le XVème siècle). Propriété de Gilles Prévost
au XVème siècle ;
![]() le
manoir de la Musse (XVème siècle). La tourelle de La Musse a disparu. La seigneurie de la Musse appartient en
1427 à Jean Gauchelaye et, au XVIIIème siècle, à Jean Maignan, famille
alliée aux Legrand de Créneue et aux Castellan. Le chevalier Le Maignan,
ancien officier de l'armée royale, fut un colonel de l'armée vendéenne.
Il milita aussi en 1815 puis surtout en 1832 et dut se retirer à Nantes
après l'arrestation de la duchesse de Berry, soutenue par Achille Guibourg
de Châteaubriant. Le colonel Le Maignan est mort en son château de La
Musse, le 13 mars 1840. Sa descendance s'est prolongée par les dames de
Boussinot au Châtenay, puis Geoffroy de Villeblanche au manoir du Plessis ;
le
manoir de la Musse (XVème siècle). La tourelle de La Musse a disparu. La seigneurie de la Musse appartient en
1427 à Jean Gauchelaye et, au XVIIIème siècle, à Jean Maignan, famille
alliée aux Legrand de Créneue et aux Castellan. Le chevalier Le Maignan,
ancien officier de l'armée royale, fut un colonel de l'armée vendéenne.
Il milita aussi en 1815 puis surtout en 1832 et dut se retirer à Nantes
après l'arrestation de la duchesse de Berry, soutenue par Achille Guibourg
de Châteaubriant. Le colonel Le Maignan est mort en son château de La
Musse, le 13 mars 1840. Sa descendance s'est prolongée par les dames de
Boussinot au Châtenay, puis Geoffroy de Villeblanche au manoir du Plessis ;
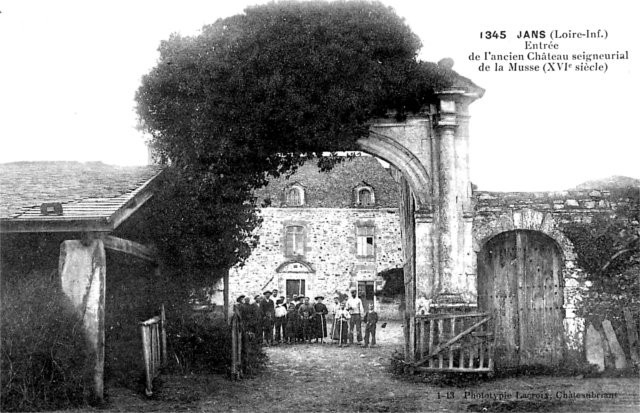
![]() le
logis de Romefort (XVIème siècle). Il s'agit d'une dépendance de la châtellenie
de Jans appartenant au XVIème siècle à Anne de Montmorency ;
le
logis de Romefort (XVIème siècle). Il s'agit d'une dépendance de la châtellenie
de Jans appartenant au XVIème siècle à Anne de Montmorency ;
![]() le
moulin
du Pont (XVème siècle) ;
le
moulin
du Pont (XVème siècle) ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de JANS
La châtellenie de Jans appartenait en 1294 à Briand Le Boeuf, sire d'Issé, qui reconnut alors devoir à cause d'elle 4 livres en deniers d'Ost au duc de Bretagne ; elle fut donnée en 1333 par le duc Jean III à Jean de Rougé, sire de Derval (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, IIII, et 1359). Cette châtellenie s'étendait en Jans, Treffieux, Abbaretz, Nozay et Derval ; parmi ses rentes on remarque celle qui portaient le nom de « gardes des festes de Jans » ; peut-être était-ce une sauvegarde accordée par le seigneur de Jans à ses vassaux pendant les fêtes des saints Julien et Gulcien, patrons de la paroisse et martyrisés à Jans même d'après la tradition.
Le sire de Jans était fondateur des églises de Jans et de Treffieux ; il jouissait d'une partie des coutumes d'Abbaretz et de Nozay (Déclaration de Jans en 1541) mais il n'avait comme domaine proche qu'une petite dîme, un bois de 100 journaux de terre et le moulin à eau de Grandville sur le Don. Toutefois le seigneur de Nozay lui devait chaque année une rente de 126 livres 13 sols 4 deniers (Déclaration de Derval en 1680).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.