|
Bienvenue chez les Lanestériens |
LANESTER |
Retour page d'accueil Retour Canton de Lanester
La commune de Lanester ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANESTER
Lanester vient du breton « lann er ster » (lande de la rivière).
Lanester, ancien pays de lande et de marécage, est un démembrement au XIXème siècle de l'ancienne paroisse primitive de Caudan. On note la présence de pêcheries gallo-romaines, au bord du Blavet, dès le IIème et IIIème siècles.
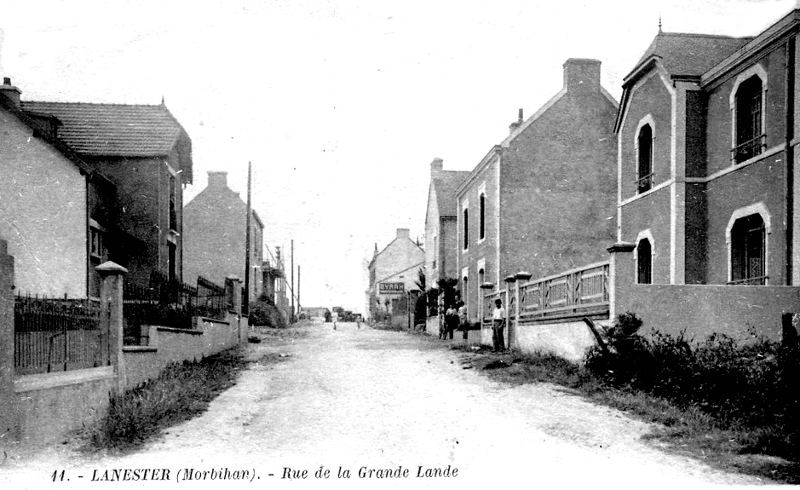
La christianisation du territoire de Lanester se fait au VIème siècle en présence de saint Guénaël (ou Guénhaël ou Guénael) qui fonde un monastère sur la rive du Blavet. Tout porte à croire, en effet, que c'est au lieu-dit Saint-Guénael, que saint Guénael fonde son dernier monastère vers 578 et qu'il rend son âme à Dieu quelque temps après (La Borderie, Hist. I. 454). Cet établissement était très modeste, mais le roi Nominoë au IXème siècle, le fait somptueusement réédifier. Malheureusement, les Normands le renversent peu après et n'y laissent que des ruines. Au XIème siècle, ces ruines sont cédées à la nouvelle abbaye Saint-Gildas-de-Rhuys, qui y fonde un prieuré simple, sans aucune sorte de juridiction. La chapelle est alors dédiée à saint Guénael, le fondateur de l'ancien monastère. Au Moyen âge, Lanester se trouve sous la juridiction de la famille de Rohan-Guémené.

Ce n'est qu'en 1907 que sont créées les deux paroisses de Lanester, Saint-Joseph-du-Plessis et Notre-Dame-Auxiliatrice-du-Pont.
La Compagnie des Indes s’installe sur le territoire de Lanester au XVIIème siècle. A partir de 1827, la Marine Nationale y installent des ateliers de construction pour la flotte militaire. Lanester est érigé en commune le 31 mars 1905.
Note : Liste non exhaustive des maires de Lanester : ... Jean-Marie Le Halpert (1909-1919), Pierre Rogel (1919-1941), Eugène Morvan (1941-1944), Pierre Rogel (1944-1945), Robert Boulay (1945-1953), Jean Maurice (1953-1996), Jean-Pierre Anfré (1996-2001), Jean-Claude Perron (2001-2004), Thérèse Thiéry (2004-2020), Gilles Garréric (2020-...), etc ..

![]()
PATRIMOINE de LANESTER
![]() l'église
Notre-Dame du Pont. Il s'agit d'un banal édifice moderne ;
l'église
Notre-Dame du Pont. Il s'agit d'un banal édifice moderne ;
![]() l'église
Saint-Joseph-du-Plessis (1907-1908), située rue Etienne-Dolet, détruite
pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à l'initiative de
l'abbé Aubernon, recteur de 1951 à 1966. Il s'agit d'un banal édifice qui
intègre des éléments, tels que les arcs intérieurs dans le nef,
épargnés par les bombardements. Le Christ en croix, oeuvre du sculpteur
Jean Mingam (1927-1987), date de 1963-1964 ;
l'église
Saint-Joseph-du-Plessis (1907-1908), située rue Etienne-Dolet, détruite
pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à l'initiative de
l'abbé Aubernon, recteur de 1951 à 1966. Il s'agit d'un banal édifice qui
intègre des éléments, tels que les arcs intérieurs dans le nef,
épargnés par les bombardements. Le Christ en croix, oeuvre du sculpteur
Jean Mingam (1927-1987), date de 1963-1964 ;
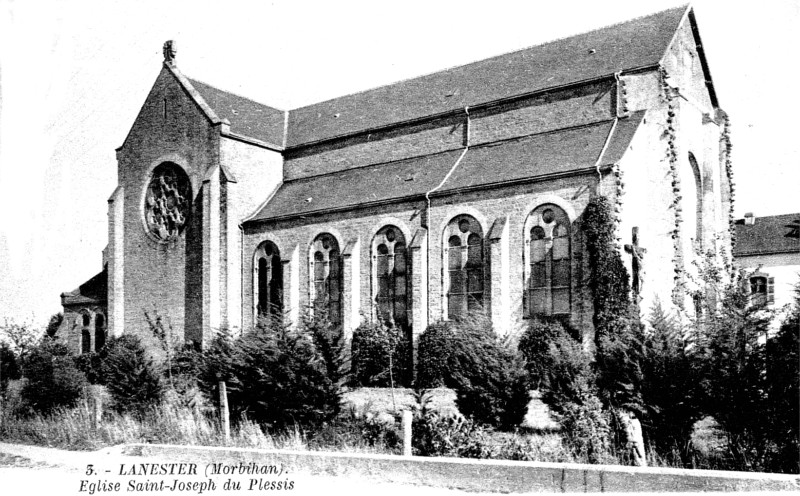
![]() la chapelle
Saint-Guénaël (XI-XIIIème siècle), restaurée aux
XVème et XXème siècles. La chapelle est édifiée par les
moines de Saint-Gildas-de-Rhuys, à l'emplacement d'un monastère fondé par
Guénaël au VIème siècle et détruit par les Normands. Il
s'agit d'une petite chapelle de forme rectangulaire, construite dès le XIème
siècle et qui a été fortement remaniée au cours des siècles suivants.
Les murs Nord et Sud, percés de petites fenêtres en plein cintre très ébrasées
à l'intérieur, subsistent seuls de la construction primitive. La façade
occidentale est percée d'une porte très simple en arc brisé et a dû être
refaite au XIIIème siècle. La grande fenêtre du chevet est à réseau
flamboyant et ne doit pas être antérieure à la fin du XVème siècle. La
chapelle est couverte d'une charpente fruste. L'édifice est restauré aux XVème et XXème
siècles. La cloche de bronze date de 1911 et porte une inscription : "TADPERON
- LOEIZ HERRIEU - MAMBERON - FRANSOEZ ER PESKER". On y trouve deux ex-voto (XIXème siècle). De l'ancien
édifice, il ne subsiste que le dallage de la nef, les encadrements de
portes des XIIIème et XVème siècles et la fenêtre du choeur ;
la chapelle
Saint-Guénaël (XI-XIIIème siècle), restaurée aux
XVème et XXème siècles. La chapelle est édifiée par les
moines de Saint-Gildas-de-Rhuys, à l'emplacement d'un monastère fondé par
Guénaël au VIème siècle et détruit par les Normands. Il
s'agit d'une petite chapelle de forme rectangulaire, construite dès le XIème
siècle et qui a été fortement remaniée au cours des siècles suivants.
Les murs Nord et Sud, percés de petites fenêtres en plein cintre très ébrasées
à l'intérieur, subsistent seuls de la construction primitive. La façade
occidentale est percée d'une porte très simple en arc brisé et a dû être
refaite au XIIIème siècle. La grande fenêtre du chevet est à réseau
flamboyant et ne doit pas être antérieure à la fin du XVème siècle. La
chapelle est couverte d'une charpente fruste. L'édifice est restauré aux XVème et XXème
siècles. La cloche de bronze date de 1911 et porte une inscription : "TADPERON
- LOEIZ HERRIEU - MAMBERON - FRANSOEZ ER PESKER". On y trouve deux ex-voto (XIXème siècle). De l'ancien
édifice, il ne subsiste que le dallage de la nef, les encadrements de
portes des XIIIème et XVème siècles et la fenêtre du choeur ;

![]() la chapelle Saint-Cornély (ou de
Locunel), ancienne chapelle romane détruite pendant
la Seconde Guerre mondiale et réédifiée en 1960 avec certains
anciens éléments ;
la chapelle Saint-Cornély (ou de
Locunel), ancienne chapelle romane détruite pendant
la Seconde Guerre mondiale et réédifiée en 1960 avec certains
anciens éléments ;
![]() la chapelle Saint-Yves ou Notre-Dame du Resto.
Elle passe sans raison pour avoir appartenu aux Templiers. L'édifice
actuel, des XVème et XVIème siècles, comprend une nef rectangulaire,
flanquée de deux chapelles limitées à l'Est par le même chevet plat que
le vaisseau principal. Les chapelles s'ouvrent sous des arcades en
tiers-point qui pénètrent d'une part dans la muraille et d'autre part dans
des colonnes engagées à base moulurée d'un simple tore. La chapelle Nord
est éclairée par une rose à réseau rayonnant. La fenêtre du chevet est
au contraire à réseau flamboyant. Des bancs de pierre intérieurs courent
le long des murs. La décoration extérieure est fruste. Un clocheton carré
en pierre s'élève sur le pignon occidental. La chapelle est couverte d'une
charpente très simple. Une Pietà (Notre-Dame de Pitié) datée du XVIème
siècle, ainsi que d'autres statues du XVIème siècle et divers objets de
culte (un calice en argent daté de 1650 et une patène en argent datée de
1650) sont découverts en 1943 sous la crypte de la chapelle saint Yves. La
statue en bois polychrome de Saint-Yves date du XVIème siècle. La statue
en bois polychrome de saint Roch date du XVIème siècle. La statue en bois
polychrome de la Vierge allaitant l'Enfant Jésus date du XVIème siècle.
La statue en bois polychrome de saint Anne (avec la Vierge et l'Enfant) date
du XVIème siècle ;
la chapelle Saint-Yves ou Notre-Dame du Resto.
Elle passe sans raison pour avoir appartenu aux Templiers. L'édifice
actuel, des XVème et XVIème siècles, comprend une nef rectangulaire,
flanquée de deux chapelles limitées à l'Est par le même chevet plat que
le vaisseau principal. Les chapelles s'ouvrent sous des arcades en
tiers-point qui pénètrent d'une part dans la muraille et d'autre part dans
des colonnes engagées à base moulurée d'un simple tore. La chapelle Nord
est éclairée par une rose à réseau rayonnant. La fenêtre du chevet est
au contraire à réseau flamboyant. Des bancs de pierre intérieurs courent
le long des murs. La décoration extérieure est fruste. Un clocheton carré
en pierre s'élève sur le pignon occidental. La chapelle est couverte d'une
charpente très simple. Une Pietà (Notre-Dame de Pitié) datée du XVIème
siècle, ainsi que d'autres statues du XVIème siècle et divers objets de
culte (un calice en argent daté de 1650 et une patène en argent datée de
1650) sont découverts en 1943 sous la crypte de la chapelle saint Yves. La
statue en bois polychrome de Saint-Yves date du XVIème siècle. La statue
en bois polychrome de saint Roch date du XVIème siècle. La statue en bois
polychrome de la Vierge allaitant l'Enfant Jésus date du XVIème siècle.
La statue en bois polychrome de saint Anne (avec la Vierge et l'Enfant) date
du XVIème siècle ;
![]() l'ancienne
maison prieurale, située jadis près de la chapelle Saint-Guénaël. La maison prieurale, qui dépendait de l'abbaye
Saint-Gildas-de-Rhuys, possédait son jardin et quelques dépendances
directes. Le prieur percevait des revenus sur plusieurs tenues qui
relevaient de lui et sur des terres situées dans l'île de Groix. Il dîmait
aussi sur quelques villages de Caudan et des environs. En retour, il devait
dire ou faire dire deux messes par semaine dans la chapelle. Le service de
la chapelle fut confié par la suite à un prêtre séculier. En 1557, le
prieur, pour payer les taxes extraordinaires de l'époque, fut obligé
d'aliéner le pré Mélio, qui fut adjugé à Jean Beaujouan, pour 8 livres
10 sous. En 1720, on trouve deux baillées à domaine congéable, données
par le prieur de Saint-Guénael de Caudan. En 1774, les revenus de ce petit
bénéfice montaient à 548 livres 16 sous, mais les charges les
réduisaient à 318 livres. Voici les noms des derniers prieurs : Jean
Guégan (pourvu en 15.., démissionnaire en 1567), René Baellec (pourvu en
1567), Mathieu de Vauchelles (pourvus en 1605, mort en 1609), André Carré
et deux concurrents (en 1609), Fr. Jacques Morin, de Rhuys (démissionnaire
en 1616), Jean Bigarré (pourvu en 1616), Julien Hervio et trois concurrents
(en 1619), Mathurin Cousturet (en 1637 et en 1652), Thomas Castel (en 1683),
Dom Georges Botherel, de Rhuys (en 1717 ?), D. Pierre de Villiers (pourvu en
17.., mort en 1729), François de Castellane (pourvu en 1729,
démissionnaire en 1738), Jean Jouffroy, de Besançon (en 1738). La
Révolution supprima ce petit bénéfice et aliéna sa dotation. La chapelle
subsiste encore ;
l'ancienne
maison prieurale, située jadis près de la chapelle Saint-Guénaël. La maison prieurale, qui dépendait de l'abbaye
Saint-Gildas-de-Rhuys, possédait son jardin et quelques dépendances
directes. Le prieur percevait des revenus sur plusieurs tenues qui
relevaient de lui et sur des terres situées dans l'île de Groix. Il dîmait
aussi sur quelques villages de Caudan et des environs. En retour, il devait
dire ou faire dire deux messes par semaine dans la chapelle. Le service de
la chapelle fut confié par la suite à un prêtre séculier. En 1557, le
prieur, pour payer les taxes extraordinaires de l'époque, fut obligé
d'aliéner le pré Mélio, qui fut adjugé à Jean Beaujouan, pour 8 livres
10 sous. En 1720, on trouve deux baillées à domaine congéable, données
par le prieur de Saint-Guénael de Caudan. En 1774, les revenus de ce petit
bénéfice montaient à 548 livres 16 sous, mais les charges les
réduisaient à 318 livres. Voici les noms des derniers prieurs : Jean
Guégan (pourvu en 15.., démissionnaire en 1567), René Baellec (pourvu en
1567), Mathieu de Vauchelles (pourvus en 1605, mort en 1609), André Carré
et deux concurrents (en 1609), Fr. Jacques Morin, de Rhuys (démissionnaire
en 1616), Jean Bigarré (pourvu en 1616), Julien Hervio et trois concurrents
(en 1619), Mathurin Cousturet (en 1637 et en 1652), Thomas Castel (en 1683),
Dom Georges Botherel, de Rhuys (en 1717 ?), D. Pierre de Villiers (pourvu en
17.., mort en 1729), François de Castellane (pourvu en 1729,
démissionnaire en 1738), Jean Jouffroy, de Besançon (en 1738). La
Révolution supprima ce petit bénéfice et aliéna sa dotation. La chapelle
subsiste encore ;
![]() le château du Mané (XVIIème siècle), restauré en 1880. Ce
château est édifié à l’emplacement d’un édifice plus ancien signalé en
1698 et qui dépendait alors de la châtellenie de Pont-Callec. Siège de la seigneurie du Mané au XVIIème siècle. Propriété
successive des familles Le Nesec, sieurs de Penhouët (en 1726), Le Guerre
(en 1854), Geoffroy (en 1882), puis des Pères Blancs d'Hennebont (au début
du XXème siècle) et de la famille Marcesche (en 1910). La tour carrée à
l'Est et la tourelle à l'Ouest ont été rajoutés à la fin du XIXème
siècle par le colonel Geoffroy ;
le château du Mané (XVIIème siècle), restauré en 1880. Ce
château est édifié à l’emplacement d’un édifice plus ancien signalé en
1698 et qui dépendait alors de la châtellenie de Pont-Callec. Siège de la seigneurie du Mané au XVIIème siècle. Propriété
successive des familles Le Nesec, sieurs de Penhouët (en 1726), Le Guerre
(en 1854), Geoffroy (en 1882), puis des Pères Blancs d'Hennebont (au début
du XXème siècle) et de la famille Marcesche (en 1910). La tour carrée à
l'Est et la tourelle à l'Ouest ont été rajoutés à la fin du XIXème
siècle par le colonel Geoffroy ;
![]() les vestiges du château du Plessis (XVème siècle).
Siège de la seigneurie du Plessis ou du Quinquis. Propriété successive
des familles Thomelin du Plessis (en 1427 et en 1464), Penhoat-Chefdubois,
Launay (en 1536), Riou (en 1650), Mauduit (XVIIIème siècle). Le château
est détruit pendant la guerre de 1939-1945. Il possédait autrefois une
chapelle privée. Le parc a été acheté par la commune de
Lanester en 1973. Il subsiste un pan de pigeonnier (XVème siècle), situé avenue du Général-de-Gaulle et
dans le Parc du Plessis ;
les vestiges du château du Plessis (XVème siècle).
Siège de la seigneurie du Plessis ou du Quinquis. Propriété successive
des familles Thomelin du Plessis (en 1427 et en 1464), Penhoat-Chefdubois,
Launay (en 1536), Riou (en 1650), Mauduit (XVIIIème siècle). Le château
est détruit pendant la guerre de 1939-1945. Il possédait autrefois une
chapelle privée. Le parc a été acheté par la commune de
Lanester en 1973. Il subsiste un pan de pigeonnier (XVème siècle), situé avenue du Général-de-Gaulle et
dans le Parc du Plessis ;
![]() le château de Kervéléan
ou Kervélean (fin du XVIIIème siècle), propriété de Pierre
Le Gallic de Kerizont (à partir de 1787), puis de la
famille Guieysse (suite au mariage de Marie-Jeanne Le Gallic avec Pierre Guieysse) ;
le château de Kervéléan
ou Kervélean (fin du XVIIIème siècle), propriété de Pierre
Le Gallic de Kerizont (à partir de 1787), puis de la
famille Guieysse (suite au mariage de Marie-Jeanne Le Gallic avec Pierre Guieysse) ;
![]() le
château de Belann, propriété de la famille La Monneraye ;
le
château de Belann, propriété de la famille La Monneraye ;
![]() le
manoir de Keraliguen (1878), situé rue Emile-Combes et édifié pour le
comte Théodore de Leusse. La propriété est acquise en 1886 par la famille
Roux-Lavergne. La communauté des carmélites de Saint-Joseph en devient
propriétaire en 1931, puis à nouveau en 1952 pour y fonder une maison de
repos pour dames (Maison Sainte-Anne-de-Keraliguen). L'édifice actuel a été restauré
vers 1994 et inauguré en 1995 ;
le
manoir de Keraliguen (1878), situé rue Emile-Combes et édifié pour le
comte Théodore de Leusse. La propriété est acquise en 1886 par la famille
Roux-Lavergne. La communauté des carmélites de Saint-Joseph en devient
propriétaire en 1931, puis à nouveau en 1952 pour y fonder une maison de
repos pour dames (Maison Sainte-Anne-de-Keraliguen). L'édifice actuel a été restauré
vers 1994 et inauguré en 1995 ;
![]() la
ferme de Saint-Niau (XVIIème siècle) ;
la
ferme de Saint-Niau (XVIIème siècle) ;
![]() la
ferme de Kerhervy (XVIIIème siècle). Une porte et une fenêtre datent de 1788 ;
la
ferme de Kerhervy (XVIIIème siècle). Une porte et une fenêtre datent de 1788 ;
![]() la fontaine de Kervéléan (1790),
située au château de Kervéléan. Elle est composée de cinq bassins ;
la fontaine de Kervéléan (1790),
située au château de Kervéléan. Elle est composée de cinq bassins ;
![]() la
fontaine de Saint-Guénaël, située au bord du Blavet ;
la
fontaine de Saint-Guénaël, située au bord du Blavet ;
![]() le puits de Kergreis (1811),
situé rue de Kergreis ;
le puits de Kergreis (1811),
situé rue de Kergreis ;
![]() le moulin du Plessis (XIXème siècle),
détenu en 1790 par Jean Le Guenezan, qui paie 10 livres de capitation ;
le moulin du Plessis (XIXème siècle),
détenu en 1790 par Jean Le Guenezan, qui paie 10 livres de capitation ;
A signaler aussi :
![]() le lech de Locumel (époque néolithique). Il s’agit
d'après la légende du prie-Dieu de saint Guénaël ;
le lech de Locumel (époque néolithique). Il s’agit
d'après la légende du prie-Dieu de saint Guénaël ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de LANESTER
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 et du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence d'aucun noble de Lanester. La paroisse de Lanester dépendait autrefois de Caudan.
© Copyright - Tous droits réservés.