|
Bienvenue chez les Lanhélinois |
|
LANHELIN |
Retour page d'accueil Retour Canton de Combourg
La commune de
Lanhélin ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANHELIN
Lanhélin vient du breton "lann" (ermitage) et de "Helen", un saint breton.

Lanhélin est, semble-t-il, un démembrement de la paroisse de Meillac. Lanhélin (église d'Hélen) figure en 1182 sur la liste des biens des Templiers de la commanderie de La Guerche.
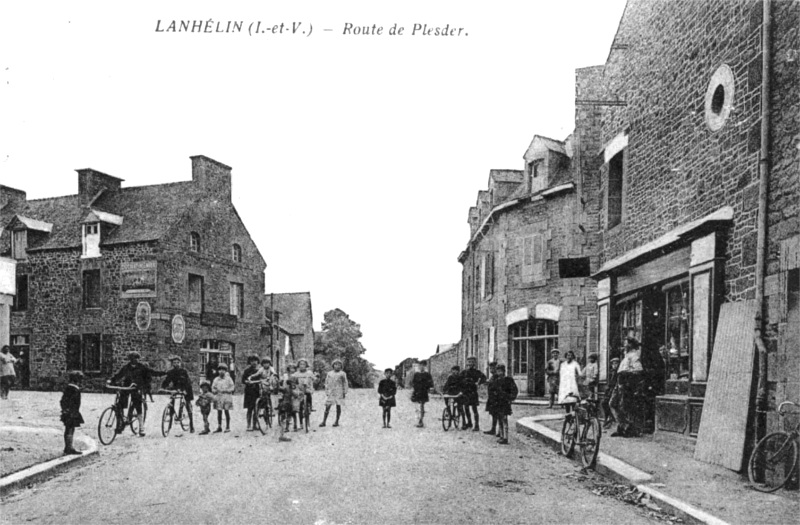
Saint Hélen a donné son nom à cette paroisse, qui doit remonter à l'occupation du pays par les Bretons. Nous avons vu qu'au XIIème siècle elle appartenait en partie aux chevaliers de l'Ordre du Temple, et leurs successeurs, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en présentaient le recteur au XIVème siècle. En 1708, le commandeur du Temple de la Guerche levait encore la moitié des dîmes de Lanhélin et payait une portion congrue au recteur de cette paroisse qui dépendait de l'ancien évêché de Dol.

Lanhélin eut au moyen-âge des maisons nobles dont celle du Boishuë et celle du Cohac qui a laissé son nom dans le bois qui lui a survécu. La motte de la seigneurie de Cohac avait été édifiée jadis sur le territoire de Lanhélin. Des vestiges sont encore visibles (deux tours) en 1621.
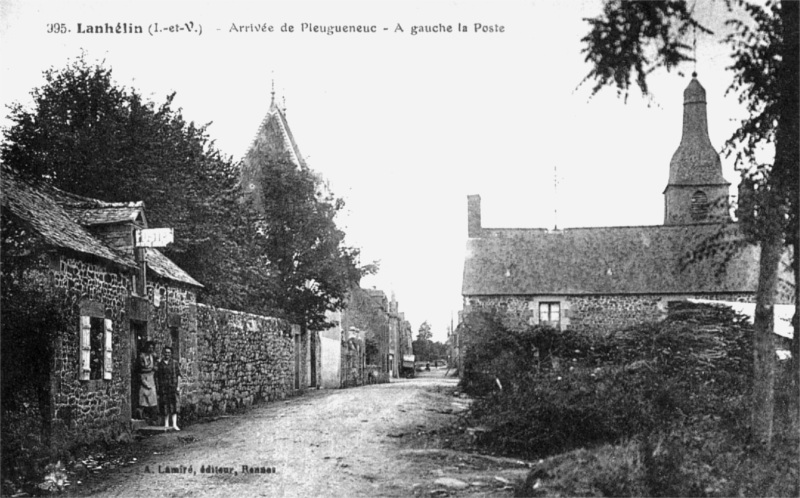
On rencontre les appellations suivantes : Lanhelon (au XIIème siècle), Lanhelen (au XIVème siècle), Lenhelen (en 1513), Lanhellan (au XVIème siècle).

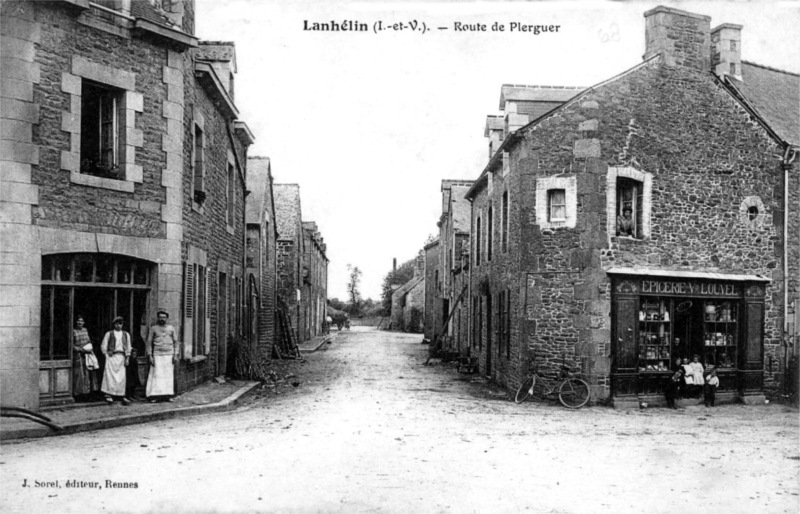
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Lanhélin : François Gaultier (en 1595). Julien Clampel (il résigna en faveur du suivant). Adam Roulland (pourvu en 1599, il donna au Chapitre de Dol six écus pour droit d'annates). Jean Chrestien (en 1622 ; il résigna en 1639 en faveur du suivant). Guillaume Deminiac (pourvu en cour de Rome, il prit possession le 8 décembre 1639). Charles Lamandé (en 1661). Antoine Thébault (en 1674). Joseph Bazin (en 1682). Bertrand Collet (en 1694). N... Le Goerech (en 1695). Jean Lejeune (il fut pourvu vers 1700 ; décédé en 1720). Pierre Blouin (prêtre de Dol, pourvu par l'évêque le 29 mars 1721, il prit possession le 28 septembre et débouta Jean-Baptiste Mahé, pourvu en cour de Rome ; décédé en 1731). Laurent Connan (prêtre de Dol, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 15 octobre et le 19 novembre 1731 ; décédé âgé de quarante-quatre ans, en 1733). Jean Guynemer (pourvu en cour de Rome, il prit possession le 6 décembre 1733 ; décédé en 1760 et inhumé dans le cimetière). Henri Le Corvaisier (prêtre de Lanhélin, il fut pourvu le 1er juillet 1760 ; décédé en 1773). Baptiste-Mathurin Martel (prêtre de Dol, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 16 mars 1773 et gouverna jusqu'à la Révolution ; il devint en 1803 recteur de Saint-Broladre). Joseph-Marie Ramon (1803, décédé en 1825). Vincent-Guillaume Hervot (1825, décédé en 1848). N... Bucheron (1848-1856). Isidore Nantel (1856-1868). Isidore Le François (1868-1874). Joseph-Marie Fédéry (1874-1880). Auguste Rolland (à partir de 1880), .... ;

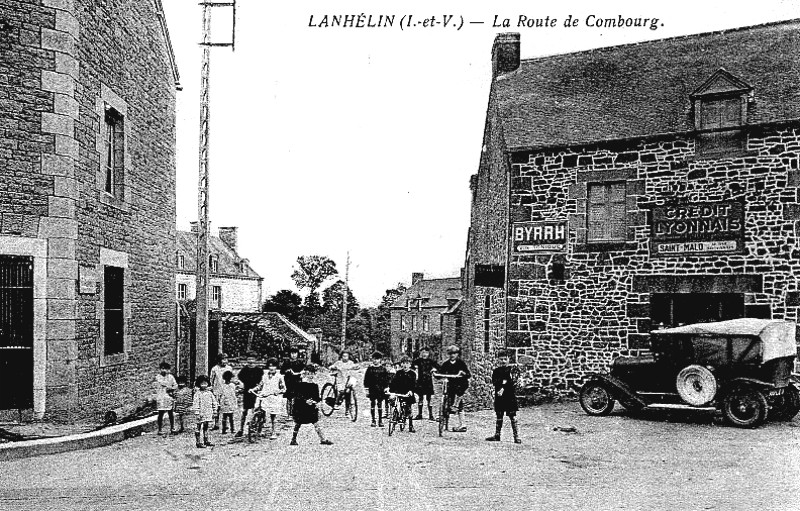
![]()
PATRIMOINE de LANHELIN
![]() l'église
Saint-André (XIVème siècle - vers 1840). Il s'agit d'une ancienne propriété des hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem, successeurs des Templiers. Saint André est le
patron de cette église, et l'on n'y rend aucun culte à saint Hélen. C'est
un édifice insignifiant en forme de croix. A la suite d'une importante
restauration et de la pose d'autels nouveaux, l'église de Lanhélin fut bénite
solennellement en 1771, et on y ajouta une tour au bas de la nef en 1778.
Quoique le commandeur du Temple de la Guerche prétendît à la seigneurie
de Lanhélin, le baron de Combourg fut maintenu en 1696 dans ses droits de
supériorité et de prééminence en cette église ; toutefois, le seigneur
du Boishue y avait son banc et son enfeu au haut de la nef, du côté de l'épître,
et Henry-François de Guéheneuc, seigneur du Boishue, y fut inhumé en 1761
(Pouillé de Rennes). L'église est restaurée
en 1771 et en partie reconstruite au XXème siècle. La tour du clocher date
de 1778. La flèche du clocher date de 1840. Le chœur et le transept
datent du XVIIIème siècle. Elle abrite une statue de la Vierge noire qui
date du XVIIème siècle. Les seigneurs de Boishuë possédaient jadis un
enfeu au haut de la nef, du côté sud ;
l'église
Saint-André (XIVème siècle - vers 1840). Il s'agit d'une ancienne propriété des hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem, successeurs des Templiers. Saint André est le
patron de cette église, et l'on n'y rend aucun culte à saint Hélen. C'est
un édifice insignifiant en forme de croix. A la suite d'une importante
restauration et de la pose d'autels nouveaux, l'église de Lanhélin fut bénite
solennellement en 1771, et on y ajouta une tour au bas de la nef en 1778.
Quoique le commandeur du Temple de la Guerche prétendît à la seigneurie
de Lanhélin, le baron de Combourg fut maintenu en 1696 dans ses droits de
supériorité et de prééminence en cette église ; toutefois, le seigneur
du Boishue y avait son banc et son enfeu au haut de la nef, du côté de l'épître,
et Henry-François de Guéheneuc, seigneur du Boishue, y fut inhumé en 1761
(Pouillé de Rennes). L'église est restaurée
en 1771 et en partie reconstruite au XXème siècle. La tour du clocher date
de 1778. La flèche du clocher date de 1840. Le chœur et le transept
datent du XVIIIème siècle. Elle abrite une statue de la Vierge noire qui
date du XVIIème siècle. Les seigneurs de Boishuë possédaient jadis un
enfeu au haut de la nef, du côté sud ;


![]() la
croix d'enclos, située près de l'église Saint-André ;
la
croix d'enclos, située près de l'église Saint-André ;
![]() le
château des Pins (1663). Deux édifices sont rajoutés au logis central au XIXème siècle ;
le
château des Pins (1663). Deux édifices sont rajoutés au logis central au XIXème siècle ;

![]() la
métairie de La Ville-Poulet (XV-XVIème siècle). Remaniée au XIXème siècle ;
la
métairie de La Ville-Poulet (XV-XVIème siècle). Remaniée au XIXème siècle ;
![]() la
maison "du Poncet" (XV-XVIIème siècle), située au n° 2 rue Laënnec ;
la
maison "du Poncet" (XV-XVIIème siècle), située au n° 2 rue Laënnec ;
![]() le
manoir de la Vallée (XVIème siècle), encore surnommé "La Hallée" ;
le
manoir de la Vallée (XVIème siècle), encore surnommé "La Hallée" ;
![]() l'ancien manoir du
Boishue (ou Boishuë). Ce manoir était la propriété de la famille Guéhenneuc ou Guéheneuc en
1742 et en 1774. On y trouvait autrefois une chapelle privative fondée en 1742 et bénite en septembre
1742, en présence de Henry de Guéheneuc et de Thérèse du Breil, seigneur
et dame du Boishue et de Cobatz. Elle est détruite à la
Révolution. Il ne subsiste qu'un puits daté du XVIème siècle ;
l'ancien manoir du
Boishue (ou Boishuë). Ce manoir était la propriété de la famille Guéhenneuc ou Guéheneuc en
1742 et en 1774. On y trouvait autrefois une chapelle privative fondée en 1742 et bénite en septembre
1742, en présence de Henry de Guéheneuc et de Thérèse du Breil, seigneur
et dame du Boishue et de Cobatz. Elle est détruite à la
Révolution. Il ne subsiste qu'un puits daté du XVIème siècle ;
![]() la
maison (1610), située à La Ville-Pion ;
la
maison (1610), située à La Ville-Pion ;

A signaler aussi :
![]() des
vestiges gallo-romains près du village de La Ville-Poulet ;
des
vestiges gallo-romains près du village de La Ville-Poulet ;
![]() l'ancien
château de la Grande-Maison, situé au bourg de Lanhélin. Il possède une tourelle ;
l'ancien
château de la Grande-Maison, situé au bourg de Lanhélin. Il possède une tourelle ;
![]() l'ancien
château de Cobatz. Il a été ruiné au XVIème siècle. Sa motte seule
subsiste. On voyait encore en 1621 deux tours et les ruines de sa chapelle
privée. Au XIIème siècle, Guigon de Cobatz ou de Chobar ayant reçu la
croix des mains de l'abbé de la Vieuville, donna à ce dernier, avant de
partir pour Jérusalem, le tiers de son Plessix, « apud Lanhelon...
terciam partem Plaisicii » ; il fit ce don du consentement des enfants
de ses soeurs, Geffroy de Meillac, Rolland de Trémigon et Robert Gruel,
n'ayant point d'autres héritiers (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, I, 728). Du château de Cobatz, ruiné pendant les guerres du
XVIème siècle, il ne reste plus aujourd'hui qu'une motte ; mais en 1621 on
y voyait encore deux tours, l'une carrée et l'autre ronde, et « la
mazure où estoit la chapelle dudit chasteau de Cobatz » (Pouillé de
Rennes). Propriété de la famille Ruffier en 1513 ;
l'ancien
château de Cobatz. Il a été ruiné au XVIème siècle. Sa motte seule
subsiste. On voyait encore en 1621 deux tours et les ruines de sa chapelle
privée. Au XIIème siècle, Guigon de Cobatz ou de Chobar ayant reçu la
croix des mains de l'abbé de la Vieuville, donna à ce dernier, avant de
partir pour Jérusalem, le tiers de son Plessix, « apud Lanhelon...
terciam partem Plaisicii » ; il fit ce don du consentement des enfants
de ses soeurs, Geffroy de Meillac, Rolland de Trémigon et Robert Gruel,
n'ayant point d'autres héritiers (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, I, 728). Du château de Cobatz, ruiné pendant les guerres du
XVIème siècle, il ne reste plus aujourd'hui qu'une motte ; mais en 1621 on
y voyait encore deux tours, l'une carrée et l'autre ronde, et « la
mazure où estoit la chapelle dudit chasteau de Cobatz » (Pouillé de
Rennes). Propriété de la famille Ruffier en 1513 ;
![]() le
Tertre du Mont-Servin. On y trouve un moulin à vent ;
le
Tertre du Mont-Servin. On y trouve un moulin à vent ;
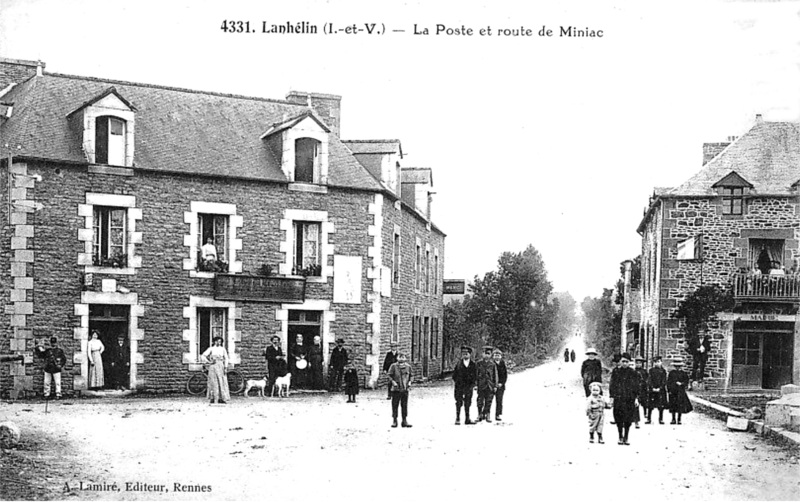

![]()
ANCIENNE NOBLESSE de LANHELIN
Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence d'un seul noble de Lanhélin :
![]() Jehan
RUFFIER (200 livres de revenu), & Rolland du Boys capitaine de Champtocé
en 1457 : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
Jehan
RUFFIER (200 livres de revenu), & Rolland du Boys capitaine de Champtocé
en 1457 : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;
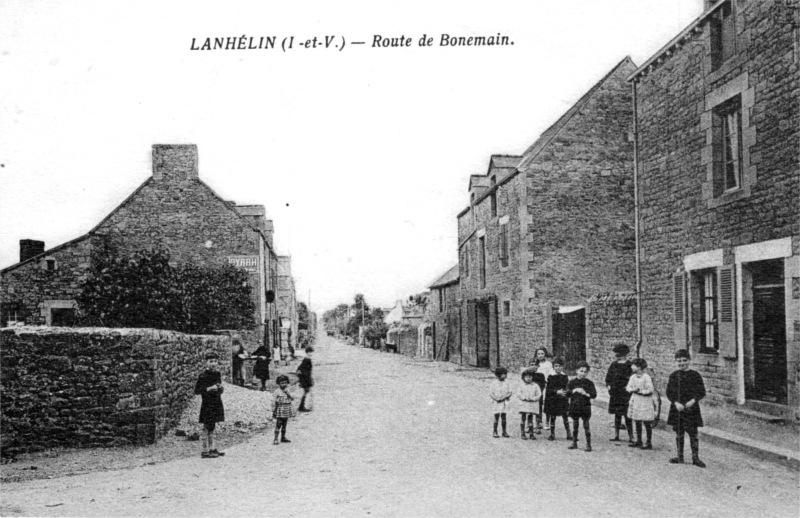
Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513 (rapport fait par Jamet Gey, Pierre Trémaudan, Jean Costard, élus), sont mentionnées à Lanhélin (Lenhelen) les personnes et maisons nobles suivantes :
![]() Jean
Ruffier, sieur du Cobaz ;
Jean
Ruffier, sieur du Cobaz ;
![]() Jacques
Hingant, sieur de la Tremblaye ;
Jacques
Hingant, sieur de la Tremblaye ;
![]() Gilles
Hingant, sieur du Treff.
Gilles
Hingant, sieur du Treff.
© Copyright - Tous droits réservés.