|
Bienvenue ! |
GUILLAUME LEJEAN : SA VIE - SES TRAVAUX - SES VOYAGES. |
Retour page d'accueil Retour "Ville de Plouégat-Guerrand"
Guillaume LEJEAN, né à Plouégat-Guerrand en 1818 fut d'abord secrétaire du Conseil de Préfecture de Morlaix. Il collabora au "Pays" avec Lamartine en 1848. Passionné pour les voyages, il commença un peu plus tard par étudier la presqu'île des Balkans, puis entreprit une exploration dans le haut Nil. Guillaume Lejean est surtout le grand explorateur de l'Abyssinie. Il s'y rendit en 1862 avec une mission pour le négus Théodoros II, mais ce cruel monarque, qui l'avait d'abord bien accueilli, le fit mettre aux fers. [Note : Theodoros II est le nom de règne du négus Kassa, empereur d’Ethiopie à partir de 1855 (vers 1818 – Magdala, Ethiopie 1868). Il fut vaincu par les Britanniques, commandés par le maréchal Napier, le 13 avril 1868 à Magdala, forteresse au nord d’Addis-Abeba. Après sa défaite, il se suicida]. Plus tard, Guillaume Lejean visita l'Inde et pénétra jusque dans la vallée de Cachemire, il fit ensuite des excursions dans la Turquie d'Europe 1867-1869. Il mourut au pays natal en 1872.

Une étroite liaison de vingt-cinq ans, appuyée d'une correspondance presque incessante avec celui qui fait l'objet de cette étude et les communications bienveillantes de plusieurs personnes qui ont également échangé des lettres avec lui, nous inspirent la confiance que, de préférence à beaucoup d'autres, nous sommes en position de faire apprécier, sinon le savant — de plus autorisés le feraient bien mieux — du moins l'homme qu'il nous a été donné de connaître intus et in cute, s'il est permis de s'exprimer ainsi. La reproduction, tantôt intégrale, tantôt partielle, des plus essentielles de ces lettres, en même temps qu'elle ajoutera à la connaissance déjà acquise de ses travaux, fera de cette étude une sorte d'auto-biographie posthume, forme qui nous a paru la plus propre à le présenter sous toutes ses faces, à le faire estimer et aimer, à perpétuer enfin les regrets qu'a causés sa mort prématurée.
LEJEAN (Guillaume-Marie), né le 1er février 1826, était fils de René Lejean et de Marguerite Le Breton, cultivateurs au village de Traondour, situé dans la commune de Plouégat-Guerand (Plouégat-Guerrand). Dès sa plus tendre enfance, il fit pressentir son caractère méditatif. Au sommet des garennes avoisinant la maison paternelle, il s'oubliait, de longues heures durant, dans la contemplation, aussi loin que sa vue pouvait s'étendre, du panorama pittoresque qui se déroulait devant lui. La mer à deux pas ; la Lieue de grève, à six kilomètres ; Locquirec et sa baie à cinq ; Lanmeur et Kernitron à quatre ; Saint-Jean-du-Doigt et Trogoff à huit ; les montagnes d'Arrez à l'horizon. Il fit ses études au collège de Saint-Pol-de-Léon où, nous ont dit deux de ses condisciples, se révélait déjà le futur géographe. Thèmes et versions étaient lestement expédiés. En revanche, la cartographie l'absorbait, voire même pendant les récréations et jusqu'au réfectoire où il esquissait les cartes que lui avait suggérées la leçon du professeur. La légende aussi avait déjà des attraits pour lui, car, à seize ans, il écrivait le récit d'une excursion dans la forêt de Brocéliande, au tombeau de Merlin, et il venait à peine d'atteindre sa dix-septième année, qu'au mois de mai 1841, il insérait dans l'Écho de Morlaix, journal hebdomadaire de cette ville, une étude ayant pour titre : Coup d'œil sur l'Histoire de Morlaix.
Après qu'il eut été reçu bachelier
ès-lettres, le 10 août suivant, sa famille, ou plutôt une de ses tantes, qui
était en outre sa marraine, insista vivement pour qu'il se fît prêtre. Ne
pouvant parvenir à vaincre la persistance de son refus, elle le pressa d'entrer
comme maître d'études, au collège de Guingamp, où elle espérait que le contact
des professeurs ecclésiastiques de l'établissement exercerait sur lui une
influence favorable à ses désirs. Lejean resta inébranlable. Il déclara
nettement qu'il ne voulait pas d'une position en complet désaccord avec ses
idées, et qui, disait-il, eût fait, de lui, à perpétuité, un hypocrite. Il
revint au foyer domestique, mais n'y resta pas long-temps. Son
article de 1841, dans l'Écho de Morlaix, avait été remarqué. Il contribua à le
faire charger du classement des archives de cette ville renfermant des documents
historiques d'un grand intérêt, pour la localité. A mesure qu'il se livrait à ce
travail, il en consignait les résultats dans une série d'articles insérés dans
l'Écho, et dont l'ensemble forme le volume intitulé : Histoire communale du
Finistère (première partie), Histoire politique et municipale de la ville et de
la communauté de Morlaix, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
Révolution française. (Morlaix, V. GUILMER) 1846, 260 pp. in-12.) Il est
difficile de condenser dans un si mince volume plus de faits substantiels que ne
l'a fait le jeune historien de vingt-deux ans. Les origines de la ville, son
histoire au Moyen-Age et sous les rois de France, son histoire municipale y sont
exposées succinctement, mais d'une façon irréfutable, appuyées qu'elles sont de
documents authentiques. Aux mois d'octobre et de novembre 1845, Lejean aborda,
en outre, dans l'Écho, l'histoire proprement dite par ses Souvenirs de la
Chouannerie dans le district de Morlaix. (An Ier- VII).
Dans l'intervalle,
Lejean nous avait adressé (juin 1845) l'article Morvan, roi des Bretons, que
nous fîmes insérer dans le t. y de la Revue Bretonne qui se publiait alors à
Brest, et qui lorsqu'elle cessa de paraître peu après, se disposait à tirer de
ses cartons d'autres articles de lui sur l'Histoire du Finistère (temps
celtiques), sur la Géographie ancienne du Département et une série de
Chroniques bretonnes.
Nous préparions, à cette époque, avec M. Cayot-Délandre, la Biographie bretonne. A la première nouvelle de notre projet de publication, il nous offrit spontanément sa collaboration par une lettre où il nous disait « Les travaux dont je m'occupe depuis quelque temps sur l'histoire révolutionnaire de l'Ouest, le voyage que j'entreprends le mois prochain pour l'exploration du Finistère, celui que j'entreprendrai également, à la fin de mai, dans la Vendée militaire, mes travaux d'histoire locale, les recherches que je ferai dans les bibliothèques publiques et les archives de Nantes, Angers, Laval, Le Mans, Fontenay, Niort et Bourbon-Vendée, pourraient me mettre à même de répondre à quelques-unes de vos questions. Dans six mois j'aurai en portefeuille toute la vie militaire, prise sur les lieux, de Cadoudal, Charette, etc. ». Un collaborateur qui puisait à pareilles sources ne pouvait qu'être accepté avec empressement.
L'exploration du Finistère, dont il est question dans cette lettre, avait pour but le levé d'une carte agronomique de ce département, mis au concours par M. de Caumont, et auquel était attaché un prix qu'il obtint.
Rentré dans ses foyers, il se mit à l'œuvre pour la Biographie bretonne, et ne tarde pas à nous adresser son article Cadoudal. Il ne nous échappa pas que le personnage était quelque peu idéalisé, et qu'une origine commune au biographe et à son héros, avait, à l'insu du premier, exercé sur lui une certaine influence ; mais la notice renfermait une exposition de faits accusant des investigations consciencieuses développées dans un style nerveux et coloré, nous n'hésitâmes pas à l'admettre. Lui-même reconnut plus tard ces imperfections, car on a trouvé dans ses papiers des corrections nombreuses faites en vue d'un supplément à la Biographie bretonne. A cet article succédèrent ceux de Charette, Chateaubriand [Note : Après la publication des Mémoires d'Outre-Tombe, il eut quelque regret d'avoir été si sympathique « à l'illustre, mais peu aimable littérateur »], Dorval (Mme), Duguesclin, Erispoé, Eudon de Porhoët, Gurwand, Jean IV, Jean V, Kergoët, Latour d'Auvergne, Le Brigant, Le Huérou, Le Perdit, Moreau, Ricou et Souvestre qui, réunis, formeraient — le calcul a été fait — un volume de plus de 500 pages, in-8° ordinaire. Une collaboration si active et si dévouée avait pour conséquence naturelle de fortifier les sympathies réciproques qu'avaient fait naître nos premiers rapports. Aussi prirent-elles graduellement, de notre part, le caractère d'une affection paternelle justifiée en outre par celle que, de son côté, il avait pour nous et pour tous ceux qui nous étaient attachés par les liens du sang.
La rédaction de l'article Cadoudal avait eu lieu pendant que Lejean remplissait à Morlaix les fonctions de chef des bureaux de la sous-préfecture, auxquelles l'avait appelé M. Léziard. Mais le 19 février 1848, le successeur de cet honorable fonctionnaire le remercia de ses services. Lejean fut plus satisfait que mécontent. La besogne administrative lui était antipathique. Flâneur par moments, ainsi que tous les penseurs qui aiment à se replier sur eux-mêmes, il considérait comme une vraie servitude l'obligation de travailler à heure fixe. Il ne rechercha donc pas de nouvel emploi, et peut-être, s'il l'avait voulu, en eût-il obtenu quelqu'un de lucratif. Depuis trois ans, il était en correspondance active avec M. Michelet, dont les premiers travaux historiques l'avaient, à bon droit, séduit. Il y avait réciprocité ; Michelet lui écrivait, en effet, le 29 janvier 1848 : « Vous êtes certainement, Monsieur, une des espérances de la France Mes trois dernières leçons s'adressent à vous plus qu'à personne en notre pays, etc. », et le 15 mars suivant, voulant favoriser l'accès de son jeune protégé à quelque emploi, il lui envoya, proprio motu, et pour qu'il pût éventuellement en user, ce qu'il ne chercha pas à faire, la recommandation suivante « Je considère M. Lejean comme un des espoirs de la France. Très-breton et très-français, il marquera par l'originalité de l'esprit et la force du caractère. Puisse la République avoir quelques appuis aussi sincères, aussi fermes ! ». Un pareil langage pouvait-il ne pas ajouter à la fascination que l'auteur du Précis de l'Histoire moderne et du Tableau de la France exerçait déjà sur son correspondant ? Pour s'y soustraire, il eût fallu plus d'âge et d'expérience. Hâtons-nous de dire que le culte de l'élève pour le maître n'alla pas, plus tard, jusqu'à approuver, sans réserve, les derniers volumes de l'Histoire de France et surtout le livre de l'Amour. De mœurs austères, Lejean, sous une enveloppe et des formes un peu agrestes, cachait une exquise délicatesse de sentiments que pouvaient apprécier ceux-là seulement qui vivaient dans son intimité, délicatesse qui lui faisait regretter dans ce livre maints détails physiologiques qu'il appelait des impuretés.
Si notre témoignage sur ce point était suspecté, nous l'appuierions de ce passage
d'une lettre qu'il écrivait de Paris, le 12 juillet 1852, à Mme Souvestre, un an
après la mort de son mari :
« Son nom, chère Madame, me revient et me
reviendra souvent en mémoire. Il y a quelques jours, c'était ce terrible
anniversaire : rien qu'un an depuis. A l'étendue des regrets, au souvenir de
tout ce qui s'est passé depuis, de tant de changements dans votre vie si
doucement uniforme pendant de longues années, je croyais me reporter à un temps
quatre fois plus éloigné, Je suis allé à Montmorency pour une affaire, le mois
dernier. Je me suis arrêté devant la maison que vous savez : rien n'est changé.
J'ai revu cette allée où je l'ai vu pour la dernière fois, je me suis rappelé
mot pour mot cet entretien que je croyais si peu devoir le dernier.... Tenez,
j'ai tort de vous entretenir de ces choses. Si je ne vous en ai jamais parlé à
Paris, ce n'était pas insouciance, c'était parti pris, intérêt pour vous, —
intérêt malentendu, peut-être, mais sincère. — Je n'ai jamais fait dans ma vie
qu'une de ces pertes irréparables, celle de ma mère, et j'aime
qu'on m'en parle ; mais il y a si longtemps, que cette tristesse n'a plus de
dangers. Il y a deux ans, je reçus chez mon père la visite de quelques personnes
de Morlaix, la femme et les enfants d'un de mes amis. La mère me demanda si
j'aimais cette maison, et comme je disais oui, elle ajouta : « Et puis, elle
vous rappelle votre mère.... ». Ce mot rapide est un des souvenirs de cœur les
plus vifs qui me sont restés, et pourtant, je n'ose jamais réveiller les
douleurs récentes chez les autres ; je croirais leur faire mal. Pardonnez-moi si
je me trompe ».
Rentré à Traondour après avoir cessé d'être employé à la
sous-préfecture de Morlaix, Lejean alla, au mois de juin, combattre dans les
rangs de la garde nationale de cette ville l'insurrection qui, pendant trois
jours, ensanglanta Paris. A son retour, il apprit tardivement que la Société
académique de Nantes avait ouvert un concours sur cette question : Examen
critique des historiens bretons. On touchait au 15 août, et les Mémoires des
concurrents devaient parvenir avant le 1er septembre. Il se mit à l'œuvre en
toute hâte et son Mémoire était reçu en temps utile. Ce n'était, ce ne
pouvait être qu'une ébauche. Aussi, bien qu'il n'eût pas eu de concurrent,
n'obtint-il qu'une mention honorable comme encouragement à se
présenter au nouveau concours, fixé le 20 novembre 1848, à l'année suivante.
Cette fois encore, il entra seul en lice, mais obtint le prix consistant en une
médaille d'or. La Société vota, en outre, la publication dans ses Annales du
Mémoire couronné qui forma un volume spécial sous ce titre : La Bretagne, son
histoire et ses historiens. — Nantes, L. et A. Gueraud ; Paris, Hachette et Cie,
1850, 459 pp, in-8°. — Après l'analyse du livre, M. le docteur Malherbe,
rapporteur de la commission chargée de son examen, s'exprimait ainsi :
« Cet
exposé vous donne une idée de l'étendue, de l'importance des études de M.
Lejean. Rien, ou au moins presque rien, ne manque à l'ensemble ; hâtons-nous
d'ajouter que son appréciation de chaque document est sage, grave et hardie tout
à la fois. Le mérite de chaque auteur est consciencieusement mis en lumière,
mais aussi ses erreurs sont signalées rigoureusement. Ennemi de tendances
exclusives, qui n'engendrent que le faux et l'exagération, il condamne la
manière de ces écrivains qui, ne voulant admettre que des documents officiels et
authentiques, rejettent absolument tout ce qui n'est appuyé que sur la tradition
populaire. Il fait voir que, si les premiers sont la base d'une histoire
sérieuse, ils ne fournissent guère qu'un récit froid et sec comme un squelette
décharné, et que, pour animer la narration, pour réveiller les générations
endormies depuis longtemps, il faut aller chercher le souffle vivifiant dans
les traditions et les fables populaires qui ont conservé la couleur et la
physionomie des temps passés. M. Lejean appartient essentiellement à l'école
historique moderne qui ne croit pas qu'on ait écrit l'histoire d'une nation pour
avoir écrit celle de ses chefs politiques, ou établi d'une manière exacte ses
annales militaires ou administratives. Il sait que la vie d'un peuple n'est
point là tout entière, mais que ses tendances agricoles, commerciales,
industrielles, et jusqu'à ses usages domestiques, ont une grande importance et
méritent l'attention la plus sérieuse de la part de l'histoire, etc., etc. ».

Lejean, comme le dit le savant rapporteur de la commission, avait été hardi. Ses hardiesses avaient atteint quelques personnes qui avaient accrédité ou laissé s'accréditer le bruit que, dans le cours de l'impression de son Mémoire, il y avait introduit des opinions qui eussent été un obstacle à l'approbation qu'il avait reçue. La Société académique de Nantes aurait été ainsi disculpée de la solidarité encourue par cette approbation. Ici une explication est nécessaire. Elle sera nette et précise. La commission avait surveillé l'impression, et il n'avait été fait au Mémoire d'autres modifications que celles qu'avait conseillées le rapport où nous lisons : « Qu’elle avait rencontré çà et là, dans cette œuvre si sérieuse, des traits plaisants et légers dont l'auteur ne lui semblait pas assez sobre, et qui, malgré l'à-propos et l'esprit qui les avaient dictés, s'accordaient peu, suivant elle, avec la gravité du sujet ». Reconnaissant la justesse de ces observations, Lejean avait élagué ce qui les avait motivées, mais n'avait altéré aucun des jugements énoncés dans le Mémoire. Quoi qu'il en soit, les accusations persistèrent. Lejean s'en émut et exhala ainsi son mécontentement dans sa lettre du 14 septembre 1851 : « Il est impudemment faux qu'il y ait quelque chose de subrepticement inséré dans mon livre. On peut collationner le manuscrit. Il y a d'ailleurs les épreuves, on y verra mes corrections marginales ; elles n'ont pour objet que l’addition de choses d'érudition ou le retranchement d'expressions trop sévèrés dans la forme ». Disons toutefois que vingt ans plus tard, au moment de partir pour son dernier voyage, alors que le contact d'une société qui lui était étrangère à ses débuts, lui avait appris à être moins abrupt, il convenait avec nous que s'il était à refaire son livre, il maintiendrait ses jugements, mais en atténuant encore l'expression, sauf pour un seul écrivain, celui dont il avait, suivant M. Malherbe, « frappé rudement de sa verge de critique les mensonges effrontés sur les antiquités bretonnes ». Pour celui-là il n'admettait aucune composition et nous inclinons à croire sur ce point — nous parions au fond — que M. de la Borderie eût partagé son opinion. (Voir la Biographie bretonne, t. 1er, p. 552).
Le temps marchait et Lejean semblait oublier qu'il n'avait pas de position assurant son avenir. Sa famille, pour qui les succès académiques avaient peu d'attraits, voulait pour lui quelque chose de moins aléatoire et surtout de plus fructueux. Il céda à ses intances en allant à Paris pour s'y préparer à l'exercice de la profession de médecin, mais il dut promptement renoncer à ce projet, par suite de la répulsion insurmontable que lui inspiraient les manipulations cadavériques auxquelles les étudiants étaient obligés, répulsion telle que, quelques années plus tard, nous l'avons vu pris de défaillance dans le cabinet de notre ami commun, le docteur Penquer, au simple aspect d'un recueil de planches d'anatomie. Que faire alors ? Demander des subsides à sa famille ? Il la savait mécontente de sa renonciation à un projet qu'elle avait caressé, et il lui répugnait de recevoir quelque chose de ceux qu'il contrariait. Son parti fut bientôt pris. Sa part dans la succession de sa mère consistait dans un revenu annuel de six cents francs. Habitué à la vie sobre et frugale du paysan breton, il vécut et se logea avec une parcimonie dont il ne se départit jamais, même aux jours où il eût pu se donner plus de confortable. Sa collaboration, peu rétribuée d'abord, à quelques journaux d'un ordre inférieur, fut le prélude de son entrée, en la double qualité de rédacteur et de chef de la correspondance, au journal le Pays, patroné par Lamartine, et dont le rédacteur en chef était M. de la Guéronnière. Survint le 2 Décembre. M. de la Guéronnière passa à l'ennemi. Mais le 3, tous ses collaborateurs protestèrent par une lettre que publièrent divers journaux, et le rédacteur en chef resta seul avec son imprimeur. La situation était d'autant plus périlleuse pour Lejean que la lettre du 3 était quelque peu compromettante, et que le quartier où il logeait alors (rue de l'Université) avait été largement partagé dans les massacres du 4. Echappé au danger, il vint, le 18, faire en Bretagne un voyage semi-électoral, semi-personnel. Il était depuis quinze jours chez son père, et se disposait à faire une excursion à Brest, lorsque Lamartine, qui l'avait placé au Pays, sur la recommandation de son secrétaire, M. Ch. Alexandre, ami de Lejean, l’appela inopinément à seconder son ami, et l’attacha à la rédaction du Conseiller du Peuple et ensuite du Civilisateur. Ses émoluments, d'ailleurs plus nominaux que réels, étaient médiocres ; mais ce n'était pour lui qu'une considération accessoire. Ce qui le contrariait le plus, c'était le véritable tohu-bohu dans lequel il vivait. Tantôt le patron lui disait : « Préparez-moi un travail sur la véritable paternité des œuvres d'Homère » ; tantôt c'était le tour de Christophe Colomb, et quand paraissaient les notices consacrées à ces deux personnages, le préparateur était tout ébahi de voir qu'une imagination luxuriante n'avait tenu aucun compte de ses laborieuses recherches. Une autre fois, l'envie prenait au poète historien de spéculer par une histoire de la Turquie, sur la faveur qu'il se supposait acquise par son voyage en Orient. Vite, Lejean de se mettre à résumer l'Histoire de l'Empire Ottoman, de Hammer, en 18 volumes in-86. Nouvelle déception. La fantaisie se substituait encore à ce que le maître jugeait trop aride. Dégoûté d'une semblable situation, Lejean l'abandonna au mois de janvier 1853.
Dans l'intervalle, il avait composé deux travaux qui étaient plus dans ses aptitudes et pour l'exécution desquels il était libre de toute entrave. Le premier est sa notice sur Carhaix, insérée dans l'Annuaire de la Société d’Emulation de Brest pour 1851, 22 pp. in-8°. Ce qu'il y a de plus saillant dans cette notice, c'est une discussion ethnographico-géographique du nom primitif de Carhaix qui, selon lui, aurait été Vorgium, tandis qu'il place à Morlaix l'antique Vorganium. Le second travail était le Mémoire qu'il présenta au concours ouvert pour 1851, par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur nos antiquités nationales, Mémoire ainsi apprécié par M. Lenormant, au nom de la Commission d'examen, dans la séance publique annuelle du 22 août de cette année : « Un érudit jusqu'ici, je crois, peu connu dans la science, a soumis au jugement de l'Académie, des Mémoires et des cartes sur les limites et l'étendue de l'Empire carlovingien, sur la France envisagée dans son aspect ethnographique et dans sa division féodale, et même sur les Cimmériens rattachés à notre histoire par d'antiques ramifications et des souvenirs primitifs. Le temps n'est pas encore venu de porter un jugement sur les efforts de M. Lejean : il ne nous a d'ailleurs transmis que des documents incomplets ; mais on y démêle, dès à présent, un esprit vigoureux, et qui ne recule pas devant les grandes difficultés. Sa carte de la France féodale, à laquelle il manque malheureusement un Mémoire explicatif, peut servir à combattre avec avantage l'idée inexacte que, d'après la France de 1789, offerte à l'attention des enfants, au début même de notre éducation, on se fait généralement de la division politique de notre pays au Moyen-Age. ».
La carte de la France féodale, commencée depuis cinq ans, était le travail dont Lejean s'occupait le plus à cette époque. « Ma grande France féodale avance, nous écrivait- il, le 13 mai 1851 : Le Comté de Toulouse, la Gascogne, le Berry, le Comté de Barcelone, le Maine, l'Anjou, l'Auvergne, le Comté de Paris, Paris, sont à peu près faits depuis longtemps. La Normandie, le Barrois, le Lyonnais avancent. La Bretagne, la Flandre, le Vermandois, l'Aquitaine, la Champagne, la Bourgogne, le Comté de Blois sont encore à faire. Ce sera un beau travail s'il se finit, un vrai monnument national. Je ne parle pas de son exécution qui n'est ni bien ni mal, mais de l'idée en elle-même, un atlas de l'ancienne France ». Puis il ajoutait : « Je fais quelquefois de l'ethnographie, car je suis obligé, pour ne pas m'esquinter, de varier un peu ; j'aime d'ailleurs les choses où il y a des découvertes à faire. J'ai été saisi d'une grande émulation en voyant la fameuse carte ethnographique de Schaffarick, les Slaves. Je veux faire, sur un plan un peu différent, les Celtes, et je crois que je réussirai ».
L'encouragement qu'il avait reçu en 1851 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le détermina à concourir de nouveau. Il n'était pas bien fixé sur le choix du sujet qu'il aurait traité. Celui qui l'attirait le plus était un des cinq suivants : Clovis (1 vol.) ; Charlemagne (2 vol.) ; Louis le Gros et les Communes (2 vol.) ; Histoire du règne municipal en Gaule, sous les deux premières races ; Histoire des forces productives de la France au Moyen-Age. De ces cinq sujets, les trois premiers étaient en voie d'exécution depuis plusieurs mois, et celui qui avait sa préférence était Clovis ; mais il craignait qu'il ne fût pas généralement goûté. Il se décida pour le dernier.
Tout en se préparant au prochain concours, il collaborait, depuis 1853, à la Nouvelle Biographie générale, à. laquelle il s'était engagé à fournir environ quatre cents articles sur des voyageurs ou géographes omis ou insuffisamment traités dans les biographies antérieures. Ses articles Cada-Nosto, Croyate, Comas, ceux sur les maisons de Coucy, de Courtenay et de Craon, les articles Dales, Douville et Egède furent les premiers résultats de cette collaboration à laquelle il renonça pour celle qui lui fut offerte au Magasin pittoresque, ou il fut chargé de la partie géographique, en remplacement de M. Marc-Carthy. Les articles qu'il y inséra étaient, ou descriptifs, comme ceux de Candie, Modon, Tombouctou, les Sources du Nil, etc., ou biographiques, comme ceux de Walknaer, Franklin, Pomponius Méla, etc. Mais ceux de ses articles qui eurent le plus d'attraits pour lui, comme pour ses lecteurs, étaient ses causeries géographiques, prélude de la rénovation de l'enseignement géographique par la substitution des descriptions pittoresques aux arides nomenclatures classiques. Et qu'on ne s'imagine pas que ses travaux à la Nouvelle Biographie générale et au Magasin pittoresque l'empêchassent de traiter d'autres sujets. Ainsi, en 1854, il insérait dans le t. II de la Revue des Provinces de l'Ouest, l'article : La légende et l'histoire, Conan Mériadec, article dans lequel il s'est attaché à exposer les nuances plutôt que les dissentiments qui le séparaient de M. de la Borderie, dans la question historique de la colonisation bretonne, vigoureusement développée par ce dernier (Biographie bretonne, Conan Mériadec). En même temps, il faisait paraître (avril 1854) dans un recueil périodique, intitulé Babel, Revue encyclopédique du XIXème siècle, qui n'eut, croyons-nous, qu'une existence éphémère, un article Origines françaises, traitant de l'histoire des races qui ont concouru à l'enfantement et au développement de la France.
Cette multiplicité de travaux ne nuisait pas à la Carte de la France féodale, car au mois d'octobre 1855, il se disposait à entamer la publication du texte explicatif, en plusieurs volumes de 7 à 800 pages in-8°, dont chacun eût contenu un ou deux grands fiefs. Il est probable toutefois qu'il en cet distrait la Bretagne. En effet, ayant appris que M. de la Borderie avait, de son côté, dressé une Carte de la Bretagne féodale, au moyen des titres déposés aux archives de l'ancienne Chambre des comptes de Nantes, il nous écrivait, le 4 décembre 1855 : « Ce sera, je l'espère, un événement dans la géographie comparée, et j’applaudirai à ce succès ». Déjà, lors du congrès de l'Association bretonne tenu à Lorient, au mois d'octobre 1848, il avait proclamé la compétence de M. de la Borderie dans la note suivante accompagnant son travail intitulé Browerech, inséré pp. 3-15 du t. 1er, 2ème partie du Bulletin archéologique de cette association « Ce travail, qui n'est qu'un fragment détaché d'une étude plus complète sur l'ancienne géographie de la Bretagne, a été par nous communiqué comme essai à l'Association bretonne (congrès de Lorient) ; nous en avons depuis élagué des assertions inexactes ou hasardées, résultats d'une première rédaction très-hâtive, et nous remercions vivement notre compatriote et confrère, M. A. de la Borderie, des conseils pleins de bienveillance et cordiale critique dont il nous a aidé dans cette révision ».
Deux ans auparavant (8 juillet 1853), l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sur le rapport de M. Beugnot, avait décerné à Lejean le prix ordinaire de 2,000 francs pour son Mémoire sur cette question : Comment et par qui se sont exécutés en France, sous le régime féodal, depuis le commencement de la troisième race jusqu'à la mort de Charles V, les grands travaux, tels que routes, ponts, digues, canaux, remparts, édifices civils et religieux. Sujet aussi vaste qu'intéressant et qui fait regretter que ce Mémoire n'ait pas été publié.
Ce succès assurait son avenir. Quoi qu'il en soit, il est peut-être continué quelque temps encore d'éparpiller ses forces, si une circonstance fortuite ne l'avait conduit à se concentrer et à entrer dans sa véritable voie, celle des voyages. Il suivait les cours de M. Guigniaut, au Collège de France. Un jour, un des passages de la leçon du professeur ayant paru à Lejean motiver quelques objections, il les exposa respectueusement dans une lettre que M. Guigniaut lut à la séance suivante avec invitation à son auteur de venir conférer avec lui, ce qui eut lieu. M. Guigniaut se prit bientôt de sympathie, d'affection, pourrions-nous dire, pour son correspondant, et désireux de le faire connaître et apprécier des juges les plus compétents, il lui conseilla de se présenter à la Société de géographie.
Admis le 1er février 1856, sur la présentation de MM. Jomard et Alfred Maury, et bientôt nommé membre de la commission centrale, il paya sa bienvenue, le 4 avril suivant, par sa Notice sur l'intérieur de la Guyane française (Bulletin de la Société, 4ème serie, t. XI, pp. 246-264), notice contenant l'analyse des voyages et des travaux exécutés, à diverses époques, dans cette colonie. La notice sur la Guyane fut presque immédiatement suivie d'un savant Mémoire intitulé : La Gaule de l’anonyme de Ravenne (Ibid. t. XII, pp. 185-266), au sujet duquel M. Alfred Maury s'exprimait ainsi dans le compte-rendu des travaux de l'année (Ibid. t. XIII, p. 20) : « Vous avez retrouvé dans ce travail le soin consciencieux que l'auteur apporte dans toutes ses recherches ; sa tâche a été souvent aride et ingrate…. On ne saurait donc trop encourager des travaux comme ceux de M. Lejean, dont la modestie nous avait fait ignorer longtemps la science ».
Cette science, M. Guigniaut voulait qu'elle fût connue de tous. Dans ce but, il demanda à M. Fortoul, au commencement d'avril 1856, pour son protégé, une mission en Turquie. Considérant comme infaillible le succès de la démarche de M. Guigniaut, Lejean nous écrivait le 21 avril : « Vous avez, ce qui ne m'étonne pas, pris intérêt à ma bonne fortune, et je vous en remercie. Mon voyage durera jusqu'à l'automne ; la subvention sera très-maigre, je le crains, et j'y mettrai du mien plutôt que de le tronquer. Je serai seul et refuserai nettement un collaborateur, au cas peu probable où l'on m'en donnerait. Ce voyage sera fatigant plus que dangereux. Le plus grand danger, c'est celui avec lequel j'ai déjà à compter. Croiriez-vous que les fièvres du Danube, les casse-cous des Balkans et les balles des Haïdanks, ne me font rien à cette heure, comparés à ceci : les amis. Voici comme : les missions dépendent du Ministère de l'instruction publique. Or, les puritains, les amis du peuple, qui mangent leurs rentes doucettement, ou qui se font 12,000 francs par an à la Bourse ou au Crédit-Mobilier, crieront que j'ai pactisé avec le 2 Décembre, que je suis rallié, etc. ; et de très-honnêtes gens, dont l'estime m'est chère, le croiront. Notez que non-seulement ce vendu est décidé à ne pas bénéficier d'un centime sur la mince subvention de l’Etat, mais qu'il y est déjà pour 900 francs de sa poche, ayant lâché, il y a trois mois, pour se préparer à ce voyage, une place de 300 francs par mois [Note : Allusion à un emploi qu'il avait occupé dans les bureaux où se préparait l'Exposition universelle]. Voilà ma seule épine, mais elle ne me sort pas, et je suis sûr d'avance de ce qui se dira. C'est triste. Ceux à qui je ne conteste pas leur goût pour la flânerie ou pour l'agiotage, ne peuvent-ils me laisser le mien pour des travaux utiles, plus utiles au progrès que les tartines humanitaires de ces messieurs ? — Voici le but de mon voyage : lever la carte des pays compris entre le Danube, la Serbie, le Montenegro, Ochrida, Sophia, Philippopoli, Andrinople, Gabrova, Routschouk (Bulgarie occidentale, Albanie septentrionale, Serbie turque, haute Thrace) ; étudier la géographie comparée d'icelles, l'ethnographie, l'agriculture, la géologie (que j'étudie en ce moment). J'attends de très-grands résultats, le terrain est vierge ou à peu près. Vous verrez, au retour, mes cartons et mes collections. J'apprends à dessiner à force, car j'aurai à copier des vues, des types, des monuments. Voici mon itinéraire projeté : Vienne, Pesth, le Danube, Routchousk et Bucharest, Gabrova, Slivore, Andrinople, Sophia, Vrania, Kouircheumli et Prekop, Pristina et Djakova, Plava, Scutari, son lac, le pays des Myrdites, Ochrida est et le bassin du Vardar, puis j'aboutirai probablement à Salonique. Mais il n'y a rien de bien déterminé, j'attends toujours le dernier mot ».
Le dernier mot déjoua ses espérances. Comme Perrette, il avait fait des châteaux en Espagne. M. Fortoul, à qui il avait adressé son plan, lui répondit le 17 mai 1856 :
« Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous-m'avez fait l'honneur de m'écrire pour me soumettre un projet de mission dans la Turquie d'Europe. Je crois, comme vous, Monsieur, qu'une exploration nouvelle et bien dirigée serait d'un grand profit pour la science, et je suis certain, d'après tout le bien que M. Guigniaut m'a dit de vous, que je n'aurais qu'à m'applaudir de vous avoir confié cette mission. Malheureusement, le crédit affecté au service des voyages scientifiques est absorbé et ne me permet pas de contracter des engagements pour l'avenir. Je regrette donc vivement, Monsieur, de ne pouvoir, pour ce motif, utiliser votre savoir et le zèle qui vous anime pour le progrès de la science ».
Agréez, etc.
Le Ministre avait eu beau dorer la pilule, la déception de Lejean fut d'autant plus vive qu'il avait plus compté sur une issue favorable. Son mécontentement s'exhala presque immédiatement dans cette lettre adressée à Mme Souvestre :
« CHÈRE MADAME,
Je ne vous ai parlé de mon voyage qu'au
dernier moment, et cependant je me suis probablement trop pressé. J'ai reçu,
jeudi soir, en vous quittant, une solution provisoire, négative pour cette
année. Reste à savoir s'il me plaira de rester, l'an prochain, à la disposition
de ceux qui, après m'avoir fait quitter, en novembre dernier, une position
lucrative pour préparer mon voyage, viennent me dire que la caisse
des missions est à sec. Six mois pour me répondre ! La saison est bien avancée
pour préparer autre chose, mais je n'ai pas à choisir. Me voilà devenu Scipion
l'Africain. Le pire qui puisse m'arriver, c'est de manquer encore le Nil et le
désert, et de vous voir prosaïquement en Bretagne dans cinq mois ; trouvez-moi
donc à plaindre.
Vous m'avez un peu raillé, chère Madame, de ce qui vous semblait chez moi une fantaisie de géographie. J'ai eu si peu de temps à vous en causer que je n'ai pu vous prouver que c'était une chose très-raisonnée (ce qui ne dit pas que ce soit plus raisonnable pour cela). En premier lieu, je vous dirai que j'ai été reçu dans le monde érudit avec une bienveillance qui s'adressait, non à ce que j'avais fait, mais à ce qu'on attendait de moi. A ce monde-là, j'ai une dette à payer. Par une grande exploration réussie, je m'acquitte en un an ; par des travaux de cabinet, en dix. Qui est sûr d'avoir devant soi dix ans de loisir, de liberté, de santé, de vie même ?.
Second motif, très-sérieux ; il est temps que je fasse ma position. Par inclination je ne suis nullement fait pour une vie de fantaisiste. Le monde est très-sévère pour les gens qui mènent cette vie-là, et, en gros, il a raison. Je ne parle pas de devoirs sociaux (car il n'est nullement prouvé que l'homme qui se doit à ses parents et à ses amis, se doive à une société qui ne s'occupe guère de lui) ; mais là où d'autres voient un devoir, je vois pour l'homme une question de dignité ; le résultat est le même. Une fois que j'aurai attaché mon nom à une œuvre bonne et utile, qui aurait le droit de regarder au temps que j'ai perdu ! Puis, pour asseoir mon avenir, un succès est un titre, et si les voyages ne m'en fournissaient pas un , il faudrait y suppléer par une voie qui m'est antipathique, les bureaux et le reste.
J'en ai causé samedi, très au long, avec Charton. Vous savez quelle confiance j'ai en lui, en son jugement, en sa chaleur d'âme et de sympathie. Il m'a fort surpris ; il aime les voyageurs, mais si ses amis songent à voyager, il va presque jusqu'à les traiter de fous. Il m'a répété ce qu'il vous avait dit jeudi, que le premier venu pourrait avec un peu d'audace mener à bonne fin une chose de ce genre — je le nie —, que j'étais destiné à me faire autrement une place dans la science ; qu'il y avait dans la géographie française une haute place vide à remplir, etc., etc. Mais les moyens pratiques ont amené une dissidence très scabreuse, où nous n'avons pu nous entendre. J'ai été cependant soulagé de pouvoir lui parler à cœur ouvert, car j'étais oppressé de mon échec. Une dernière considération : je mène depuis plusieurs années une existence facile où je m'habitue à défiler ma vie sans efforts et sans secousses. J'ai besoin de sortir de cette flânerie et de faire une station dans la vie réelle : prendre l'existence au collet n'est jamais un mal ; et je tiens assez à m'essayer moi-même.
Vous allez, chère Madame, voir Morlaix, une petite ville où je ne suis guère en odeur de sainteté. Je connais mon bilan, et je vous en fais grâce. Ah ! si j'avais voulu rester chef de bureau de la sous-préfecture, — un pouvoir — et donner quelques espérances de conversion catholique !... Les quelques familles du lieu qui m'ont conservé, de plus en plus vives, leurs sympathies d'avant 1818, m'en sont d'autant plus chères, et des affections qui ont résisté à l'entraînement de la voix publique, sont de grandes et solides réalités ».
Mme Souvestre essaya de mettre du baume sur sa plaie, mais elle était encore trop saignante. Son mécompte l'avait profondément affecté. Témoin sa réponse du 31 mai 1856.
« CHÈRE MADAME,
Votre lettre m'a été bien douce, et l'aurait été
encore plus, si elle n'avait été attristée par les nouvelles que vous me donnez
de la santé des vôtres. Je comprends d'autant mieux vos inquiétudes que j'en
éprouve du même genre, pour mon père dont la santé est assez compromise par les
travaux auxquels il ne se trouve pas d’âge à renoncer.
J'aurai, sans doute,
à mon prochain voyage chez moi, quelque chose à faire sur ce point. J'ai bon
espoir, et j'espère aussi que l'état de santé dans lequel vous avez trouvé votre
mère, tient beaucoup plus aux derniers jours de la mauvaise saison qu'à une
vieillesse qui peut encore se prolonger quelques années, entourée et consolée
par ces soins affectueux qui prolongent la vie en la rendant douce à porter. Nos
craintes sont toujours en raison de nos affections, et je prends plaisir à
penser que votre sollicitude s'exagère la réalité.
Vous me parlez longuement de mon voyage, et avec des paroles qui m'ont fait du bien. Je suis fort triste en ce moment, triste de l'échec le plus sensible que j'aie éprouvé depuis des années. Mon voyage en Orient est différé, me dit-on, de neuf mois environ ; mais, après ce qui s'est passé, quel fonds faire sur des assurances verbales ? Je m'y raccroche cependant, mais avec défiance, et en m'occupant des autres choses qui peuvent me servir. J'ai renoncé aux deux voyages d'Afrique, peu attiré par leurs conditions actuelles, qui soit inférieures.
J'entre parfaitement dans les excellentes choses que vous me dites, tout en vous demandant à m'expliquer sur certains points où j'ai trouvé prise à de petits malentendus. Vous ne comprenez pas mon impatience, à mon âge, chère Madame ; je dépasse trente ans, et depuis dix ans environ que je donne des espérances, je trouve ridicule de ne donner que cela. Je serais plus patient si on me garantissait encore dix ans assurés (j'espère bien atteindre le XXème siècle, mais je ne suis pas sûr d'une année). La bienveillance de mes amis et de mes confrères a tiré sur moi une traite qu'il est de ma dignité d'acquitter... Donc, mon échec modifie mes plans d'emploi de ma fin d'année. Je vais partir pour Nantes où se tient le Congrès des Sociétés savantes de France, ensuite je me rendrai en Angleterre, où j'ai des documents à recueillir. A mon retour, je compte rester trois mois en Bretagne pour travailler avec ardeur sur les documents que j'aurai rapportés de Londres, d'Oxford et du Congrès de Nantes ».
Cette lettre se terminait par ces boutades humoristiques :
« Madame Michelet a reçu philosophiquement l'affreuse nouvelle de la triste fin de Pluton. Elle m'a avoué que ce malheur qui l'aurait affectée il y a deux ans, lui est moins sensible aujourd'hui après une séparation déjà ancienne. Je soupçonne un animal de rouge-gorge, insolent, querelleur et estropié, d'être le remplaçant de Pluton, et cela ajouté à la haine que m'inspire cet oiseau. Je suis heureux de constater que depuis huit jours, il commence à céder le terrain à un gros hanneton que Mme Michelet nourrit, blanchit, dorlote, et surtout étudie, ce dont ce coléoptère, qui risque de se voir imprimé dans six mois, n'a pas l'air de se douter.... Les enfants sont très-gentils, mais on devrait bien ne les avoir qu'à quatre ans bien sonnés ».
Si M. Fortoul n'avait voulu engager ni l'avenir, ni même le présent, il en fût de même de son successeur, M. Rouland qui, sur la recommandation de l'Académie des Inscriptions, chargea Lejean, mais à titre gratuit, d'une mission ayant pour objet des recherches géographiques et ethnographiques en Moldavie, en Valachie et en Bulgarie.
La condition de gratuité. n'arrêta pas Lejean. Il était si impatient de visiter l'Orient, qu'il n'hésita pas à consacrer à son excursion le montant du prix que lui avait décerné l'Académie et les économies provenant de son emploi dans les bureaux de l'exposition.
Parti de Paris, le 8 avril 1857, il nous écrivait de Bucharest, le 17 mai, une longue lettre d'où nous extrayons les passages suivants :
« Le jour même de mon départ, je recevais votre bonne et longue lettre, et j'y répondais en vous envoyant le livre que vous demandiez. L'avez-vous reçu ? Le soir, je prenais la route de Bucharest par la Belgique, l'Allemagne du Nord, la Bohême, l'Autriche ; quel détour ! J'ai vu Cologne, Hanovre, Leipzig, Dresde, Prague, Vienne. J'ai vu.... (Quand aura-t-il tout vu ?) Eh bien ! J'ai vu à Vienne deux Juives d'une beauté renversante. Je n'ai pas été renversé ; mais, étant resté quelque temps à les admirer, et ayant entendu un monsieur qui les accompagnait, prononcer le mot Bucharest, j'ai lié connaissance avec ce monsieur (pas avec les demoiselles, hélas !) qui était leur frère. Il allait en Valachie, où il est négociant. C'est un jeune homme de vingt-quatre ans, parlant six langues, d'une obligeance exquise ; nous nous sommes liés très-fort, il m'a rendu mille services. Un hasard heureux ayant fait que nous nous arrêtions aux mêmes points, nous ne nous sommes pas quittés. Il a des sœurs mariées un peu partout, de sorte qu'il me pilotait gracieusement dans beaucoup d'intérieurs israélites. J'ai pu revenir ainsi sur bien des idées fausses à l'égard des Juifs. Je n'aurais pas cru que l'esprit de famille fût aussi vif parmi eux. Dès qu'on a franchi le seuil de ces maisons à porte basse, lourde et misérable, derrière laquelle ils semblent se retrancher contre la jalousie et la cupidité, on passe dans une maison à style mauresque, légère, aérée, dans un salon rempli de fleurs et entouré de divans, où une jeune femme, d'une beauté délicate et sévère, vient vous offrir sur un plateau le café ou les doulcheatz d'usage, que vous acceptez en portant, la main au front en guise de salut. Du reste, cette hospitalité n'est pas particulière aux Juifs ; elle est générale dans ce pays-ci avec quelques variations : ainsi, chez les Serbes, un visiteur célibataire ne voit pas les dames de la maison, tandis que chez les Valaques, ce sont surtout elles qui font les honneurs de la casa.
J'ai donc parcouru l'Allemagne du Nord, vu les fêtes de Pâques à Vienne, et pris à Pesth le bateau du Danube. C'est ainsi que j'ai traversé la Hongrie, vrai vestibule de l'Orient. Le fleuve coule entre la rive occidentale, couverte de villages et de cultures, et la rive orientale, la la fameuse Putza, immense plaine d'alluvion, où l'on ne voit guère que quelques troupeaux conduits par des bergers à cheval — Hungari calcati nascuntur — « les Hongrois naissent tout éperonnés », dit un proverbe du pays.
Ces Hongrois sont vraiment une belle race, tournure fière, aspect un peu sauvage avec leurs moustaches sans fin. Il n'est pas jusqu'à leurs bœufs qui n'aient des cornes d'une longueur... ! Le costume des paysans a deux couleurs : le blanc et le noir ; et a de grands rapports avec ceux de nos Bretons du centre du Finistère, vers Brasparts, où sont les pillawers ; mais il y a de plus chez les Magyars, un grand manteau blanc : le pantalon est quelquefois très-étroit, quelquefois (surtout dans la plaine) tellement large, qu'il ressemble à un jupon.
J'ai débarqué à Semlin, dernière possèssion autrichienne, dans l'intention de passer à Belgrade que je voyais en face, le Danube entre nous deux. J'y ai passé en un quart d'heure ; trajet fort court, où j'ai vraiment franchi la limite des deux mondes. Comme c'est bien l'Orient, que cette ville à la fois serbe, turque et juive ! Au débarqué, je me trouve en face d'une espèce de bandit, vêtu en paysan aisé, avec une ceinture ornée d'une ferraille suffisante, au besoin, à défendre un fort détaché. Ce brigand pittoresque est un gendarme serbe qui me demande mon passeport. Le reste à l'avenant.
Belgrade est une ville médiocre comme étendue et comme population. Elle n'a pas plus de 21,000 habitants, dont 15,000 Serbes. La citadelle est aux Turcs, qui fournissent des troupes aux portes de la ville ; satisfaction innocente et qui ne tire pas à conséquence, car les Serbes sont bien là chez eux et y font tout ce que bon leur semble. La ville est sans monuments ; églises et mosquées sont modernes ; les ruines du palais du prince Eugène sont les seules antiquités du pays.
Les Serbes sont un peuple agricole et pasteur, et leurs villes existent à peine ; cependant à Belgrade, il y a un mouvement littéraire remarquable, et dont je voudrais vous parler si le loisir ne me manquait.
Je vous avouerai que je suis fanatique de la Serbie, où j'ai passé huit jours. Comme pays, comme race, comme individus, comme État politique et social, ce petit pays, qui peut équivaloir à sept ou huit départements français, est vraiment un modèle. Vous savez que la Serbie est libre, bien que les Turcs aient conservé la citadelle de Belgrade. Le gouvernement est représentatif. Le chef de l’Etat est un hospodar (prince) de la famille de Kan-George, le libérateur. Il y a un Sénat nommé par le suffrage le plus large, et les paysans forment dans ce pays agricole une partie considérable de ce Sénat. L'impôt est très faible ; l'instruction publique est énormément développée, le paupérisme est nul, car tout le monde trouve du travail. Depuis que le pays est libre, tout le monde est armé ; chaque maison doit avoir tant de fusils, de pistolets, de kandjars, etc; inspections et exercices à des époques fréquentes ; et, quand le tambour bat, on a sous les armes 120,000 hommes qui ne sont pas à dédaigner. J'ai pu les comparer sur place aux troupiers turcs, et je puis vous affirmer que ceux-ci ne brillent guère à côté. Vraie liberté, car chacun fait ce qu'il lui plaît, à condition de ne pas nuire aux autres ; vraie égalité, car tous ont les mêmes droits civils ; pas de classe privilégiée, pas de servilité ; vraie fraternité enfin, car l'esprit familial et national y a une force inouïe, et il n'y a pas de haine de classe, puisqu'il n'y a pas de riches et de pauvres, mais des gens aisés et des travailleurs aspirant à le devenir. Pour dernier trait, la moralité est telle que, l'an dernier, le nombre de naissances illégitimes, à Belgrade, a été de 8, et dans la province du même nom, 0.
Ma curiosité, pleinement satisfaite sur Belgrade, je suis retourné à Semlin reprendre le paquebot, et en un jour et demi, je suis arrivé à Giurgewo. Je vous ferai grâce des rives du Danube. Elles sont pourtant admirables, principalement jusqu'à Widdin, car au-delà elles s'aplatissent, et si le fleuve y gagne comme majesté, il y perd comme encadrement.
J'ai passé dans l'après-midi les fameuses Portes-de-Fer : c'est un rapide qui doit être très dangereux pour la petite navigation, mais le vapeur se joue de cet obstacle. A Turnul-Severino, j'ai pu admirer les ruines du pont de Trajan ; et je dis admirer, car il a fallu une forte main pour jeter un pont sur un pareil fleuve.
Il faisait nuit quand nous avons passé à Widdin et à Kalafat ; c'est dommage, j'aurais aimé à voir tout cela, le sérail du pacha de Widdin sur le bord du fleuve, et ces champs de bataille où, entre Turcs et Moscovites, a commencé.
Cette lutte d'Orient, terminée à Sébastopol. Plus loin, nous apercevons Nicopolis, et débarquant à Giurgewo, où l'on s'est encore assez bien battu en 1854, j'ai gagné de là Bucharest par terre, à travers une contrée presque déserte, misérable ; par ci, par là, quelques puits et quelques amas d'informes cabanes. Bucharest fait une heureuse diversion à ce triste aspect : figurez-vous une ville de 130,000 âmes qu'on ne peut voir que quand on y entre, tant elle est enfouie dans un fouillis d'arbres et de vergers qui la rendent ravissante à la vue. En effet, à part un corps assez maigre et de très-longs bras, comme l'araignée, Bucharest se compose de machalas ou quartiers extérieurs groupés autour de 107 églises ; c'est-à-dire, que chaque maison est le centre d'un enclos, jardin ou verger, et le tout forme des agglomérations ravissantes. J'ai loué pour six mois la moitié d'une villa de ce genre, l'autre moitié était habitée par une famille de petits boyards, excellentes gens dont je suis le commensal moyennant un arrangement des plus commodes, et qui m'entourent de soins et d'attentions. J'y goûte le plaisir de travailler en paix, d'avoir à mon gré trois choses que j'adore soleil, ombre et verdure, une véranda pour prendre le frais quand je veux... J'ai trouvé ici une masse de documents dont je tire grandement parti. Rien que ce que j'ai déjà réuni suffirait pour honorer ma mission ; ainsi, soyez rassuré sur ce point.
Je pars demain pour une excursion en Turquie, où je passerai huit jours entre Routschouk et Tirnova. J'abrègerai, car j'apprends par le consul et les journaux que la route est salie de brigands. Si cela est, le pacha de Routscliouk en sera quitte pour me prêter des gendarmes. Après ces huit jours, je reviendrai à Bucharest, d'où je passerai en Moldavie et à la nouvelle frontière, et de là, s'il se peut, dans la Dobrudja ; mais je n'ai pas encore de parti pris. La saison, du reste , rend la position de Bucharest très salubre, et je me porte à merveille.
Que vous dirais-je de ce peuple ? Quelque bien et beaucoup de mal. Plusieurs qualités françaises : l'amabilité, la sociabilité ; comme défauts, une servilité énorme dans tontes les classes, et, dans l'aristocratie, l'immoralité des femmes. J'oubliais aussi deux choses un patriotisme ardent, prêt à tous les sacrifices, et peu de constance dans les affections de famille ou autres. Puis, je ne trouve pas que ce soit un peuple brave quelques hommes savent risquer leur vie, mais ils sont rares, et ils ont beau mépriser les Grecs et les Serbes, ces deux peuples ont sur eux l'avantage de savoir pro patrià mori. « Je déteste les Grecs, me disait l'émigré valaque Bolliac, mais ils valent bien plus que nous ; ils sont une nation ! ».
Physiquement, c'est une race admirable que les Valaques. La beauté, qui est l'exception en France, est ici la règle. Aussi, les yeux finissent presque par se blaser. Quand on a vécu au milieu du fracas ridicule des toilettes parisiennes, des crinolines, des chapeaux invisibles et de tout ce joli prétentieux, on admire avec un bonheur inouï la grâce orientale et la sévère poésie des costumes roumains, juifs, serbes, bosniaques, bulgares ; ici, la femme du plus pauvre ouvrier, assise, le dimanche, à la porte de son petit jardin, en robe de borandjik (soie crue), ou en peignoir lamé d'argent, avec un collier de ducats, et coiffée de ses longues tresses noires mêlées de jasmins, vous fait rêver de Diane ou de Polymnie. Ici, rien n'est commun ; c'est souvent barbare, mais cette barbarie est noble comme tout ce qui est la nature… ».
A cette lettre succéda la suivante, datée de Bucharest, le 2 juillet 1857 : « Depuis ma lettre du 17 mai, il y a eu un changement dans ma situation. J'ai fait un voyage en Turquie, excursion de quinze jours, fructueuse sous bien des rapports, mais du reste assez ruineuse. Il. est vrai que je voyageais en prince, avec mes gens, drôles de types. Ce qu'il y avait de curieux, c'étaient encore mes zaptiés (gendarmes irréguliers) que les pachas me prêtaient : Turcs fort pittoresques, vêtus dans le vieux goût, turban, large pantalon brodé, veste idem, ceinture avec toute l'armature obligée et le tchiboucq en guise de carabine. Ces braves gens me gardaient et me témoignaient zèle et courtoisie et recevaient sans observations mes batchick (gratifications, peu ou beaucoup). En revanche, un suroudji (postillon), Tzigane à face d'acajou, toujours enveloppé dans son immense ceinture rouge, n'était jamais content. J'ajoute à ce portrait celui du kiradji (courrier). Panaioti, bulgare chrétien, farci de signes de croix, maître fripon, soigneux de moi, du reste, me faisant des comptes d'apothicaire. A Roulschouk, j'eus une tentation de me plaindre au pacha qui lui aurait fait donner cinquante coups de bâton pour me faire plaisir, mais je suis parti trop rapidement. Ce pacha lui-même était un singulier type : grand seigneur, très-bonnes manières, me répétant plusieurs fois qu'il était civilisé et noble, pas comme un tas de porte-pipes de la veille dont on fait des visirs du lendemain. Seulement, ce fils d'Osman, si civilisé, faillit assommer sous mes yeux un malheureux domestique pour une faute des plus légères.
Au tiers de ma route, je trouvai les zaptiés un peu chers, et je m'en passai. Le dernier que je lâchai à Bjela, avait un air narquois qui me déplut, car nous allions entrer dans une grande forêt et l'on parlait de brigands. Que Dieu me pardonne mes soupçons ! mais, dans ce pays, gendarmes et brigands ne sont pas aussi ennemis qu'il le fraudrait. J'avais passé une nuit, à Bjela, j'avais fait sensation, on pouvait avoir monté un coup. J'arme mes deux pistolets, et je me lance dans la forêt suivi du suroudji (pour comble de chance, je venais d'humilier cruellement ce sire, à propos d'une proposition malhonnête et trop turque qu'il m'avait faite). J'en fus pour mes frais de bravoure : pas un chat, mais deux superbes tortues, grosses comme des plats à barbe. J'avais envie de les capturer pour orner votre chambre aux bêtes (celle où je couche quand je vais chez vous), franchement c'était trop lourd.
Délivré dos brigands, je continue ma route , sans grands accidents. A Kotschilan, on refuse de me loger, mais je fais la grosse voix. Je montre mes lettres pour Osman-Pacha, kaïmakan de Tirnova ; le cachet turc fait merveille, on me loge à la bulgare. Quand on voyage en Turquie, voici comme on loge : on arrive à sept ou huit heures du soir au village ; on s'adresse au maire (tcharbadji), littéralement soupier, car il est censé veiller à ce que le voyageur ait sa soupe et le logement. Ce municipal vous loge chez un paysan qui s'occupe de vos chevaux, la ménagère balaie la terrasse, y étend une natte, un tapis, des coussins, vous vous installez en attendant le souper. Les importants du village viennent vous y voir, causer de Stamboul et de Franghistan. Puis la femme ou la fille du logis vous verse de l'eau sur les mains, apporte un grand plateau de bois sur lequel est le souper, composé de pain fraîchement cuit et tout chaud, pas trop mauvais, de soupe, d'œufs au plat, d'une sorte de pâtisserie et de yaourst (gros lait) jamais de viande. Puis, vous vous roulez dans votre couverture de cheval, et vous vous couchez sur le tapis. S'il fait mauvais temps, tant pis pour vous ; s'il y a des puces (il y en a toujours), tant pis encore. Le matin, on déjeune à peu près de même, car on ne mangera pas avant le soir ; on monte à cheval, on part, et votre hôte vous donne au diable, car vous avez dérangé son monde, et consommé ses denrées et son fourrage, sans payer un sou, vu que c'est un chrétien, un raya. Moi, je payais, de sorte que ces bons Bulgares me prenaient pour un gospodin inglis (un seigneur anglais) et me baisaient les mains ; les Turcs me regardaient, je crois, comme un niais, de payer quand je pouvais m'en dispenser ».
La lettre adressée de Bucharest, le 10 juin 1857, à Mme Souvestre, ajoute, sur les mœurs
orientales, quelques détails intéressants :
« CHÈRE MADAME,
Au retour
d'un voyage en Turquie je trouve votre longue lettre. Vous êtes bien bonne
d'avoir compris que, si une lettre me fait du bien, c'est en raison directe de
son étendue. Elle m'a fait songer, ce qui n'est pas toujours un bien pour moi.
Vous aviez l'attention délicate de vous enquérir de ma santé, de ma situation.
Ma santé n'a cessé d'être bonne, et ma situation doit me satisfaire. Il est
vrai que je songe qu'on m'a promené, à Paris, deux ans pour ne me rien donner ;
qu'on a cru me rendre un grand service en me donnant, un titre gratuit en
échange de découvertes réelles à faire ; que ce titre même m'oblige à une tenue,
et me défend certaines ressources, de donner des leçons, par exemple ; que 1,000
francs pris à propos sur la Caisse des Missions me sauveraient du désagrément de
manquer le plus précieux de ma mission, mon voyage dans la haute Albanie ; que je
n'aurais pas ces 1,000 francs, mais qu'on en trouvera probablement 15,000 pour
un petit monsieur chargé d'aller chercher des monuments grecs dans la Corse
ou dans la Martinique ; que, quand j'ai gagné quelques ducats à Bucharest, il
faut que j'aille les dépenser sur la rive droite ; et quand ils sont mangés, je
revienne travailler de nouveau pour les dépenser encore ; qu'il faut
cependant que, pour tous ces Valaques, j'aie l'air d'avoir les poches remplies
de l'or officiel, parce que si on me soupçonnait de n'être que ce que je suis —
un voyageur résolu et marchant soutenu par ses propres ressources et non par
celles de l'État — je serais perdu aux yeux de ces gens et un peu à ceux des
trois-quarts de mes compatriotes ; que grâce à tout cela, une mission de six
mois se réduira, comme travail effectif, à deux, et qu'au retour, il ne manquera
pas de gens pour dire : « Voilà donc ce qu'il a fait en six mois ? » Je songe à
cela, et ce n'est ni gai, ni sain, ni brave ; et le travail en souffre, ce qui
ne vaut rien. Car enfin, si je fais un livre utile, qu'importe au lecteur par
quelles ressources je l'ai pu faire, et comment j'eusse pu mieux faire ? L'homme
n'est qu'un accident d'un jour, mais la science est une grande chose éternelle.
Je suis heureux ici. Du travail, de bonnes relations, un pays que j'aime assez. De quoi vous parlait ma lettre ? Des Valaques ? Quelle singulière nation ! Des enfants qui se croient des hommes, mais du moins des enfants sympathiques. Les Serbes, que j'admire bien davantage, sont dignes, mais un peu roides. Les Roumains sont les Français du Danube, avec une certaine ingénuité en plus ; seulement ils tiennent à ne pas être ingénus. Leur cordialité est charmante et leur dévouement sincère. Le sentiment ne leur manque pas ; c'est la solidité, le sérieux, la moralité qui leur manquent. Je leur dis quelquefois : « Vous êtes enfants et déjà vous êtes vieux et gangrenés jusqu'à la moelle ». Ils répondent « C'est le fait des Fanariotes ». « Eh ! morbleu, laissez-là les Fanariotes, et, corrigez-vous ! ». J'aime quelques individus, mais pas la masse. Il m'a paru que les paysans valent mieux, si affaissés qu'ils soient ; quant à l'aristocratie, c'est une étable d'Augias. Entrez dans un salon, et vous pouvez dire tout d'abord neuf sur dix de ces hommes sont des voleurs ; neuf sur dix de ces femmes sont..... ou le seront. Une frivolité, une légèreté, une paresse, un luxe inouïs, et, pour suffire à des dépenses folles, des ressources honteuses ou l'exploitation impitoyable du klakasch, (paysan corvéable). Il est vrai que la boyarie confiant aux Tziganes bohémiens « l'éducation de ses enfants et la conduite de ses voitures, » on voit d'où sort chaque génération. Et pour les jeunes filles, on a de plus la gouvernante française et surtout allemande, c'est-à-dire le plus souvent une aventurière qui a beaucoup souffert. Le romanesque exagéré et sans grandeur des jeunes roumaines me semble venir en grande partie de là. Vous me direz que la mère...., mais la mère a bien autre chose à faire ; et les bals des Ghika, des Ribesco, des Cantacuzène, des Troubetskoï, des Floresco, que sais-je ? Ne faut-il pas veiller à ce que les succès d'intérieur ne fassent pas « maigrir les plus belles épaules de la Valachie ? » (Historique).
Je croyais les Valaques au moins braves erreur. Ils vous digèrent un affront avec un stoïcisme superbe et puis, ils disent « Donnez-nous des fusils ! » — « Qu'en feriez-vous, mes enfants ? ». On vous en donnera, des petits couteaux pour les perdre. Cependant le peuple, sous l'uniforme, fait un bon soldat : on a vu, en 1848, les pompiers de la caserne Spiro se défendre cinq heures contre l'armée turque, prendre deux canons, tuer un pacha et trois cents hommes, en perdant eux-mêmes quarante-sept des leurs. Comme patriotisme, j'apprécie davantage les Valaques ; c'est le sentiment le plus vivace en eux. Il y a ici, non pas seulement des individus, mais des familles entières dignes de la vieille Rome, les Golesco, par exemple. La vieille Mme Golesco , la kokona mare, mère de cinq proscrits, sans compter ceux qui pourraient l'être, est vraiment la mère des Gracques. Je ne sais pas s'il y a des Valaques qui risqueraient leur petit doigt pour leur père, mais pour la Roumanie, la plupart joueraient leur tête, et mieux, leur fortune. Singulière race, et qu'on aime pourtant !
Mais de quoi vous ai-je parlé près de trois pages ? Je reviens de Tirnova. J'avais passé quelques jours à Routschouk, d'où je me suis mis en route, le 31 mai, pour les Balkans. Près Samovoda, sur la Jantra, je rencontre un convoi escorté par les Arnautes les plus pittoresques et les plus brodés qu'on puisse voir : c'était un harem en voyage, je crois. Une manière d'eunuque jette un cri ; ces dames, — quinze ou seize, empilées dans quatre arabats — se voilent précipitamment ; je passe au pas, et j'inspecte le chargement féminin. Une n'était pas voilée, elle l'était même trop peu ; du front à la ceinture, elle n'était guère plus vêtue que la Vénus de Milo ; il faisait si chaud ! type grec, quatorze ans au plus, et ravissante. Une heure après, j'étais à Tirnova, la plus belle chose que j'aie vue de ma vie. Entassez sur un rocher haut comme le Jura et bien plus escarpé, baigné de trois côtés par une rivière, une ville de 30,000 âmes groupée autour d'un pic verdoyant appelé le Kartal (en turc, les aigles) — véritable nid d'aigles en effet — vous aurez cette vieille capitale des rois bulgares. J'y ai été reçu à bras ouverts, comme si j'avais été un commissaire français ; si les cloches n'ont pas sonné pour moi, c'est que, d'abord, il n'y a ni cloches ni églises apparentes dans la tolérante Turquie ; les vieilles basiliques chrétiennes ont été transformées en mosquées. Les Bulgares n'ont rien de saillant, types intelligents et sérieux plutôt que beaux. En revanche, je n’ai rien vu d'aussi charmant que les jeunes filles bulgares, soit à Routschouk, soit à Tirnova ; beautés moins matérielles et moins Junons que les Roumaines, mais bien plus intelligentes ; elles n'ont rien de l'indolence superbe et un peu bestiale qui vous impatiente dans les femmes d'Orient après les premières minutes accordées à l'admiration ».
Les deux lettres de Lejean à MM. Ernest Desjardins et Jomard (Bulletin de la Société de Géographie, 4ème série, t. XV, pp. 99-116), la première de Bucharest, le 11 juin 1857, la seconde de Jassy, le 12 août suivant, nous font connaître le degré d'avancement successif de ses travaux. Ils l'avaient conduit à reconnaître que la carte de la Moldavie, de Kiépert, bien que supérieure à celles qui l'avaient précédée, était cependant assez souvent erronée pour la Turquie d'Europe proprement dite (la Bosnie exceptée ) comme topographie et surtout comme orographie. Il entreprit de la réédifier, et traita, dans ce but, le 21 août 1857, avec les libraires Codresso et Petrini, de Jassy, de l'exécution d'une carte de la Moldavie, en neuf feuilles, comprenant les nouvelles acquisitions et les plans particuliers de Jassy et de Galatz. Ses honoraires furent fixés à 2,000 francs, dont 800 lui furent payés à Bucharest, après le levé de la carte, et le reste à Paris, quand elle aurait été gravée. Cette bonne aubaine lui permit de se donner le luxe d'un cheval avec bride, selle, etc., et de faire dans la Turquie centrale une excursion, d'où il rapporta, à défaut d'idées turcophiles, ce qui valait mieux , les matériaux de la Carte ethnographique de la Turquie d'Europe, qu'il publia plus tard dans un des cahiers supplémentaires de Mittelungen, du docteur Petermann, de Gotha, sous ce titre : Ethnographie de la Turquie d'Europe, Gotha, Justus Perthes, 1861, in-4° de 38 pages compactes, à deux colonnes, contenant, l'une le texte français, l'autre une traduction en allemand. Malgré quelques erreurs qu'il se proposait de corriger, ce Mémoire en dit plus sur la question d'Orient que bien des volumes. Quant à la carte, ses teintes nettement tranchées, font ressortir le rôle forcément assigné aux diverses populations vassales de la Turquie, en cas de conflit entre elles et leur suzerain. Les évènements dont l'Orient est en ce moment le théâtre, le démontrent.
Lejean s'était abusé sur le chiffre de la dépense de son voyage. En se refusant à user pour lui et son escorte du privilège, non-seulement de ne point défrayer cette escorte, mais encore de la faire nourrir et héberger, comme lui-même, par les rayas, sans bourse délier, il s'était mis dans un grand embarras d'où le fit sortir l'à-compte payé à Bucharest, et qui lui suffit tout juste jusqu'à son arrivée à Paris, le 15 décembre 1857 ; il ne lui restait plus que vingt centimes. Sa collaboration au Magasin pittoresque et des travaux exécutés pour divers éditeurs, le remirent à flot et lui permirent, en attendant une nouvelle mission, de préparer, d'après le conseil de M. Guignaut, sa thèse pour le doctorat, thèse qui devait faire l'objet d'une étude sur la géographie comparée de la France.
Mais la thèse fut promptement laissée de côté. M. Rouland le chargea, le 12 août 1858, de recherches géographiques et ethnographiques dans la haute Bulgarie, la haute Albanie et le Monténégro. « Je ne doute pas, Monsieur, lui écrivait le Ministre, du succès et des heureux résultats des nouvelles investigations que vous allez entreprendre. J'en ai pour garant l'intéressant rapport que vous m'avez adressé relativement à votre voyage de l'an dernier dans les principautés danubiennes.
Pour vous faciliter ce but autant qu'il est en mon pouvoir, j'écris aujourd'hui même à M. le Ministre des Affaires étrangères et le prie de vous donner une lettre de recommandation aux agents diplomatiques des contrées que vous devez visiter, etc. » — L'appui officiel dont il est question dans cette lettre fut refusé, en raison de la situation politique du Monténégro et des provinces avoisinantes de la Turquie d'Europe. Le Ministre des Affaires étrangères pensait que, dans le Monténégro particulièrement, la présence d'une personne chargée d'une mission aurait des inconvénients qu'il importait d'éviter dans un moment où les grandes puissances s'occupaient du règlement des affaires de ce pays.
Ce refus de lettres l'accréditant près des consuls français n'arrêta pas Lejean. Comme la précédente, sa mission devait être gratuite, mais le Ministre revint, croyons-nous, sur sa première décision et alloua à son délégué une indemnité de 20 francs par jour. Parti de Paris, au mois d'août 1858, Lejean y rentrait dans les premiers jours du mois d'octobre suivant, rapportant force matériaux, dont une partie a servi au récit qu'il a fait de sa mission dans le Tour du Monde, auquel il collabora dès la fondation de cette importante publication en 1860, et où ce récit, approprié à l'esprit et au cadre du recueil, a été inséré, avec neuf vues et une carte du Monténégro, dans les livraisons 5, 6 et 19, sous ces titres : Voyage en Albanie et au Monténégro, — Voyage en Herzégovine. Dès son arrivée, la Revue contemporaine lui demanda une série d'articles qui, avec sa collaboration au Magasin pittoresque et la mise en œuvre des matériaux recueillis dans le cours de sa mission, furent sa principale occupation jusque vers la fin de 1859.
Dans l'intervalle, un de ses amis les plus dévoués, M. Ernest Desjardins, l'avait présenté à une dame aussi distinguée par l'esprit que par le caractère, Mme Hortense Cornu, filleule de la reine Hortense. Mme Cornu, qui n'approuvait pas de tous points la politique impériale, avait fait de ses salons un terrain neutre où se rencontraient, chaque dimanche, des personnes accueillies uniquement pour leur mérite scientifique, artistique ou littéraire. Très dévouée néanmoins au fils de sa marraine, elle exerçait sur lui une influence devant laquelle pâlissait celle des personnages officiels les plus autorisés, et qu'elle s'empressait de mettre au service de toute idée, de toute entreprise généreuse. Plus elle avait connu Lejean, plus elle l'avait apprécié. Elle aurait voulu qu'il eût occupé un emploi. Lejean était rétif. Ce qu'il préférait à tout, c'était une mission eu Afrique, dont il rêvait depuis longtemps, séduit qu'il était par la perspective d'attacher son nom à la découverte des sources du Nil. Effrayée des dangers qu'il voulait, courir, Mme Cornu ne céda qu'à ses instances réitérées en sollicitant de l'Empereur la mission qu'il convoitait. Cette fois encore, et bien injustement, les amis ne ménagèrent pas les récriminations. Lejean n'était rien moins qu'un renégat, un transfuge. De part et d'autre, rien n'avait motivé ces qualifications, où l’odieux le disputait au ridicule. Lejean avait cru avec raison que la science et la politique sont deux choses qui peuvent, qui doivent même rester étrangères l'une à l'autre, et séparant le souverain du Mécène, pour qui il eut toujours une profonde reconnaissance, il conserva intactes ses opinions [Note : Ces opinions ne se faisaient jour que dans des épanchements intimes. Mais après la bienveillance dont il avait été l'objet de la part de l'Empereur, il ne se croyait pas le droit de les divulguer. Il y aurait eu, à ses yeux, inconvenance, ingratitude même. Témoin ce passage de sa lettre du 30 mai 1868 à Mme Souvestre : « Vous savez qu'on aime à faire en soi-même des livres qu'on n'écrit jamais. Le mien, c'est La Fin d'un Empire, — Le Tableau des dernières années de l'Empire byzantin. — Le livre est tout fait dans ma tête, mais je n'en écrirai pas une ligne, parce qu'il aurait un succès d'arme de guerre, genre de succès funeste à la vraie science »]. En cela, du reste, il fut à l'aise, car il ne lui fut jamais demandé compte, ou, ce qui vaudrait peut-être mieux encore, elles n'empêchèrent pas l'Empereur, s'il les connaissait, d'approuver, avec des signes réitérés de bienveillance, le plan de son voyage, dans une audience qui se termina pas ces paroles : « Partez, Monsieur, l'argent ne vous manquera pas ». Il ne manqua pas en effet.
Parti de Paris dans les premiers jours de janvier, il nous écrivait le 17 d'Alexandrie d'Egypte « Je suis pour quelques heures encore à Alexandrie d'où je pars pour le Caire, duquel Caire je pars vers le 1er février pour le Haut-Nil. J'ai reçu des fonds et une mission pour aller aux sources du Nil, et le jour que votre lettre m'arrivait, je quittais Paris pour Marseille. Je serai probablement à Khartoum vers le 20 mars au plus tard. J'y organiserai une expédition. Je suis seul chef, et le gouvernement français demande pour moi au gouvernement égyptien tout l'appui possible, c'est-à -dire des hommes. Au pis aller, je serai quitte pour les payer. Je suis bien armé, j'ai des bibelots pour les négrillons, des verroteries, etc., et si cela ne suffit pas, j'ai un revolver superbe que je vous montrerai au retour. Croyez que je n'en abuserai pas ».
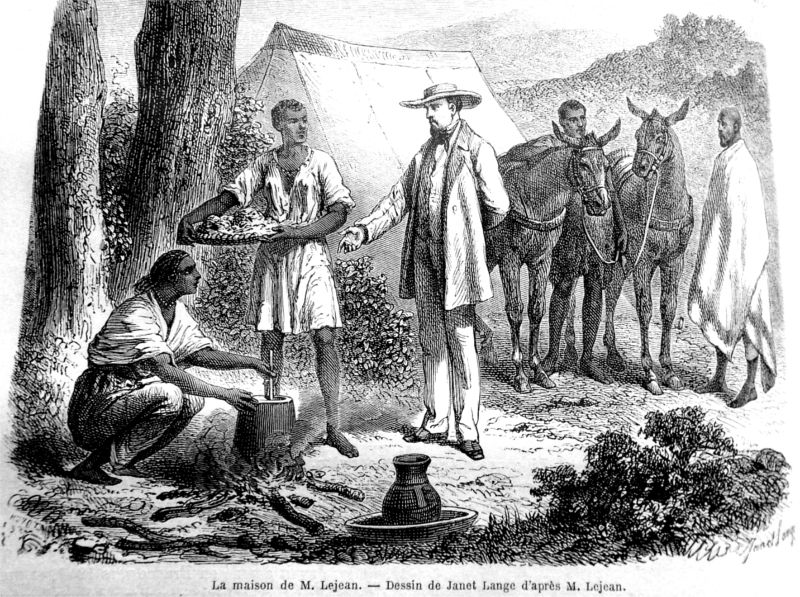
Le 20 janvier 1860, il était au Caire d'où il adressait, le 4 février, la lettre suivante à Mme Souvestre :
« CHÈRE MADAME,
Que Dieu vous garde des tentations de paresse que vous donne cette belle
Egypte. Depuis quinze jours que je suis au Caire, j'ai écrit une lettre, et
aujourd'hui pourquoi est-ce que je vous écris puisque je suis de mauvaise
humeur ? J'ai pris passage sur le Gabair, vapeur de la compagnie Medjidié qui
fait le service de la mer Rouge. Le gouvernement a happé le Gabair pour faire
une tournée dans les ports, et on me transborde sur l'Hedjaz qui doit partir le
6 mars. Voilà que le vice-roi veut envoyer en pèlerinage à La Mecque tout
son harem. Je serai donc le 8 à Suez ; le 16 — je l'espère — à Souakin ».
« 11 Février.
Je continue ma lettre à Suez, et je viens d'apprendre
qu'on partira peut-être le 14. Ces dames ne sont pas prêtes. Décidément, je ne
serai poli à bord que tout juste. La femme en Orient semble créée pour deux
choses : gêner et souffrir. La musulmane n'est guère qu'un paquet, et en dehors
de l'Islam, elle ne compte pas toujours pour grand'chose. Dernièrement, un
négociant, M. Weiss, demeurant rue Mouski, au Caire, père d'une jeune fille
de quinze ans environ, a eu l'idée de la mettre en loterie pour un mois, à 25
francs le billet, à 250 billets. Le gagnant a été un vieux turc si hideux que la
fille a refusé ; le turc a réclamé ferme et a fini par se désister, moyennant 500
francs. La loterie a été recommencée et le prix a échu à un français qui, au
bout du mois, a loyalement rendu Mlle Weiss à ses nobles parents.
Je suis arrivé à Suez par le chemin de fer qui traverse le désert. Ce désert est grand
comme deux de nos départements, et n'est pas tout-à-fait désert ; il y est poussé
deux arbres, et je vous prie de croire qu'on les voit de loin. Nous avons eu un
coup de simoun superbe ; le ciel et la terre étaient d'un rouge sinistre, les
tourbillons de sable enveloppaient le convoi qui passait dans l'espace comme un
convoi fantôme. Le train suivant est resté enterré dans les sables à mi-route,
la locomotive ensablée n'a pu ni avancer ni reculer, les poteaux du télégraphe
balayés comme des tiges de blé ; on est resté un jour et demi sans nouvelle du
train. J'ai couru par ma faute un autre petit danger. Ce matin j'ai voulu
traverser la mer Rouge à marée basse, et j'y ai réussi ; mais, au retour, la
marée est venue comme un fleuve, j'ai été surpris par les eaux à mi-chemin.
Aperçu par un batelier arabe que j'ai hélé, j'ai été recueilli par ce fils
d'Ismaël qui, au moment du sauvetage, a commencé par discuter avec
moi, au plus juste prix, le taux de l'opération, préalablement à tout.
Après discussion, ma vie ayant été estimée par moi 22 sous, par lui 30, nous
sommes tombés d'accord à 23. Je vais tous les matins flâner dans le désert, que
j'aime de plus en plus. Ne croyez pas que le désert soit monotone ; il a des
aspects, des détails, des épisodes qui ont un charme pénétrant pour un voyageur
passionné comme moi. Un détail vous dira à quel point Suez est enveloppé de
désolation ; l'eau y vient du Caire par le chemin de fer, comme train de
marchandises, et y coûte 1 fr. 25 les 40 litres.
Avant le chemin de fer, une
famille riche y dépensait 5 francs par jour pour l'eau ».
« Souakin, 5 Mars.
Je suis sur la frontière d'Abyssinie. Traversée heureuse, mais d'une lenteur
intolérable. J'ai logé, à Djedda chez un riche négociant dont la femme portait
un ravissant costume d'intérieur ; un peu décolletée seulement ; du front à la
ceinture, un collier à trois rangs de sequins pour tout voile ; causant
très agréablement, pelotonnée sur son divan, et l'orteil dans la main ; dévote
par dessus le marché. Elle était du Caire, et me parlait amèrement des dames de
Djedda, qui disaient d'elle : une femme du Caire, sauf votre respect. — Les
dames de Souakin sont des négresses fort laides, décolletées aussi, mais de la
tête aux pieds, et pommadées de beurre rance ».
Parti de Souakin, à dos de chameau, le 13 mars, Lejean, après s'être arrêté à Kassala, se dirigea vers Khartoum où il resta trois mois (mai-août). Pendant son séjour dans cette ville, il écrivit le 24 juillet 1860, à Mme Souvestre, la lettre suivante :
« CHÈRE MADAME,
Je viens de déchirer une lettre de quatre pages
très serrées. Quand on souffre, il faut le dire en deux lignes et pas en quatre
pages. Après cela, est-il bien vrai que je souffre ? Je combats, ce qui a bien
ses joies aussi quand on a raison. Un post-scriptum, que j'ai seul conservé,
vous dira en partie ce que c'est. Je suis tombé dans une ville de 40,000 âmes,
aimable et hospitalière à la surface, ignoble au fond. La traite des nègres la
plus éhontée alimente ce luxe, et quant à la moralité de l'ensemble, c'est une
moralité de négriers ; le vice grossier et cynique à faire rougir les lazzaroni ; à
la surface, une franc-maçonnerie, et sous tout cela, des gens qui passent leur
vie à se diffamer les uns les autres. Je ne voulais pas me mêler de leurs
vilenies ; mais mis en demeure de me prononcer sur la traite, d'appuyer ou
d'abandonner deux ou trois gens d'honneur qui m'avaient bien reçu et qui
résistaient à la gredinerie générale, j'ai fait mon devoir, et j'ai la guerre
avec la colonie, car ces messieurs ont la prétention d'être la colonie
européenne de l'Afrique centrale. Le pis, c'est que, contre cette coalition de
misérables, je ne sais trop qui osera ici me louer une barque et des hommes pour
continuer mon voyage. Du reste, vu la bravoure connue des négriers, je ne
cours aucun danger personnel, bien que ces messieurs sachent très-bien que j'ai
surtout poussé à un procès si grave qu'ils en sont venus, dans leurs petits
comités, à discuter leurs chances de bagne. Bon voyage ! Un mot qui vous peindra
Khartoum. M. P...., consul de France, a été la nuit dernière assommé de coups de
canne et déchiré de coups de griffe par une Abyssinienne cuivrée, son esclave et
sa Briséis ; il est allé se plaindre au pharmacien en chef français-musulman qui
a fait amener l'esclave chez lui pour quelques jours. Afin de la calmer,
il la battait tous les matins à coups de cravache ; or, j'ai vu
fonctionner la cravache de cet apothicaire, elle coupe la chair comme un bon
sabre, et je plains Mlle Aajémi. Ce pharmacien, nommé Tiran, excellent homme,
malgré quelques manies, est le mari assez docile d'une grecque qu'il a achetée
toute petite, belle, honnête et imposante personne qui n'a jamais été
très-heureuse ; elle a perdu une fille qui la consolait des légèretés de son
seigneur. Il m'a avoué qu'une cicatrice profonde qu'elle porte à la main
provient d'un coup de sabre qu'il lui donna un jour dans un moment de vivacité,
mais tout cela est oublié. « Elle me rompt la tête pour que je l'épouse à
l'européenne, mais je la vois venir; elle veut que je me réduise à une seule
femme. Comment trouvez-vous cette rouerie ? ».
De Khartoum, Lejean fit route pour le Kordofan, sur un petit âne d'Égypte, monture des gens comme il faut de cette ville, et, le 6 août, il était au village d'Oudourman, sur la rive gauche du Nil Blanc, en face du Mogrin, ou confluent des deux fleuves. Le lendemain il s'engagea dans le désert et continua par une route presque parallèle au Nil. Parvenu au village de Djébel, il fut contraint par la fièvre de revenir à Khartoum, où il rentra dans un complet épuisement, deux mois après s'en être éloigné. Quand il fut un peu remis du choc violent que sa constitution venait d'éprouver, il songea à donner sérieusement suite à ses projets d'exploration du Nil Blanc. Pendant qu'un aventurier cypriote, intelligent et actif, s'occupait des préparatifs de son voyage et lui frétait un negher (cange à quatorze avirons), en même temps qu'il enrôlait l'équipage nécessaire, Lejean faisait diversion à ses ennuis, en écrivant, le 23 novembre, à M. Ernest Desjardins : « Mon bon ami, si je ne vous écris que quinze lignes, m'en voudrez-vous ? J'ai la fièvre, je suis abattu, mais je réussis à coups d'écus. J'aurais dû commencer par là. Je pars dans treize jours sur ma barque, à moi, pour les sources disputées. Comme vous êtes plus archéologue que topographe d'inclination, je vous parlerai d'antiquités que j'ai copiées dans les affreuses montagnes Haraza, frontières du Kordofan. Grâce aux exagérations des Arabes, j'avais été induit à chercher des ruines là où il n'y avait que des peintures sur la surface inférieure d'une table de granit blanchie par le polissage, mais du moins, ces peintures, une fois la première mauvaise humeur passée, m'ont paru fort intéressantes. Elles sont asti-slamiques, car il y a des figures humaines, et de plus, des guerriers portent un justaucoms qui n'a de rapport avec aucun costume de l'Afrique moderne, si j'en excepte ce qu'on dit de la garde du roi de Darfour. Pour avoir quelques lumières sur tout cela, j'aurais besoin de feuilleter la collection des bas-reliefs égyptiens. La scène est une razzia. Une tribu victorieuse, ou plutôt un goum, chasse une masse de cavaliers qui se défendent le javelot en main ; des moutons, un éléphant, une girafe font partie du butin. Une sorte de géant combat pour les vaincus : il a la barbe en pointe et un costume assez analogue à celui des Francs aux premières Croisades. Pour qu'on ne se trompe pas sur la coupe du justaucorps, il y en a un dessiné à part comme sur les prospectus des tailleurs parisiens. L'homme qui attaque l'éléphant est monté sur un animal qui semble un ab-garu, une licorne, presque la licorne héraldique d'Angleterre, formes et stature du cheval. Tous les personnages et tous les animaux sont dessinés au simple trait, puis peints en rouge, sauf les moutons, et, je crois, un cheval. J'ai pu me rendre compte de ce procédé de travail en voyant une esquisse imparfaite que j'ai copiée et dont le trait seul est fait. Les contours sont nets, mais la matière colorante ne tient pas au frottement, Cinq ou six figures ont été effacées sur la même pierre, deux sur la pierre en face, et ce n'est pas par le temps. Cependant, pour la seconde pierre, j'admets l'action de la lumière et d'une forte pluie battant très-obliquement. Eu tout cas, mes dessins sont fidèles, mais incomplets (16 fig. sur 20), ce qui tient à mon état de fièvre. J'essayai de calquer un groupe, mais les bras me tombèrent ; ne pouvant dessiner debout, je me couchai sous la pierre et pus ainsi dessiner deux ou trois figures ; mais il fallut à peu près me porter à ma case, à vingt pas de là.
Quant au principal groupe d'antiquités, voici ce que m'a dit le cachef d'Abou-Haraz, homme très-véridique et très-bon observateur : « En 1854, étant cachef à Katcha, je fus chargé d'aller recueillir l'impôt des Kababich, et je fus au Djébel-Haoudoan, leur principale résidence. Ils avaient fui quand j'arrivai, et je me mis à faire le tour de la montagne qui est comme ceci (il m'en a fait une sorte de plan) ; les maisons des villages étaient en pierre, et j'y pénétrai par curiosité : les pierres portaient des sculptures de toutes sortes de choses, des animaux, des hommes, des femmes reconnaissables à leurs seins nus ; quelques personnages étaient debout, les bras croisés sur la poitrine ; d'autres assis, le dos incliné en arrière « avec un objet qui était sans doute un bendukieh (un fusil) ». J'ai pris des renseignements plus circonstanciés sur la situation du lieu qui est malheureusement en plein désert ; mais avec l'or et de bons dromadaires on va loin.
J'ai reçu. fort inopinément un secours impérial de 5,000 francs, grâce auquel je puis fréter une barque, et je pars dans quatre jours, malgré les intrigues et les trahisons de Khartoum. Ma barque se nomme la Bretagne, 29 hommes d'équipage, dont 20 soldats bien armés. J'ai bien vite deviné par où me venait le supplément sauveur, mais ne serait-ce pas vous qui auriez averti ? Vous en êtes bien capable : en fait de services à rendre, vous êtes efficace.
Je suis malade depuis le jour des antiquités, mais depuis trois jours, la convalescence a repris nettement le dessus, sauf quelque faiblesse des jambes, et avec la santé sont revenus l'espoir, la confiance, le forward. Au Nil ! ».
Le 29 novembre, Lejean quitta le quai de la Mondovie, et après avoir doublé la pointe Mondjera, il entra, par un bon vent de nord, dans le plus grand des deux fleuves jumeaux qui forment le Nil. Nous ne donnons pas son itinéraire jusqu'à Gondokoro où il arriva, le 22 janvier 1861. Une excursion de trois semaines lui fit acquérir la conviction qu'il ne pourrait s'avancer plus au sud. Il lui aurait fallu au moins soixante hommes pour lutter contre l'hostilité et la rapacité des Madi : quelques tentatives qu'il fit pour se joindre à des Khartoumiens qui se disposaient à gagner l'intérieur, n'eurent aucun succès. Tous ces individus projetaient des opérations véreuses et craignaient quiconque n'avait pas avec eux la solidarité du crime, ou, au moins, un silence complaisant. Ce n'est pas tout, la fièvre paludéenne qui ne le quittait pas, avait affaibli chez lui le ressort moral. Le 12 février, mettant le cap au nord ; il descendit le fleuve en traversant les pays Bary et Denka dont il a caractérisé le type les mœurs et les coutumes dans un chapitre intéressant. Arrivé, le 25 février, à l'entrée du lac Nô qu'il avait traversé en venant, et le 5 mars dans un autre lac beaucoup plus grand, il le nomma lac de l'Ambadja, à cause des bois épais d'ambadja dont il est, bordé. Forcé, par l'épuisement de ses gens, de mouiller, le 9 mars, à Oaon-Oaon, ou ils construisirent des abris pour lui et pour eux, il reçut le lendemain la visite d'une douzaine de grands beaux nègres qui traversèrent un marigot à la nage et venaient lui vendre un peu de lait qu'ils portaient dans des calebasses appuyées à d'assez gros cylindres que formait le tronc de l'ambadja. Lejean leur demanda un bœuf et un mouton ; les rusés sauvages, qui voyaient bien à quelle extrémité, lui et ses compagnons étaient réduits, lui vendirent des provisions à un prix exorbitant. Il paya un bœuf médiocre vingt fers de lance, et, pour un mouton, il dut, après force pourparlers, céder deux belles lances, toutes montées, de sa collection. Le lait se payait en belles verroteries blanches (long-long) que les noirs serraient au fond d'un porte-monnaie fort singulier ; c'était un coquillage fluviatile, une grande hélice vert bouteille à l'extérieur, d'un blanc violacé au-dedans ; et où l'on pouvait introduire les quatre doigts.
Son campement était établi sur une île appelée Toura. Pendant que ses gens se remettaient de leur épuisement, lui, tout affaibli qu'il était, il explorait les environs. Désireux de visiter les marigots aussi loin qu'un canot pourrait pénétrer, il partit un matin dans une felouque montée par quatre hommes, et traversant, tantôt dans sa barque des lagunes stagnantes, tantôt à pied des terres marécageuses, il atteignit le fond même du Bahr-et-Gazal. Cette excursion compléta ses connaissances et fixa ses idées sur l'hydrographie de ce fleuve. Il devenait évident pour lui qu'il n'était qu'un CANAL DE DRAINAGE DES MARAIS DU NEUVIÈME DEGRÉ et des cours d'eau qui les alimentent, principalement le Bahr-el-Djour. Cette exploration compensait ainsi en partie l'insuccès de sa tentative vers le sud. Il avait réussi à faire le premier un relevé rigoureux du cours de ce fleuve jusqu'au point où il cesse de porter barque, et en constatant la singulière nature de cet affluent du Nil, successivement lac, marais et canal draineur, selon les saisons de l'année, il avait pu éclaircir plusieurs points jusque-là obscurs dans l'hydrographie de ce bassin. Malheureusement la nature même du sol avait limité ses excursions et l'absence totale de montagnes, de simples collines mêmes, l'avait privé d'un élément précieux de relevés topographiques. A ses études directes et faites de visu s'étaient ajoutées les informations qu'il avait recueillies çà et là. Les obstacles matériels n'étaient pas les seuls qui l'obligeassent à rétrograder. Ses hommes étaient trop affaiblis pour tirer la cordelle quand il le fallait, et les privations avaient fait tomber une quinzaine d'entre eux dans un marasme et une sorte' de prostration stupide, inquiétante pour leur raison. Lejean lui-même n'était guère mieux. La fièvre l'avait à peu près quitté à Toura, mais il lui en était resté un ébranlement moral et une irritabilité nerveuse qui ne se dissipèrent qu'à la longue. A Oaon-Oaon, il avait reçu à la jambe, et principalement au cou-de-pied, sept ou huit piqûres d'une mouche roussâtre (peut-être le nâm du Soudan), et ces piqûres avaient laissé de larges plaies qui, sans être douloureuses, ne se cicatrisèrent que lentement. Ainsi cloué sur son anghareb, il avait encore à souffrir du khamsin qui, pendant plusieurs jours, souffla du Kordofan, avec des alternatives de brises fraîches et brûlantes bien autrement douloureuses et irritantes qu'un air uniformément embrasé. L'impatience et le découragement allaient infailliblement ramener la fièvre, lorsqu'un petit vapeur envoyé à sa rencontre par ses amis de Khartoum, le remorqua et le déposa dans cette ville, après cinq mois d'absence. Le 28 juin, il s'embarqua à Korosko pour Assouan, d'où il regagna le Caire. Moins de deux mois après, il rentrait à Paris, qu'il ne fit que traverser et vint se reposer à Traondour, où il arriva tout fourbu, nous écrivait-il, le 26 août 1861.
Mme. Cornu, nous l'avons vu, n'avait cédé qu'à contre-cœur aux instances de Lejean, lorsqu'elle avait sollicité pour lui une mission en Afrique. Pendant le voyage, les dangers qu'il avait courus avaient plus d'une fois éveillé sa sollicitude, et pour qu'il ne s'y exposât pas davantage, elle aurait voulu le retenir en France, au moyen d'un emploi qui eût satisfait ses aptitudes et ses goûts. Telle était une chaire de géographie commerciale qu'elle voulait faire créer pour lui dans une de nos grandes places de commerce (Marseille, Bordeaux, Nantes). M. E. Desjardins lui communiquait ce projet dans une lettre du 22 septembre 1861, à laquelle Lejean fit la réponse suivante, où il explique comment il voulait réparer l'insuccès de sa mission.
« Plouégat-Guerand, le 5 octobre 1861.
Vous êtes bien aimable de trouver
le temps, au milieu de vos occupations multiples, de m'écrire quatre pages bien
pleines, et pleines sous tous les rapports. Je réponds tout d'abord au principal
objet de votre lettre, le projet d'une chaire de géographie. C'est pour moi,
une chance inespérée, bien supérieure à mon espoir qui se bornait à un emploi
fort secondaire dans une bibliothèque de Paris ; mais, je pense, comme vous, que
j'ai besoin de rester encore une année au moins, in statu quo. D'abord, j'ai
besoin de publier mon voyage, et si je puis rédiger partout la partie
narrative, ce n'est qu'à Paris que je puis m'occuper de la partie scientifique,
de beaucoup la plus importante. En Afrique, les pays occupés par des
gouvernements civilisés, Algérie, Égypte, le Cap, sont seuls relevés en entier
et sur une base scientifique à peu près exacte. Ailleurs, on est arrivé à une
vérité relative par des reconnaissances isolées dont le réseau a été vérifié et
coordonné par la géographie critique ; témoin le Maroc, Tunis, Tripoli,
l'Abyssinie, le Zanguebar, la moitié du Soudan, la Nubie. Avant dix ans, les
pays de cette seconde classe, notamment l'Abyssinie, les États barbaresques
et le Sénégal auront passé à la première ; il s'agit aujourd'hui de
faire monter à la seconde classe les vastes régions qui sont encore à la
troisième, c'est-à-dire tout ce que les cartographes les plus prudents laissent
à peu près en blanc sur leurs cartes. Ce sera, pour le Soudan oriental, l'objet
de la partie purement géographique de mon livre. J'ai atteint, à l'ouest
jusqu'au 25° de long. (E. de Paris) ; de ce point, mes informations ont rayonné
au S., à l'O. au N.-E. ; elles se combinent avec celles de Barth et de Koelle, et
le grand desideratum équatorial sera rétréci, à partir du Nil Blanc, sur une
profondeur de quarante lieues en moyenne, sur un développement de 11°.
J'ai fait ce que j'ai pu, mon ami ; mais, en somme, je me suis fourvoyé en prenant la route de Khartoum au lieu de celle de Zanzibar. Le Nil Blanc est désormais impraticable à moins d'une armée. Peney passera peut-être, parce qu'il dispose de 400 hommes fournis par une compagnie négrière ; malgré cette force, il a été attaqué dès le 5 ou le 6 janvier dernier dans le Nyambora, à deux pas de Gondokoro, et a eu quelques hommes hors de combat. Je crois que le monde savant ne m'en voudra pas d'avoir eu un échec inévitable, mais, en fait, C'EST TOUJOURS UN ÉCHEC, et je ne veux pas l'accepter. Je suis donc résolu à donner une compensation, c'est-à-dire, à moins de graves obstacles, à passer la saison de 1862 dans la Turquie d'Europe, à mes frais, et à mettre ainsi la dernière main au grand travail que je poursuis depuis mes missions en 1857 et 1858, la Topographie de la Turquie européenne (moins les États vassaux). Vous savez que les matériaux abondent, mais qu'il y a partout des lacunes qui empêchent de faire une carte d'ensemble. Ainsi, les Russes ont cadastré toute la Bulgarie orientale ; mais ils n'ont pas fait les terrains (style d'état-major). Ainsi, Friedl a donné la Bosnie, d'après les relevés autrichiens, mais il est incomplet et très erroné dans la partie S. Viquenl a fait la Thrace et la Macédoine, mais il a bien des portions faites d'après renseignements. Pour l'Épire et la Thessalie, Pouqueville a donné quelques fragments détaillés ; mais avant la carte de l'officier grec Nicolaïde (1859), on n'avait pas une carte d'ensemble de la Thessalie qui fut passable. La Dardanie, en blanc sur la belle carte de Kiépert, (les rivières pointillées !) La Macédoine, à l'O. du Streymon, à peu près inconnue. L'Herzégovine, la Haute-Albanie, tout l'ouest de la Bulgarie, tout le nord de la Thrace, idem. — Que faut-il pour remplir ces lacunes ? J'ai, en 1857, fait la Bulgarie centrale et l'ancienne province d'Hœmimous ; en 1858, quelques portions de l'ancienne Illyrie. Il me resterait à compléter les parties douteuses de la Bosnie, de Friedl ; à parcourir la province de Widdin et à la rajuster avec mes levés de 1857 et avec deux bonnes reconnaissances, de Nissa à Philoppolis (russe et autrichienne), que je possède, à relever en entier la Dardanie en m'appuyant à Sophia et à Pristina à saisir le relief compliqué de l’Herzégovine que j'ai fortement tâté en 1858 ; à fouiller quelques cantons de la Guegaria (la carte de Hecquard, malgré son détail apparent, est misérable), à bien étudier les bassins lacustres d'Ochrida, de Presba, de Castoria, d'Ostrova, les articulations du Pinde, les tailles par où s'échappent le Penée et l’Haliacmon, et le relief vrai de l'Olympe et de l'Ossa, le nord de la Chalcidique, presque inconnue, le cours des fleuves appelés autrefois Achéloüs, Axius, Erigon et l'île de Thasos (les autres îles ont été relevées par la marine anglaise). De mars à octobre, j'ai le temps de remplir ce programme. Si varié qu'il soit, mon ordre de marche serait à peu près ceci [Note : Cet itinéraire fut à peu près celui qu'il suivit dans la mission dont il fut chargé plus tard] : Routschouk, Jeny-Zagra Philippopolis, Drama, Salonique, l'Olympe, Larisse, Pharsale, Tirhala, Calavrytes, Metzovo, Thalissa, Sarigoul; Monastir, Ochrida, les Dèbres, le Merdita, Djakova, Prisren, Uskup, Istib, Vrania, Kourchoumli, Nissa, Isnebol, retour par Koumchouli à Novr-Bazar, Fotcha, Seraïevo, Mostar, Holatz, retour en France par Raguse. Les points soulignés sont ceux des séjours les plus prolongés. Parmi les plans que je relèverai, je noterai celui des champs de bataille de Pharsale, Philippes et Cynoscéphales qui ont été croqués quelquefois, mais jamais relevés avec précision ; je m'en suis assuré. L'Empereur qui travaille à son histoire très technique de César, serait peut-être aise d'avoir le premier de ces plans.
Je voudrais vous faire une question. J'ai un projet d'articles sur un sujet étranger à mon voyage, bien que mon voyage m'en ait fourni les éléments : c'est la traite des noirs sur le Nil Blanc. Les consuls en Égypte, a qui j'en ai parlé, m'y ont vivement poussé, parce que la publicité sérieuse donne à leurs efforts un appui moral qu'ils désirent. Mais voici la question : je désirerais faire un article de trente pages pour la Revue des Deux-Mondes, la seule qui offre une vraie publicité. Mais, depuis près de deux ans que j'ai quitté Paris, j'ignore bien des choses, et je ne sais pas si la Revue est restée un terrain neutre, où l'on peut se montrer sans compromettre sa position de voyageur patronné. Je vous serai bien reconnaissant de m'éclairer là-dessus ».

Lejean, dans sa lettre du 21 janvier 1862, nous exprimait l'espoir de retourner en Turquie : « Recu très-bien par l'Empereur, nous y disait-il, je lui ai offert ma collection qui va orner le Musée ethnographique, mon atlas va passer à la gravure; quatorze grandes feuilles, et le devis n'est pas cher : 8,640 francs. Entre nous, on parle de me renvoyer en Turquie pour sept ou huit mois, de mars à octobre. Vous lirez le 1er février, ou le 15 au plus tard, un article de moi, dans la Revue des Deux-Mondes (c'était celui qui fut inséré le 15, sous ce titre : Le Haut-Nil et le Soudan. Souvenirs de voyage), avec suite au prochain numéro, et quelque chose dans le Tour du Monde. Dam ! la marmite coûte cher et le bois aussi... M. Guignaut, me voyant l'autre jour à l'Institut, s'est levé plein d'enthousiasme et a révélé aux assistants, qui ne s'en doutaient guère, que le nouveau Caillet était présent et les honorait de sa société. Mon paletot n'a pas rougi de cet éloge à bout portant, parce qu'il était gris ». Mais le renvoi en Turquie n'eut pas lieu, car dans l'intervalle la position de Lejean avait changé d'une manière notable, et la lettre précédente, commencée à Paris, se terminait, le 2 février, à Plouégat-Guerand, par ce post-scriptum : « Je suis nommé consul en Orient ». Il était, en effet, nommé, non pas consul, mais vice-consul à Massouah, et chargé en même temps d'une mission diplomatique près de Théodore II, empereur d'Abyssinie. Une note et une carte concernant l'Afrique, que Mme Cornu fit parvenir en haut lieu, dans les premiers jours de février, obtinrent une approbation exprimée en ces termes : « C'est, un homme de grands moyens, une tête claire et capable. Je l'ai nommé consul, sa note est très-intéressante ». A quelques jours de là, une seconde note fut remise. L'Empereur renouvela ses éloges, et ajouta d'un ton impérieux : « Il partira, il est consul ». Ce ton impérieux s'explique par le mécontentement qu'éprouvait Napoléon du retard que mettait M. Thouvenel, ministre des affaires étrangères, à régulariser la situation de Lejean et à expédier ses instructions, retard qui se prolongea assez longtemps encore puisqu'il ne partit de Paris que le 8 mai.
Parvenu à Alexandrie d'Égypte, il adressa à M. Ernest
Desjardins la lettre suivante, si intéressante au point, de vue scientifique :
« Je suis arrivé à Alexandrie, d'où je repars après-demain. Je ne comptais pas y
faire un séjour aussi fructueux sous tous les rapports ; j'y ai trouvé un
aide-de-camp de Théodore, le lieutenant Chespeedy, qui va en Angleterre pour un
achat de fusils, plus un agent anglais du feu Négousié, plus enfin les précieux
et introuvables manuscrits de Malzac. Vous jugerez de leur importance par le
document ci-contre que je vous prie de communiquer à la Société de Géographie.
C'est la solution de la question qu'elle avait mise au concours (prix
d'Abbadie) sur le débit du Fleuve Blanc et de ses affluents. C'est un véritable
évènement en géographie, et ces chiffres mettent fin à bien des hypothèses. Dans
d'autres cahiers, Malzac a donné les débits des divers affluents secondaires, le
Modj, le Niébor, le Roï, etc. Mais ceci ne fait rien à l'objet principal.
L'Abiad est toujours la branche reine ; il eût été important de vérifier son
débit à Gondokoro. Je le crois égal ou supérieur à celui qu'on trouve au moment
du confluent avec la Gazal, parce que si, du 5° au 9° de lat. N., il se grossit
de quelques marigots, il s'affaiblit près Fenna-Médin, de l'énorme saignée qui
va former le Zerafa. Voir, pour comprendre tout cela, la carte de Poncet.
Malzac a étudié un beau fleuve qui a une profondeur de 5m 35 et une vitesse de
46 mètres à la minute, c'est le Roï ; je crois que c'est le Iey, de Morlang,
Peney, etc., et le Bahr-Djour, de Poncet. Il faut que les voyageurs se jettent
maintenant dans l'ouest, au-delà du Djour, où il y a de si belles découvertes à
faire, mais il faut se défier des hâbleurs noirs. On vient d'inventer des
Niam-Niam blancs, à belles barbes, civilisés et cannibales. Je crois que c'est
une amère plaisanterie des noirs contre les civilisés de Khartoum.
Vous apprendrez avec plaisir une bonne nouvelle. M. de Beauval, gérant du Consulat général de France, en Égypte, a obtenu des frères de la doctrine chrétienne du Caire, l'abandon d'une créance de 2,700 francs, due à cette maison par notre intrépide et infortuné compatriote, le Dr Peney ; il a de plus, je crois, obtenu du gouvernement égyptien une pension pour la veuve et les enfants du savant voyageur ».
Du Caire, où il se trouvait le 5 juin, il nous écrivait : « Je ne vous ai pas encore écrit depuis le 8 mai, jour où j'ai dérapé de Paris, et ce n'est guère qu'au Caire que je parviens à me reconnaître. Je pars dans quelques jours pour ma résidence de Massouah. Mon voyage n'a pas été signalé par beaucoup d'accidents, sauf un fort désagréable sur le chemin de fer Victor-Emmanuel : ils m'ont égaré une caisse clouée, contenant la moitié de mes dépêches et les plus confidentielles. J'ai eu beau remuer ciel et terre, je n'en ai pas de nouvelles [Note : Cette caisse lui parvint au Caire par la voie de Trieste, elle était intacte]. J'ai obtenu, de diverses Chambres de commerce françaises des produits à offrir en don à Théodore II, et j'espère obtenir de lui un joli petit traité de commerce. Heureusement que mes lettres de créance n'étaient pas dans la fatale caisse ».
Cette lettre se continuait ainsi, à Louqsor, le 23 juin : « Après une masse d'ennuis et de tribulations au Caire, j'en suis parti par la voie de terre, hélas ! et je serai dans deux jours à Assouan, frontière de Nubie. De là, un grand mois me suffit pour atteindre Gondar. Les tuiles m'arrivent déjà comme grêle : fièvre, chaleur de 43°, simoun et le reste… ».
La veille, il avait adressé à Mme Souvestre la lettre suivante :
« Karnak-Louqsor, 22 juin 1862.
CHÈRE MADAME,
Je
suis en Thébaïde par une chaleur de 42°40 ; je vais lentement, le vent est
capricieux. Je m'ennuie depuis le 6 mai ; je n'ai été malade que deux jours sur
cinq en moyenne ; cela s'améliorera, je l'espère, surtout avec une bonne hygiène.
L'Abyssinie est saine, ce n'est pas comme Khartoum dont j'ai eu des nouvelles
ces derniers temps. C'est vraiment miracle que j'y aie échappé ; sauf quelques
routiers, tout ce que j'y ai connu a péri. Est-ce là ce qui y attire les
touristes ? Figurez-vous que Khartoum possède, depuis quelques semaines, une
espèce de jolie fille millionnaire qui joue à la lady Stanhope d'occasion ; elle
a vingt-quatre ans, s'appelle Mlle de Capellen, hollandaise, court les champs
en tête à tête avec un Saïs arabe, vit dans une sorte de hutte encombrée de
chiens, d'armes et de harnais, et — voici l'odieux — traîne avec elle deux
bonnes femmes qui ne la suivent que par dévouement, sa mère et sa tante, et ce
sera miracle si elle les ramène en Europe.
Quant à moi, me voilà hors de France, et Dieu sait pour combien de temps. J'ai la confiance que je reviendrai, mais il faut compter avec les maladies et des ennuis de bien des espèces. J'aurai de longs jours d'oisiveté lourde, car, en Afrique, l'homme est esclave de la nature, du soleil, des pluies, toutes choses qu'il maîtrise chez nous. Je travaillerai, mais sans avoir l'excitant du frottement scientifique journalier comme en Europe. J'ai la nausée du parlottage métaphysique ou futile de Paris, et cependant la lecture m'est nécessaire, parce que je trouve souvent dans la page écrite le simple, le neuf, le vrai, le fort, que je trouve de moins en moins ailleurs. Pourquoi ? Paris s'est trop complu dans ce feu d'artifice qu'admirent les étrangers et les provinciaux ; quand on l'a pénétré, on trouve que c'est toujours la même fusée, et qu'elle est vide. Puis, le verbiage dispense de tout, parce qu'on tourne, comme l'écureuil, dans la roue de quelques mots sempiternels ; on se proclame le cerveau du monde, et l'on se garde bien de songer au Bas-Empire. J'ai, depuis près de deux mois que j'ai quitté Paris, essayé de me rendre compte par les journaux français et les correspondances parisiennes des journaux étrangers, des préoccupations du monde parisien ; j'y ai trouvé l'écho des scandales occasionnés par des prouesses de jockey-club et des comptes-rendus des représentations théâtrales données devant un public payant pair l'aristocratie du faubourg — pour les pauvres, si vous le voulez. — On a remarqué les diamants et les beaux yeux de Mme de P..., et le jeu décente de Mme de M..., joli éloge qui suppose que le contraire pourrait avoir lieu ! — Ma foi, vivent les barbares, ils sont au moins plus vrais. Si je n'avais pas à lutter à, chaque heure contre la nature extérieure, je me ferais ici une douce existence provisoire ; mais, Dieu me garde de rester en Afrique un mois de plus que le temps nécessaire à mes opérations. Je vous le dis bien bas, il y a des eaux, des arbres, des fruits, des prés, des brises et un soleil bon enfant que l'Europe seule nous donne. Ah ! le soleil lybien, le brigand, avec son état-major d'ophtalmies, de fièvres, de dyssenteries, d'insolations, de simoun, avec quel bontieur, chaque soir, je lui souhaite une bonne nuit !
Écrivez-moi long, parce que vous savez bien que, chez moi, une certaine morosité d'expression n'est qu'une manière de faire mes réserves sur des gens et des choses que j’aime au fond. Paris m'irrite tous les nerfs, mais je me garderai bien de m'en passer. Je vis au milieu d'un temps où règne une dose d'esprit banal, sec et apprêté qui discute tout, tamise tout, juge tout, et n'arrive à rien. Que me dira le grand mot de la vie ? Je comprends l'attrait des grands dangers pour les âmes curieuses et chercheuses, car il y a des profondeurs que l'âme ne sonde que quand elle se penche déjà à moitié sur l'abîme inconnu. Moi, je ne reculerai pas devant le danger, mais je ne le chercherai pas ; un peu par instinct de conservation, un peu parce que je me crois une carrière scientifique à fournir, un peu parce que je crois que je serai regretté ; c'est une fatuité assez inoffensive que j'ai là. Serrez quelques mains pour moi et ne m'oubliez pas ».
Arrivé à Karthoum, il y fut retenu jusque vers la mi-septembre par le mauvais état des routes, à partir de
cette station. C'est de là qu'il adressa à Mme Souvestre les deux lettres
suivantes :
« 17 août.
Je suis à Khartoum, et un proverbe grec dit : « Il
ne faut pas médire des loups à Lycopolis. » Aussi les Grecs d'ici, à bon droit
reconnaissants, me prouvent leurs sympathies par des tracasseries et une série
d'hostilités qui ne m'empêchent pas de passer d'heureuses journées dans la
maison de mon courageux et dévoué ami Bolognèse.
Les affaires d'Abyssinie sont plus graves. Par suite d'un contre-temps fâcheux, je n'ai pu arriver à temps à la frontière d'Abyssinie, et j'ai dû aller passer la saison des pluies à Khartoum, où j'ai des nouvelles. Théodoros n'est pas à Gondar ; il fait la guerre dans le Sud, et mis en défiance contre nous par ces malheureux évènements de 1859 que je suis chargé précisément de réparer, il laisse entrer les voyageurs européens, les protège, prévient tous leurs désirs, mais ne les laisse plus sortir. On finit pourtant par sortir, après force aventures, comme le baron Henglin, ou en jurant de revenir, comme le lieutenant Specdy. Je n'aimerais pas une captivité déguisée, mais ce que j'aimerais encore moins, c'est un fiasco. Donc, fussé-je sûr d'être retenu, j'irai ; rien n'y fera. Il faut que j'en aie le cœur net ; si Théodoros est un barbare surfait par ses prôneurs, je me débarrasserai tout de suite de cette affaire d'Abyssinie ; s'il est l'homme que l'on dit, je puis être utile à mon gouvernement. J'espère être fixé le plus tôt possible, car l'incertitude est ennuyeuse, et l'attente irritante ; et, bien que dans ma dernière lettre, je vous aie dit, je crois, du mal de la France, je vous avouerai bien bas que je ne serais pas fâché d'être oiseau pour aller y passer un mois. Les travers et les mille défauts de la France se sentent de près, ses grandeurs et ses douceurs de loin ».
« 17 août 1862, midi.
Je suis un peu triste. C'est aujourd'hui le pardon de Plouégat,
fête annuelle de ma famille. A l'heure où je vous écris, à 1200 lieues d'ici,
les miens sont réunis dans ce salon où nous avons déjeuné ensemble, il y a sept
ans ; il me semble que je vois et compte les convives ; une superbe journée, un
franc soleil d'août, pas l'infâme soleil d'ici ; par delà, les jardins en fleurs,
la route couverte de gais passants. Je ne suis pas un exhibiteur de sentiments,
mais je suis triste. — Je suis en plein orage ici ; l'hostilité perfide de toute
une ville, le spectacle quotidien d'infamies qui peuvent à peine s'écrire, la
guerre qui menace de me fermer la route avant que les canons ne parlent. —
Théodoros prépare une expédition pour reconquérir un territoire, grand à peu
près comme l'Espagne, que l'Égypte a enlevé, dit-il, à ses prédécesseurs.
Aujourd'hui, le gouvernement a reçu copie d'une sommation faite par lui aux
chefs de la frontière ; il ouvrira la campagne en octobre. L'armée
égyptienne a un grand matériel, mais les soldats sont des brutes. Les Abyssins
sont bien autrement soldats, mais ils n'ont ni carabines de précision, ni
artillerie sérieuse. — Ma vie ne court guère de dangers quant à ma captivité,
elle n'aura jamais qu'un temps. Ah ! cette petite Capellen qui a 100,000 francs
de rentes, qui pourrait vivre si doucement dans quelque ville de Rhodes ou de
Chypre, et qui vient s'enterrer pour des années dans cette Afrique, sans eau,
sans arbres, sans verdure, sans figures humaines — car je ne donne ce nom ni à
ces brutes nègres ni à ces infâmes arabes qui leur donnent la chasse — elle a
loué un petit vapeur, et elle est maintenant dans les marais du 8e degré. Bon
voyage ! Et J.-J. Rousseau, qui accuse la civilisation ! Ah ! les déclamateurs,
serinettes ennuyeuses et trompeuses ! Europa ! Europa ! Europa !
Je vous embrasse toutes deux. Je vous ennuie souvent et vous impatiente quelquefois, mais je vous aime bien toujours ».
C'est encore de Khartoum qu'il adressa le 8 septembre, à Mme Cornu, une lettre [Note : Mme Cornu et Lejean échangeaient un assez grand nombre de lettres. Informée en 1873 qu'un ami de Lejean se proposait d'honorer sa mémoire, elle se montra disposée à se dessaisir de celles qu'il lui avait adressées et qui offraient un intérêt considérable à plus d'un titre. Mais elle était retenue par des scrupules bien naturels. Ignorant dans quel esprit devait se faire la publication, elle ne voulait pas que les lettres de Lejean pussent être mal interprétées, et que la haute position qu'elle avait obtenue pour lui devint une occasion ou un prétexte de critique. Elle craignait enfin que la politique ne trouva place dans sa biographie et dans la publication de documents auxquels, la vie, les travaux et les voyages de Lejean interdisaient de donner ce caractère. Ayant malheureusement trop tardé à la rassurer, nous n'avons pu lui prouver que, comme Lejean, nous ne voulions pas faire de ses travaux le prétexte de discussions politiques, ni introduire le Deux-Décembre là où il n'a que faire. Aussi avons-nous la confiance que notre étude aurait obtenu son approbation, si la mort ne l'avait enlevée avant sa publication. Décédée en 1874, à Longpont, près de Loujumeau et de Montlhéry, elle a légué à la Bibliothèque Nationale les lettres que l'Empereur lui avait adressées, et parmi lesquelles il y en a peut-être où il est question de Lejean. Mais le testament de Mme Cornu prescrit de n'ouvrir qu'à une époque déterminée le paquet contenant ces lettres] à laquelle cette dame fit le 21 novembre la réponse suivante qui laisse supposer, ou que Lejean avait mission de ménager une alliance entre la France et l'Abyssinie, à l'exclusion de l'Angleterre, ou que tout au moins, il avait fait part à Mme Cornu d'un projet d'ambassade de Théodoros à cette dernière puissance, projet dont il voulait le détourner ou contrebalancer par l'envoi d'une ambassade en France. Voici, du reste, ta réponse de Mme Cornu, attestant son patriotisme et la noblesse de ses sentiments :
« Paris, 21 Novembre 1862.
MON CHER
MONSIEUR LEJEAN,
J'ai reçu votre lettre de Khartoum, du 8 septembre, le 8
de ce mois. Elle a donc mis deux mois à me parvenir ; c'est long. Sans doute qu'au
moment, ou je la lisais, vous étiez déjà installé à Gondar ou, tout au moins,
près du Charlemagne de l'Abyssinie, car j'aime à croire qu'enfin vous aurez
trouvé des chameliers et des chameaux. J'attends maintenant avec des impatiences
de plusieurs sortes, d'amitié, de curiosité, de patriotisme, la nouvelle de
votre arrivée et du commencement de vos négociations.
Vous ferez parfaitement de détourner, au profit de la France, l'ambassade projetée, et de faire comprendre à l'empereur Théodore, que nous seuls sommes sans convoitises de ses Etats. Sans doute il aura su ou apprendra que le pacha d'Egypte est venu en Europe, et qu'il a été très-bien reçu par l'empereur Napoléon. Cela ne me semble pas devoir l'effrayer. Il est chrétien, catholique. A moins qu'il ne se jette de lui-même dans les bras de l'Angleterre, il serait le bienvenu dans son ambassade. Aussi faites tous vos efforts pour amener Théodore à nous ; c'est dans son intérêt et dans le nôtre. N'a-t-il pas quelque enfant à élever, lui ou les siens ? ne les enverrait-il pas ici ? ou quelque officier à instruire ? S'il n'a pas d'artillerie, qu'il envoie ici en faire fondre des modèles, et qu'il appelle des ouvriers français ; bien payés, il en ira, surtout si vous parvenez à nouer des relations constantes et régulières. Je ne crois pas que les Anglais qui convoitent, ou la possession, ou la suzeraineté, ou le protectorat de son pays, trop près des côtes pour soutenir en Théodore un monarque puissant, et indépendant, je ne crois pas que les Anglais le pourvoient largement d'ustensiles de guerre perfectionnés, à part des fusils plus ou moins bons, au lieu que nous avons intérêt à sa force et à ce qu'il soit non digérable (sic) par l'Angleterre. Il me semble que notre politique ne devrait pas être très-difficile à faire-prévaloir, puisqu'elle s'appuie autant par intérêt propre que par antithèse de l'Angleterre sur l'indépendance des peuples. Mais je vous dis là toutes choses que vous savez, que vous trouvez mieux que moi dans deux grands mobiles, l'amour de l'humanité d'abord, l'amour de votre pays ensuite. Aussi j'espère grandement de votre mission ; la politique et la science de notre cher pays y auraient grand profit et autant l'un que l'autre.
J'ai envoyé votre intéressante lettre à Compiègne. Je pense qu'elle aura été très-goûtée et donnée au Ministre, aussi, dans cette prévision, en avais-je pris copie.
Votre caisse perdue m'a donné bien du souci, et j'ai bien maugréé après vous. Mettre des papiers importants dans une caisse clouée qui suit, ni plus ni moins qu'une provision de linge ! Ce peut être distraction de savant, ce n'est pas vigilance de diplomate assurément. Oh ! géographe ! oh ! philosophe !
Adieu, mon cher Monsieur Lejean. M. Duplan est très-content que ses étoffes aient eu du succès à Khartoum. Nous espérons qu'il en sera de même en Abyssinie. Je voudrais bien que les villes de commerce qui vous ont donné des échantillons puissent en retirer quelques commandes. Le commerce, c'est là le grand lien !
Ne me rapportez pas de gazelle ; qu'en ferais-je ? La pauvrette, elle mourrait immédiatement sans chaleur et sans espace. Quelque petit oiseau, à la bonne heure, et encore ! Ce que je désire, c'est que l'Abyssinie vous conserve en santé et devienne votre illustration.
Mon mari, MM. Duplan vous serrent amicalement les mains. M. Cernuschi est à Tunis depuis trois mois pour affaires, mais il revient.
Au revoir, mon cher Monsieur Lejean. Tout à vous et de tout cœur ».
Aussitôt que l'état des chemins le lui permit, Lejean se remit en route, et parvenu à Sennaar, il écrivit, le 19 octobre, à M. Ernest Desjardins, une lettre d'où nous extrayons les passages suivants :
« Me voici enfin en route. Les vents du nord qui sont venus, et les chemins qui ne sont plus inondés me l'ont permis. J'ai remonté le fleuve bleu jusqu'à, Messaliémé, puis j'ai gagné, à dos de chameau, Oued Médiné, puis Sennaar, où je suis, en attendant des chameaux, pour gagner, par une route de traverse, Gallabat, Vohin et Tchelga. Cette dernière ville est la résidence du Belembros (chef des quatre forteresses), Guelmo, sorte de magyar abyssin que tous me peignent comme un parfait galantuomo, ce qui est loin de m'être indifférent, car en entrant à Tchelga, je deviens prisonnier d'Etat.
Ne vous en effrayez pas plus que je ne m'en effraie moi-même. Tout étranger entrant en Abyssinie, quelle que soit sa qualité, est à la fois l'hôte et le prisonnier du Négus qui le traite fort bien, ne le laisse manquer de rien (« je suis ton père et tu es mon fils », c'est sa phrase stéréotypée), mais ne le laisse sortir que quand il lui plait, quelquefois fort tard. Le caractère diplomatique ne sauve pas de cette contrainte. M. Matcalfe Plowden, consul d'Angleterre à Gondar, ou il a rendu tant de services à son gouvernement, n'a jamais pu obtenir la permission d'aller seulement à Massouah toucher son traitement, et comme il s'en plaignait : « N'est-ce que cela, dit Théodore ? Mon fils ne doit manquer de rien chez moi », et il lui a fait un liste civile très-confortable. Il est vrai que M. Plowden était l'ami le plus cher du Négus, et tout en me faisant agréer de S. M. Abyssine, j'espère échapper à cette redoutable paternité. Je suis, en somme, peu inquiet. En tous cas, l'étranger n'est pas l'objet d'une contrainte matérielle. S'il persiste à passer sans l'autorisation du Négus, il est libre, mais des estafettes le suivent jusqu'à la frontière, à portée de fusil, prévenant partout l'habitant de n'avoir aucune relation avec le voyageur. Aujourd'hui, chose nouvelle depuis des siècles, le pouvoir central est si respecté en Abyssinie qu'un voyageur ainsi signalé est parfaitement sûr de ne trouver sur sa route ni une mule, ni un pain, ni un verre d'eau, et il est, bien difficile de traverser ce vaste Etat en se suffisant à soi-même.
Donc, dans une quinzaine, je l'espère, j'aurai vu l'homme qui fait tant parler de lui en ce moment dans l'Afrique orientale. On bavarde tant sur son compte que je n'ose établir une opinion que mes observations ultérieures démentiront peut-être. Eu tous cas, c'est un grand homme, mais j'ai grand’peur qu'il ne faille ajouter : avorté.
Théodoros,
en arrivant au pouvoir, a trouvé l'Abyssinie
mangée par deux plaies : les Gallas, au sud-est ; l'intérieur, les grands
vassaux dont les querelles coûtaient plus de sang que la guerre extérieure. Il a
écrasé les grands barons, tué Beuro-Godjo et Négusié, chassé Ros-Ali, soumis
Bêcher et le roi du Choa, pris Oubié qu'il mène partout avec lui. Il cherche
actuellement à refouler les Gallas, rude besogne et guerre sauvage, victoires
que peut suivre une catastrophe irréparable. Ses réformes à l'intérieur ne sont
pas populaires. Les Abyssins, paladins avant tout, sentent d'instinct que, sous
un gouvernement fortement constitué, si le bien-être matériel est plus assuré,
l'homme isolément diminue en énergie virile, et ils donneraient tous les
Charlemagne possibles pour un Richard ou un Roland. Ils ont tort ; ils devraient
avoir appris par l'effroyable expérience qu'ils ont faite en ces derniers temps
(1830 à 1853) que les romans de chevalerie en action coûtent cher aux peuples.
En somme, ils admirent Théodoros, 1e craignent, l'aiment peu, et ne le
comprennent pas du tout. Il se sent isolé au milieu des 50,000 hommes qui se
font tuer sur un signe de lui, ne se fie à personne, surtout depuis que Bell est
mort, et tout en admirant le génie européen, il méprise les Européens, comme
individus, n'ayant guère eu que des aventuriers autour de lui. Il a peu le désir
de sortir de chez lui ; d'abord, parce que son absence peut amener une
révolution ; puis parce qu'il ne croit guère qu'il y ait un pays plus beau que le
sien. Il interroge les pays qui reviennent de Jérusalem, et, quand il apprend
que la Terre-Sainte est une contrée pauvre, rocailleuse, sans eau et sans
arbres, il dit : « Si la terre élue de Dieu est ainsi, que sont les autres, et
qu'ai-je besoin de les voir ? ». Ses mots sont un singulier
mélange de grandeur et de barbarie. Il s'est substitué au conseil féodal des
likaiient (les douze grands juges héréditaires) qui jugeait mal, et juge (comme
un vrai Salomon, dit-on) les procès des petits aussi bien que des grands. Comme
on lui représentait respectueusement (car il est assez prompt à user de la main)
qu'il nuisait à sa santé en passant les nuits à réviser les petits procès des
gueux, il répondit : « Moi aussi , j'ai été un pauvre. Et si un pauvre homme,
condamné par un mauvais juge, va se plaindre à Dieu que j'abandonne le soin de
la justice à des méchants, croyez-vous que Dieu ne l'écoutera pas ? ».
Dernièrement, le patriarche ayant fait construire un moulin à farine, le Négus
blâma cette innovation, en disant : « Que ferons-nous des femmes si nous
employons les machines ? ....... ». On dit que du temps de sa première femme, c'était
un homme parfait ; mais, celle-là morte, il a épousé par politique la fille
d'Oubié, princesse abyssinienne, c'est-à-dire, l'orgueil multiplié par
l'entêtement. De là des scènes quelquefois vives. Un jour qu'elle boudait : « Je
crois, dit le Négus, que tu aimes mieux ton père que moi ? … ». « Et quand cela
serait ? » dit-elle par bravade. Il y répondit par une solide correction
manuelle, et Bell, qui voulait galamment intervenir, reçut deux vigoureux
soufflets. Pour humilier la dame, Théodoros prit tout de suite une femme de
naissance infime ; partout où il va il traîne avec lui ses deux femmes, comme
Louis XIV au siège de Namur. Dans sa tente, il siège entre Oubié et l'ex-roi de
Choa qu'il
traite en rois. Son fils, grand jeune homme de vingt ans, ne siège
que parmi les simples officiers... ».

Après avoir levé le plan de Sennaar, qui n'est qu'un amas de ruines, Lejean alla visiter, à sept heures de marche, à l'ouest de cette station les antiquités du Mont-Sagadi, prétendues sépultures qui ne lui parurent que des formes bizarres de rochers. Il partit ensuite pour Kardodji, en face de Seron, et d'un long marais à l'ouest du Nil, où il fut saisi de fièvre. Il s'avança vers l'est et coupa les deux îles formées par le Nil Bleu, le Dendar et Rabad. De Rabad (14 novembre) il se dirigea presque à l'est vers Gallabat, étudia le massif de Ras-el-Fil, composé de trois chaînes parallèles à l'Albara, continua de suivre l'itinéraire indiqué dans la lettre précédente, et arriva, vers la fin de janvier 1863, à Devra-Tabor, où il eut avec Théodoros, le 25 de ce mois, une entrevue, suivie le lendemain de sa réception officielle. Elles furent, l'une et l'autre, l'objet de la relation contenue dans les deux lettres adressées, la première le 30 janvier à Mme Cornu, la seconde le lendemain, à M. Ernest Desjardins, qui les a fondues en une seule date sa communication à la Société de Géographie (Bulletin, etc., 5ème série, t. VI, pp. 73-76), communication qui ne comportait pas certains détails dont la reproduction nous semble intéressante à plus d'un titre.
« Kaffa, près Devra-Tabor, le 30 janvier 1863,
MADAME,
Je ne vous ai pas donné de
mes nouvelles depuis Sennaar; et j'aurais un monde de choses à vous dire,
voilà pourquoi je veux abréger : J'ai fini par atteindre le « Négus Nagash za
Aitiopya » le roi des rois d'Ethiopie. Il a un lion dans ses armes ; c'est une
hirondelle qu'il devrait y placer, car on n'a pas d'idée d'une pareille
ubiquité. Suivez, si vous pouvez, sur une bonne carte d'Abyssinie, le résumé de
ses marches pendant ce mois. 2 janvier, du camp de Miedja au camp de Madhera
Mariam ; 12, départ pour le Godjam ; arrivée, le 15, au Tabba Ouaha ; le 22,
retour à Mahdera ; le 25 au soir, à Devra-Tabor ; le 26, excursion à
Kaffa; retour au Tabor ; le 29, nouvelle de guerre, retour à Madhera. On suppose
qu'il va passer le Nil. C'est donc miracle que je l'aie rencontré. J'ai envoyé
au Ministre mon rapport officiel ; me permettrez-vous un entretien plus familier
?
Mardi 25, averti que le Négus arrivait à Kaffa, j'ai passé mon uniforme. Un des missionnaires européens est venu en hâte me dire « Venez saluer S. M., elle arrive, elle monte la côte à pied ». J'ai vu venir un tourbillon d'officiers indigènes tout vêtus de velours et de soie, et au milieu d'eux un homme d'environ 44 ans, de complexion sèche et robuste, de figure ouverte et bonhomme, les yeux vifs, le front magnifique, vêtu avec une simplicité telle qu'elle semblait une épigramme contre les autres : c'était Théodoros II. Il m'a fort gracieusement accueilli et, arrivé à un palais où il s'est reposé un instant, il m'a fait asseoir sur son tapis, m'a fait quelques questions sur la portée des projectiles de guerre, « chose que vous devez bien connaître puisque vous êtes un européen et un homme instruit », et a fini par me demander quand il me conviendrait d'être reçu officiellement. J'ai naturellement répondu en me mettant aux ordres de S. M., et j'ai été reçu le lendemain, mercredi, avec tous les honneurs imaginables. Les présents impériaux, surtout le revolver, ont fait un effet superbe, mais la lettre encore davantage. Le Négus ne se possédait pas de joie. Il faut vous dire qu'il connaît bien son histoire ancienne, pas mal son histoire moderne et est assez bien au fait de la situation actuelle de l'Europe. Ses modèles sont David, Alexandre, Napoléon Ier. Pourquoi David ? Je le constate sans chercher à l'expliquer. Le nom de l'empereur actuel a pour lui un prestige d'autant plus singulier qu'il n'a guère pu être informé que par les agents anglais qui l'entouraient et qui ont l'habitude de parler avec animosité de Napoléon III. Je dois pourtant dire que feu M. W. Plowden, consul britannique à Gondar, avait coutume de parler avec sympathie et déférence de S. M. I.
Le Négus m'a témoigné son contentement en me faisant installer dans la plus splendide de ses tentes et en donnant des ordres pour me faire fournir largement les vivres et toutes les autres choses dont j'aurais besoin pendant mon séjour ; de plus, il a donné l'ordre à son orfèvre en chef de me confectionner une selle semblable à celles qu'ont les grands officiers de la couronne. Mais ce n'est rien auprès des présents qu'il destine à LL. MM. II., et qui sont en main à l'atelier impérial d'Adouah. J'ai su beaucoup de choses par des indiscrétions de cour. Il y a en particulier un bouclier, le chef-d'œuvre d'un art dont la tradition me semblait perdue en Orient. Une seule des 30 ou 40 rosaces de ce bouclier ferait l'admiration d'un Froment Meurice. Depuis les dons d'Al-Raschid à Charlemagne, jamais souverain français n'aura reçu d'Orient un pareil bijou.
Théodoros veut envoyer en France, vers le mois de juillet, deux ambassadeurs pris parmi les hommes les plus intelligents et dans la haute aristocratie de l'empire. Je ne sais pas encore quels sont les hommes honorés de son choix ; mais je me tiendrai au courant, et je veillerai à ce que la France ne soit pas mystifiée comme il y a vingt ans. On a fait trop de bruit, en 1810, de l'ambassade d'Abyssinie qui n'était, au point de vue des Abyssins, qu'une mission insignifiante envoyée à un pays jusqu'alors inconnu, par un aventurier réussi, le maire du palais Oubié. Je doute fort que le Négus d'alors, au fond de son palais délabré, ait jamais eu connaissance de cette ambassade. Les Abyssins sont un peuple très-aristocrate. A leurs yeux, le bâtard Oubié et les simples debterus qu'il envoyait avec M. Lefèvre n'avaient pas qualité pour traiter avec une grande puissance. Plus tard, l'agent consulaire à Massouah, M. Degontier, brouillé avec M. Lefèvre, écrivait au ministère qu'il avait parmi ses domestiques un des deux ambassadeurs d'Oubié. Ce n'en étaient pas moins des hommes instruits, comme le prouve leur journal de voyage traduit par M. Lefèvre ; mais, dans l'idée du pays, c'étaient des gens de rien. Cette fois, il en sera autrement. Je saurai dans peu qui seront les deux hommes choisis, et j'enverrai une notice individuelle sur eux. Ce sera un fait important, car je ne sais pas, depuis trois siècles, d'ambassade abyssine envoyée en Europe. Le Négus, dont les vues civilisatrices ne sont pas toujours bien appréciées dans ses Etats, songe très-judicieusement à s'affermir et à grandir aux yeux de ses sujets en se faisant constater par l'Europe. Il doit aussi envoyer une mission en Angleterre, et c'est le consul de S. M. B., M. Cameron, qui doit accompagner l'ambassade. Je crois utile, sous bien des rapports, que j'en fasse autant pour celle qui nous est destinée, et j'ai demandé, à cet effet, à M. le Ministre, un congé de quatre mois. Je pense qu'il sera également à propos qu'un des nombreux transports que nous avons dans la mer Rouge pour le service de l'Indo-Chine soit envoyé en temps utile à Massouah pour prendre les ambassadeurs, car le service de Massouah à Djedda ne se fait que par des barques arabes, ce qui le rend incommode, irrégulier et quelquefois périlleux.
Vous savez qu'à mon départ de Paris, j'étais fort curieux de voir Théodoros et de juger par moi-même de tous les récits contradictoires qu'on en fait. L'ensemble de ce que j'ai vu et entendu en Abyssinie me mène à cette conclusion c'est un barbare doué d'un grand génie organisateur. Il suffit de lire tous les voyageurs depuis Bruce jusqu'à M. Galinier, ou d'interroger les souvenirs des natifs pour sonder l'abîme d'anarchie, de désorganisation et de ruine dont il a sauvé l'Abyssinie. La sécurité matérielle est aujourd'hui aussi grande que dans l'Europe centrale ; le brigandage féodal est supprimé ; le commerce est possible. Il y a dix ans, chaque soir de marché, dans le moindre village, était ensanglanté ; aussi les produits du sol ne se vendaient pas : pour un sel (22 centimes), on avait six ou sept poules, pour deux sels, un mouton. A présent, le paysan vend bien le superflu de sa production ; il n'y a que deux villes (Gondar et Adouah) ; tout le monde est producteur agricole, et il n'y a que le riche qui ait besoin d'acheter, mais pour les besoins de sa domesticité, c'est-à-dire, de son luxe. On paie des impôts réguliers. Un homme opprimé par des hobereaux ou des tyrans de village n'a qu'à crier : Théodoros amlak (par le Dieu de Théodore !) ; c'est le haro des Normands, et il ne fait pas bon de passer outre. Voilà le régime actuel. Voulez-vous juger de l'ancien par une anecdote ? En 1848, Oubié fit courir le bruit de sa mort, et tout le monde se réjouissait, l'armée la première. Le troisième jour, Oubié apparut au milieu du camp, mieux portant que jamais, et dit : « Il a plu à mes fidèles sujets de me supposer défunt, il est donc juste qu'ils me paient un teskar (festin funéraire) ». Le teskar d'Oubié fut un impôt écrasant qui pesa sur tout le Tigré (pays aussi grand et aussi peuplé que le Portugal) et le ruina net, des provinces entières furent dépeuplées. Si ce régime avait duré, l'Abyssinie n'eût eu de refuge que dans la conquête étrangère. Les fellahs du Soudan ont eu à souffrir, mais ils n'ont pas sur les bras, pendant vingt ans, comme le Tigré, un régime de janissaires, auprès duquel les dragonnades de Louis XIV seraient bénignes. Théodoros, en montant au pouvoir, a trouvé une agglomération, ou plutôt une désagrégation de trois royaumes et de plus de quarante fiefs sans cesse en guerre. Il a tout fondu et pétri ensemble, et créé un empire. La noblesse indigène en a été si reconnaissante, que depuis dix ans, il a eu à comprimer 53 insurrections ; il est en train d'en finir avec les nos 54 et 55 (le vice-roi de Godjam et les grands barons du Choa). Je ne parle pas du n° 56 (insurrection de l'Adona) du mois dernier, parce que le peuple qui est ici aussi attaché au souverain que la noblesse l'est peu, a réglé l’affaire lui-même. Un baron mécontent a surpris Adouah et forcé MM. Cameron et Shimper (botaniste allemand bien connu) à se réfugier dans l'église d'Axum. A l'instant, les campagnes se sont soulevées, huit paroisses ont marché sur Adouah ; un combat sanglant a eu lieu et le chef des paysans a été tué ; mais les hommes exaspérés ont fini par écraser les rebelles et saisir le chef insurgé qui a été mis à mort sur le champ avec toute sa famille.
Théodore me rappelle, par les bons et les mauvais côtés, un autre grand barbare, Charlemagne. Au lieu d'imposer à ses sujets une civilisation contemporaine exotique, comme l'ont fait Pierre le Grand, et en général les réformateurs orientaux, il cherche son modèle dans l'histoire du passé ; il veut revenir à l'empire abyssin de l'an 1500, comme Charlemagne voulait évidemment revenir à l'empire romain de Théodose. La plupart de ses réformes sur la justice, l'esclavage, l'administration, la peine de mort, sont des retours à l'ancien code national. Il y a un certain esprit sage et pratique à chercher le perfectionnement de sa nation dans les propres éléments de cette nation, tout en comprenant et en essayant prudemment quelques améliorations européennes. Entre les deux réformateurs les similitudes abondent : même fanastisme, mêmes guerres de propagande exterminatrice (les Saxons, les Gallas) ; même grandeur d'âme habituelle démontrée par quelques exécutions impitoyables ; même rapidité stratégique ; dans la vie privée, mêmes légèretés conjugales ; même simplicité d'habitudes. L'un et l'autre n'ont été battus qu'une fois dans des combats épisodiques (Roncevaux, la Zériba). Une différence à l'avantage du Négus, c'est qu'il paie de sa personne et qu'il a terminé plusieurs insurrections par des duels brillants à cheval, où il a toujours expédié son homme, et toujours de la même manière : une balle au front, tirée au galop.
J'ai fait allusion à son ménage, c'est son côté faible. Sa première femme, épousée quand il n'était encore que dejdaz (duc), était une femme de naissance modeste, et, à ce qu'on m'a toujours dit, une personne accomplie : douce, charitable, soumise à ses devoirs. Son fils dedjaz Mecheca, âgé de vingt ans et prince héréditaire, a hérité de ses vertus et de sa popularité. Après sa mort, le Négus a fait un mariage politique ; il a épousé la fille d'Oubié, devenu son prisonnier, la belle Toronèche (ce mot veut dire pureté), La jeune impératrice est trè-belle, blanche comme une Française, sage, spirituelle, lettrée ; mais c'est une princesse abyssine, c'est-à-dire la quintessence de l'orgueil. Les premiers torts cependant ne sont, dit-on, point d'elle. Un jour de très-grande fête, elle demanda au Négus une amnistie en faveur de beaucoup de nobles, détenus comme partisans d'Oubié. Théodoros, furieux, lui dit : « Tu conspires avec ton père, est-ce que tu le préfères à moi ? » — Elle eut le tort de répondre : « Peut-être », et reçut à l'instant un superbe soufflet. Le chambellan James Bell, qui intervint galamment, en reçut autant ; Oubié fut mis aux fers, et le Négus, pour vexer sa femme, prit quatre favorites qu'il quitta plus tard, parce qu'il ne les avait prises que par dépit, il en a gardé une, nommée Onar-kénèche (précieuse comme l'or), parce qu'il a cru trouver en elle une affection sincère et la douceur que sa femme n'a pas. Du reste, ce singulier homme aime sa femme au fond ; il est fier d'elle et lui a conservé sa situation de reine légitime. Il ne peut s'empêcher d'aller de temps à autre la voir pour s'entendre dire les choses les plus mortifiantes. « Crois-tu que je te craigne ? Tout ce que tu peux me faire, c'est de me tuer, et après…. Tu seras déshonoré, et moi, l'on me plaindra... ». Théodoros a aussi quelquefois des confessions fort amusantes devant la cour. Il arrive parfois qu'un prêtre courageux (chose rare ici) lui fait des remontrances, et le Négus de dire : « C'est vrai je suis le scandale de l'Éthiopie ; je suis vraiment devenu un bien méchant homme, n'est-ce pas, mes enfants ? ». Silence général et embarrassé. — « Je n'étais pourtant pas ainsi autrefois ; d'où vient ce changement ? Sans doute de ce que le démon est devenu plus fort que moi. O mes enfants ! je suis un grand pécheur ; il faut que je change ! ». Mais la nuit porte conseil, et il part pour Devra-Tabor, où est la favorite chez qui j'ai eu le plaisir de déjeuner, le 5 janvier, sans aucun appareil officiel, bien entendu.
Il a rempli les quatre prisons d'État de nobles insoumis ou suspects. Quand il condamne quelque chef à cette réclusion forcée, il lui dit : « Va, tu n'y resteras pas toujours ; que Dieu te délivre ! ». Ce n'est pas, comme cela en a l'air, une ironie insolente ; cela veut dire : « Que Dieu pacifie l'Abyssinie de manière à ce que je puisse te délivrer sans danger pour l'État ! ». Le condamné comprend, salue et est emmené.
Je ne conclus encore à rien, le Négus ayant disparu, selon son habitude, pour aller batailler au sud ; mais je le reverrai bientôt et ne veux revenir à Massouah qu'après avoir rempli de mon mieux le programme qui m'est confié. Les dispositions de Théodoros me donnent le meilleur espoir. Avant de savoir mon arrivée, il avait écrit à S. M. Napoléon III, une lettre qu'il a confiée à un jeune touriste français, M. Bardel, en ce moment en route pour l'Europe. Je regrette vivement ce châssé-croisé de lettres qui n'eût pas eu lieu, si l'absurde police abyssine ne m'avait pas retenu vingt-quatre jours à la frontière.
Souvenir respectueux à M. Cornu ; amitiés à votre comité des dimanches soirs. Dites bien à M. D... que produits de la rue Vivienne ont soutenu sous le 12° de latitude, l'honneur de l'industrie française, et permettez-moi de compter sur une de vos lettres. Oserai-je vous demander quatre pages ?
Je vais écrire à Lyon et à Valenciennes. Votre reconnaissant G. LEJEAN » [Note : Mme Cornu communiquait à l'Empereur toutes les lettres que Lejean lui adressait, et voici en quels termes elle lui faisait connaître, le 15 août 1863, l'impression favorable qu'elles produisaient. « J'avais lu votre intéressante lettre de janvier à l'Empereur. Il avait été très-frappé de tout ce que vous me disiez alors sur Théodoros et ses qualités de souverain. Il m'avait demandé la lettre pour la lire, à son tour, à l'Impératrice, en exprimant son contentement sur vous et ce que vous faisiez pour le service de la France. Il était très-bien disposé pour l'empereur Théodoros. Le ministre M. Drouyn de Lhuys avait aussi fait de grands éloges de vous et de vos rapports. J'ai envoyé les dernières lettres à Vichy. Je ne sais quel effet elles auront produit, ayant dû partir moi-même pour venir ici (Saint-Gervais, Haute-Saône) pour cause de santé, etc. »].
« Devra-Tabor, 31 Janvier 1863.
.......... J’ai fait un beau voyage, géographiquement et géologiquement parlant, dans les provinces (jusqu'ici inconnues) entre le Nil Bleu et Gallabat. Gallabat est un petit Etat neutre dont le chef est nommé par le Négus, et qui paie 2,000 dollars de tribut à l'Egypte, autant à l'Abyssinie. Il a été formé par des nègres musulmans qui, revenant du pèlerinage de la Mecque, s'arrêtent là et se livrent au commerce et à la culture avec une activité qui contraste avec l'orgueilleuse paresse de leurs voisins. Je ne vous ennuierai pas des détails de mon voyage d'Abyssinie par Tchelga, la rive du lac, Devra-Tabor. On entre aisément en Abyssinie, mais c'est une souricière où on subit toutes les vexations possibles avant d'avoir pu avertir le Négus que l'on est arrivé, et le Négus galope quelquefois sans cesse d'une province à l'autre. Je plains ses ennemis, ses aides de camp et ses chevaux. Voulez-vous retourner en arrière ? Impossible : vous êtes entré, vous êtes prisonnier d'Etat. Le Négus est le seul Abyssin qui aime les étrangers, mais il les aime un peu comme ses poupées. Quand on lui plaît, on ne peut plus avoir la permission de sortir de l'empire. Je connais ici plusieurs Européens qui attendent vainement cette permission depuis des années. Il y a un missionnaire allemand qui veut aller se marier en Europe. Le Négus lui dit : « Est-ce qu'il n'y a pas de femmes ici ? ». Le malheureux, de guerre lasse, va, je crois, épouser une métisse. Grand bien lui fasse Je connais ici plusieurs filles d'Européens et d'Abyssiniennes, et ces exemples ne prêchent guère en faveur des doctrines de cabinet de M. Michelet sur les croisements de races. En général, je regarde comme une marque d'infériorité d'esprit de se contenter d'un être inférieur pour une chose qui demande tant d'égalité que le mariage. Le civilisé qui s'appareille avec la barbare se flatte en vain d'influer sur elle; c'est elle qui déteint sur lui. Je vois cela à Khartoum comme en Abyssinie. Quant aux enfants, ils deviennent ce qu'ils peuvent : le père s'en occoupe peu, la mère pas du tout ; ils passent le temps à bavarder et à polissonner avec les domestiques, et voilà comme ils grandissent. Madame leur mère, roulée dans sa chama, et pelotonnée sur un divan, passe la journée à jouer avec ses pieds nus et à regarder devant elle avec de magnifiques yeux stupides.... Il y a, à Bala, un séminaire appelé Saint-Chriscowa, fondé pour former et envoyer per orbem des missionnaires protestants forts sur la théologie et les professions manuelles. Cela est bien imaginé en théorie, mais, en pratique, cela aboutit souvent à envoyer au loin, aux frais des fidèles, des gens positifs, qui vivent bien, prêchent peu et profitent de leurs talents en menuiserie et en ferblanterie pour courir après les dieux florin et dollar. Du reste, aimables gens dont j'ai gardé bon souvenir, mais toujours en défiance de la France et des papistes, et âmes damnées de la politique anglaise. En venant ici, ils voulaient prêcher ; Théodoros leur a dit : « Mes enfants, nous sommes tous chrétiens, n'est ce pas ? Il y a de petites différences entre votre culte et le mien, c'est vous qui devez avoir tort ; donc, n'en parlons plus. Prêchez à mes sujets, si vous voulez, de ne pas voler et mentir, mais laissez la Vierge tranquille, elle ne vous a rien volé. Maintenant, parlons raison. J'ai besoin d'obusiers. Pouvez-vous m'en faire ? ». Les Allemands sont assez souples devant les puissances terrestres ; ils n'ont pas fait de prosélytes, mais ils ont fait des obus. Le roi paie bien, et ils font bien leurs affaires et les siennes, mais ils ne font pas pour le pays, la civilisation et l'influence de l'Europe, ce qu'ils pourraient et devraient…. Physiquement, les Abyssins sont bien doués, et pas un peuple en Orient ne pose mieux pour l'effet. D'Abbadie les appelle très-justement gens togata ; ce sont en effet des Romains un peu bistrés, mais fort beaux. Je vous enverrai une masse de dessins qui vous donneront une idée d'un art que je ne soupçonnais pas, frère de l'art sarrazin, et qui lui a survécu. La fantaisie abyssine, dans l'ornementation, est d'une variété prodigieuse ; en revanche, la peinture religieuse (figures) est plus que naïve. Dans un tableau (La Sainte Famille), la Vierge file du coton ; dans un autre (Passage de la Mer Rouge), les Hébreux poursuivis font une fusillade bien nourrie contre les Egyptiens. En somme, il y a souvent de la majesté, de la verve et de la couleur, etc., etc. ».
Les bonnes dispositions que Théodoros avait témoignées à Lejean, le 25 et le 26 janvier, furent confirmées par l'offre qu'il lui fit, dans la soirée du 8 février, soit de rester à Kaffa ou à Gondar, soit de l'accompagner dans une expédition contre Tedla-Gualu, chef rebelle du Godjam. Lejean, dans l'intérêt de sa mission, tenait à rester près du Négus le plus longtemps possible, et sa réponse, qui n'était pas douteuse, lui fit le plus grand plaisir. Monté sur une excellente mule, présent de Théodoros, il le suivit dans cette expédition dont il a donné le récit journalier (Théodoros II, le nouvel empire d'Abyssinie, etc., pp. 142-149. Paris, AMYOT, 1865, 300 pp. in-12). L'étoile du Négus pâlissait, la campagne ne fut pas heureuse, et il fut obligé de battre en retraite. Dans sa colère il exerça des rigueurs qui exaspérèrent les populations. L'irritation de l'armée se traduisait en nombreuses désertions ; Théodoros fit battre le pays par des masses de cavalerie qui égorgeaient tous les soldats pris en flagrant délit de fuite. De cette situation naquit un complot, le plus redoutable qui eût encore menacé les jours et le pouvoir de Théodore, qui soupçonnait Lejean de n'y pas être étranger. En même temps il apprenait que les Egyptiens occupaient sa capitale. Ce personnage fantasque était donc on ne peut plus mal préparé à accueillir la demande que lui fit Lejean, le 2 mars, de pouvoir retourner à Massouah pour y expédier les affaires urgentes du consulat, et d'où il convoierait lui-même les deux caisses de présents offerts par Napoléon à S. M. abyssinienne. Ajoutons que, ce jour-là, Théodoros, d'ailleurs coutumier du fait, avait abusé du cognac. Transporté de colère, il s'écria : « Je le retiendrai à tout prix ; qu'on le mette aux fers, et, s'il cherche à fuir, qu'on le tue ! ». Neuf hommes se jettent aussitôt sur Lejean, revêtu de son uniforme de consul, et l'accouplent à un pauvre diable rendu responsable de son évasion. Le sbire chargé de l'opération s'en acquitta consciencieusement, au point que craignant, en raison de la petitesse de la main de Lejean qu'elle ne passât à travers les menottes, il avait si bien rivé la chaîne, qu'à chaque mouvement du prisonnier, le fer lui entrait dans le poignet. Théodoros, qui était présent, eut la délicate attention de la faire desserrer de quelques millimètres. Que se passait-il pendant ce temps dans l'esprit de Lejean ? « Je ne sais, a-t-il dit plus tard (Tour du Monde, 213ème livraison), si aucun de mes lecteurs connaît cette situation plus morale encore que physique, d'avoir eu les fers rivés au poignet, et d'avoir ressenti chacun de ces coups de marteau dans sa chair et dans ses oreilles à la fois ? C'est au cerveau surtout que ces coups secs et métalliques retentissent comme des coups de tonnerre. Je ne connais rien de plus irritant et de plus douloureux. Ma surexcitation d'abord violente, fit subitement place à un calme régulier. Je n'étais guère en voie de réflexion, mais trois choses se dessinèrent vigoureusement dans le miroir de ma pensée : mon innocence, mon caractère officiel, l'honneur de la grande famille à laquelle j'appartenais parmi les nations. Je compris qu'ici, comme en bien d'autres cas, le rôle d'offensé était encore matériellement préférable à celui d'offenseur, et j'assistai avec sang-froid et une sorte de curiosité bizarre, à tous les détails brutaux de l'opération ». L'émotion qu'il avait éprouvée n'avait, en effet, duré qu'un moment, et le calme qui lui avait succédé persistait lorsque, le surlendemain, il écrivait à M. Richard Cortambert :
« Sans être un Decius, j'envisage froidement la chose, et je trouve que, si ma carcasse détériorée peut donner une autre Algérie à la France, elle aura trouvé bon emploi. Un agent européen qui va dans les antres de ces tigres d'Orient, sait ou doit savoir ce qu'il joue, et s'il perd la partie, tant pis pour lui. Cela ne doit pas arrêter un gouvernement. Je suis triste d'avoir à vous dire tout ceci ; car, au fond, j'admire et j'aime toujours ce diable d'homme qui, cependant, avant-hier, a donné cet ordre textuel : Prenez-le, mettez-le aux fers et, s'il cherche à fuir, tuez-le ».
Le 3 mars, le Négus, dégrisé, fit déchaîner son captif [Note : Son compagnon ne fut déchaîné qu'au bout d'un mois, mais reçut plus tard un riche fief en compensation] et lui offrit la liberté s'il voulait lui accorder son amitié d'abord, ensuite la promesse de rester prisonnier sur parole à Devra-Tabor, avec faculté d'aller où bon lui semblerait dans un rayon de 30 à 40 lieues jusqu'au retour de M. Bardel. Lejean n'était pas en position de refuser. Il resta donc, mais sans s'abuser sur la possibilité de nouveaux dangers qu'il aurait affrontés non par ostentation, mais par devoir. Nous en trouvons la preuve dans sa lettre du 3 juin 1863, à M. Ernest Desjardins, lettre nous faisant connaître les difficultés de la mission dont il était chargé, et où il exprime des prévisions dont les évènements ultérieurs ont justifié la sagacité :
« Toujours prisonnier indéfiniment. Le Négus qui était un grand homme populaire et respecté, il y a quatre ans, est devenu fou d'orgueil depuis que la soumission des révoltés du Tigré l'a rendu absolu ; il est tombé dans une double ivresse, l'eau-de-vie et les femmes. Depuis la campagne du Godjam où, avec un énorme déploiement de force, il s'est fait chasser par les rebelles, il a perdu toute confiance en son étoile, ce qui est le premier mot de la fin, et lui, jadis si brave et si actif, il s'enferme dans sa tanière de Vofarghef lançant des ordres draconiens contre les chefs et les districts restés fidèles (les autres sont hors de sa portée), rongeant son frein sous les messages insultants de Tedla-Duala (qui, pour bien des gens est le soleil levant), et, pour retenir ses troupes qui se débandent, leur livrant, en trois mois, quatorze provinces à saccager. Depuis trois semaines, on n'a pas eu de ses nouvelles ; il a commandé à ses missionnaires allemands un obusier monstre qu'ils ont promis en tremblant, mais qu'ils ne pourront pas faire, et de l'eau-de-vie qu'ils lui font à profusion, qui le tue doucement, et qui leur est mieux payée que les sermons.... qu'ils ne font pas. Ce qui lui a fait le plus de mal, ce ne sont pas les pieds et les mains coupés par milliers, ce sont les églises brûlées et profanées pendant ces trois derniers mois. Un Abyssin me disait « Il détruit les églises, il finira mal. Il dit qu'il hait les mauvais prêtres, mais pourquoi ne cherche t-il pas les bons ? ».
Les gens à bibles sont bien coupables de leurrer l'Allemagne et l'Europe au sujet de cet homme. Mais, s'ils exposaient la situation vraie, l'intolérance du roi, l'inutilité de leur présence, on les rappellerait, ce qui ne ferait pas leur affaire. L'un d'eux, Martin Flad (qui est, lui, un vrai apôtre), me disait : « Ce sont de pieux mensonges qui sont, en somme, improbes. On fait croire au monde protestant qu'on a 1,500 néophytes dans un pays où on n'en a pas un. Et pourquoi cela ? Parce que les comités ont besoin de résultats à jeter aux yeux des Yankees. Les Allemands, les Anglais souscrivent par pitié ; les Yankees, gens positifs, aiment les coups de la grâce comme des coups de grosse caisse, et ne donnent jamais leurs dollars pour des espérances incertaines ».
Tout ce que j'ai écrit à M. Thouvenel sur le Négus, en 1861, était vrai en 1860, mais, dans l'intervalle, la mort de James Bell (qui avait civilisé cet homme, comme le matelot breton Corolier avait formé Radama Ier) a rompu la digue, et Théodoros II va à la dérive. Il porte, dès à présent, la marque des hommes finis.
Notre gouvernement a été bien illogique dans les affaires du Tigré, en 1860. Il n'a eu ni la force de résister aux obsessions de Jacobis et des missions étrangères, ni de les appuyer franchement. Si l'intérêt lazariste était anti-français et funeste, il fallait le repousser ; s'il était nôtre, le bien soutenir. On reconnait Négousié comme roi, on lui envoie avec fracas cette ambassade Russell et 1,500 fusils, mais on néglige de joindre les 500 hommes d'infanterie de marine ou de chasseurs à pied qui auraient balayé tous les Chinois de Théodoros, et Négousié, seul poltron au milieu d'une armée qui voulait se battre, se sauve déguisé en domestique, et puis, finit bêtement — et le Négus publie partout qu'il a vaincu le protégé de la France. Russell tombe à Halay au milieu d'une émeute où le drapeau français est foulé aux pieds ; il est pris par un vassal du Négus, interné à Halay, et se sauve nonobstant de nuit à Massouah, laissant à l'ennemi les trois hommes de bonne volonté (deux missionnaires et un Abyssin) qui ont garanti sa parole. On a perdu là une excellente occasion de mettre l'Abyssinie sous le protectorat de la France, comme Taïti, et c'eût été son salut (elle périt d'anarchie). Si on croyait avoir le droit et le devoir de le faire, il fallait le faire carrément; si on ne le croyait pas, il ne fallait rien faire du tout.
Je tiens beaucoup à ce que les choses s'arrangent, moyennant que le Négus fasse des excuses (et on peut l'espérer) et qu'il accepte vis-à-vis de la France les liens réciproques qui existent entre nous et les grandes monarchies d'Orient (cela je ne l'espère pas aujourd'hui). Tu-Duc et le fils du Ciel peuvent reconnaître la loi de la nécessité, mais je connais assez le fils de David pour savoir qu'il ne l'acceptera qu'après quelque sanglante leçon que ses sujets me semblent disposés à lui donner sous peu. On ne sait pas assez ce que c'est qu'un illuminé croisé d'un ivrogne. Je crois bien qu'il périra avant qu'un étranger puisse passer ou résider en Abyssinie sans être son esclave. Or, la France ne peut pas accepter cela : nos nationaux ont des droits, même en Russie et en Autriche, et ne peuvent pas être sous le bâton d'un roitelet vide et gonflé qui serait renversé d'un bâillement de Napoléon III. Une bagatelle peut amener le conflit, car l'isthme de Suez amène chaque année de nouveaux visiteurs ; ce qui la retardera, ce sera la patience intéressée, des parties lésées, Les uns comme Coffin, Plowden, Schimper, se sont faits barons abyssins, sont devenus sauvages, ont perdu leur position d'Européens et quelque peu leur moralité, et ne se plaindront pas vite d'un gouvernement qui pourrait, sur le terrain de la légalité, leur demander compte de certaines peccadilles. Ils aimeront mieux baiser ses bottes, recevoir ses aumônes et se faire oppresseurs à son ombre. Voilà pour les grands. Les petits sont un fretin d'aventuriers, ouvriers renvoyés de l'isthme, banqueroutiers de Marseille et du Caire, et qui, fussent-ils bâtonnés à Gondar, ont un intérêt majeur à cacher leur face aux consulats. Restent les marchands de catéchismes qui avalent des avanies incroyables parce que le Négus leur paie bien leurs grotesques obusiers, et que, s'ils partaient d'ici, ils ne pourraient que redevenir, en Allemagne, ce qu'ils étaient jadis, ébénistes, tailleurs de pierre et charcutiers. En un mot, il faut arriver à ceci : C'est qu'un Européen puisse avoir pour sa personne et sa propriété la même sécurité en Abyssinie qu'en Egypte. Pour ma part, j'affirme la chose impossible sous Théodoros. Si mon collègue Cameron y arrive pour ses nationaux, je consens à passer pour un imbécile aux yeux de M. Drouyn de Lhuys. Si je parviens à sortir d'ici, je n'en serai pas moins disposé à rentrer si mon gouvernement me l'ordonne, mais je serais sans illusion et parfaitement certain que ni mon uniforme, ni mon drapeau ne me protégeront.... J'expédie par ce courrier, à mon ministre, quatre gros rapports et dix kilos de cousso pour les hôpitaux de Paris. Les médecins de votre ville ne me voteront pas des couronnes civiques ».
Ce ne fut que le 15 septembre que le Négus accueillit la requête ci-après de Lejean :
« SIRE,
Je reçois
aujourd'hui mes lettres de Massouah. J'apprends que mon gouvernement est inquiet
de mon absence et qu'il a envoyé à Massouah un vapeur pour s'informer de mes
nouvelles. Désirant éviter de déplaire à l'Empereur, mon maître, je prie
instamment Votre Majesté de m'autoriser à rejoindre immédiatement mon poste,
d'où je pourrai revenir en Abyssinie, quand le service de mon Souverain et celui
de Votre Majesté l'exigeront.
En attendant que les présents destinés par Napoléon III à Votre Majesté soient arrivés, je la prie d'accepter l'envoi que je me permets la liberté de lui offrir, comme un remerciement de ses libéralités envers moi [Note : C'était un revolver, celui-là même, a-t-on dit, dont Théodoros se serait servi lorsqu'il s'est fait sauter la cervelle pour ne pas tomber vivant aux mains des Anglais. C'est possible, mais il est bien possible aussi que l'amour du pittoresque et de la légende ait trouvé original de faire de celui que le Négus avait si rudement traités, l'instrument, à coup sûr inconscient, de sa mort].
Si Votre Majesté m'accorde la permission que je lui demande, je la prie en même temps d'y joindre une lettre qui me serve au besoin à rentrer en Abyssinie, sans éprouver à la frontière un retard préjudiciable à la prompte expédition des affaires des deux gouvernements.
Je suis avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur. Le Vice-Consul de France, en mission en Abyssinie. G. LEJEAN ».
Toutefois, Lejean ne partit pas immédiatement. Théodoros lui assigna Gondar pour résidence jusqu'au retour de M. Bardel qui arriva, dans les premiers jours de septembre, porteur d'une réponse du Gouvernement français, à la lettre qu'il lui avait remise. Le Négus, fier de ce succès diplomatique, convoqua à Gondar, tous les Européens établis en Abyssinie, pour entendre la lecture du message impérial ; mais il avait préalablement ouvert la lettre pour la livrer aux traducteurs, de sorte que le contenu en fut vite connu et que Lejean put, sans indiscrétion, se concerter avec son collègue britannique et les membres les plus influents de la petite colonie, en vue d'une action commune sur l'esprit du Négus, dans le sens des instructions qu'il avait reçues. La lettre officielle demandait en termes courtois, mais fermes, la tolérance religieuse pour les missions catholiques romaines, protégées par la France. Les missionnaires bâlois, dirigés par le consul anglais et par M. Martin Flad, leur principal levier, mirent un grand empressement à lui offrir leur concours sur cette question religieuse dans la voie de la tolérance, conforme, disaient-ils avec raison, à l'esprit du protestantisme éclairé. Toute cette diplomatie fut dépensée en pure perte. Théodoros avait été assez irrité du passage de la lettre relatif aux missions romaines, et d'un autre lui faisant entendre qu'il jouerait trop gros jeu en attaquant l'Egypte. Il le savait bien, mais il était exaspéré qu'on le pensât. La déconfiture qu'il avait subie vers 1843, sur le Rahad, en attaquant 200 Egyptiens, était une blessure secrète, mais toujours saignante : « Je connais, avait-il dit, la tactique des gouvernements européens, quand ils veulent prendre un Etat d'Orient. On lance des missionnaires d'abord, puis des consuls pour appuyer les missionaires, puis des bataillons pour soutenir les consuls. Je ne suis pas un rajah de l'Indoustan pour être berné de la sorte : j'aime mieux avoir affaire aux bataillons tout de suite ». Après une série de scènes curieuses et caractéristiques, Théodoros répondit à ce qu'il regardait, comme une provocation de la France, par un ordre d'expulsion de son agent (28 septembre 1863). Lejean se hâta de regagner Massouah, avant que la nouvelle de sa disgrâce, semée sur la route, lui attirât des tracasseries de la part des autorités locales, Il avait été bien avisé de se hâter, car, quatre ou cinq jours après son départ, Théodoros était revenu sur sa décision du 28 septembre et avait dépêché un officier chargé de le ramener. Heureusement que quand cet officier arriva à Dobarek et transmit au chef de ce district l'ordre qui concernait Lejean, celui-ci avait un jour d'avance. Le chef de Dobarek descendit vers les basses terres jusqu'à la rivière Euzo, mais là il eut avis de quelque mouvement rebelle Terso, maître de toutes ces provinces, et craignant de se voir couper la retraite, il revint en toute hâte sur ses pas, racontant, pour excuser sa timidité, que Lejean avait déjà une avance de plusieurs jours. Théodoros, en recevant cette nouvelle, manifesta un violent mécontentement et prononça ces paroles qui, plus tard, furent repétées textuellement à celui qu'il avait fait poursuivre : « Voilà un homme qui est parti avant d'avoir su si je lui étais ami ou ennemi ».
Lejean suivit la route du
Tigré, pénétra dans la Kolla (les basses terres) et arriva, tout jubilant, le
17 novembre à Massouah d'où il écrivit, le même jour, à M. Ernest Desjardins :
« .... Le Négus est à présent très-bas. Il ne vit plus que du pillage successif de
ses provinces, et cette affreuse ressource lui manquera avant six mois
peut-être. J'ai parlé de ce modus regendi dans une dépêche au Ministre (du 5
juin) et j'ai donné la liste des provinces mangées. (c'est, le mot officel) de
février à mai 1863.... L'Abyssinie ne peut être sauvée que par l'Europe. Le
bourreau qui la ruine en ce moment est encore le seul indigène qui ait quelques
principes de gouvernement et quelque capacité, vestiges de ses brillants débuts.
Les insultes à l'Europe se multiplieront encore, et si nous n'intervenons pas,
l'Angleterre le fera et prendra le Tigré (une vraie Algérie) pour faire ses
frais....
En ce moment, mon intérêt le plus grave n'est pas le consulat. Prêtez-moi cinq minutes toute votre attention j'aime à causer avec vous de toutes mes affaires, car vous êtes vir boni consilii. Vous savez la découverte de Speke et Grant, c'est-à-dire, la constatation du lac Nyanza comme réservoir du Nil Blanc ; mais en était-il la source ? En tout cas, mon voyage de 1860-1861, est tellement distancé, que, si je tarde encore un an à le publier, je deviendrai aussi ridicule que le serait aujourd'hui Darnaud en donnant le sien ; que va l'être (je le crains) d'Abbadie, malgré son éporme savoir. Pourtant, j'ai aussi divers résultats :
1° L'exploration du Bahr-el-Gazal, connu de nom seulement avant moi ; 2° une bonne topographie du Kordofan et du Sennaar ; 3° l’ethnographie, pour la première fois débrouillée, de tout le nord-est de l'Afrique, avec ses 67 langues ; 4° La géologie et l'agronomie du pays parcouru ; 5° Enfin beaucoup de géographie comparée. Je puis donc encore espérer d'arriver à temps pour assurer mes droits d'antériorité dans ce steeple-chase et honorer le patronage qui m'a mis à même d'y figurer ; mais il faut, pour cela, que je publie en 1864. Ce n'est pas tout : je vous ai dit que les sources du Nil ne sont pas trouvées, car la masse d'eau qui sort du Nyanza est telle qu'il faut bien y voir, non un lac source, mais un autre lac traversé par un fleuve, comme le Léman, le Tzana, etc. Où donc serait la source ? Peut-être au pied du Kilimandjaro ; peut-être serait-ce même à ce fameux Liba ou Riba, fleuve mystérieux de l'équateur dont parlent tous les nègres de cette région interrogés par les missionnaires et les voyageurs. Or, je veux retenter le problème par Monbaz ou par le Gabon jusqu'à ce qu'il ait été résolu par moi ou un autre. Le bruit fait autour de Speke et de Grant m'avertit de la passion qu'on y met dans le monde savant et ailleurs. J'ai parlé de mon projet assez en détail à Mme Cornu, et d'autre part j'ai demandé au Ministre un congé de huit mois, alléguant pour revenir en France, ce qu'il sait parfaitement, que ma présence en ce moment à Massouah n'est nullement indispensable. Et maintenant, je vous demanderai un service : ce serait de voir sinon le Ministre, au moins M. Herbet ou M. Meurant, et de savoir si le congé en question m'est accordé ; s'il ne l'est pas, de donner ma démission avec remerciements pour la bienveillance que S. Exc. m'a témoignée. C'est une résolution grave, mais je n'hésite pas et les antécédents m'obligent. Puisque je me suis mis dans cette question du Nil, il ne faut pas que le patronage impérial soit ridicule et que les Anglais me passent sur le corps. Je ferai quelque grande découverte, ou je périrai, et je ne serai pas sifflé dans l'un ou l'autre cas. Les informations que je prendrai à Paris décideront si je dois prendre par le Gabon et aller à l'est, ou par Zanzibar à Monbaz et au Kilimandjaro, d'où je descendrai sur Nyanza, puis sur le Nzige. Le Riba coule à l'est et finit dans un grand lac, serait-ce le Tanganika ou le Nzige, ou un quatrième lac encore inconnu ? Quant au grand fleuve où d'Abbadie a cru voir le Haut-Nil-Blanc, à l'est du Kafa, il se confirme pour moi que c'est simplement le Juba ou Djoub qui va à la mer des Indes, etc. ».
C'était deux jours avant d'avoir écrit cette lettre que Lejean avait adressé sa demande de congé. Le Ministre, par sa décision du 8 avril 1864, lui en accorda un de six mois pour qu'il pût donner ses soins à la publication de son voyage en Abyssinie et de celui aux sources du Nil de 1860 à 1861. Le congé était d'ailleurs justifié, ajoutait le Ministre, par le besoin d'un repos bien nécessaire après les pénibles épreuves qu'il avait subies.
Dans l'intervalle et jusqu'au jour de son départ Lejean avait fait diverses excursions, notamment dans le Taka. Parti de Massouah, le 11 juillet 1864, il passa dix-neuf jours à tirer des bordées par une mousson contraire le long de la côte pelée et maussade d'Arabie. A Koudoufah, où il passa un jour, il visita l'intérieur de la ville sans exciter nulle part aucune émotion compromettante, ce qui le confirma dans l'opinion que l'Arabie est (sauf les villes saintes, les environs d'Aden et le pays Wahabite), la contrée musulmane où l'on trouve le moins de fanatisme religieux. En arrivant à Djedda, il vit le vapeur de Suez disparaître à l'horizon ; il l'avait manqué de quelques heures. L'aimable hospitalité du consul, M. Aadjonte Pellissier lui fit oublier les ennuis d'une station à Djedda, au mois d'août. Il partit le 15 août, jour où M. Pellissier venait de refuser la protection française à un négociant algérien qui faisait publiquement un chargement de 200 esclaves pour Suez. Après dix jours passés en Egypte, il dit, le 29 août, un adieu, qu'il ne croyait pas définitif, à cette « Afrique terrible et enchantée, a-t-il dit (Tour du Monde, 268ème livraison), que l'on ne parvient jamais à oublier, et dont le souvenir, ajoute-t-il, lui donnait parfois jusqu'en France, jusque dans Paris, de longues heures de nostalgie ». Arrivé à Paris, il n'y resta que le temps strictement nécessaire pour rendre au Ministre un compte sommaire de sa mission, tant il avait hâte de se réfugier dans la petite maison que sa marraine venait de faire construire, à son intention, à Kerampont, tout près de la demeure paternelle.
Nous venons de voir que le commerce des esclaves avait un adversaire en M. Pellissier. Lejean ne l'était pas moins. Nous ne parlerons pas des stigmates qu'il a infligés dans ses derniers écrits à cet infâme trafic. Ce ne sont là, dirait-on peut-être, que des vœux platoniques, aussi préférons-nous nous appuyer sur des faits attestés par trois lettres datées de Massouah, les 24 mars 1863, 13 et 24 mai 1864, lettres que nous avons sous les yeux et dans lesquelles le R. P. Ch. Delmonte, procureur de la mission des Lazaristes en Abyssinie, l'appelait le bienfaiteur de la mission, en raison des services qu'il lui avait rendus près du gouverneur, et où il lui témoignait sa reconnaissance de son intervention, couronnée de succès, pour empêcher l'envoi à Djedda de femmes chrétiennes achetées comme esclaves. Nous pourrions produire aussi plusieurs lettres des gens les plus honorables de la colonie européenne, invoquant son appui contre les exactions et la complicité intéressée de ce gouverneur dans le commerce de la traite. Ce n'est pas tout. Regardant comme un des premiers devoirs d'un représentant de la France à l'étranger, de l'y faire aimer et bénir, il adresssait â l'impératrice Eugénie, par l'intermédiaire de Mme Cornu, la lettre suivante :
« MADAME,
Il y a au village
d'Hevo (frontière d'Abyssinie), un couvent habité par quatre religieuses
indigènes, catholiques, chassées de leur province natale par l'influence du
patriarche schismatique. Elles sont âgées, pauvres, et vivent péniblement d'un
travail manuel fort grossier, mais sans se plaindre. Le hasard seul et une œuvre
charitable à laquelle je voulais les employer, m'ont fait connaître cette misère
supportée héroïquement et sans faste. J'ai osé espérer, Madame, que l'auguste
bienveillance de Votre Majesté s'étendrait sur de saintes infortunes encourues
pour la foi catholique et solliciter pour ces pieuses femmes un léger secours —
(40 ou 50 dollars, 210 à 262 fr.) seraient un secours splendide pour ce pays —
qui leur permettra d'associer dans leurs prières votre nom à celui de votre
auguste époux, que ces populations éloignées ont appris à respecter et à bénir. Je suis, etc. ».
Revenu à Paris, le 15 décembre, Lejean eut la malencontreuse faiblesse de se laisser aller à faire, le 7 janvier 1865, dans les salons de la rue de la Paix, une conférence sur ses voyages aux deux Nils et en Abyssinie. Une grande émotion l'empêcha d'apporter tout l'ordre désirable dans le récit de ses pérégrinations. Il fut obligé de s'arrêter avant d'être arrivé à la moitié de son sujet. L'auditoire lui avait néanmoins témoigné sa bienveillance et sa sympathie, en écoutant, sans le moindre signe d'improbation et sans les interrompre, des récits faits sans méthode et avec de pénibles tâtonnements. Il y eut pour lui, il faut bien le reconnaître, un véritable échec. Et pourtant il possédait bien la matière ! Mais troublé à son entrée par l'appareil du lieu, il n'avait pu, comme il nous le dit plus tard, reprendre possession de lui-même. Il fut plus heureux lorsque, le 27 mai 1867, il résuma, devant la Société Académique de Brest, dans une causerie familière de près de deux heures, l'intéressant voyage qu'il venait de faire dans l'Asie centrale. Là il se sentait à l'aise. Aussi se donna-t-il pleinement carrière et captiva-t-il son auditoire par maintes descriptions pittoresques, telles que celle de la vallée de Kachemyr, sur laquelle il s'étendit plus particulièrement.
On conçoit, malgré tout, la bienveillance avec laquelle fut écouté, le 7 janvier, celui qui s'exprimait ainsi [Note : Revue des Cours littéraires, t. II, p. 31] :
« Il m'est souvent arrivé, Messieurs, que des personnes qui avaient senti s'éveiller en elles le désir de pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique, m'ont franchement demandé quelles étaient les chances de succès, de luttes, de souffrances, de mort même qui pouvaient les atteindre. Je leur ai répondu : Si vous laissez derrière vous une famille à qui vous deviez compte de votre existence, ne partez pas ; si vous ne vous sentez pas assez fort pour renoncer au doux comfort européen, ne partez pas. Mais, si vous êtes libre, résolu, si vous voulez à tout prix savoir, si vous voulez scruter les mystères de l'Afrique jusques dans leurs dernières profondeurs ; si vous voulez étudier sur le vif les questions que nous agitons à travers des tempêtes de livres et de journaux, et surtout si vous êtes assez intelligent pour saisir sous une enveloppe toujours brutale, quelquefois un peu grossière, la véritable noblesse et la véritable grandeur de cette nature que vous allez voir, eh bien ! partez ! Vous aurez faim, vous aurez soif, vous mangerez des choses impossibles, vous boirez une eau qui aura tantôt la couleur de l'encre et tantôt la couleur de l'absinthe ; vous subirez des chaleurs excessives ; vous aurez la fièvre, et malgré tout cela, très-probablement, vous survivrez. Lorsque vous serez revenu en Europe, toutes vos souffrances passées ne vous laisseront plus qu'un souvenir, je dirai presque de bonheur, et vous n'aspirerez qu'à une chose, c'est à recommencer ! L'Afrique est une séductrice vraiment redoutable quand on y a touché, il faut qu'on y revienne.
Il y a pour tant des chances fatales. Le nombre des compatriotes que nous avons perdu depuis quelques années dans ces hasardeuses expéditions le prouve assez, mais il ne faut pas se les exagérer. Un excellent moyen de braver tous les dangers de l'Afrique et d'en revenir sain et sauf, c'est d'être parfaitement persuadé qu'on ne mourra pas. Si, malgré tout cela, il vous arrive malheur, si vous n'avez pas été égoïste, si vous avez songé à honorer votre pays, à faire profiter la science, la civilisation, l'humanité, des souffrances que vous avez endurées : eh bien ! vous aurez inscrit votre nom à côté des noms glorieux de Clapperton, de Mungo Park, de Richardson, et de tant d'autres que je pourrais citer. Franchement je ne vous plaindrai pas ».
Ce noble langage n'est-il pas un écho de celui que tenait Augustin Thierry alors qu'ayant perdu la vue à déchiffrer de vieilles chartes, il se comparait, avec un juste orgueil, au soldat mutilé qui a tout donné à son pays, et qu'il ajoutait : « Avec l'étude, on traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait à soi-même sa destinée ; on use noblement de la vie. Voilà ce que j'ai fait et ce que je ferais encore, si j'avais à recommencer ma route ; je prendrais celle qui m'a conduit où je suis. Aveugle et souffrant sans espoir, et presque sans relâche, je puis rendre ce témoignage qui, de ma part, ne sera pas suspect : il y a au monde quelque chose qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la santé elle-même, c'est le dévouement à la science ».
Quatre jours après sa mésaventure, il reçut une fiche de consolation, il était nommé chevalier de la Légion d'honneur. La veille, son congé avait été prolongé de trois mois. Mais avant son expiration, tiraillé en haut lieu par des influences rivales, chaos où il perdait le fil, il reconquit sa liberté, en se démettant, le 3 juin 1865, de son vice-consulat. Il lui fut promis qu'en échange de cette position, il serait chargé de missions annuelles. La promesse se réalisa promptement. Le 4 juillet, le Ministre de l'Instruction publique le chargea d'une mission scientifique ayant pour objet de visiter la Boukharie et d'étudier ce pays au point de vue de la géographie, de l'histoire, de l'ethnographie et de l'archéologie. Il lui était accordé une indemnité de 6,000 fr. payables par moitié en 1865 et 1866. « Le programme de voyage que vous m'avez proposé, lui écrivait le Ministre m'a paru satisfaisant. J'appelle particulièrement votre attention sur l'utilité qu'il y aurait de dresser une carte exacte du khanat de Boukhara, et, s'il est possible, de Kaboulistan et des contrées voisines ; de vérifier, avec plus d'exactitude qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, quels sont au juste les lieux qu'occupaient au siècle dernier les Iraniens„ les Afghans et les Kurdes ; de suivre les traces d'Alexandre dans la Bactriane ; de rechercher les villes citées par Pline et Ptolémée, et de photographier les monuments anciens de Samarkand, de Balkh et des autres localités qui ont conservé des vestiges. d'antiquités ».
Devant rencontrer des difficultés presque insurmontables, en raison des circonstances politiques, Lejean proposa d'y apporter des modifications, et après entente avec le Ministre de l'Instruction publique et celui des Affaires étrangères, le programme fut ainsi modifié, le 28 juillet, sur la proposition de Lejean ; il se bornerait à explorer les parties les moins connues de la Perse orientale, le Hérat et l'Afghanistan jusqu'à la frontière anglaise.
Parti de Paris au mois de septembre, et le 15, il était à Constantinople, d'où il écrivait, trois jours après, à M. E. Desjardins : « Je voyage avec une lenteur qui me fait enrager, car l'hiver approche. Le Danube était bas, de sorte que, de paquebot en coucou, j'ai eu, de Basiach à Stamboul, huit ou neuf transbordements, quatre jours d'attente à Kustendji (l'ancienne Tomi d'Ovide). Cet homme d'esprit y a eu le temps d'écrire les Tristes et les Pontiques pour apprendre au monde lettré combien il s'y ennuyait. Jugez de moi qui n'avait pas cette ressource ! Il est vrai que j'avais celle de fumer beaucoup de narghilé qu'Ovide n'avait probablement pas.
Je suis depuis trois jours à Constantinople, merveille du monde. J'ai toujours parlé avec dédain de Stamboul que je croyais surfait, mais il m'a fallu m'incliner et admirer. Le Bosphore est incomparable… Je pars la semaine prochaine pour Samsoun, où je commence mon grand voyage par Erzeroum, Van, le Kurdistan, etc. Je suis en instance pour obtenir mes entrées à l'état-major ottoman, afin de faire d'inventaire de ce que la Turquie possède sur son propre empire. Je pense qu'en deux heures j'aurai tout vu ».
D'Angora, où il était le 8 décembre 1865, il adressa au ministre de l'instruction publique le rapport suivant : « Les rigueurs de la saison qui me ferment la route d'Arménie et m'obligent à prendre la route plus longue d'Angora, Siva et Diarbeker, m'aura du moins permis d'accroître considérablement la somme de mes informations en tout genre : géographie comparée, ethnographie, géodésie, statistique, etc. L'Asie Mineure, étudiée à fond sous le rapport archéologique, est, sous presque tous les autres rapports, un terrain vierge, où une commission scientifique trouverait une belle œuvre à accomplir. Cela tient principalement à l'état politique de cette province dont un tiers environ est parcouru par des Kurdes encore barbares et par des Turkomans qui le sont à moitié, de sorte que les routes les plus intéressantes à explorer pour un voyageur, sont coupées par des bandits que l'autorité turque se garde bien d'inquiéter. Il y a plus : un voyageur résolu et bien armé obtient très difficilement des pachas la permission de prendre, à ses risques et périls, toute autre route que celle de la poste ou des grandes caravanes. On peut cependant triompher de ces obstacles, mais il faut pour cela plus de temps que je n'en puis consacrer ü cette portion très-secondaire de mon programme.
J'avais l'intention de profiter de mon séjour forcé de quatre jours, à Angora, pour adresser à Votre Exc. Un premier rapport, mais je suis ici absolument sans livres, ce qui me met dans l'impossibilité de rédiger un travail offrant une certaine exactitude scientifique. Il m'a été plus facile de mettre au net une carte et deux plans que j'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus avec quelques brèves explications.
Carte au 1 / 50.000 d'une portion de la Galatie. Ce spécimen que je ferai suivre d'autres feuilles dressées à la même échelle, montre à quel point le relief réel de l'Asie Mineure est heurté et tourmenté, et répond peu à l'idée qu'on pourrait s'en faire d'après le dessin élégant, mais adouci et peu varié des cartes (d'ailleurs, si estimables de Kiépert, Tchihotchef et Vroutchenko). Le levé de l'Anatolie entière serait une œuvre de première valeur, mais une entreprise énorme, qui reviendrait de droit au gouvernement turc, si ce gouvernement avait l'intelligence de pareilles choses et des officiers capables de les mener à bonne fin. Comme malheureusement ces deux choses lui manqueront longtemps, il serait à désirer que des savants européens fissent pour les pays les plus historiques de la péninsule (Ionie, Lydie, Carie), ce que Fellows, Spratte, Forbes, ont fait pour la Lycie et la Troade. En ce qui me concerne, j'ai l'espoir que mes levés, à grande échelle, dirigés presque en diagonale à travers la péninsule, avanceront notablement nos connaissances topographiques sur ces magnifiques contrées.
Plan des ruines d'Aimanghir. — Le site précis de Gordium a été jusqu'ici inutilement cherché, et je suis loin d'être sûr de l'avoir trouvé ; seulement, j'ai exploré avec soin le terrain où cette ville a dû exister, et des ruines fortuitement découvertes cette année à Aïmanghir, à 120 kilom. dans l'ouest d'Angora, m'ont paru répondre à la position de Gordium, qui, du reste, ne semble avoir été qu'une bourgade phrygienne, illustrée par une anecdote. Je ferai, à mon retour, un rapport spécial sur cette découverte, ainsi que sur une localité bien autrement importante que j'ai explorée à Ghevran (2 k. O. de Mudurlu).
Plan de Kustendji (Tomi) et de ses kourganes. — Cette localité, illustrée par l'exil d'Ovide, m'a paru assez intéressante, autant par les souvenirs classiques qui s'y rattachent que par les nombreux tumuli qui l'avoisinent, pour mériter un levé topographique plus précis que les relevés à vue, faits par les Russes et les Anglais avant et depuis 1855. J'ai pu constater que des fouilles ont été exécutées sur divers points du Val de Trajan, travail hâtif et grossier, où il n'y avait guère à espérer de découvertes, et que d'autres fouilles avaient été pratiquées sur divers kourganes, mais (à ce qu'il m'a semblé) avec bien moins de méthode que celles que les Russes ont faites avec tant de succès autour de Panticapée.,Je reste convaincu que les kourganes de Kustendji réservent à des fouilles bien faites des résultats correspondant à ceux qu'on a obtenus en Crimée.
Je pars après-demain pour Sivas. Le froid devenu intense et les montagnes neigeuses m'obligeront peut-être à me rabattre sur Kaisarieh. Je ne prendrai qu'à la dernière extrémité cette route qui me fait perdre trois ou quatre jours. Une fois descendu sur Diarbékir, je serai délivré de presque toutes les difficultés, du moins les plus graves, qui sont le froid et la brièveté des jours. De Diarbékir, je gagnerai Mossoul, puis Hamadan (Ecbatane) en levant sur ma route le plan détaillé d'Arbelles, les Mansiones Parthicœ d'Isidore de Characène et les marches d'Alexandre ».
De Mossoul,
qu'il gagna à cheval, il adressa au Ministre, le 22 février 1866, un second
rapport donnant aussi le détail de ses travaux depuis son départ d'Angora :
« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence une série de
levés
topographiques formant huit feuillets, dont voici le détail :
1°
Itinéraires de Marach à Semiel (Comagène, Mésopotamie, Assyrie) relevés à
l'échelle de 1/200.000 (6 feuilles);
2° Plans des villes d'Aintab, Mardin,
Orfa ;
3° Plans des cités antiques de Telo, Nisibus, Bezabde, Kala ;
4°
Plan du Castellum Maurorum (Mésopotamie) ;
5° Plans des châteaux de
Mardin, Edesse, Marach ;
6° Plan de l'église Saint-Jacques de Nisibe.
Je
dois à Votre Exc. de courtes explications relativement à ces divers travaux
et principalement aux plans détachés.
Ainsi qu'elle pourra s'en convaincre,
j'ai évité avec soin de m'arrêter aux localités déjà explorées. Lorsque j'ai
levé des plans de villes, modernes, c'est que ces levés n'avaient pas été faits,
et j'ai suivi la même règle pour les plans des cités grecques ou byzantines. Je
ne suis pas le premier voyageur qui se soit arrêté à Nisibe ou à Bezabde, mais
je suis le premier à en avoir dressé les plans topographiques nécessaires pour
l'étude de la géographie comparée de ces régions.
Je pense que les voyageurs anglais (dont je n'ai pas les livres sous les yeux) ont signalé les ruines de Tela (Antinopolis) entre Orfa et Mardin ; mais je doute qu'ils aient accordé toute l'attention qu'elles méritent à ces belles ruines qui suffiraient (jointes à celles de Dara, qui en sont à vingt-deux lieues) pour justifier l'envoi d'une mission spéciale en Mésopotamie.
Je n'en dirai pas autant de Nisibe. Cette, cité, célèbre au début du Bas-Empire par les sièges qu'elle a soutenus, est aujourd'hui si complètement ruinée, qu'une journée m'a amplement suffi pour la visiter et en lever le plan. Quatre colonnes insignifiantes et l'église (d'ailleurs très-curieuse) de Saint-Jacques de Nisibe, sont tout ce qui reste debout de cette antique colonie ; elle a disparu sous une couche de terres cultivées d'une épaisseur moyenne de deux mètres, mais l'ancienne enceinte reste reconnaissable, et le plan que j'en ai levé permet de comprendre les récits de Zonare et de Zosime relativement aux sièges qu'en a fait Sapor II.
Bezabde (Djeziréh), où ce même Sapor fut plus heureux qu'à Nisibe, est un très-curieux spécimen de fortification du Bas-Empire. C'était une tête de pont du Tigre, très-forte de front, c'est-à-dire vers le fleuve, assez faible des autres côtés. Il y a une fort belle citadelle antique eu ruines, et je crois que ce lieu mériterait une étude plus approfondie que celle que j'ai pu lui consacrer.
Le Castellum Maurorum, aussi du Bas-Empire, est mieux par sa construction, et je compte en faire l'objet d'une monographie, de même que Kala, sorte de Kast beaucoup plus primitif, et où je vois le Kala de la Bible ; mais la démonstration ne saurait trouver place ici.
Je sais l'intérêt que Votre Excellence porte aux monuments géographiques attestant la présence des Croisés en Orient, à la Géographie des Croisades en un mot. Comme documents relatifs à cette grande époque, j'ai levé avec soin les plans de diverses forteresses qui s'y rattachent, notamment Mardin, Marach, Edesse. J'ai pris en outre un assez grand nombre de vues et de détails à l'appui de ces plans, et j'aurai l'honneur, à mon retour, de les mettre sous vos yeux.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'envoi que je fais à Votre Excellence ne comprend qu'une faible partie des notes de tout genre que j'ai prises dans ce voyage. Mes minutes originales forment un dossier assez volumineux que je laisse en dépôt à M. le consul de France à Mossoul, lequel me le fera parvenir par une voie sûre, lorsque j'en aurai besoin. Dans le cas, peu probable je l'espère, où ma tentative pour passer l'Hindou-Koh et descendre sur Yarkand et le Turkestan chinois aboutirait à une catastrophe, je dois désirer que les archives des deux ministères qui m'ont fait l'honneur de me commissionner conservent quelques documents utiles pouvant témoigner de la conscience que j'ai mise à remplir mon mandat. Aussi profiterai-je de toutes les occasions d'envoyer alternativement à Vos Excellences les parties de mes travaux que je pourrai mettre au net sans ajouter de nouveaux retards à ceux que j'ai déjà subis.
Je veux, avant de finir cet exposé, faire part à Votre Exc. d'une découverte assez intéressante que j'ai faite près d'un lieu nommé Derik, à dix heures O.-N.-O. de Mardin [Note : Il lui arriva dans cette ville la mésaventure détaillée dans la plainte ci-après : « Dans la nuit du 30 janvier 1866, un vol avec escalade et effraction a été commis au préjudice du soussigné dans l'habitation du sieur Johannes Chouha, négociant à Mardin. La justice locale a fait emprisonner quelques individus soupçonnés de ce vol, mais jusqu'à ce moment les recherches n'ont abouti à aucun résultat. Le soussigné croit devoir faire observer que si un pareil fait a pu se produire au centre de la ville, dans une maison parfaitement close et au point du jour, il est autorisé à incriminer l'extrême négligence des agents de la police locale, ou même la complicité de quelques-uns. Il doit ajouter qu'ayant envoyé, dans la matinée, son drogman au Serai, accompagné de deux personnes notables de la ville, afin de déposer une plainte entre les mains du kaïmakan, ces trois personnes n'ont pu pénétrer près de ce fonctionnaire que dans la soirée, quatorze heures après le vol, et lorsque les malfaiteurs avaient eu tout le temps d'échapper aux investigations de la justice. Il se croit, dans ces circonstances, autorisé à protester énergiquement contre la conduite du kaïmakan de Mardis, qui n'a su ni prévenir le délit en question, ni en assurer la punition. Fait à Mardin, le 3 février 1866. G. LEJEAN, Ex-V.-Consul de France, chargé d'une mission du Gouvernement français ». Inutile d'ajouter que le kaïmakan, probablement intéressé dans le vol, ne fit rien pour découvrir les auteurs du vol et que la protestation de Lejean resta à l'état de lettre morte]. Dans un tombeau antique, qui m'avait frappé par sa construction étrangère, et que j'ai fait ouvrir, j'ai trouvé beaucoup d'objets tout-à-fait identiques à ceux qu'on a recueillis dans les sépultures scytho-cimmériennes de Panticapée. C'est, je crois, la première fois qu'on découvre des antiquités cimmériennes si loin de la Mer Noire ; je ne puis expliquer leur présence que par l'invasion des Cimmériens sous Lygdamis, vers 631, lorsqu'ils ravagèrent toute l'Asie Mineure et finirent par être exterminés par le roi lydien Alliate. Le temps m'a seul empêché de faire ouvrir d'autres tombes barbares, voisines de celle que j'ai ouverte ; mais, c'est, une veine que je reprendrai si je repasse au retour en cet endroit.
Une excursion que je regrette énormément de n'avoir pu tenter, et qu'il serait désirable de voir faire à loisir, c'est la reconnaissance des monts Sindjar et du cours du Khabour (Chaboras), entre Mossoul et l'Euphrate. Il y a là les ruines d'une foule de villes romaines et assyriennes, et, parmi les premières, Resaïna, Zenodotia, Tibériopolis, Thubida, Thamurion, Zama, Hileia, et l'antique prospérité de ces villes, sous une administration intelligente, est attestée par les livres et les médailles, et contraste singulièremere avec l'état actuel de la Mésopotamie, livrée à quatre tribus d'Arabes pillards qui en font un désert. La terre seule est restée aussi fertile qu'au temps ou Hérodote assimilait sa production à celle du tiers de l'Asie. J'ai lu le livre de M. Layard, qui a fait une courte excursion vers le Khabour ; il est le seul à l'avoir vu, et s'est borné à quelques notes. En général, les illustres savants qui sont venus explorer ici la mine inépuisable des antiquités assyriennes, se sont renfermés dans cette spécialité ; ce qui laisse aux voyageurs à venir un vaste champ pour les époques grecque, romaine et byzantine. Votre Excellence croira-t-elle que le champ de bataille d'Arbelles n'a pas encore été étudié ? Je pars demain dans cette direction, et ferai en sorte qu'il ne m'échappe pas.
Ce qui m'occupe le plus en ce moment, c'est l'ethnographie de tout ce pays. L'élément turc, dès qu'on a passé l'Euphrate, est nul : il est remplacé par les derniers débris de la race arménienne (Syriens, Chaldéens, Sabéens) et par les Kurdes, auxquels se joignent des populations de sang iranien, mais dont l'origine n'est pas moins mys-térieuse que les croyances. On connaît les Jésides que je n'ai, à cause de cela, étudiées qu'en passant ; mais on ne connaît pas le Chebak, peuple et secte occupant trente-huit villages en Assyrie, et sur lesquels j'aurai des choses neuves à dire. Je prépare lentement les éléments d'un grand travail ethnographique sur toute la Turquie d'Asie, et j'y joindrai plus tard la Perse, si j'ai le loisir d'étudier ce pays si plein de souvenirs. Je suis, etc. ».
Lejean avait promis au Ministre de fréquents rapports, il tenait parole. En effet, le 23 mars 1866, il lui adressait de Mossoul, le rapport suivant :
« J'ai l'honneur d'adresser sous ce pli à Votre Exc., six feuilles de relevés géodésiques d'une portion du Kurdistan (Assyrie). Les quatre feuilles, sans titre, sont des parties d'une grande carte au 84000ème (échelle de la carte de France, de Cassini), résultat d'une excursion de vingt-trois jours que je viens de faire dans les districts chaldéens. Le petit tableau d'assemblage ci-annexé, -et dont les numéros sont reproduits au dos des feuilles, permettra de les raccorder aisément ensemble. La feuille d'itinéraires au 200000ème forme le complément de la série d'itinéraires de Marach à Mossoul, série que j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Exc. par l'avant-dernier courrier.
Votre Exc. est le juge le plus compétent de l'utilité scientifique que peuvent ou ne peuvent pas avoir ces levés. Je n'ai donc point à insister sur ce point. Je me bornerai seulement à lui faire observer que l'extrême incorrection des meilleures cartes pour cette partie du Kurdistan, notamment dans la direction des montagnes et le cours des rivières, m'a paru justifier et même nécessiter un levé topographique très-détaillé, pouvant servir de canevas de bons travaux à venir. L'illustre Kiépert, dans le Mémoire explicatif qui accompagne sa belle carte (Die Euphrat-Tigris Lander), émet le voeu que les visiteurs futurs de cette région rendent à la topographie plus de services que ne l'ont fait en général les voyageurs précédents.
Mais le résultat le plus-intéressant de cette excursion est, si je ne me trompe, la découverte de deux cités antiques inconnues et dont je joins ici les plans détaillés. L'une, appelée par les indigènes Kesari Roum (Cœsarea Grœcorum), semble une cité gréco-byzantine, contemporaine des guerres de Sapor et de Chosroes. Le plan de la citadelle est bien conservé, la position topographique excellente, au point de bifurcation qui mène au cœur du Kurdistan. Le plus curieux, archéologiquement, n'est pas la place en elle-même, mais un système d'ouvrages extérieurs fermant la gorge où est posé Kesari, ouvrages en partie détruits et d'une construction plus grossière que la citadelle elle-même.
L'autre est une vaste ruine située au pied du Bedaro, à quelques heures du Tigre, et appelée dans le pays Zabarane ; c'est une très-intéressante localité, et j'ai pu, ainsi que S. Exc. peut s'en convaincre, lever un plan, en quelque sorte cadastral, d'une grande partie de la cité antique. La ville proprement dite est séparée par un mur cyclopéen d'une enceinte supérieure où je n'ai pas trouvé trace de construction et qui me paraît avoir été la ville primitive, l'enceinte forte et grossière où se retiraient les Carduques lorsque la plaine était envahie par des ennemis supérieurs en forces. La basse ville appartient certainement à deux époques, peut-être même à trois époque barbare, caractérisée par les habitations troglodytiques dont j'ai figuré un certain nombre par des points, puis par des tombeaux creusés dans le roc vif ; — époque médo-persique ou assyrienne, à laquelle appartiendraient les habitations non souterraines, principalement la file de maisons étagées qu'on remarque au S. O., plus les deux portes et les remparts ; — époque gréco-byzantiné, marquée par la construction en briques que les indigènes appellent Hammam (le bain) et le quartier de 25 à 30 maisons qui l'entourent.
Je serais tenté de voir dans Zafarane la ville double des inscriptions cunéiformes que M. Oppert place un peu arbitrairement à Djezireh, à douze lieues plus au nord. Je n'en dirai pas davantage à Votre Exc., n'ayant pas ici les livres qui me seraient nécessaires pour rédiger un mémoire sur ces deux localités ; c'est une lacune que je m'empresserai de combler en arrivant en France. Mais je ne puis trop insister sur l'intérêt qu'offrirait ce pays pour une exploration future. Si Votre Exc, jugeait à propos d'envoyer une expédition de ce genre en Mésopotamie et en Assyrie, mes plans, dont je garantis l'exactitude matérielle, pourraient toujours servir de jalons. La Mésopotamie, portée sur les cartes comme un désert, est une plaine admirablement féconde, et où, avant et sous les Romains, abondaient les villes et les villages. Une traversée du Tigre à l'Euphrate, entre Mossoul et Anah, révélerait une foule de choses des plus importantes. Je lis dans la grande inscription de Nimroud un récit circonstancié d'une marche de Sardanapale III, de Calach à Anatho (Nimroud-Anach), énumérant sur la route onze cités riches et considérables. Je sais d'autre part que les tumuli voisins du Sindjar et des rives du Khabour (Chaboras) sont couverts de ruines antiques, probablement de l'époque Ninivite ; c'est une hypothèse à vérifier.
J'ai arrêté aujourd'hui ma place pour Bagdad, d'où j'irai très-vite et directement dans l'Inde. Ce n'est qu'à la frontière britannique, près Peichawer, que je pourrai reprendre mes travaux géographiques. Des journaux anglais, que j'ai trouvés ici, donnent les plus tristes nouvelles de l'Afghanistan, dévasté par une guerre civile prolongée ; c'est une route qui se ferme pour moi, mais j'en serai dédommagé au décuple si je puis pénétrer dans le Turkestan chinois et passer la frontière russe. Je serai au pied de l'Hindou-Koh à la fin de mai ou vers le 10 juin, au plus tard, excellente époque pour étudier le Karietsan et se préparer à tenter, vers la fin de juillet, l'ascension de l'Hindou-Koh ou du Pamir, sans courir la chance de périr de froid.
En ce moment les communications sont difficiles entre Mossoul et Bagdad. Les caravanes ne marchent qu'en nombre, la poste turque a été arrêtée près Kertouk par les Arabes, maîtres des deux rives du Tigre ; l'escorte a été dispersée après avoir eu des hommes tués. J'ai dû me résigner à subir des lenteurs que je n'avais pas prévues, et pour occuper utilement quelques jours de loisir, j'ai projeté une excursion au champ de bataille d'Arbelles, situé à six ou sept lieues de Mossoul, sur le Ghazir (Bumodus), sans qu'on soit bien d'accord sur le point précis. MM. Place et Oppert le placent dans la plaine qui s'étend au N.-E. d'Ain Safra, ce qui serait impossible, si le fait était aussi accrédité que se le figure Kiépert ; je vois, par Arrien et Quinte-Curce combinés, que Gangamela, où se livra réellement la bataille, est sur le Ghazir (Bumodus), à 80 stades du Zab (Lycus). Reste à déterminer le point précis où ces deux rivières n'ont entr'elles qu'une distance de 15 à 16 kilomètres (80 stades) et où commence une plaine limitée par des collines (Ynloxoï) assez hautes pour empêcher deux armées de se voir. J'ai l'intention de lever un très-vaste plan (au 20,000ème ou au moins au 40,000ème) qui pourra éclairer la question. Je suis, etc. ».
L'excursion dont il parle dans ce Mémoire eut lieu peu de jours après et a fait le sujet d'un Mémoire spécial qui a été imprimé avec un plan au 200,000ème.
Il résulte de ses investigations, que le point de la bataille d'Arbelles avait été Gamy, comme il l'avait conjecturé, la plaine de Gangamela où existe un village appelé Tell-Gomel. « Dans ce pays, dit-il, où les langues sémitiques ont rait reculer les idiomes iraniens, le TELL arabe est l'équivalent du GAU, GAH persan ; pagus TELL-GOMEL serait donc le même que GAU-GOMEL) le village sur le Gomel. Je sais bien que les auteurs anciens l'ont traduit par village du chameau et répété à ce sujet une histoire d'un chameau qui aurait sauvé la vie à Darius Ier. Cette anecdote est tout-à-fait dans l'esprit de l'Orient, et n'a rien qui puisse la faire rejeter comme invraisemblable ; cependant, quand on se rappelle toutes les étymologies arrangées après coup par les Orientaux et même chez des peuples plus sérieux, on peut être tenté d'en préférer une moins romanesque et plus géographique. Dans ces régions, beaucoup de noms de fleuves n'ont pas changé depuis la plus haute antiquité, lorsqu'une invasion barbare ne leur a pas donné des noms de fantaisie (Kara-Sou, eau noire ; Nehr-el-Asi, le fleuve rebelle). En tout cas, que Gangamela veuille dire pays du Gomel ou pays du chameau, je suis convaincu que ce lieu est fort antique, et que des fouilles faites dans le tumulus qui le soutient, donneraient des résultats intéressants.
Grangarmela n'était, au rapport de Strabon (XV, I), qu'un pauvre village an temps d'Alexandre ; cependant Pline (V, 24) en fait une ville, et Ptolémée la mentionne dans l'Assyrie. Si la géographie ptoléméenne offrait plus de précision dans ses tables, je pourrais y chercher un argument pour la rectification que je propose, car elle place Gangamela plus au nord que Ninive (Ninus) et à un demi-degré de longitude (550 stades) à l'ouest d' Arbelles. Mais on ne peut voir là, qu'un hasard heureux, quand on voit dans la même table la fameuse Ctésiphon placée tout près de Ninive, presque au débouché du grand Zab, dans le Tigre. Voici, au reste, les chiffres auxquels je fais allusion (PTOL. Géog, VI, I) :
Ninus
: LATITUDE : 36° 2/3 ; LONGITUDE : 78°
Gangamela : LATITUDE : 37° 1/4 ; LONGITUDE : 79° 1/2
Arbela : LATITUDE : 37°
1/4 ; LONGITUDE : 80°
Lejean aimait à se reposer de ses travaux sérieux par des épanchements intimes et familiers avec ses amis. Témain cette lettre qu'il nous écrivait de Mossoul, le 24 mars :
« Ma santé, malgré un très-dur voyage (traversée du Taurus, en janvier, précédée de la traversée de la Cappadoce, en décembre), est splendide. Je suis en ce moment dans les délices de Capoue, représentés par la maison hospitalière de mon collègue de Mossoul, M. Lanusse, connu par sa noble conduite à Damas, en 1860. J'y suis depuis cinq jours, je mange, je bois, je dors dans un lit (!!!!), je fume comme un Vésuve, j'engraisse et je travaille à mettre mes cartes au net. Je pars dans cinq jours pour Bagdad, d’où j'irai par steamer dans l'Inde, d'où je reviendrai comme je pourrai. Vous savez, ou vous ne savez pas, que ma destination principale est cette terra incognita entre l'Inde anglaise, le Turkestan libre et la Tartarie chinoise. Comme j'ai rassemblé déjà depuis quatre mois un assez gros bagage scientifique, je brusquerai probablement mon retour, afin de venir me reposer et terminer mon Voyage aux deux Nils, dont 14 cartes sur 17 sont gravées, mais dont un demi-volume de texte reste encore à faire... Que vous dirai-je de moi ? Je vais à Kurrachée, puis à Moultan, puis à Peichawer, d'où je dois partir pour Yarkand (Tartarie chinoise), et, si je ne puis passer la frontière, revenir par la même route qu'à l'aller. Je reviendrai si Dio vuole ; et pourquoi pas ? Le pauvre Barth est revenu de Tombouctou pour mourir à Berlin d'un coup de sang ». Ne semblerait-il pas, quand il parlait ainsi, qu'il avait le pressentiment de son propre sort ?
Son rapport au
Ministre, daté de City of London, le 28 avril 1866, nous fait ainsi
connaître la suite de ses travaux : « J'ai l'honneur d'informer Votre Exe. que
je suis en route pour l'Inde et que je lui adresse quatre feuilles de relevés
topographiques avec de courts mémoires à l'appui. Ces travaux sont :
1°
Un plan de Séleucie et Ctésiphon, points visités avant moi par Rich et
autres voyageurs, mais jamais levés ;
2° Un plan de la partie N. des ruines
de Babylone, destiné à rectifier les plans anglais, incomplets pour cette
partie. N'ayant pas sous les yeux le plan de M. Oppert, j'ignore s'il est plus
exact que les plans (d'ailleurs si estimables), de Ker Porter, Jones et Selby ;
3° Des plans d'anciennes cités babyloniennes, Sispara, Borsippa, Accad ;
4°
Un plan de Pakrit sur le Tigre ;
5° Enfin, un relevé général des environs
de Hillé ou Hilla (Babylone) avec le détail de la lagune Hindia (ancienne
Pallacopas), le tout fort mal figuré sur les cartes existantes.
J'ai peut-être tort d'appeler mémoires de simples notes explicatives ayant trait à des questions d'érudition que je ne pouvais creuser bien profondément, n'ayant pas les livres nécessaires. C'est un travail que je ferai en Europe. Je prends seulement la liberté d'appeler l'attention de Votre Exc. sur la découverte que j'ai faite (ou crois avoir faite) de la position de Sispara, si importante dans les traditions chaldéennes de Bérose, et sur le petit travail où j'ai essayé de suivre, pas à pas sur le terrain, le récit de la retraite des Dix mille à travers l'Assyrie (Xénophon, Anabase III), récit parfaitement inintelligible pour qui n'a sous les yeux que les cartes déjà connues. Ainsworth et Chesny ont fait le même essai ; leur travail, excellent pour d'autres parties, m'a semblé vague et un peu confus pour celle que j'ai tenté d'élucider.
Je remercie vivement Votre Exc. de sa lettre bienveillante [Note : Dans cette lettre datée du 19 avril 1866, le Ministre, après avoir accusé réception de l'envoi que Lejean lui avait fait de Mossoul, le 22 février précédent, s'exprimait ainsi : « Je comprends très-bien que pendant le cours d'un voyage laborieux, vous ne puissiez m'adresser que des notes peu développées sur le résultat de vos travaux et que vous réserviez pour un autre moment des renseignements plus détaillés et plus complets. Toutefois, celles que vous m'avez communiquées suffisent pour me donner une excellente idée de la manière dont vous poursuivez votre exploration, et je ne doute pas que l'ensemble de toutes vos études n'apporte un contingent utile à la connaissance des faits historiques et archeologigues qui concernent la contrée que vous parcourez. Recevez, etc. »], et je n'ai pas besoin de l'assurer que je me ferai un point d'honneur de justifier, par les résultats définitifs de ma mission, la confiance dont elle m'honore, et l'intérêt qu'elle vent bien me témoigner.
Mon séjour forcé en Babylonie ne m'aura pas été inutile ; outre des travaux géodésiques, malheureusement fort restreints dans ce pays plat et à demi-noyé, j'aï pu relever la position de beaucoup de villes et de villages antiques et réunir les éléments d'un travail assez neuf sur la céramique babylonienne qui était extrêmement avancée. Je puis donc, dans cette spécialité, suppléer à la perte de la collection Fresnet Oppert, qui a péri, comme on le sait, dans les eaux du Tigre. Je suis, etc. ».
Ce que Lejean appelait de simples notes
composait les deux documents que le Ministre de l'Instruction publique, dans sa
lettre du 15 juin 1866, lui disait avoir lu avec beaucoup d'intérêt, en ajoutant
que, quand il aurait complété les résultats de sa mission, il s'empresserait de
les soumettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
1°
Commentaires géographiques de l'Anabasis (fragment daté du 28 avril 1866, 6 pp.
in-f°), avec une carte ayant pour titre : Esquisse de la section de l'Anabasis
(retraite des Dix mille) comprise entre Mossoul et Djeziré, levée à l'échelle de
1 / 750,000.
2° Sispara. — Carte générale de la haute Babylonie, —
Séleucie et Ctésiphon, 3 pp. in-f°. Ce dernier document, daté de Bassora,
le 2 mai, est résumé dans les livraisons 396 et 397 du Tour du Monde.
Lejean s'étant remis en route, parvint, le 13 mai, à la bouche la plus occidentale de l'Indus et prit le lendemain le chemin de fer à Kotrec. Le 19, il était à Sita, où il prit passage sur le steamer anglais le Phara, et le 3 juin, après 29 jours de traversée, il débarquait à l'escale de Moultan. Une nuit passée en chemin de fer le conduisit le lendemain, de grand matin, à Lahore. A peine descendu à l'Hôtel Victoria, il prit un fiacre qui le mena à la résidence, éloignée d'une lieuse, de M. Macleod, gouverneur général du Pendjab. Il l'a ainsi raconté lui-même (Ibid) : « Je suis introduit ; je trouve un homme âgé, de figure à la fois grave et accueillante, d'un aspect presbytérien, moins la raideur, un type net, aimable et accentué de la prédominance du gouvernement civil dans le pays le plus militaire, le plus nouvellement conquis et le plus exposé de l'Inde anglaise.
Nous allons vite au fait. Je lui expose mon intention de pénétrer à tout risque dans l'Hindou-Kola, c'est-à-dire dans les montagnes libres entre l'Afghanistan et le Turkestan ; c'est là qu'habitent les mystérieux Siahpoch, cette race blanche vivant à peu près, dit-on, à l'état édénique, et où j'ai la quasi-certitude de trouver les premiers anneaux de la grande chaîne des peuples indo-germains, c'est-à-dire de presque toutes les races civilisées. J'ajoute que mon projet est simple ; c'est de tâcher de gagner Djellalabad, dans le royaume de Kaboul, et de là, de me rendre, comme je pourrai, chez les Siahpoch. Je termine en lui demandant le concours moral que le gouvernement donnerait à un voyageur anglais dans ma position, sous forme de recommandations, d'appui près des indigènes.
Il m'écoute avec beaucoup d'attention, et me refuse net.
Je reste un peu surpris, et je lui demande s'il a l'intention de m'empêcher par force de passer la frontière.
En aucune façon, me répond-il avec calme. Seulement, comme tout voyageur européen qui voudrait entrer en ce moment dans le Kaboulistan serait parfaitement sûr d'y périr, nous en refuserions la permission à nos officiers s'ils s'avisaient de la demander, et quant à un voyageur étranger comme vous, nous ferions pour sa sécurité tout ce qui est en notre pouvoir, en lui prouvant par toutes nos informations que sa tentative est insensée, et s'il y persistait, en lui refusant toute aide pour courir à la mort.
Il n'y avait qu'à reconnaître là une sage sollicitude. Je le fais ; mais je n'étais pas convaincu. Je modifie ma demande en sollicitant seulement une recommandation pour le sous-préfet (deputy commissioner) de Peichawer (prononcez pechaour), poste avancé de la domination anglaise sur la frontière afghane, où je voulais au moins m'assurer des difficultés du voyage projeté et les toucher en quelque sorte du doigt.
M. Macleod me fait donner cette recommandation par son secrétaire, M. Thorton, aimable et studieux jeune homme dont je me propose de cultiver plus amplement la connaissance. Comme moyen de transport, il me conseille de traiter de gré à gré avec une entreprise de dak (diligence indigène) plutôt que de prendre le gouvernement van dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'industrie privée. Je suis le Conseil et je m'en trouve bien. Mes préparatifs sont vite faits ; ce soir, à dix heures, je serai en route pour Peichawer.
Le dak que j'ai loué est un singulier véhicule. C'est une caisse verte, un fourgon fermé contre la poussière et la chaleur. Mon domestique y a installé deux lits, un pour moi, un pour lui. Je ne changerai cette voiture qu'à Attok ».
Le 5 juin, à la tombée de la nuit, il franchit le Jélum (Hydaspe des Grecs, Vitasta sanscrit). « D'où vient, dit-il (Tour du Monde, 455ème liv.), le petit frisson d'émotion et de respect que j'éprouve en franchissant ce fleuve, presque vulgaire d'aspect, si je le compare à tant d'autres ? C'est que mon imagination reconstitue sans effort la grande scène épique qui s'est passée là il y a vingt-deux siècles. Je suis sur le champ de bataille de l’Hydaspe, o se sont heurtées l'Inde et la Grèce, sous les deux figures épiques de Porus et d'Alexandre-le-Grand ». Il surmonte son émotion, et Arrien à la main — c'est le seul livre qu'il ait emporté — il constate sur place l'exactitude de l'expédition d'Alexandre, et il donne (Ibid.) un résumé du récit de son auteur.
Le 12 juin, il avait atteint Peichawer, et le lendemain il était à Murrec, où il écrivait à M. Ernest Desjardins une lettre continuée le 11, le 30 et le 31 juillet. Ces lettres complètent le récit qu'il a donné dans le Tour du Monde, de cette partie de sa mission. Les voici :
« Murrec, Western-Himalaya, 13 juin
1866.
......... Le nom qui est en tête de cette lettre vous apprendra que je
suis à peu près au point extrême de ma mission, et je pars dans deux heures pour
Cachemyr, où je serai dans six jours. De là, je ne sais pas encore si je
pousserai vers Khotah Tartarie chinoise, ou plutôt ex-chinoise, car voilà quatre
ans que les Fils du Ciel ont été bousculés et chassés de ce vaste pays qui est
aussi grand que tout l'empire d'Autriche, et qui est très-naturellement inconnu
en Europe, si ce n'est à Londres et à Saint-Pétersbourg. Les Russes avancent et
avaleront en quelques années tous ces petits États, où
l'anarchie musulmane a succédé au gouvernement faible, mais régulier des
Chinois. Vingt mille Russes sont à Djizzat, près Samarkand ; Boukhara
est
peut-être pris depuis un mois, le bruit en courait à Lahore, lorsque j'y ai
passé. Je rapporte une splendide moisson d'informations politiques et
commerciales sur tous ces pays compris entre l'Inde et la Russie asiatique. Je
rédigerai tout cela à Téhéran, et le Ministre aura de quoi lire.
Je verrai, d'après ce que me dira le résident anglais de Cachemyr, si je puis, avec quelque sécurité, faire une pointe sur Khotah. Je n'en éprouve pas la nécessité absolue, car, en fait d'informations de tout genre, Serinagar ou Islamabad peuvent m'en donner de suffisantes. Puis, je ne veux pas arriver en Perse en automne, je perdrais les chances de bonnes études à faire, au retour, dans la Perse occidentale, l'Arménie et le Kurdistan. En tout cas, tout va bien. J'ai caboté dans le golfe Persique de Bassorah à Kurrachée, avec assez de succès pour pouvoir donner, à mon loisir, un commentaire soigné du voyage de Stéarque. Le seul livre que j'aie dans ma malle, est un Arrien qui me rend les plus grands services. De Kurrachée à Lahore, je n'ai rien fait, mais le Pendjab et l'ancienne Caphène m'ont fourni une récolte d'antiquités grœco-bactéro-bouddhiques dont vous n'avez pas d'idée. J'ai trouvé dans la Caphène les plus curieux monuments de l'âge de pierre, aussi beaux qu'en Bretagne (Carnac excepté). Comme je rapporte de la Caphène, 22 photographies de statues et bas-reliefs et 10 dessins dito, et du Pendjab, une vingtaine de photographies aussi dito, vous jugerez. J'ai perdu ma peine à chercher Aornos, et je n'ai pu aller chez les Siapoch, mais enfin, j'ai des compensations ».
« Murrec,
11 juillet.
J'arrive de Cachemyr pays splendide paradis
du monde ; excursion pénible, mais fructueuse, surtout ethnographiquement. J'ai
vu à Serinagar un envoyé de Khotan, qui m'a donné les informations nécessaires
sur son pays, mais qui ne m'a pas encouragé à y aller. J'ai commencé des études
sur les langues aryennes et anti-sanscrites de l'Indus moyen, et je suis arrivé
à des résultats qui m'ont paru intéressants sur les rapports de ces langues avec
celles de l'Europe. Je crois que la clef de nos origines philologiques est là,
chez ces petits peuples montagnards (Kachemyr, Chilas, Ghilghit, Sapioch,
Darda), plus encore que dans le sanscrit. Je me réserve, au retour, de faire une
communication là-dessus à l'Institut. En attendant, je suis dans l'embarras. Mes
lettres de France sont parties avant-hier pour Cachemyr, le jour même où
j'arrivais à Murrec ; j'attends ici leur retour, ce qui peut me faire manquer le
prochain vapeur pour l'Europe. Par contre, cela me ferait utiliser ici quinze
jours de plus, lesquels quinze jours j'emploierais en revenant sur la Caphène
et en recherchant les sites d'Aornos, Mangrala, Outatchanda, Pencela, et dans le
Pendjab, Taxila et Sangala. J'ai beaucoup travaillé dans le Cachemyr sur
l'architecture bouddhique et dessiné plusieurs stanpas intéressants. C'est,
comme en Caphène, de l'art grœco-bactrien mis au service du bouddhisme ».
«
Amretzir, 30 juillet,
J'ai reçu mes lettres le 14, quitté Murrec le 15,
passé deux jours à Rawel-Pindi, et je repars d'ici après-demain, sur Aornos ; je
ne suis pas plus avancé, mais, comme j'ai pris des vues des trois localités qui
peuvent revendiquer ce nom, nos savants auront au moins des pièces à conviction.
Je suis presque fixé sur la position de Taxila, et tout-à-fait sur
celle de Sangala, dont je vais, demain matin, lever un plan détaillé. Les
indications d'Arrien sont très exactes sur le lieu ainsi que sur le champ de
bataille que j'ai étudié avec soin. Amretzir est une ville de 1,800,000 âmes
[Note : Lejean a rectifié ce chiffre dans le Tour du Monde (543ème
livr., p. 339) et la réduit à 3 ou 400,000 âmes], le centre le plus actif de la fabrication des cachemires ; des monuments
d'une splendeur que rien n'égale en Europe. Vous verrez mes photographies. J'ai
visité hier le temple Sirk ; le dôme, les clochetons en or massif ; des millions
de pierres précieuses enchâssées dans les murs. On juge en ce moment-ci un des
curés du lieu, qui a détaché quelques plaques de la coupole et les a remplacées
par des plaques dorées : le vol représente un lak et demi de roupies (375,000
fr.), y compris pour 50,000 fr. d'émeraudes et lapis-lazuli remplacées par de la
verroterie. Il n'y a plus de foi ! J'ai lu ici Jacquemnot (correspondance) et je ne
comprends rien à la faveur qui accueille chez nous ce livre vide, faux bavardage
à la Gaudissart sur un pays dont on ne doit pas parler légèrement. On a rendu un
vilain service à Jacquemont en imprimant toute cette jacasserie vulgaire ».
«
31 juillet.
J'en ai fini avec Sangala-Euthymedia, plans et vues. Cette
position était importante à fixer pour l'ensemble de la campagne d'Alexandre
dans l'Inde. Je retourne ce soir à Lahore, où je passerai deux à trois jours à
copier les bas-reliefs grœco-bactriens que je ne puis faire photographier. Le
4, je serai à Moultan ; le 5, je prendrai le vapeur de l'Indus pour Bombay; où
j'espère être le 14, et le 15 je quitte l'Inde pour Bender-Abbas, où j'arrive le
19. De là, je vais droit à
Téhéran, et de Téhéçan à Trébizonde, puis à Constantinople. J'espère être à
Paris vers le 20 novembre, pas guère avant, mais pas après ; santé bonne ;
chaleur accablante depuis que je suis dans les plaines ; orages gigantesques
comme tout ce qu'on voit dans l'Inde. J'ai hâte d'aller en Perse où je
travaillerai mieux ; cependant je suis content de l'ensemble de mes travaux dans
l'Inde ».
L'itinéraire indiqué dans cette lettre fut un peu modifié, car, le 10 août 1866, il était encore à Moultan, et c'est de là qu'est datée la lettre suivante adressée à Mme Souvestre :
« Chère Madame, je vous écris seulement pour m'excuser et pour que vous ne m'accusiez pas d'oubli, car j'ai peu l'esprit à écrire quand je voyage. Les voyageurs sont prolixes d'impressions, et moi, je ne trouve rien de plus déplacé que d'envoyer, à quelqu'un qu'on aime, de longues descriptions que tout le monde peut aller chercher dans le premier livre venu. Vous avez dû frémir de crainte de recevoir de moi une lettre datée de Bagdad et contenant deux pages sur les Khalèbes, ou de Persépolis une tartine bourrée de !!! destinés à figurer les quarante colonnes de Tchilminar. Rassurez-vous, je vous dirai l'Inde au retour, ou plutôt, je vous montrerai mes dessins et mes photographies. Aujourd'hui, je suis convenable, c'est-à-dire, sobre. Que je vous dise seulement que j'ai trouvé l'Inde supérieure à ce que je pensais. La nature y est sublime et les œuvres de l'homme dignes des contes de fées. Palais en marbre, portes d'or massif, diamants incrustés dans les murs. Le peuple qui vit au milieu de ces merveilles est assez doux pour ne pas se dire qu'elles sont une insulte à des hommes qui vivent de cinq sous par jour. Même dans les révolutions on n'y a pas touché. Un vieux proverbe arabe, que j'ai recueilli sur le Nil, disait : Et kokhom Turkistan, et mâl Indoustan, el ahl Frenghistan ; le pouvoir est aux Turcs, la richesse aux Indous, l'intelligence aux Européens. Le premier paragraphe n'est plus vrai, Dieu merci, mais le reste ne ment pas. J'étais l'autre jour à Amretzir, à dix lieues de Lahore, une petite ville sous-préfectorale que vous ne trouvez pas sur bien des cartes : elle compte 1,800,000 âmes [Note : Nous avons vu qu'il a, plus tard, rectifié ce chiffre] dont environ 100,000 tisseurs de cachemires. Ces ouvriers sont très-heureux ; ils gagnent 18 sous par jour, pas de morte-saison ; les enfants gagnent 12 sous. Leur faire est vraiment merveilleux Je veux, au retour, avoir du succès dans votre salon ; je parlerai cachemires comme un commis de la maison Delisle. J'ai des nouvelles de toutes mains : la guerre, qui tire à sa fin, et où les Italiens ne brillent guère, tout en se battant bien ; l'Allemagne qui marche, à coups de fusils, à une unité hostile à la France ; la question romaine, qui nous prépare bien des secousses et des hypocrisies.
Je pars après-demain pour Bombay, d’où — je ne sais où. Mais je dois être à Paris au 20 novembre. Me reposerai-je un peu cet hiver ? J'ai un arriéré à vider, un gros livre à terminer, bien des choses de détail, un Mémoire à l'Institut, un gros rapport au Ministre, etc. Mais je ferai cela, partie chez moi, partie à Paris, à tête reposée. Vous ne sauriez croire avec quelle cordialité j'ai été accueilli partout dans l'Inde. Vraiment, ces pauvres Anglais ne sont, pas bien jugés chez nous. Je regrette de n'avoir eu que trois mois à leur donner, et d'avoir passé l'hiver dans les gorges du Taurus dans la neige et les glaces, des pays superbes et impossibles » [Note : Une nuit d'hiver dans l'Anti-Taurus (Tour du Monde, t, XXVI, p. 161 et suiv.) est un récit saisissant des dangers qu'il avait courus dans la nuit du 1er janvier 1866].
Nous ne pouvons, faute de documents, suivre Lejean en Perse. Tout ce que nous savons, c'est qu'après avoir visité Aboucheher en septembre, Ispahan et Téhéran en octobre, il revint à Constantinople, et de là à Paris.
Pendant les quatre années suivantes (juin 1867 — fin de 1870) Lejean, sauf les intervalles qu'il passa, soit à Paris, soit en Bretagne, fut occupé d'une mission dont le chargea le Ministre des Affaires étrangères, le levé d'une carte de la Turquie d'Europe. Les archives du ministère possèdent les parties levées en 1867 - 1869, comprenant 66 feuilles, dont 31 sont à l'échelle de 1 / 100,000 et 35 à l'échelle de 1 / 200,000 La partie levée en 1870 est vraisemblablement perdue, comme nous le verrons plus loin.
Les principaux résultats de sa campagne de 1867 sont consignés dans les trois lettres suivantes, adressées, les deux premières à M. E. Desjardins, la troisième à nous-même :
« Routschouk, 26 juillet, 1867.
Cela va un peu moins vite que je ne l'espérais, mais enfin je ne dois pas me
plaindre. J'ai fait les Balkans de Dobroudja qui forment deux massifs moins
étendus et surtout moins hauts que je ne pensais. Ce n'est qu'autour d'Ortakéne
et de Gretche qu'on trouve quelque chose qui mérite ce nom de Balkan. Ces
massifs sont boisés ; cependant, le déboisement a aussi commencé là ; aussi les
cours d'eau tarissent-ils l'un après l'autre. Slava, au confluent de deux
beaux dérés, n'a pas une goutte d'eau courante ; Baberdajh n'a qu'un filet ; la
petite rivière marquée sur les cartes comme la grande artère du pays (rivière de
Kambes et Valunou) était à sec quand j'y ai passé ; le Katalin de même.
J'ai quelques inscriptions, la plupart trouvées par M. de Schen, et j'ai découvert, à trois heures de Baberdajh, à Slava, une fort belle enceinte de ville romaine avec une massive acropole : superbe position militaire. J'en ai levé le plan avec soin.
Je vais passer quelques jours à faire, avec M. Bozozowski (ingénieur-géographe au service turc), l'ennuyeuse besogne de compléter le levé des parties non faites des bassins inférieurs du Lom, de la Jantra, de l'Orma, du Vid ; puis je vais à Ilivré, qui me servira de hase d'opération pour la partie du Balkan qui me reste à faire. De là, je descendrai en Macédoine, où je commencerai à travailler à mon plaisir. J'aurai des choses plus intéressantes à vous dire de l'Olympe, de l'Ossa et du Pélion, trois ascensions qui me prendront une quinzaine et me permettront de terminer mon levé de la Thessalie.
Vous avez vu la Dobroudja : rien de changé, sauf les routes s'améliorant et que les colonies européennes et latines réussissent et multiplient. On entend peu de turc par là, mais en revanche beaucoup d'allemand, de polonais, de russe, de grec. Je n'ai pas besoin d'ajouter : de valaque et de bulgare. Toultcha n'a pas de quais, mais il a deux photographes. J'ai eu un peu de fièvre et ai été fort heureux, en pareille occurrence, d'être le moucafir de M. et de Mme Langlois qui ont été charmants pour moi. Langlois a été votre élève à Bonaparte et m'a parlé de vos cours en termes que je ne crois pas devoir vous répéter par égard pour votre modestie ».
« 29 juillet.
Mauvais
temps. — M. Bozozowski est retourné en toute hâte. Il n'y a guère de
sécurité dans un pays plein de Circassiens en armes. Mon voyage avec lui est
manqué. Je vais tâcher de faire la chose seul, après quoi, j'irai par le chemin
de fer à Varna où j'ai affaire, puis je gagnerai la Macédoine comme je pourrai.
J'ai bien fait de lever en octobre dernier le plan de la très-curieuse forteresse romaine de Koutlovsa. Cette année, une route a passé à travers ces ruines et les a bouleversées ; et comme il n'est mal qui ne serve à bien, une inscription latine y a été trouvée. Je l'ai.
Je pars ce soir pour aller lever le terrain au confluent des deux Lom ; on m'y signale aussi deux castella, à Krosno et Giurgevo ; je les verrai. Giurgevo est la ville ancienne à laquelle a succédé Routschouk. L'évêque de Routschouk a pour titre officiel : évêque de Giurgevo ».
« Volo (Thessalie), 20 novembre 1867.
Le temps
me manque pour vous écrire longuement, car j'arrive de la Macédoine par le mont
Olympe, et je repars demain pour l'Epire, de crainte que la neige ne me ferme
les passes du Pinde ; je reviens par Corfou , et j'espère être à la maison le 15
décembre… Je suis ahuri de travail. Je me suis engagé avec le Ministre à lui
parfaire, en deux années, la carte de la Turquie d'Europe au 1/200,000 et je ne
vois que maintenant combien la tâche est rude. Montagnes sur montagnes, Ossa sur
Pélion. J'ai grimpé le Pélion dimanche, et je serai sur l'Ossa dans six à sept
jours ».
La campagne de 1868 ne fut pas, à beaucoup près, aussi heureuse que la précédente. Le Ministre, par sa lettre du 15 juin 1868, l'avait autorisé à y consacrer huit mois. Mais il avait déjà subi plusieurs accès de fièvre lorsque, le 8 septembre, il écrivait de Rohova à M. Ernest Desjardins : « Couché les quatre fers en l'air, la fièvre au corps, rongé par toutes les puces de la Bulgarie, l'esprit passé à la sépia, votre précieux ami n'était pas, il y a quelques jours, un objet digne d'envie..... Je suis en convalescence d'hier, mais ce n'est que d'aujourd'hui que je risque un peu de viande et un doigt de vin. Je pars cette nuit pour Routschouk. En trois jours, l'appétit revenant, je serai absolument remis et je filerai le plus droit possible sur Salonique, par terre. De là, j'irai visiter la Chalcidique (qui n'est pas encore figurée en détail sur les cartes), — affaire d'une semaine, — d'où je partirai pour aller porter ma carte au vieux Jupiter au sommet de l'Olympe. Je vous écrirai du sommet même si je l'atteins.
Ma campagne scientifique va aussi bien que je puis le désirer. J'ai à peu prés fini la Bulgarie ; avec un peu de temps, fructueusement passé auprès de Salonique, j'aurai fini la Macédoine, et avec mes ascensions des montagnes sacrées, complété la Thessalie, je retomberai alors sur l'Epire et l'Albanie, et les mènerai rondement ; mais comme le temps file, file, file ! ».
« 8, au soir.
Je fais bien de parler d'escalader
l'Olympe, et je ne puis même pas doubler le cap d'un morceau de rôti. L'essai de
ce matin n'a pas très-réussi..... En ce moment, je ne veux vous parler que de
mon dernier voyage. Parti de Widdin, j'ai été droit à l'ouest jusqu'au Timok,
frontière serbe que j'ai longée jusqu'à Adlié, ville de nouvelle fondation. De
là, j'ai gagné Osmanie sur la rivière Arzur, et je suis revenu à Widdin. Pays
très-ondulé, très-boisé, très-peuplé, pittoresque, riche ; les villages
bulgares, de jolis villages d'opéra. Parti par eau pour Rahova. De Rahova, parti
pour Vratza (15 lieues au S.-S.-O.), tourné au S.-S.-E. à travers des steppes
sans fin pendant 10 lieues, atteint la belle rivière Esker à Tchoumakowa ;
trouve là des antiquités nombreuses et l'enceinte d'une ville antique. De là,
filé à travers bois, à Gabari ; autres antiquités, puis à travers un magnifique
pays, à Pistenir, d'où un terroir d'une très-belle sauvagerie,
bois, ruisseaux charmants, me mène à Vratza. Petite ville mixte, vingt mille
hommes, adossée à une section presque à pic du Balkan. J'escalade ce Balkan en
zigzag, très-péniblement, et j'arrive sur un plateau enchanté : longues prairies
séparées par des traînées de collines rocheuses couvertes d'arbres résineux,
eaux fraîches, petits lacs, et de tous les bords du plateau, des échappées
splendides sur la plaine, Jolies antiquités roumaines à une demi-lieue de la
ville ; un amour d'aqueduc (où est le photographe ! ). Retour par la route
d'ouest. Cela ne va pas : fièvre, 15 lieues à cheval, pas de ressources sur la
route, des steppes, pas un arbre, du soleil à la face et des villages faits pour
des cochons, ou des Bulgares. Quelle barbarie kalmouke ! A une lieue avant
Rahova, je tombe d'épuisement au pied d'une meule de foin. A Rahova, je retrouve
mon bon médecin arménien — et çà va ».
« Routschouk, 13 septembre.
Guéri
— fort sur le bifteak aux pommes, n'en parlons plus. Ce voyage ; me fatigue plus
que les autres, surtout à cause de l'absence de mon drogman ».
La guérison dura peu, car à Philippopolis, il eut encore trois ou quatre accès de fièvre qui se reproduisirent à Sophia, d'où il annonça, le 10 octobre, à M. Emile Jouvaux, qu'il lui fallait, pour cette année, renoncer à poursuivre son voyage. Rentré en France, à, petites journées, il ne fit que traverser Paris et accourut à Plouégat-Guerand. (aujourd'hui Plouégat-Guerrand). Il y avait peu de jours qu'il y était, lorsque, le 9 décembre 1868, il écrivit à Mme Souvestre la lettre suivante :
« Chère Madame, je ne sais si le hasard vous a appris que je suis revenu de Turquie avec le foie et la rate endommagés, moyennant quoi la Faculté m'a mis au régime, et je suis en ce moment convalescent. Je veux acquérir la santé d'un buffle pour fournir six à huit mois de fatigues nouvelles en Turquie, et je compte repartir en avril. Ce voyage pourrait bien être mon adieu à la vie errante.
Je suis assez préoccupé depuis quelques années d'écrire mon livre, celui qui fera ma réputation, si j'en mérite une, et depuis trois mois environ, j'ai fixé mon choix et mon sujet. Je suis dans de bonnes conditions pour cela : dix ans de voyages qui m'ont beaucoup appris, aisance, célibat et loisir absolu, — car en octobre prochain, je serai libre de tout lien ministériel. Je gagne largement ma vie, sans courir après l'argent. Les préoccupations d'argent et les soins de la vie de famille ont empêché neuf sur dix des gens forts que j'ai connus, de faire leur livre. Je sais que votre mari prenait déjà, au collège, des notes pour ses Bretons ; mais les gens qui tiennent leur idée à dix-huit ans sont bien rares. Après tout, j'ai bien tort de tant solenniser ; je ne sais pas même encore si je ferai jamais quelque chose. On me fait de l'étranger des propositions fort tentantes, mais je vous l'ai dit, je ne suis pas coureur d'argent, et j'aurai à partager le plus de temps possible entre la Bretagne et Paris. Je suis pour le moment tranquille, quoique l'hiver fasse rage à ma porte ».
L'air natal le remit assez promptement pour lui permettre, pendant son séjour à Kerampont, de coordonner les éléments de sa carte de Turquie. « Je la pousse vivement, nous écrivait-il le 13 janvier 1869 : 12 feuilles finies, 20 fort avancées ; 14 vont bien ; 2 seulement ne sont pas commencées. Je suis M. Touche à tout, et je le regrette. ».
Nous n'avons sur sa campagne de 1869 d'autres détails que ceux que renferme sa lettre à Mme Souvestre, datée de Scutari, le 13 et le 29 juin.
« 13 juin.
Si
ceux qui me reprochent mes sentiments contre les.
Turcs et ma sympathie pour les chrétiens d'Orient, venaient dans ce pays-ci, je
suppose qu'ils seraient édifiés. Il y a une heure, j'ai vu passer sous ma
fenêtre un groupe de femmes chrétiennes en pleurs elles vont en exil à Nissa, en
Bulgarie, à pied, à travers d'abominables montagnes. Qu'ont-elles fait ? Elles
composent la famille d'un Albanais qui a tué un autre homme par vendetta, et
s'est sauvé. La justice. civilisée du pacha a fait mettre aux fers toute la
famille innocente, et on la jette en exil. Un autre Albanais musulman, presque
le même jour, a fait la même chose ; le pacha a aussi envoyé saisir les femmes
de la maison, mais les musulmans du village ont chassé les gendarmes, et le
pacha qui ne demandait qu'un prétexte pour céder, n'a pas insisté. Voilà
l'égalité des cultes en Turquie, égalité à laquelle croient les ignorants et les
diplomates. Ce pacha a fait son éducation à Paris, parle français, et pose pour
l'homme civilisé. Les gens bien gouvernés, comme nos Français, pour qui le
maximum de l'oppression consiste à ne pas recevoir l'indépendance belge ou à ne
pas pouvoir divaguer à la salle de la Jeune Gaule, sont fort indifférents du
sort de dix millions de chrétiens écrasés sous un régime dont les Cafres ne
voudraient pas ».
« 29
juin.
J'arrive d'une promenade dans les
montagnes, et j'ai appris aux Scutarins surpris qu'il y a, à quatre lieues de
leur ville, une Suisse albanaise, pleine d'enchantements, qu'ils ne soupçonnent
pas : des lacs, des torrents, des vallées splendides. Cela vous peint ces gens-ci.
Rassurez- vous sur le compte des exilées dont je vous ai parlé plus haut.
L'évêque catholique de Presrend, sujet autrichien, a retenu ces femmes à
leur passage dans sa ville, et signifié au pacha qu'il va déférer l'affaire à
Constantinople. Le gouvernement turc se gardera bien de se heurter à un prélat
autrichien, et tout cela tournera à la confusion du pouvoir civil, comme on dit
chez nous. Quel pays !
Je suis désolé des troubles de Paris, mais je le suis moins des chrétiens irréconciliables. Il était temps de faire savoir au monde que la première cité du globe en a assez du régime personnel déraillé. En revanche, les campagnes ont voté avec un ensemble touchant pour les candidats ministériels. Si les gens sages ne sont pas dégoûtés du suffrage universel appliqué à un pays sans instruction, ils ont la foi robuste. L'Empire s'en va, et je ne suis pas rassuré sur ce qui lui succédera. Morgue et rouerie chez les orléanistes ; inexpérience et incapacité dans le parti républicain honnête ; brutalité et immoralité dans la démocratie avancée qui est la plus forte. Joli bilan! ».
Revenu bien portant de sa campagne de 1869, il rapporta d'Orient de curieux documents sur Scanderbeg, et s'occupa de leur mise en œuvre pour faire diversion au tracé de ses cartes. Mais une dernière campagne était nécessaire pour qu'il pût compléter sa carte de la Turquie. Sa mission fut continuée. En allant, comme en revenant, il s'arrêta à Venise. Les deux lettres suivantes, adressées à M. Ernest Desjardins, nous apprennent quel emploi il y fit de son temps et quelles parties de l'Orient il visita cette année.
« Venise (mardi)
[Note : Cette lettre n'est pas autrement datée, mais elle doit avoir été écrite
vers le 10 mai 1870].
.......... Hier, j'ai compulsé tout le manuscrit de
Bolizza, sur l'Albanie, et j'ai collationné mon calque de Fra Mauro, de Santarem, avec
l'original. Celui-ci est très-lisible, et celui de
Santarem est très-mal copié. J'ai relevé quatre-vingt-huit erreurs, rien que
pour la Turquie et la Grèce. En voici quelques unes : l'Italie est difficile à
lire, car elle porte force traces de doigts ; le copiste Santarem s'est épargné
la peine de lire en la faisant toute en carte muette, pas un nom. La
photographie rend bien les écritures bleues et rouges, mais pas les bistres. Le
plus sûr est de collationner Santarem avec l'original, affaire de deux jours.
Mes quatre-vingt-huit corrections ne m'ont pas pris une heure. Il n'y a de bien
difficile que l'Italie, la presqu'île turco-grecque, la presqu'île ibérique, la
France, l'Angleterre, la Turquie d'Asie, l'Arabie, l'Egypte et l'Abyssinie,
l'Inde avec Ceylan. Je suis tout-à-fait décidé. Une photographie de grandeur
naturelle serait ici très-coûteuse, et ne servirait à rien, car les noms en
bistre ne sortent pas. J'ai acheté une réduction au quart chez Munster, qui me
donne les écritures bleues et rouges couramment lisibles. L'agrandissement
exécuté à Paris à 1m90, qui est la dimension de l'original, ne reviendra pas à
quatre-vingts francs.
Bachit, auteur de l'excellent livre la Republica Veneta e la Persia, vient de publier une suite fort curieuse sur les relations des Italiens avec l'Abyssinie au XVème siècle, et prépare un fac-simile de l'Abyssinie, de Fra Mauro, en chromolithographie. Je verrai comment cela serait fait. Il faudra cinq couleurs : rouge, noir, bleu, vert, jaune. Je rendrai le bistre en noir. Je ferai mon collationnement rectificatif demain et après-demain. Que je publie ou non, plus tard, cela one sera toujours utile.
J'espère partir dans deux ou trois jours, quand j'aurai fini mon travail de rat de bibliothèque. J'ai trouvé l'abbé Valentinetti fort, obligeant. Il m'a dit que M. Jomard avait voulu avoir un fac-simile de Fra Mauro, et qu'on lui demandait 16,000 francs [Note : C'est une erreur. C'est M. Ernest Desjardins qui avait fait la démarche, et on lui avait demandé 1,800 francs] !!! J'ai bien employé ma matinée. J'ai pris tous mes extraits de Bolizza, et copié de Fra Mauro presque toute l'Italie et la Sicile, la France, les Iles Britanniques, la Crimée, l'Asie Mineure ; il ne reste de difficile que la côte sud de la Méditerranée, de Cyrène à Melilla ; mais les portulants m'aideront ».
« Trieste, 13 mars,
Vous voyez que le
temps passe, pourtant je ne le perds pas. J'ai visité les archives de Fraci et
de Corser, à Venise. J'y ai remarqué, outre des portulants dont je ferai mon
profit, des cadastres précieux de certains pays, Argolide, Arcadie, Candie,
très-utiles pour servir de traits d'union entre l'époque antique et la moderne.
J'ai failli rester quelques jours de plus à Venise, pour copier ceux d'Argos et
de l'Arcadie, mais je reviendrai à Venise.
L'Istrie est précieuse, on y travaille beaucoup. Nous n'avons pas en France une revue archéologique de la valeur de l'Istria , commencée en 1846 ; je pars demain pour Capo d'Istria, à la recherche des Rimliani ou Valaques d'Istrie, dont j'ai eu hier un bon aperçu préliminaire. Votre beau-frère sera satisfait de ce que je lui en donnerai. C'est une langue tout-à-fait sœur du daco-roumain, mais avec des mots qui ont, je crois, disparu de celui-ci ; elle n'a pas l'article. J'ai besoin de cette étude pour compléter mes notions sur les autres Roumains... De Raguse, j'irai faire un tour en Herzégovine ...... ».
« Salonique, 8 août 1870.
....... Je suis encore pour quinze à vingt jours dans le rayon de cette ville, à cause
de l'Olympe et de l'Ossa que je
vais fouiller à fond.... J'ai copié mon Fra Mauro à Venise, et même, grâce à
l'obligeance des autorités, je l'ai calqué en partie. Mon fac-simile vous fera
plaisir. Cela m'a pris neuf ou dix jours, je ne me rappelle plus. J'étais devenu
légendaire à Saint-Marc ; on m'appelait il Francese de Fra Mauro ; les ciceroni me
montraient à leurs Anglais, cela devenait trop bête.
Je viens de parcourir l'Epire, l'Albanie, la Macédoine : pas une seule inscription latine. On vient d'en découvrir plusieurs, près Pritren, en Bulgarie, où je compte aller. Cette fois, toutes les inscriptions latines que je trouverai seront à vous. Quoique contrarié par une effroyable chaleur, mon voyage, cette année, est encore plus fructueux que celui de l'an dernier, grâce à des ascensions de montagnes répétées. Celle de l'Olympe sera un morceau de dure mastication, mais j'espère m'en bien tirer. — J'ai fait la connaissance de divers brigands passés et présents ; ce sont des gens assez originaux et pas trop désagréables. Le plus amusant que j'ai vu, est un certain Vakili Pala, chef de brigands, qui a travaillé l'Epire pendant dix-sept ans ; mais, devenu sourd comme un pot, il a compris qu'il fallait songer à son salut, et s'est fait moine. Il regrette sa vie de bandit et en parle avec un enthousiasme à faire envie d'être Klephte ».
(P. Levot)
© Copyright - Tous droits réservés.