|
Bienvenue chez les Liffréens |
LIFFRE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Liffré
La
commune de Liffré ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LIFFRE
Liffré vient peut-être du nom germanique "Liutfred".
La paroisse de Liffré semble avoir été érigée au début du XIIIème siècle, en même temps que Sérigné en La Bouëxière. Plusieurs prieurés s'y installent sous la protection des ducs. Il est à remarquer que les chartes assez nombreuses concernant les prieurés du Feu, de Champfleury et de Sérigné, tous situés sur le territoire actuel de Liffré, ne mentionnent même pas cette paroisse. On peut en conclure qu'au XIIème siècle, époque de la fondation de ces prieurés, la paroisse de Liffré n'existait vraisemblablement pas. Quand on considère, au reste, cette paroisse, encore aujourd'hui environnée des forêts de Rennes, de Chevré et de Sévailles, — forêts qui à l'origine ne devaient faire qu'un seul tout, — on comprend aisément qu'au moyen-âge le territoire de Liffré dut être tardivement érigé en paroisse ; on sait, en effet, qu'anciennement les forêts ne faisaient point partie des paroisses, étant considérées comme terres inhabitées.
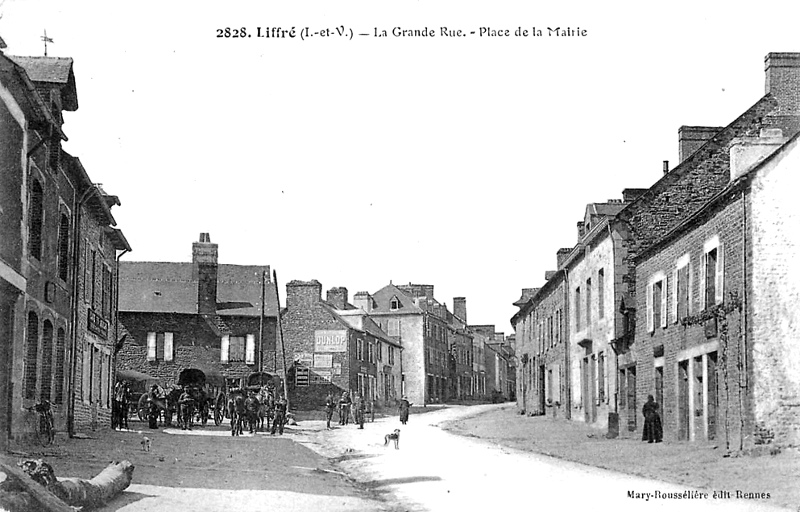
Nous avons vu précédemment qu'il existait au moyen-âge une paroisse à Sérigné. Nous savons positivement que cette paroisse fut érigée au commencement du XIIIème siècle. Il se pourrait bien que l'érection de la paroisse de Liffré fût à peu près contemporaine de celle de Sérigné. Au XIIIème siècle, en effet, eurent lieu de grands défrichements sur la lisière des forêts environnant Rennes ; c'est alors que disparut la forêt de Mont-Mohon et qu'il fallut régler si souvent les devoirs respectifs des moines et des recteurs au sujet des dîmes novales recueillies sur les territoires conquis par l'agriculture. Quant à Sérigné, nous avons dit que sa paroisse disparut vers la fin du XVIème siècle et que son territoire fut alors réuni à celui de Liffré. En 1691 le recteur de Liffré, Thomas Constance, rendit aveu au roi pour neuf traits de dîme dont il jouissait en sa paroisse, savoir : le Bourg, le Breil, Launay, la Martouais, Colleray, Mordrée, la Plardaye, Fouillard et Champgiron. Son successeur, M. Bazin, déclara en que ses dîmes valaient 1 590 livres de rente et qu'il jouissait en plus de la chapellenie de la Benazerie, valant 80 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure).
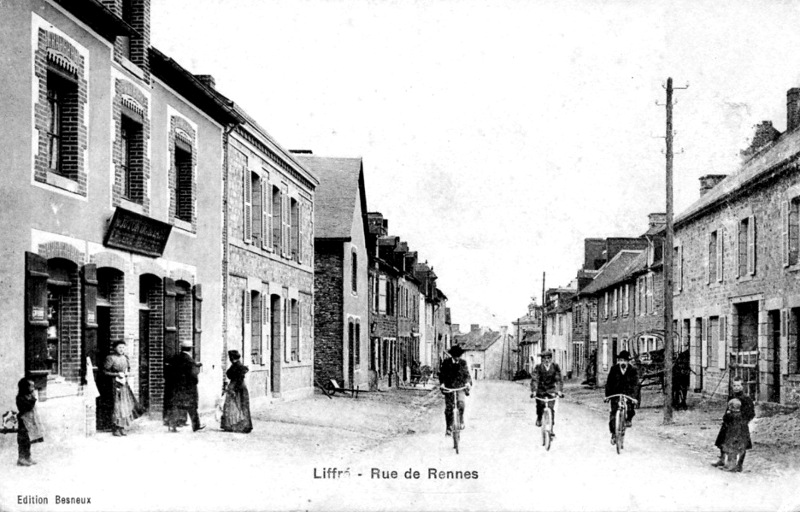
Liffré est occupé comme l'abbaye de Saint-Sulpice, par les troupes françaises qui menacent Rennes en 1491 pour obliger la duchesse Anne au mariage avec le roi de France. La paroisse de Liffré dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes. Les Républicains y défirent les Royalistes le 5 juin 1794.
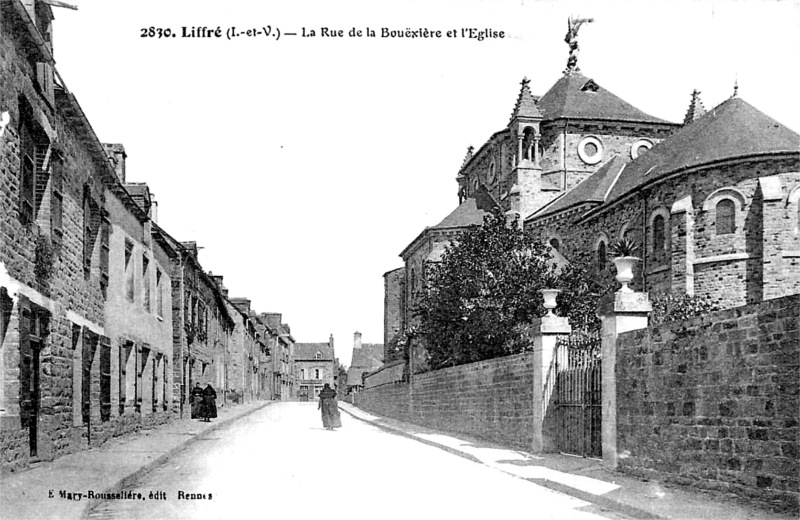
On rencontre l'appellation suivante : ecclesia de Liffreyo (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Liffré : Martin Ollivault (en 1592), Jean Perrin (en 1603), Thomas de Rollée (en 1622), Claude Picaud (en 1642 et en 1671), Thomas Constance (en 1691 et jusqu'en 1704), Guillaume Pezor (en 1704), Jacques Chesnais (1727-1735), Jean-Alexis Guignerot (1735-1759), Julien-François Coullon (1760-1770), Jean-Baptiste Minois de Valière (1770-1775), François-Joseph Bourdet (1776-1787), François Bazin (1787-1789 et 1803-1807), François Eon (1807-1822), François Vaugeois (1823-1878), François Gougeon (à partir de 1879), ....

Voir
![]() " Les
mémoires d'un prêtre breton, exilé pendant la Révolution française
".
" Les
mémoires d'un prêtre breton, exilé pendant la Révolution française
".
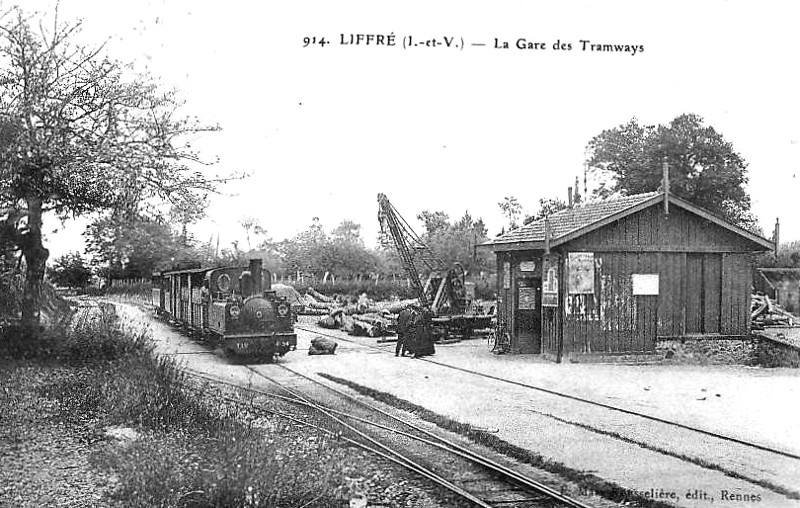
![]()
PATRIMOINE de LIFFRE
![]() l'église
Saint-Michel (1891), édifiée sur les plans des architectes Arthur Regnault
et Hyacinthe Perrin. Dédiée à saint Michel archange, l'ancienne église
de Liffré était une construction insignifiante dont les plus anciennes
parties ne semblaient pas remonter au-delà du XVIème siècle. C'était à
l'origine une simple nef, à laquelle ont été ajoutées deux chapelles en
1837. L'ancienne sacristie datait de 1623. On y voyait encore quelques
pierres tombales armoriées, entre autres celle de Jean Boullé, sieur de la
Gaillardière (XVIIème siècle), portant trois boules. Vers le
milieu du XVIIème siècle, Thomas de Rollée, recteur de Liffré, pria les
Dominicains de Bonne-Nouvelle de vouloir bien établir la confrérie du
Rosaire dans son église, et il y fit construire à cet effet une chapelle
qui a dû faire place à l'une des anciennes chapelles (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). On y trouvait autrefois des
pierres tombales appartenant à la famille Boullé, seigneurs de la
Gaillardière (XVIIème siècle). Le maître-autel à baldaquin date de
1891. La chaire date de 1891 ;
l'église
Saint-Michel (1891), édifiée sur les plans des architectes Arthur Regnault
et Hyacinthe Perrin. Dédiée à saint Michel archange, l'ancienne église
de Liffré était une construction insignifiante dont les plus anciennes
parties ne semblaient pas remonter au-delà du XVIème siècle. C'était à
l'origine une simple nef, à laquelle ont été ajoutées deux chapelles en
1837. L'ancienne sacristie datait de 1623. On y voyait encore quelques
pierres tombales armoriées, entre autres celle de Jean Boullé, sieur de la
Gaillardière (XVIIème siècle), portant trois boules. Vers le
milieu du XVIIème siècle, Thomas de Rollée, recteur de Liffré, pria les
Dominicains de Bonne-Nouvelle de vouloir bien établir la confrérie du
Rosaire dans son église, et il y fit construire à cet effet une chapelle
qui a dû faire place à l'une des anciennes chapelles (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). On y trouvait autrefois des
pierres tombales appartenant à la famille Boullé, seigneurs de la
Gaillardière (XVIIème siècle). Le maître-autel à baldaquin date de
1891. La chaire date de 1891 ;

![]() la
croix de Saint-Raoul (XXème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;
la
croix de Saint-Raoul (XXème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;
![]() la
fontaine Saint-Raoul (époque celtique), située dans la forêt domaniale de Rennes ;
la
fontaine Saint-Raoul (époque celtique), située dans la forêt domaniale de Rennes ;
![]() le
manoir Saint-Denis (1850) ;
le
manoir Saint-Denis (1850) ;
![]() la
maison "du relais du roi" (XVIème siècle), située au n° 4 rue de Rennes ;
la
maison "du relais du roi" (XVIème siècle), située au n° 4 rue de Rennes ;
![]() le
manoir de la Basse-Galinais (XVIème siècle) ;
le
manoir de la Basse-Galinais (XVIème siècle) ;
![]() la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Breil-Orond ;
la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Breil-Orond ;
![]() 2 moulins
à eau : du Feu, de Liffré, Haut-Fourneau à Sérigné ;
2 moulins
à eau : du Feu, de Liffré, Haut-Fourneau à Sérigné ;

A signaler aussi :
![]() la
motte féodale (âge de fer – XIIIème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;
la
motte féodale (âge de fer – XIIIème siècle), située dans la forêt domaniale de Rennes ;
![]() l'ancienne
chapelle de l'Hermitage. Elle est mentionnée dès 1157 et semble avoir
été fondée par les ducs de Bretagne ;
l'ancienne
chapelle de l'Hermitage. Elle est mentionnée dès 1157 et semble avoir
été fondée par les ducs de Bretagne ;
![]() l'ancien
manoir de la Gaillardière. Le manoir possédait une chapelle privative
dédiée à Notre-Dame. Le 14 juillet 1721, Renée Le Pigeon, veuve de
Charles Leziart, seigneur du Dezerseul, sénéchal de
Saint-Aubin-du-Cormier, et habitant son manoir de la Gaillardière, fonda
des messes pour tous les dimanches et fêtes dans la chapelle de ce manoir,
dédiée à la Sainte Vierge. En 1772, le chapelain Antoine de Mareil étant
mort, Michel Leziart, seigneur du Dezerseul, présenta Jean Minois de Valière,
recteur de Liffré, pour le remplacer. En 1781, Mgr de Girac ordonna de
faire des réparations urgentes à la chapelle de la Gaillardière. Le
dernier chapelain, M. Riaux, vicaire à Liffré, déclara en 1790 que ses
charges consistaient alors en deux messes par semaine et deux services par
an, et qu'il jouissait de la métairie de la Guérinais, affermée 160 livres.
Rétablie en 1809 par Mlle Leziart du Dezerseul, cette fondation se dessert
maintenant dans l'église paroissiale. Le domaine était à la famille Léziart, seigneurs de Dézerseul en 1721 et 1772 ;
l'ancien
manoir de la Gaillardière. Le manoir possédait une chapelle privative
dédiée à Notre-Dame. Le 14 juillet 1721, Renée Le Pigeon, veuve de
Charles Leziart, seigneur du Dezerseul, sénéchal de
Saint-Aubin-du-Cormier, et habitant son manoir de la Gaillardière, fonda
des messes pour tous les dimanches et fêtes dans la chapelle de ce manoir,
dédiée à la Sainte Vierge. En 1772, le chapelain Antoine de Mareil étant
mort, Michel Leziart, seigneur du Dezerseul, présenta Jean Minois de Valière,
recteur de Liffré, pour le remplacer. En 1781, Mgr de Girac ordonna de
faire des réparations urgentes à la chapelle de la Gaillardière. Le
dernier chapelain, M. Riaux, vicaire à Liffré, déclara en 1790 que ses
charges consistaient alors en deux messes par semaine et deux services par
an, et qu'il jouissait de la métairie de la Guérinais, affermée 160 livres.
Rétablie en 1809 par Mlle Leziart du Dezerseul, cette fondation se dessert
maintenant dans l'église paroissiale. Le domaine était à la famille Léziart, seigneurs de Dézerseul en 1721 et 1772 ;
![]() l'ancien
manoir de la Motte-Gaillardière. Il possédait autrefois une chapelle
édifiée au milieu du XVIIème siècle et dédiée à Notre-Dame. Dès le
15 avril 1635, Mgr de Cornulier permit au propriétaire du manoir de la
Motte-Gaillardière d'y bâtir une chapelle. Toutefois, ce petit sanctuaire
ne fut terminé qu'en 1665 ; le recteur Claude Picaud en fit alors la visite
et la trouva « bastie en l'honneur de Dieu et de Nostre Dame ». Le
24 septembre de la même année, Julien Boullé, sieur de la Motte-Gaillardière,
y fonda deux messes par semaine et la dota de 65 livres de rente. Mais de
ces deux messes, l'une seulement devait être dite en la chapelle, l'autre
devait être acquittée dans l'église paroissiale. Ces messes étaient à
l'intention des ancêtres du fondateur : Guillaume Boullé et Jeanne Le
Chapt, sieur et dame de la Mazure, ses bisaïeuls ; Jean Boullé et Thomase
Gicquel, sieur et dame de la Gaillardière, ses aïeuls, et Julien Boullé
et Perrine Le Gal, sieur et dame de la Huberdière, ses père et mère
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 44). En 1737, François
Fournier fut pourvu de cette chapellenie ; mais quand il en prit possession,
il ne trouva que des ruines à la Motte-Gaillardière, et il s'engagea par
suite à dire les deux messes de la fondation à l'autel Saint-Gilles, dans
l'église paroissiale. Cette fondation prit alors le nom de chapellenie de
la Benazerie ; nous avons dit qu'elle valait 80 livres en 1790. Propriété successive des familles
Boullé (aux XVIème et XVIIème siècles), Bréhand, et Léziart,
seigneurs du Dézerseul (en 1707 et 1789) ;
l'ancien
manoir de la Motte-Gaillardière. Il possédait autrefois une chapelle
édifiée au milieu du XVIIème siècle et dédiée à Notre-Dame. Dès le
15 avril 1635, Mgr de Cornulier permit au propriétaire du manoir de la
Motte-Gaillardière d'y bâtir une chapelle. Toutefois, ce petit sanctuaire
ne fut terminé qu'en 1665 ; le recteur Claude Picaud en fit alors la visite
et la trouva « bastie en l'honneur de Dieu et de Nostre Dame ». Le
24 septembre de la même année, Julien Boullé, sieur de la Motte-Gaillardière,
y fonda deux messes par semaine et la dota de 65 livres de rente. Mais de
ces deux messes, l'une seulement devait être dite en la chapelle, l'autre
devait être acquittée dans l'église paroissiale. Ces messes étaient à
l'intention des ancêtres du fondateur : Guillaume Boullé et Jeanne Le
Chapt, sieur et dame de la Mazure, ses bisaïeuls ; Jean Boullé et Thomase
Gicquel, sieur et dame de la Gaillardière, ses aïeuls, et Julien Boullé
et Perrine Le Gal, sieur et dame de la Huberdière, ses père et mère
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 44). En 1737, François
Fournier fut pourvu de cette chapellenie ; mais quand il en prit possession,
il ne trouva que des ruines à la Motte-Gaillardière, et il s'engagea par
suite à dire les deux messes de la fondation à l'autel Saint-Gilles, dans
l'église paroissiale. Cette fondation prit alors le nom de chapellenie de
la Benazerie ; nous avons dit qu'elle valait 80 livres en 1790. Propriété successive des familles
Boullé (aux XVIème et XVIIème siècles), Bréhand, et Léziart,
seigneurs du Dézerseul (en 1707 et 1789) ;
![]() l'ancien
prieuré du Feu. Au XIIème siècle vivait dans les vastes solitudes de la
forêt de Rennes un pieux ermite nommé Haton. Il habitait un vallon sauvage
appelé le Faou ou le Fou (c'est-à-dire le Hêtre), où il avait rassemblé
quelques disciples menant comme lui la vie hérémitique ; aussi
l'appelait-on Haton du Fou. Il parait que cet ermitage avait été fondé
sur un terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Georges. En effet, le
village du Feu est presque contigu au hameau de Sans-Secours ; or, dès l'an
1037, le duc Alain III avait donné à sa soeur, l'abbesse Adèle, toute la
partie de la forêt de Rennes appelée Sans-Secours, « partem illam
foreste que Sine Securtum nominatur » (Cartulaire de Saint-Georges,
124). Cependant, Raoul, seigneur d'Acigné, et Geoffroy, son frère, prétendaient
avoir droit sur la terre du Fou, ce que naturellement contestaient les
religieuses de Saint-Georges. Vers 1160, Raoul fit beaucoup de mal à ces
dernières, mais finit par revenir à de meilleurs sentiments ; pour réparer
ses injures, il leur donna quelques dîmes, et son frère et lui renoncèrent
à leurs prétentions sur le Fou moyennant 10 sols qu'ils reçurent des
religieuses. Bien plus, Geoffroy d'Acigné, fils de Raoul, après avoir mené
une vie désordonnée, touché de la grâce divine, abandonna le monde et se
voua à la retraite et à l'exercice de la pénitence sous la conduite de
Haton, qui était alors prieur de Notre-Dame du Fou. En se consacrant à
Dieu et en quittant le siècle, Geoffroy d'Acigné, du consentement de ses
frères et de ses autres parents, donna au prieuré du Fou et à l'abbaye de
Saint-Georges la plus grande partie de ses biens. C'est dans l'église de
Saint-Martin d'Acigné que fut fait le don et que fut célébrée la
profession religieuse du baron pénitent (« Dedit Deo et Sanctae Mariae
de Fago se et sua, scilicet terram totam et omnia prata quae a foramine
tiliae de Louvineio usque ad capellam dou Fou illud magnum nemus occupat ;
et stabilitatem et obedientiam in presentia Hatonis prioris ejusdem loci
promisit usque ad mortem ». (Cartulaire de Saint-Georges, 165). Nous
ignorons au juste combien de temps dura la communauté d'hommes dirigée au
Fou par le prieur Haton. Il est probable que ce dernier quitta cet ermitage
peu de temps après la conversion de Raoul d'Acigné et que ses disciples le
suivirent. En 1174 nous trouvons, en effet, Haton établi avec ses frères
dans une autre partie de la forêt de Rennes, peu éloignée au reste du
Feu, à Louvigné, en Acigné. Quant aux Bénédictines de Saint-Georges,
elles ne fondèrent point un prieuré proprement dit au Feu ; elles y
construisirent seulement un petit manoir, sorte de maison de champs où
elles pouvaient se retirer parfois avant l'établissement de la clôture
dans leur abbaye ; à côté elles formèrent une métairie et donnèrent un
logement au chapelain chargé par elles de desservir la chapelle de
Notre-Dame. En 1491, tous ces bâtiments étaient tombés « en ruyne et
décadence », à la suite des guerres venant de désoler cette partie
de la Bretagne ; ce fut l'abbesse Françoise d'Espinay qui les fit
reconstruire vers l'an 1500. Peu d'années après, Marie de Kermeno, élue
abbesse par les religieuses de Saint-Georges qui s'opposaient à la réforme
de ce monastère, voyant son élection contestée, se retira au prieuré du
Feu avec les Bénédictines ses adhérentes (1524). L'année suivante,
Christine Toustain, pourvue par le roi de l'abbaye de Saint-Georges, concéda
à cette soeur le manoir du Feu pour demeure, avec une pension de 300 livres.
En 1528, Jeanne de la Primaudaye, nouvelle abbesse de Saint-Georges,
confirma Marie de Kermeno et ses compagnes Jebanne Doré et Magdelaine de
Cornillé dans la jouissance du prieuré du Feu et y ajouta 400 livres de
pension sur les revenus de l'abbaye ; mais en 1534 Marie de Kermeno quitta
le Feu pour devenir enfin abbesse légitime et incontestée de
Saint-Georges. Au XVIIème siècle, « le lieu et manoir du Feu », situé
en la paroisse de Liffré, consistait en « maisons principalles, chapelle,
métairie, grange, pressouers, courts et jardins d'iceluy herbregement, prés,
prairies, terres arables et non arables, bois taillis et de haute futaie,
contenant par fonds en tout 110 journaux de terre ; — un moulin à eau
avec ses moutaux, au proche d'iceluy lieu du Feu, sur la rivière de Veuvres
et Chevré ; — et, pour cause de ladite maison du Feu, droit d'usage ès
forêts de Rennes, Saint-Aubin et Liffré et landes en dépendantes pour
pannage et pasturage de leurs bestes et avoirs du Feu, tant en temps de glan
qu'autre, et de prendre litière desdites landes » (Cartulaire de
l'abbaye Saint-Georges, 355, 356). Le Pouillé de Rennes dressé par
ordre de Mgr Turpin de Crissé (1713-1723) nous dit que « le prieuré du
Feu, réuni à la mense abbatiale de Saint-Georges, doit une messe tous les
dimanches et vaut 1 200 livres de rente ». En 1790, les religieuses de
Saint-Georges affermaient 500 livres la métairie du Feu et 500 livres le
moulin de même nom (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25).
Aujourd'hui, le Feu n'est plus qu'un village situé dans une vallée aussi
sauvage que pittoresque. Le vieux manoir prioral est encore debout, tel à
peu près que le construisit l'abbesse Françoise d'Espinay ; il présente
deux portes ogivales presque accolées, de vastes croisées à meneaux
sculptés et plusieurs écussons frustes timbrés d'une crosse et placés
dans de petites arcatures ogivales. Derrière ce logis se trouve la métairie
et devant se dresse la chapelle ; celle-ci n'offre plus guère d'antique
qu'une porte ogivale à colonnettes contemporaine du manoir et ornée comme
lui des armoiries de l'abbesse de Saint-Georges ; le reste de l'édifice a
été refait dans les derniers siècles, et on y lit sur une pierre la date
1697 ; le chevet est occupé extérieurement par une vaste niche renfermant
une statue colossale de saint Marc sculptée en bois ; cette chapelle sert
maintenant d'écurie. Signalons enfin, pour terminer, un très ancien puits
et un vieux moulin à eau qui achèvent de donner à ce petit coin de terre
un caractère d'antiquité fort intéressant (abbé Guillotin de Corson) ;
l'ancien
prieuré du Feu. Au XIIème siècle vivait dans les vastes solitudes de la
forêt de Rennes un pieux ermite nommé Haton. Il habitait un vallon sauvage
appelé le Faou ou le Fou (c'est-à-dire le Hêtre), où il avait rassemblé
quelques disciples menant comme lui la vie hérémitique ; aussi
l'appelait-on Haton du Fou. Il parait que cet ermitage avait été fondé
sur un terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Georges. En effet, le
village du Feu est presque contigu au hameau de Sans-Secours ; or, dès l'an
1037, le duc Alain III avait donné à sa soeur, l'abbesse Adèle, toute la
partie de la forêt de Rennes appelée Sans-Secours, « partem illam
foreste que Sine Securtum nominatur » (Cartulaire de Saint-Georges,
124). Cependant, Raoul, seigneur d'Acigné, et Geoffroy, son frère, prétendaient
avoir droit sur la terre du Fou, ce que naturellement contestaient les
religieuses de Saint-Georges. Vers 1160, Raoul fit beaucoup de mal à ces
dernières, mais finit par revenir à de meilleurs sentiments ; pour réparer
ses injures, il leur donna quelques dîmes, et son frère et lui renoncèrent
à leurs prétentions sur le Fou moyennant 10 sols qu'ils reçurent des
religieuses. Bien plus, Geoffroy d'Acigné, fils de Raoul, après avoir mené
une vie désordonnée, touché de la grâce divine, abandonna le monde et se
voua à la retraite et à l'exercice de la pénitence sous la conduite de
Haton, qui était alors prieur de Notre-Dame du Fou. En se consacrant à
Dieu et en quittant le siècle, Geoffroy d'Acigné, du consentement de ses
frères et de ses autres parents, donna au prieuré du Fou et à l'abbaye de
Saint-Georges la plus grande partie de ses biens. C'est dans l'église de
Saint-Martin d'Acigné que fut fait le don et que fut célébrée la
profession religieuse du baron pénitent (« Dedit Deo et Sanctae Mariae
de Fago se et sua, scilicet terram totam et omnia prata quae a foramine
tiliae de Louvineio usque ad capellam dou Fou illud magnum nemus occupat ;
et stabilitatem et obedientiam in presentia Hatonis prioris ejusdem loci
promisit usque ad mortem ». (Cartulaire de Saint-Georges, 165). Nous
ignorons au juste combien de temps dura la communauté d'hommes dirigée au
Fou par le prieur Haton. Il est probable que ce dernier quitta cet ermitage
peu de temps après la conversion de Raoul d'Acigné et que ses disciples le
suivirent. En 1174 nous trouvons, en effet, Haton établi avec ses frères
dans une autre partie de la forêt de Rennes, peu éloignée au reste du
Feu, à Louvigné, en Acigné. Quant aux Bénédictines de Saint-Georges,
elles ne fondèrent point un prieuré proprement dit au Feu ; elles y
construisirent seulement un petit manoir, sorte de maison de champs où
elles pouvaient se retirer parfois avant l'établissement de la clôture
dans leur abbaye ; à côté elles formèrent une métairie et donnèrent un
logement au chapelain chargé par elles de desservir la chapelle de
Notre-Dame. En 1491, tous ces bâtiments étaient tombés « en ruyne et
décadence », à la suite des guerres venant de désoler cette partie
de la Bretagne ; ce fut l'abbesse Françoise d'Espinay qui les fit
reconstruire vers l'an 1500. Peu d'années après, Marie de Kermeno, élue
abbesse par les religieuses de Saint-Georges qui s'opposaient à la réforme
de ce monastère, voyant son élection contestée, se retira au prieuré du
Feu avec les Bénédictines ses adhérentes (1524). L'année suivante,
Christine Toustain, pourvue par le roi de l'abbaye de Saint-Georges, concéda
à cette soeur le manoir du Feu pour demeure, avec une pension de 300 livres.
En 1528, Jeanne de la Primaudaye, nouvelle abbesse de Saint-Georges,
confirma Marie de Kermeno et ses compagnes Jebanne Doré et Magdelaine de
Cornillé dans la jouissance du prieuré du Feu et y ajouta 400 livres de
pension sur les revenus de l'abbaye ; mais en 1534 Marie de Kermeno quitta
le Feu pour devenir enfin abbesse légitime et incontestée de
Saint-Georges. Au XVIIème siècle, « le lieu et manoir du Feu », situé
en la paroisse de Liffré, consistait en « maisons principalles, chapelle,
métairie, grange, pressouers, courts et jardins d'iceluy herbregement, prés,
prairies, terres arables et non arables, bois taillis et de haute futaie,
contenant par fonds en tout 110 journaux de terre ; — un moulin à eau
avec ses moutaux, au proche d'iceluy lieu du Feu, sur la rivière de Veuvres
et Chevré ; — et, pour cause de ladite maison du Feu, droit d'usage ès
forêts de Rennes, Saint-Aubin et Liffré et landes en dépendantes pour
pannage et pasturage de leurs bestes et avoirs du Feu, tant en temps de glan
qu'autre, et de prendre litière desdites landes » (Cartulaire de
l'abbaye Saint-Georges, 355, 356). Le Pouillé de Rennes dressé par
ordre de Mgr Turpin de Crissé (1713-1723) nous dit que « le prieuré du
Feu, réuni à la mense abbatiale de Saint-Georges, doit une messe tous les
dimanches et vaut 1 200 livres de rente ». En 1790, les religieuses de
Saint-Georges affermaient 500 livres la métairie du Feu et 500 livres le
moulin de même nom (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25).
Aujourd'hui, le Feu n'est plus qu'un village situé dans une vallée aussi
sauvage que pittoresque. Le vieux manoir prioral est encore debout, tel à
peu près que le construisit l'abbesse Françoise d'Espinay ; il présente
deux portes ogivales presque accolées, de vastes croisées à meneaux
sculptés et plusieurs écussons frustes timbrés d'une crosse et placés
dans de petites arcatures ogivales. Derrière ce logis se trouve la métairie
et devant se dresse la chapelle ; celle-ci n'offre plus guère d'antique
qu'une porte ogivale à colonnettes contemporaine du manoir et ornée comme
lui des armoiries de l'abbesse de Saint-Georges ; le reste de l'édifice a
été refait dans les derniers siècles, et on y lit sur une pierre la date
1697 ; le chevet est occupé extérieurement par une vaste niche renfermant
une statue colossale de saint Marc sculptée en bois ; cette chapelle sert
maintenant d'écurie. Signalons enfin, pour terminer, un très ancien puits
et un vieux moulin à eau qui achèvent de donner à ce petit coin de terre
un caractère d'antiquité fort intéressant (abbé Guillotin de Corson) ;
![]() l'ancien
prieuré de Sérigné. Engelbaud, archevêque de Tours (1150-1156), confirma
la donation qu'avait faite aux religieuses de Saint-Sulpice Clémence, femme
de Juhel de Mayenne, de toute la dîme de Sérigné et du bois voisin, «
totam, decimam Sirigniaci et nemoris adjacentis ». Ce don fut fait avec
l'approbation de Goranton de Vitré, dans le fief duquel se trouvait sans
doute Sérigné. Ce Goranton de Vitré n'en resta pas là : peu de temps après,
de concert avec Geffroy son frère, et Hervé son fils, il donna lui-même
deux portions de dîme à Sérigné, « duas partes decimœ de Seriniaco
», et toute la dîme des terres nouvellement défrichées dans la forêt,
lui provenant d'un don du comte de Bretagne, « dederunt etiam totam
decimam exemplorum forestœ quam possidebant ex dono comitis Britanniœ ».
Enfin, ces généreux seigneurs concédèrent aux religieuses une terre pour
y construire une chapelle et un cimetière, « terram ad cimiterium et ad
capellam inibi construendam » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, I, 653). En 1164, Etienne de La Rochefoucaud, évêque de Rennes,
Raoul, son archidiacre, Nine, abbesse de Saint-Sulpice, Goranton de Vitré,
Geffroy et Hervé, se trouvèrent réunis à Sérigné. Le prélat confirma
en cette circonstance la donation faite aux religieuses de Saint-Sulpice, bénit
le nouveau cimetière, consacra la chapelle et investit l'abbesse Nine de
tout ce qu'on lui donnait en lui présentant un bâton, signe d'autorité
(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 653). La chapelle de Sérigné
fut construite sur une colline appelée Mont d'Asnel, « in Monte Asnelli
». Les religieuses de Saint-Sulpice, en y plaçant un de leurs frères
Condonats, songèrent, semble-t-il, à faire immédiatement ériger en paroisse
tout ce territoire nouvellement défriché pris sur la forêt, et l'évêque
de Rennes ne paraît pas s'être fortement opposé à leurs désirs. Dès
l'année suivante, en effet, nous voyons une contestation s'élever entre
ces religieuses et Robert, recteur de la Bouëxière, au sujet de la
nouvelle chapelle et de ses dépendances. Le bon évêque Etienne de La
Rochefoucaud vint heureusement les mettre d'accord et fixa en même temps
les limites du territoire de Sérigné ; il régla, en 1165, que l'église
de Sérigné, son cimetière, ses dîmes et tous ses droits paroissiaux, «
ecclesia illa et cimiterium et decimœ et omnia parochialia », s'étendraient
du fleuve appelé Derlande (aujourd'hui rivière de Chevré) jusqu'à la forêt,
« a fluvio qui dicitur Derlanda osque ad forestam ». Toutefois,
comme nous l'avons vu, l'église et le bourg de Sérigné, avec leurs dépendances,
ne furent réellement érigés en paroisse qu'une quarantaine d'années plus
tard, par l'évêque Pierre de Dinan (1199-1210), et en même temps que l'église
et le bourg de Saint-Sulpice-des-Bois. Il est très probable que les bornes
de la nouvelle paroisse de Sérigné furent celles qu'avait déterminées dès
1165 l'évêque Etienne de La Rochefoucaud (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). La paroisse de Sérigné existait encore en 1510, car à cette époque le
recteur, « rector de Serigneio », fut imposé pour 33 sols 4 deniers. Bien
plus, d'après une note trouvée aux Archives départementales, elle n'avait
pas disparu en 1554, lorsque frère Jean de Morais, « prieur-recteur de
Sérigné », résigna ce bénéfice. Mais les Pouillés du siècle
suivant n'en parlent plus que comme d'un prieuré ; on pourrait donc
assigner la fin du XVIème siècle pour époque de l'extinction de la cure
de Sérigné et de l'union de son territoire à celui de la paroisse de
Liffré. Devenu de la sorte simple prieuré, et les religieux de
Saint-Sulpice n'existant plus eux-mêmes, Sérigné ne fut bientôt plus
considéré que comme une chapellenie dont la présentation appartint
toutefois à l'abbesse de Saint-Sulpice jusqu'au moment de la Révolution. A
cette époque M. Riaux, vicaire à Liffré, qui jouissait de Sérigné en
qualité de chapelain, déclara que « ce petit prieuré ou chapellenie
consistait en un petit trait de dîme et en deux pièces de terre nommées
l'une les Cimetières, l'autre le Pain-Bénit, le tout de la valeur de 120
livres, à charge d'une messe le dimanche et de l'entretien de la chapelle,
lesdites charges évaluées 50 livres » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Outre la messe du dimanche, une fondation de
trois autres messes se desservait en cette chapelle tous les jeudis,
vendredis et samedis (cette fondation, faite par Vincent Feulienne, Julienne
et Guillemette Galesne valait 65 livres de rente). Aujourd'hui, Sérigné
est un gros village pittoresquement assis dans une vallée de la forêt de
Rennes, au bord d'un bel étang ; mais il ne reste plus rien d'intéressant
dans son ancienne église, convertie en maison d'habitation. Les seigneurs
de Sérigné, possesseurs jadis du manoir de ce nom, avaient tous les droits
honorifiques dans cette église ; aussi y voyait-on à la principale vitre
du sanctuaire les armoiries des barons de Vitré, des ducs de la Trémoille
et des marquis du Bordage, successivement seigneurs de Sérigné (abbé Guillotin de Corson) ;
l'ancien
prieuré de Sérigné. Engelbaud, archevêque de Tours (1150-1156), confirma
la donation qu'avait faite aux religieuses de Saint-Sulpice Clémence, femme
de Juhel de Mayenne, de toute la dîme de Sérigné et du bois voisin, «
totam, decimam Sirigniaci et nemoris adjacentis ». Ce don fut fait avec
l'approbation de Goranton de Vitré, dans le fief duquel se trouvait sans
doute Sérigné. Ce Goranton de Vitré n'en resta pas là : peu de temps après,
de concert avec Geffroy son frère, et Hervé son fils, il donna lui-même
deux portions de dîme à Sérigné, « duas partes decimœ de Seriniaco
», et toute la dîme des terres nouvellement défrichées dans la forêt,
lui provenant d'un don du comte de Bretagne, « dederunt etiam totam
decimam exemplorum forestœ quam possidebant ex dono comitis Britanniœ ».
Enfin, ces généreux seigneurs concédèrent aux religieuses une terre pour
y construire une chapelle et un cimetière, « terram ad cimiterium et ad
capellam inibi construendam » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de
Bretagne, I, 653). En 1164, Etienne de La Rochefoucaud, évêque de Rennes,
Raoul, son archidiacre, Nine, abbesse de Saint-Sulpice, Goranton de Vitré,
Geffroy et Hervé, se trouvèrent réunis à Sérigné. Le prélat confirma
en cette circonstance la donation faite aux religieuses de Saint-Sulpice, bénit
le nouveau cimetière, consacra la chapelle et investit l'abbesse Nine de
tout ce qu'on lui donnait en lui présentant un bâton, signe d'autorité
(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 653). La chapelle de Sérigné
fut construite sur une colline appelée Mont d'Asnel, « in Monte Asnelli
». Les religieuses de Saint-Sulpice, en y plaçant un de leurs frères
Condonats, songèrent, semble-t-il, à faire immédiatement ériger en paroisse
tout ce territoire nouvellement défriché pris sur la forêt, et l'évêque
de Rennes ne paraît pas s'être fortement opposé à leurs désirs. Dès
l'année suivante, en effet, nous voyons une contestation s'élever entre
ces religieuses et Robert, recteur de la Bouëxière, au sujet de la
nouvelle chapelle et de ses dépendances. Le bon évêque Etienne de La
Rochefoucaud vint heureusement les mettre d'accord et fixa en même temps
les limites du territoire de Sérigné ; il régla, en 1165, que l'église
de Sérigné, son cimetière, ses dîmes et tous ses droits paroissiaux, «
ecclesia illa et cimiterium et decimœ et omnia parochialia », s'étendraient
du fleuve appelé Derlande (aujourd'hui rivière de Chevré) jusqu'à la forêt,
« a fluvio qui dicitur Derlanda osque ad forestam ». Toutefois,
comme nous l'avons vu, l'église et le bourg de Sérigné, avec leurs dépendances,
ne furent réellement érigés en paroisse qu'une quarantaine d'années plus
tard, par l'évêque Pierre de Dinan (1199-1210), et en même temps que l'église
et le bourg de Saint-Sulpice-des-Bois. Il est très probable que les bornes
de la nouvelle paroisse de Sérigné furent celles qu'avait déterminées dès
1165 l'évêque Etienne de La Rochefoucaud (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). La paroisse de Sérigné existait encore en 1510, car à cette époque le
recteur, « rector de Serigneio », fut imposé pour 33 sols 4 deniers. Bien
plus, d'après une note trouvée aux Archives départementales, elle n'avait
pas disparu en 1554, lorsque frère Jean de Morais, « prieur-recteur de
Sérigné », résigna ce bénéfice. Mais les Pouillés du siècle
suivant n'en parlent plus que comme d'un prieuré ; on pourrait donc
assigner la fin du XVIème siècle pour époque de l'extinction de la cure
de Sérigné et de l'union de son territoire à celui de la paroisse de
Liffré. Devenu de la sorte simple prieuré, et les religieux de
Saint-Sulpice n'existant plus eux-mêmes, Sérigné ne fut bientôt plus
considéré que comme une chapellenie dont la présentation appartint
toutefois à l'abbesse de Saint-Sulpice jusqu'au moment de la Révolution. A
cette époque M. Riaux, vicaire à Liffré, qui jouissait de Sérigné en
qualité de chapelain, déclara que « ce petit prieuré ou chapellenie
consistait en un petit trait de dîme et en deux pièces de terre nommées
l'une les Cimetières, l'autre le Pain-Bénit, le tout de la valeur de 120
livres, à charge d'une messe le dimanche et de l'entretien de la chapelle,
lesdites charges évaluées 50 livres » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Outre la messe du dimanche, une fondation de
trois autres messes se desservait en cette chapelle tous les jeudis,
vendredis et samedis (cette fondation, faite par Vincent Feulienne, Julienne
et Guillemette Galesne valait 65 livres de rente). Aujourd'hui, Sérigné
est un gros village pittoresquement assis dans une vallée de la forêt de
Rennes, au bord d'un bel étang ; mais il ne reste plus rien d'intéressant
dans son ancienne église, convertie en maison d'habitation. Les seigneurs
de Sérigné, possesseurs jadis du manoir de ce nom, avaient tous les droits
honorifiques dans cette église ; aussi y voyait-on à la principale vitre
du sanctuaire les armoiries des barons de Vitré, des ducs de la Trémoille
et des marquis du Bordage, successivement seigneurs de Sérigné (abbé Guillotin de Corson) ;
![]() l'ancien
prieuré de Champfleury. En 1162, le jour de la Purification, Conan IV, duc
de Bretagne, se trouvant à la cathédrale de Rennes, donna aux religieux de
Savigné un quartier de sa forêt de Rennes nommé Champfleury, pour y
construire une grange, « concessi ad œdificandam grangiam Campum
Floridum ». Tout le Chapitre de Rennes fut témoin de cette donation
(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 646). Pour plus de sûreté,
les religieux de Savigné firent approuver cette fondation ducale par Guy,
forestier du prince, qui s'empressa de céder aux moines tous les droits sur
Champfleury que pouvait lui donner sa charge (Dom Morice, Preuves de
l'Histoire de Bretagne, I, 636). Quelque temps plus tard, André, seigneur
de Vitré, du consentement de ses frères Alain, Robert et Josselin, donna
à l'abbaye de Savigné l'attache de la chaussée de son moulin de
Champfleury, « dedi atacheiam calceiœ molendini de Campo Florido »
; les religieux lui promirent, en échange, de prier chaque année pour l'âme
des sires de Vitré et d'établir en leur abbaye, le jour de Saint-Martin
d'hiver, une pitance générale de pain blanc, vin et poisson. Fulcon, abbé
de Clermont, et Guillaume, abbé de Savigné, furent présents à cette
fondation d'André de Vitré (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne,
I, 681). En 1679, François de la Vieuville, abbé de Savigné, déclara que
la seigneurie de Champfleury unie à son abbaye comprenait « le manoir
dudit lieu avec sa chapelle y joignant, et où on célèbre la messe tous
les dimanches et festes ; — la métairie de Champfleury ; —
l'emplacement d'un moulin à eau ruiné par les guerres passées ; — 200
journaux de terres labourables, prés et landes, en Liffré ; — un fief
avec une haute justice ; — le droit d'usage en la forêt de Liffré ; —
l'exemption pour les vassaux des devoirs de fouage, garde, etc. » (Archives
nationales, P. 1731). Cette chapelle construite à Champfleury, dans la
paroisse de Liffré, était fort délabrée en 1781, et Mgr de Girac ordonna
qu'elle fût aussitôt réparée et mise en état décent pour que les
messes de fondation y fussent acquittées. A cette époque et depuis
longtemps déjà, la grange de Champfleury était unie, comme nous venons de
le voir, à la mense capitulaire de Savigné. Le 12 février 1790, dom
Verdier, prieur de Savigné, déclara que « la terre et seigneurie de
Champfleury, en Liffré, consistait en maison, cour, jardin, étable, écurie,
grange et autres bâtiments ; — quelques menues rentes seigneuriales ; —
une juridiction avec son greffe ; — une chapelle, enfin, à laquelle était
cy-devant annexée une portion de dîmes qu'on refusait de payer, prétendant
qu'on devait y dire la messe » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 26). Ogée assure que l'abbé de Savigné faisait
assez souvent sa résidence au manoir de Champfleury ; nous ne savons ce
qu'il y a d'exact dans cette assertion dont nous n'avons pas de preuves
(abbé Guillotin de Corson).
l'ancien
prieuré de Champfleury. En 1162, le jour de la Purification, Conan IV, duc
de Bretagne, se trouvant à la cathédrale de Rennes, donna aux religieux de
Savigné un quartier de sa forêt de Rennes nommé Champfleury, pour y
construire une grange, « concessi ad œdificandam grangiam Campum
Floridum ». Tout le Chapitre de Rennes fut témoin de cette donation
(Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 646). Pour plus de sûreté,
les religieux de Savigné firent approuver cette fondation ducale par Guy,
forestier du prince, qui s'empressa de céder aux moines tous les droits sur
Champfleury que pouvait lui donner sa charge (Dom Morice, Preuves de
l'Histoire de Bretagne, I, 636). Quelque temps plus tard, André, seigneur
de Vitré, du consentement de ses frères Alain, Robert et Josselin, donna
à l'abbaye de Savigné l'attache de la chaussée de son moulin de
Champfleury, « dedi atacheiam calceiœ molendini de Campo Florido »
; les religieux lui promirent, en échange, de prier chaque année pour l'âme
des sires de Vitré et d'établir en leur abbaye, le jour de Saint-Martin
d'hiver, une pitance générale de pain blanc, vin et poisson. Fulcon, abbé
de Clermont, et Guillaume, abbé de Savigné, furent présents à cette
fondation d'André de Vitré (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne,
I, 681). En 1679, François de la Vieuville, abbé de Savigné, déclara que
la seigneurie de Champfleury unie à son abbaye comprenait « le manoir
dudit lieu avec sa chapelle y joignant, et où on célèbre la messe tous
les dimanches et festes ; — la métairie de Champfleury ; —
l'emplacement d'un moulin à eau ruiné par les guerres passées ; — 200
journaux de terres labourables, prés et landes, en Liffré ; — un fief
avec une haute justice ; — le droit d'usage en la forêt de Liffré ; —
l'exemption pour les vassaux des devoirs de fouage, garde, etc. » (Archives
nationales, P. 1731). Cette chapelle construite à Champfleury, dans la
paroisse de Liffré, était fort délabrée en 1781, et Mgr de Girac ordonna
qu'elle fût aussitôt réparée et mise en état décent pour que les
messes de fondation y fussent acquittées. A cette époque et depuis
longtemps déjà, la grange de Champfleury était unie, comme nous venons de
le voir, à la mense capitulaire de Savigné. Le 12 février 1790, dom
Verdier, prieur de Savigné, déclara que « la terre et seigneurie de
Champfleury, en Liffré, consistait en maison, cour, jardin, étable, écurie,
grange et autres bâtiments ; — quelques menues rentes seigneuriales ; —
une juridiction avec son greffe ; — une chapelle, enfin, à laquelle était
cy-devant annexée une portion de dîmes qu'on refusait de payer, prétendant
qu'on devait y dire la messe » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 26). Ogée assure que l'abbé de Savigné faisait
assez souvent sa résidence au manoir de Champfleury ; nous ne savons ce
qu'il y a d'exact dans cette assertion dont nous n'avons pas de preuves
(abbé Guillotin de Corson).
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Denis-de-la-Forêt. Près de ses ruines se trouvent la Croix et la fontaine Saint-Raoul ;
l'ancienne
chapelle Saint-Denis-de-la-Forêt. Près de ses ruines se trouvent la Croix et la fontaine Saint-Raoul ;
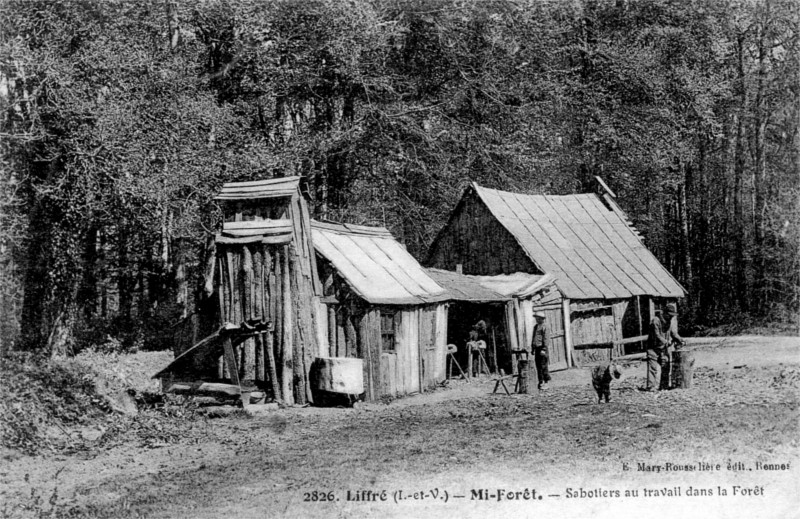
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de LIFFRE
Sur le territoire actuel de Liffré fut créée, au commencement du XIIIème siècle, la paroisse de Sérigné, confiée à un religieux-prieur dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois. Cette paroisse subsista jusqu'au XVIème siècle et son territoire fut alors annexé à ceux de Liffré et de la Bouëxière. C'est, en effet, dans la paroisse de la Bouëxière que se trouva placé le manoir de Sérigné, après l'extinction de la paroisse de ce nom, quoiqu'il fut assez voisin du bourg de Sérigné, concédé à Liffré. Cette seigneurie de Sérigné donna son nom à une famille représentée au XIIème siècle à la cour des barons de Vitré par Robert de Sérigné (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I. 717 et 778). Mais, en 1406, Sérigné était devenu la propriété de Marie de Rochefort, femme de Bertrand Gouyon, sire de Matignon, décédé l'année suivante. Cette dame mourut elle-même en mars 1419, laissant plusieurs fils, dont un cadet, Lancelot Gouyon, prit alors le titre de seigneur de Sérigné (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II. 990). L'ainé toutefois, Jean Gouyon, sire de Matignon, hérita en réalité de cette seigneurie, pour laquelle il rendit aveu au duc de Bretagne le 15 mai 1424 (Archives de Loire-Inférieure). Jean Gouyon épousa Marguerite de Mauny, dont il eut, entre autres enfants, Marie Gouyon, mariée en 1433 à Richard, sire d'Espinay, qui reçut en dot la seigneurie de Sérigné. Mais la dame d'Espinay mourut à la fleur de l'âge et sans enfants, le 18 mars 1434, et Sérigné revint aux mains de son père, le sire de Matignon (Archives de Loire-Inférieure). Jean Gouyon décéda à son tour le 23 février 1450, laissant la seigneurie de Sérigné à son fils aîné Bertrand Gouyon, sire de Matignon, qui en fournit deux ans plus tard le minu au duc de Bretagne. Bertrand Gouyon ne conserva pas Sérigné : il donna, le 19 septembre 1467, cette terre en partage à sa soeur Isabeau Gouyon, femme de Guy, sire d'Espinay (Archives du château de la Magnane). A partir de cette époque les sires d'Espinay possédèrent Sérigné, qu'ils firent unir par le roi à leur marquisat d'Espinay, érigé en 1575. Leur héritier, Charles de Schomberg, duc d'Halluin, — fils d'Henri de Schomberg et de Françoise d'Espinay — vendit, le 7 avril 1633, le marquisat d'Espinay, comprenant la châtellenie de Sérigné, à Henri, duc de la Trémoille et baron de Vitré. Ce dernier seigneur retira Sérigné du marquisat d'Espinay pour en avoir plus d'argent. Il commença par vendre, le 9 mars 1635, à François du Poulpry, conseiller au Parlement de Bretagne, et Guillemette Le Drenec, sa femme, le manoir et la métairie de Sérigné, les étangs et moulins dudit lieu, les droits d'usage en la forêt de Saint-Aubin, en un mot tout le domaine proche de la châtellenie de Sérigné (Archives d'Ille-et-Vilaine, E. 289. A noter qu'en 1657, M. et Mme du Poulpry revendirent la terre de Sévigné à Mathurin Blohio, seigneur de Kervern). Un peu plus tard, le 24 novembre 1654, il céda pour 55 000 livres la seigneurie même de Sérigné à René VII de Montbourcher, marquis du Bordage, qui la fit unir par le roi à son marquisat en 1656 (Archives du château de la Magnane). Lorsqu'en 1669 René de Montbourcher, fils de René VII, épousa Élisabeth Gouyon de la Moussaye, son père lui donna par contrat de mariage la châtellenie de Sérigné. Les successeurs de ce seigneur, devenu marquis du Bordage à la mort de son père, conservèrent jusqu'à la Révolution cette châtellenie de Sérigné, dont le dernier possesseur fut René-François de Montbourcher, marquis du Bordage, décédé seulement en 1835. Châtellenie d'ancienneté, Sérigné relevait en partie du roi sous ses domaines de Rennes et de Saint-Aubin-du-Cormier, et en partie de la baronnie de Vitré. Cette seigneurie comprenait quinze fiefs avec haute justice s'étendant en neuf paroisses : Sérigné, Liffré, Gosné, Ercé-près-Liffré, La Bouëxière, Dourdain, Chasné, Livré et Acigné. La juridiction de Sérigné s'exerçait au XVIIème siècle au bourg de la Bouëxière, mais un arrêt du Parlement de Bretagne rendu en 1704, à la requête du marquis du Bordage, ordonna la translation de ce tribunal au bourg d'Ercé-près-Liffré (Archives du château de la Magnane). Les fourches patibulaires de Sérigné se composaient de quatre piliers élevés sur la lande de Guinebert en Dourdain, des ceps et colliers pour la punition des malfaiteurs se trouvaient aux bourgs de Gosné et de Dourdain (Archives du château de la Magnane). De la châtellenie de Sérigné relevaient plusieurs belles seigneuries, telles que le Plessix-Pillet et le Plessix-Dourdain, le Bertry, la Normandaye, le Plessix-d'Ercé, l'Estourbeillonnaye, l'Aubouclère, etc. (Archives nationales, P. 1709 et 1722). Le seigneur de Sérigné était prééminencier supérieur et fondateur des églises paroissiales de Sérigné, Dourdain et Gosné, et avait en chacune d'elles des bancs et enfeus et ses armoiries « en peinture et relief » (Archives nationales). Il avait reçu des ducs de Bretagne un droit de pacage et d'usage pour bois de construction et de chauffage dans leur forêt de Saint-Aubin-du-Cormier. Voici quel était au XVème siècle le domaine proche de la châtellenie de Sérigné : le manoir de Sérigné et la métairie du même nom, — le bois de Sérigné, — les étangs de Sérigné et leurs moulins tant à draps qu'à blé, — et le moulin de Quincampoix. Nous avons dit que ce domaine fut distrait de la châtellenie en 1635 et acquis presque tout entier par M. du Poulpry. Néanmoins ce dernier n'acheta point le moulin de Quincampoix, sur le bord de l'Islet en Gosné : il devint la propriété du seigneur de la Dobiaye qui, en 1665, le tenait féodalement de la juridiction de Sérigné, à devoir d'offrir chaque année au seigneur, pendant le mois de janvier, « deux sonnettes d'argent avec leurs longes de rubans rouge et bleu » (Archives du château de la Magnane). Au milieu du XIXème siècle, l'ancien bourg de Sérigné n'était plus qu'un village et son vieux manoir était devenu un établissement industriel : un haut-fourneau avait été établi au bord de ses vastes étangs, dans une des plus jolies vallées des environs de Rennes (abbé Guillotin de Corson).
Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Eon Pofraie et Jean Radouillet, plusieurs nobles sont mentionnés à Liffré :
![]() le
manoir Doufou (du Fou ou du Feu) appartenant à l'abbesse de Saint-Georges ;
le
manoir Doufou (du Fou ou du Feu) appartenant à l'abbesse de Saint-Georges ;
![]() le
manoir de Champflori (Champfleury) appartenant à l’abbé de Savigné.
le
manoir de Champflori (Champfleury) appartenant à l’abbé de Savigné.
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Liffré".
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.