|
Bienvenue ! |
LA SEIGNEURIE DE MONTAUBAN ET SES PREMIERS SEIGNEURS |
Retour page d'accueil Retour page "Ville de Montauban-de-Bretagne"
L'objet principal de cette notice est de rechercher l'origine des sires de Montauban ; mais avant de parler des seigneurs, je parlerai de la seigneurie qui leur donna le nom et l'existence.
Quand on fait l'histoire d'un fief, il faut d'abord dire ce que c'est que ce fief, en indiquer l'étendue, les vicissitudes ; les particularités et les prérogatives, en un mot en donner la description. Après cela, on passe, si l'on veut, à l'histoire des possesseurs, dont l’importance le plus souvent dépend de celle du fief lui-même. Dans l'existence, dans les alliances et là généalogie d'une dynastie féodale, bien des circonstances, et souvent les principales, sont déterminés par les exigences, par les convenances, les attenances du fief qui ferme le patrimoine de cette dynastie. Au moyen-âge, surtout dans l'institution féodale, la terre — on l'a dit depuis longtemps — est plus forte que l’homme ; c'est elle, la plupart du temps, qui règle la place, le rôle, la fortune de ses maîtres. Si l'on veut nous renseigner exactement sur les maîtres, il faut donc d'abord nous dire ce qu'est la terre. Faire l'histoire des seigneurs avant d'avoir fait connaître la seigneurie, ce serait un peu, à mon humble avis, « mettre la charrue devant les bœufs ».
La méthode opposée à celle que je préconise a été, je le sais, souvent employée ; de nos jours, elle l'est encore par d'estimables auteurs, qui croient, je n'en doute pas, avoir de bonnes raisons d'en agir ainsi. Je n'entends ici me faire le censeur de personne. Je veux dire seulement pourquoi je ne cède pas à ces exemples, pourquoi je persiste à suivre la marche qui me semble être de beaucoup la plus naturelle, la plus claire, la plus logique.
***
Décrire une seigneurie, ce n'est point entasser au hasard quelques notions plus ou moins curieuses empruntées aux aveux, minus et declarativos, — encore moins, comme font d'autres, copier et reproduire de longues listes de pièces de terre et de rentes minuscules par deniers ou par grains, ce qui ne sert à rien et est d'un ennui mortel.
Pour faire connaître nettement une seigneurie, il faut d'abord en indiquer l'étendue générale, puis rechercher, analyser les traits principaux, les droits, les prérogatives, en suivant dans cet exposé l'ordre prescrit par la nature des choses, en observant avec soin ce qu'on peut appeler l'étagement féodal.
Dans toute seigneurie importante il y avait trois choses, trois ordres de droits et de biens: 1° le domaine direct, 2° le fief proche, 3° l'arrière-fief et les mouvances nobles.
Le domaine direct (ou simplement le domaine) était la partie de la seigneurie dont le seigneur se réservait la propriété, la jouissance personnelle et immédiate. Cela embrassait aussi ce qu'on appelait les « droits généraux, » c'est-à-dire les grandes prérogatives féodales, comme la juridiction sur les tenanciers et vassaux de la seigneurie, les bannalités, les droits sur les foires et marchés, les péages, les coutumes, les droits honorifiques dans les églises et autres de même genre.
Le proche fief, c'était les terres ou pièces de terre que le seigneur avait distraites de son domaine, qu'il en avait aliénées à perpétuité, mais sous l'obligation perpétuelle imposée aux concessionnaires (que l'on appelait habituellement tenanciers) de servir au seigneur des rentes ou redevances déterminées en argent ou en nature, et de lui rendre des services ou corvées pour l'exploitation de son domaine. Les terres ainsi concédées, chargées de rentes ou cens, étaient le plus souvent de condition roturière ; il y avait aussi cependant quelques terres nobles chargées de rentes féodales.
L'arrière-fief, enfin, était la partie de la seigneurie que le seigneur avait aliénée en la concédant à des vassaux nobles, sous l'obligation perpétuelle de certains services réputés nobles, qui pouvaient varier, dont les principaux, les plus essentiels, étaient la prestation de la foi (serment de fidélité) et hommage au seigneur supérieur (ou suzerain), l'assistance à sa cour (qu'on appela plus tard en Bretagne le chambellenage), le service militaire, les prestations pécuniaires dites aides féodales. — Souvent un vassal, ayant reçu de son seigneur une terre dans les conditions ci-dessus, se créait à lui-même, par des concessions faites sur cette terre à diverses personnes, des tenanciers et des vassaux qui relevaient de lui directement et du seigneur supérieur indirectement ou en arrière-fief. De là le nom donné aux terres composant la troisième division de la seigneurie. — Mais comme beaucoup de fiefs nobles mouvant, c'est-à-dire, relevant directement par foi et hommage du seigneur supérieur, ne consistaient qu'en domaine et n'avaient ni tenanciers ni vassaux, c'est-à-dire point d'arrière-fief, mieux vaudrait peut-être désigner la troisième division de la seigneurie sous le nom général de mouvances nobles.
Domaine direct et droits généraux ;
Proche fief et rentes
féodales ;
Mouvances nobles et arrière-fief :
Tels sont les éléments essentiels. de toute grande seigneurie ; ils en forment, on peut le dire, les trois étages. Etant parfaitement distincts, quiconque se mêle d'histoire féodale est tenu de les distinguer, de les étager nettement, — sous peine de tout brouiller et de faire, au lieu d'histoire, du barbouillage.
Aujourd'hui, la matière historique féodale semblant être, surtout en Bretagne, en grande faveur, il était bon de rappeler ces principes, que je vais tenter d'appliquer dans la description sommaire de la seigneurie de Montauban.
I
LA SEIGNEURIE DE MONTAUBAN.
Sorte, de triangle irrégulier dont la base regardait le Nord et la pointe le
Sud, cette seigneurie s'étendait sur neuf paroisses, savoir (en allant du Nord
au Sud) :
Quédillac,
Landujan,
Irodouër,
Saint-Mervon,
La Chapelle du Lou,
Le Lou,
MONTAUBAN,
Saint-Uniac,
Boisgervili.
La seigneurie de Montauban comprenait, en domaine, proche fief ou arrière-fief, la totalité de chacune de ces paroisses ou au moins, la très grande généralité de son territoire. Toutefois la baronnie ou comté de Montfort avait des prétentions (mal fondées, je crois) sur des fiefs considérables existant dans les paroisses du Lou, de Landujan et d'Irodouër.
Domaine direct et droits généraux.
Le chef-lieu de la, seigneurie était le château de Montauban, situé à, une demi-lieue dans le N.-N.-E. de la ville du même nom, et qui semble avoir imposé son nom à la paroisse, nommée d'abord (aux XIIème et XIIIème siècles) Senteleium, en français Santelei, c'est-à-dire Saint-Éloi, qui est encore aujourd'hui le nom du patron de la paroisse.
Ce château, dans une situation très pittoresque, au bord d'un étang (le lac de Montauban), sur la lisière de la forêt du même nom, offre encore de hautes murailles et de grosses tours, beaux restes de l'architecture militaire du moyen-âge [Note : On trouvera la description du château de Montauban à la fin de ce travail dans la notice par laquelle M. Louis de Villers veut bien le compléter, et où l'on verra aussi que le nom de lac, dont la déclaration de 1681 décore l'étang qui entoure ce château, est une qualification très hyperbolique].
Le domaine direct, les droits et prérogatives du sire de Montauban étaient fort considérables ; nous ne pouvons mieux en donner idée qu'en reproduisant la description incluse dans la déclaration de la seigneurie de Montauban présentée au roi, le 26 mars 1681, par Anne de Rohan, veuve de Louis de Rohan prince de Guémené, elle-même de son chef princesse de Guémené et dame de Montauban [Note : Archives dép. de la Loire-Inférieure. — Chambre des Comptes de Nantes. Déclarations, Domaine de Rennes, vol. XIV, n° 15, f. 1 à 8 et f. 11 et 12].
(DOMAINE).
« En la paroisse de Saint-Eloy de Montauban :
Le château de Montauban, situé en la paroisse Saint Eloy ; donjon, lac, quatre douves à l'entour, boulevarts, chesnettes, première, seconde et troisième court, ponts-levis, le, tout contenant environ 6 à 7 journaux de terre.
Item une chapelle, à l'issue de la basse-court, avec ses droits de dixmes et privileges y accoustumés, pour laquelle est deub par chacune sepmaine trois messes qui se disent en l'eglise paroissiale dudit Montauban, à cause que ladite chapelle est ruinée depuis longtemps.
Item les jardins dudit lieu, contenant environ 2 journaux de terre dont le concierge a acoustumé de jouir.
Plus le coulombier, situé près la métairie du chasteau.
Davantage les métairies de la Porte (près ledit château), — du Mesnil, — de la Ville-Nicolas, — de la Hionnaie (sic), — La Grand prée de Montauban, autrement le pré de la Rivière, entre le chasteau et la ville dud. Montauban.
Item, la ville de Montauban, cohue, cep, post [Note : Post, pôt, pilier, poteau] à collier, marché ordinaire au jour de mercredi, avec la foire du jour St Martin et autre foire, quinzaine après, appellée la petite foirette ; et autres foires les jours St Michel et le mardy d'après le jour Ste Catherine, avec les coustumes deues et attribuées auxd. foires.
La justice patibulaire à quatre posts et deux estages, situé et elevée de tout temps en un emplacement appelé la Pescherie. Plus l'exercice de la jurisdiction dud. lieu au jour de mercredy et autres jours, comme les cas occurent, par les officiers de madite dame [Note : « Madite dame, » c'est-à-dire Anne de Rohan, princesse de Guémené et dame de Montauban, qui fait cette déclaration], tant de la jurisdiction de sa baronnie (de Montauban) que des officiers de sa cour des eaux, bois et forests, en son auditoire et forteresse de prisons (sic) en lad. ville, appelle led. lieu le petit Chastelet, connaissance de tous delits et punitions de tous cas, sauf les renvois et appellations.
Plus, madite dame a droit de patronage et presentation au bénéfice et cure de Montauban et au prieuré de Monstreul près la forest de Montauban (duquel droit elle n'est plus en possession), avec les chapelles de St Maurice et de Lanneloup en la paroisse dud. Montauban : ès quelles, ni en l'église de Montauban, il n'y a personne qui ait enfeu prohibitif ni chapelles, armes ni armoiries, que celles de mad, dame, si ce n'est par sa permission ou souffrance.
Plus, a droit et privilège de contraindre ses subjets et autres habitans de la Forest de les faire assister aux chasses, pour tendre raiz, les charroyer, mener et ramener à son chasteau, et faire les huées, lorsqu'il lui vient à plaisir.
Item, la forest de Montauban, qui consisté en bois de haute fustaie à l'étendue de 421 journaux de terre ou environ, et 1,800 journaux de taillis aux deux bouts de lad. haute fustaie appellés Claharel, la Grande laye de la Haie Morin, Sus Bouhal, la Saudraye, sur la Ville Durand, et Monstreul, et en general, tout le pourpris des taillis dud. lieu, avec les taillis à l'autre bout de lad. grande forest, Sur la Guiguenaie, le Pas-Botté, le Pas aux Charettes, la brosse appelle la Brosse de Callou, avec leurs lizières et chevauchées, droit de suite de bois derobé et tout privilége qui appartient à forest réformée, à l'instar de celles du Roy.
Item, la Haye dud. Montauban, botis et accens d'icelle, situé le long du grand chemin qui conduit de Montauban à Bedescq, laquelle commence à l'issue et sortie dud. Montauban et finit au Chastaignier Dreuslin.
Item, la coustume et trespas [Note : Lieu ou passage où les marchandises payaient un droit de péage] de St Eloy, dans la ville et paroise dud. Montauban, et le trespas du Pas aux Charettes.
Les moulins de Chaillou et estang d'iceux... — Les perrières de Chaillou, vallée et pasturage à l'entour de l'estang dud. Lieu — Le moulin près la ville de Montauban, au bout de la vieille chaussée vers la Maladrie, avec les estangs, reservoirs et biez d'icellui, et deux estangs pres Monstreul qui bordent la forest dud. Montauban. — Une masse de moulin à vent près l'Essart et le village de Couascurel.
Item, les landes et communs qui sont en lad. paroisse de Montauban et aux paroisses de St Uniac, le Boisgervilly, Quédillac, le Loup, la Chapelle du Loup, Yrodouër, Sct Mervon, avec les noës de Quémen ».
(DROITS GÉNÉRAUX).
« Item, mad. dame a privilège inumemorial, d'avoir un forestier en la forest (de Montauban) franc de fouage, lequel s'appelle franc forestier, avec un sergent franc de fouage en la paroisse de Montauban, qui est le sergent de la Verge noble ; autre sergent franc en la paroisse de St Uniac ; autre franc en la paroisse du Boisgervilly, autre en celle du Lou, autre en la Chapelle du Lou, autre en Yrodouer, autre en Landujan, autre en Quédillac. — Outre, celui qui est seigneur d'un bailliage appellé la Jehannaye, situé en la paroisse du Bedescq, tient de mad. dame à privilège d'avoir un sergent franc de fouage eu lad. paroissse de Bedescq, lequel bailliage appartient à escuyer Guy de la Lande sieur du Lou.
Plus, mad. dame a l'autorité et superintendance en l'assemblée de Quédillac qui est au jour de la Magdeleine, et le lendemain par ses officiers peut faire tenir sa cour, mesurer et estelonner les vaisseaux [Note : Vases servant à mesurer les grains et les liquides], et avoir les amendes sur les forfaicts, laquelle assemblée se tenoit autresfois au jour Saint-Sauveur. — Autre pareil privilège en l'assemblée de S. Uniac, qui se tient les jours et festes de S. Uniac et de S. Pierre. — Autre pareil privilège en l'assemblée et foire du Lou, aux jours S. Laurans et S. Barthelemy.
Et mad. dame a en toutes les paroisses cy-dessus déclarées droit de post armoyé de ses armes comme dame supérieure en icelles ; — a droit de ban et estanche, tout ferme droict et debvoir de rachat èsdites paroisses, de police sur toutes marchandises et de bouteillage sur tous breuvages; duquel droit de ban et estanche mad. dame n'est plus en possession.
Mad. dame a officiers en sa baronnie, comme senechal, alloué, lieutenant, procureur fiscal, greffier et autres, avec les gaiges leurs deubs et attribués ; elle a un maistre particulier des eaux bois et forests en sad. baronnie, un procureur de lad. cour des eaux et forests, — un vendeur en icelle, — un greffier qui rapporte tous exploits de lad. cour des eaux et forests.
A droit et privilege pour elle et ses subjets de ne plaider à Rennes, fors à l'endroit de sa menée, et peut retirer ses hommes en sa cour ».
Impossible de trouver un domaine plus riche, plus complet : forêts, étangs, moulins, grand château féodal, une ville entière, rien n'y manque. Et les droits seigneuriaux sont à l'avenant : justice à quatre piliers et à deux étages, juridiction des eaux et forêts, droits de foires et assemblées, de coutumes et péages, bouteillage, ban et étanche, etc., corvées pour la chasse, franchise des sergents, droits honorifiques dans les églises et armoiries dans toutes les paroisses ; bref, tout ce qui caractérise les grandes seigneuries, les vieilles baronnies de Bretagne.
Le proche fief et les mouvances féodales étaient, nous allons le voir, en rapport avec ce beau domaine et ces hautes prérogatives.
Fief proche et rentes féodales.
Le fief proche était fort considérable. La déclaration de 1681 énumère plus de 900 tenanciers payant au seigneur de Montauban des rentes féodales.
Pour la perception, ces rentes étaient réparties en plusieurs arrondissements, que l'on appelait bailliages, dans chacun desquels la recette était faite par un collecteur commissionné par le seigneur et qualifié sergent bailliager.
Dans la paroisse de Montauban, il y avait plus de 400 tenanciers astreints aux rentes féodales, répartis en cinq bailliages, savoir : bailliage de la Verge Noble, 127 tenanciers, — de Lesvran, 177, — de Treguenot, 63,— des Ferrières et de la Guiguenaie, 68, — du Pas des Haies, 18 (total, 453).
Ces rentes se payaient en argent. Les rentes en grains formaient un autre gros bailliage dit de la Greneterie, dont le rôle comprenait 240 tenanciers répandus dans les paroisses de Montauban, Irodouër, Landujan, Quédillac.
Et dans Landujan, Irodouër, le Lou et la Chapelle, la déclaration de 1681 compte encore 214 tenanciers chargés de rentes en argent. — Total, 907.
Arrière-fief et mouvances nobles.
Les seigneuries et terres nobles relevant de la baronnie de Montauban étaient fort nombreuses, entre autres (d'après la déclaration de 1681) 19 en la paroisse de Montauban, 17 en le Lou et la Chapelle, 30 en Landujan, 31 en Irodouër. Aussi nous bornerons-nous à nommer celles qui avaient juridiction et droit de justice, haute, basse ou moyenne, sur leurs vassaux et tenanciers [Note : Il y avait, on le sait, trois sortes de justices féodales : la haute justice, qui était une juridiction pleine et entière, civile et criminelle ; la moyenne et la basse, dont les droits étaient moins étendus. Nous indiquons ici ces divers genres de juridiction par les lettres H. J., — M. J., — B. J., placées après le nom de chacune des terres qui en jouissait. Pour former la liste qui suit, nous avons consulté, outre la déclaration de 1681, l'état des juridictions fourni en 1766 à l'intendant de Bretagne par le subdélégué de Montauban (Arch, d'Ille-et-Vilaine)] :
En la paroisse de Montauban.
1. — La seigneurie de la Ribaudière, haute justice, dont une partie relevait du roi en
ligence et de Montauban en juveignerie, le reste de Montauban en ligence.
2-4. — Trois terres possédant moyenne justice : l'Aunai-Thébaut, —
l'Aunai-Julienne, — la Ville-Durand.
5-8. — Quatre terres à basse-justice :
Caslou, — la Lande-Josse, — l'Essart, — Lescouët.
En Quédillac.
9. — La Heuzelais, qui avait H. J. sur une partie de ses fiefs, et M. J. seulement
sur le reste.
10. — Ranléon, H. J.
11. —
La Regnerais, B. J.
12. — La Livière, B. J.
En Landujan.
13. — Le Boishermez-Tircoq, H. J.
14. — Le Plessis-Coudrai, M. J.
15. — Pontelain,
M. J.
16. — Léauville, B. J.
En Irodouër.
17. — Le Plessis-Giffart, H.
J.
18. — Bouvet, M. J.
19. — Le Quengo, M. J.
20. — La Ville au
Sénéchal, B. J.
21. — Pont-Denieul, B. J.
En Saint-Mervon.
22. — La seigneurie de Saint-Mervon, M. J.
En la Chapelle du Lou.
23. — Le Plessix-Botherel, « qui autresfois se nommoit le Plessix-Hiette, » M. J.
Les Botherel en firent au XVIIème siècle une luxueuse habitation ; dans un numéro du Mercure galant des dernières années du XIXème siècle on lit : « Cette maison (le Plessix-Botherel) est dans l’evesché de S. Malo. Ses jardins, ses statues, ses bois, ses eaux, son orangerie, sa basse-cour, le dedans et la propreté de ses meubles la rendent une des plus agréables du pays. Le principal agrément qui s'y trouve est une grande avenue plantée de chênes, de châtaigniers, de marronniers d'Inde, qui va du château au bourg, et il y a une lieue de France ». Vers la moitié de sa longueur, cette avenue se trouvait coupée par une autre du même genre, la rencontre formant un rond-point au milieu duquel, sur un tertre gazonné, se dressait un buste de Louis XIV en bronze, porté par un piédestal haut de six pieds, dont les quatre faces présentaient des inscriptions à la louange du roi. — L'article du Mercure, avec la description de ce monument, contenait aussi un copieux éloge de la famille qui l'avait érigé. C'était assez naturel ; mais il y eut un accident. Cette famille étant alors en procès avec Jean Picquet de la Motte, greffier en chef du Parlement de Bretagne et receveur des consignations, lança contre lui un factum fort injurieux, et le greffier se donna le malin plaisir d'insérer dans sa réponse le pompeux article du Mercure, lardé de notes satiriques fort piquantes.
Le fond de la querelle pourrait bien avoir été tout simplement une rivalité entre Picquet et les Botherel sur leurs maisons de campagne ; car le factum de ceux-ci accuse le greffier de multiplier « les vexations et les injustices pour satisfaire à son luxe, élever à grands frais un superbe château dans un cloaque, pour revêtir ce palais dedans et dehors de marbre et de jaspe, y faire briller l'or partout où l'art le permet, l'orner des peintures les plus rares, y entretenir des années entières Jouguenet (sic), ce fameux peintre pensionnaire du Roi et nombre des plus savants suppôts de la première Académie de peinture de l'Europe, afin de pouvoir se vanter d'avoir fait d'un vilain lieu le séjour de la volupté et de la magnificence, — sans que les exemples de Pierre Remy, de Montagu et de tant d'autres aient pu apporter le moindre tempérament à cette maladie » [Note : C'était accuser nettement Picquet de la Motte de concussion. Car Pierre Rémy, seigneur de Montigni, et Jean Montagu, seigneur de Marcoussis, l’un et l'autre trésoriers-généraux de France, celui-ci sous Charles VII, celui-là sous Charles le Bel (de 1322 à 1328), furent tous deux condamnés à mort plus ou moins justement pour ce crime ; Rémy pendu le 25 avril 1328 (au début du règne de Philippe de Valois), Montagu décapité le 17 octobre 1409. — On peut juger par là de la violence de ce factum].
Évidemment les splendeurs du château de M. le greffier portaient ombrage à celles du Plessix-Botherel. Inde iræ !
En la paroisse du Lou.
24. « La maison du Lou, H. J., logis, estang, douves, bois, moulin, rabines, mottes, colombier, garennes, » avec cinq métairies dites de la Porte, de la Mare, de la Croix du Lou, de la Massardaie et de la Haie-Mangeart ; plus quelques fiefs et bailliages [Note : Déclaration de Montauban de 1681, f. 32]. En 1637, sur la requête de Roland de la Lande, seigneur du Lou, le roi Louis XIII unit à cette terre l'Aunai-Thébaud, situé en Montauban, la Téhelière, Trégomain en la Chapelle, et il érigea le tout en châtellenie sous le titre de châtellenie du Lou, avec droit, entre autres, d'orner cette juridiction d'une justice patibulaire à quatre piliers [Note : Arch. de la Loire-Inf. Chambre des Comptes de Nantes, Livres des Mandements, 35e coté XXXVII, f. 29].
En Saint-Uniac.
25. — La terre de Quénétain, B. J.
En Bois-Gervili.
26. — Une terre à haute justice : la Morandaie.
27-29. — Trois ayant moyenne justice : le Bois-Hamon, — le Bois-Picard, — la Ville-Olivier.
Soit une trentaine de fiefs à juridiction, et beaucoup d'autres mouvances.
Donc, sans être une seigneurie de premier ordre comme Vitré, Retz, Rohan, Porhoët, Fougères, Gaël-Montfort avant son démembrement, et quelques autres, Montauban avait tout ce qu'il faut pour faire une « grande seigneurie » et méritait tout autrement ce titre que ces petites châtellenies à la douzaine, auxquelles, à mon humble avis, on le prodigue aujourd'hui trop aisément.
II
ORIGINE DES SEIGNEURS DE MONTAUBAN.
Quand on examine, sur la carte féodale de Bretagne, la façon dont la seigneurie de Montauban se trouve enclavée entre la baronnie de Montfort et celle de Gaël, — qui sont les deux parties d'un même tout, domaine primitif de la dynastie féodale des Gaël-Montfort, — on est invinciblement porté à croire que la seigneurie de Montauban était, elle aussi, originairement une part de ce tout et en dut être détachée pour former le partage de l’un des puinés de cette maison.
Conjecture qui se change à peu près en certitude quand, dans la dotation primitive de l'abbaye de Saint Jacques de Montfort, fondée en 1152 par Guillaume Ier, baron de Gaël-Montfort, on voit ce seigneur donner aux moines de la nouvelle abbaye phisieurs terres situées in Senteleio [Note : D. Morice, Preuves, I, 614. « Dedi eis (dit le fondateur), in Senteleio, terram Orene de Curia. » Et plus bas : « Dedit Amicia uxor mea, in Senteleio, terram juxta burgum in vincis Gaufridi filii Bino et participum [et] in terra Bernerii unum quarterium frumenti. » Il est donc incontestable qu'à ce moment Montauban faisait encore partie de la baronnie de Montfort], c'est-à-dire en la paroisse de Saint-Éloi Montauban, centre et chef-lieu de la seigneurie de ce nom : preuve certaine que Montauban, à cette époque, faisait encore partie de la baronnie de Gaël-Montfort.
Conséquence forcée de ce fait : c’est que la seigneurie de Montauban fut démembrée de Gaël-Montfort seulement après 1152, et constituée à cette époque en faveur de l'un des puînés de la maison de Montfort-Gaël : d'où la conclusion inévitable que les sires de Montauban tirent leur origine des Montfort-Gaël et non des Rohan, comme on le dit d'habitude en répétant une assertion simplemente conjecturale du P. Du Paz.
Et d'ailleurs, en ce qui concerne la Généalogie des Montauban donnée par cet auteur, disons tout de suite que tout ce qu'il en dit pour les temps antérieurs au XIIIème siècle n'a aucune valeur, ne reposant (comme il l'avoue lui-même) sur aucune preuve [Note : Au début de sa généalogie des seigneurs de Montauban, Du Paz dit : « Les titres d'icelle maison ont esté perdus par l'injure du temps, bruslez et dissipez par les guerres anciennes et civiles d'entre Jean de Bretagne comte de Montfort l'Amaury et Charles de Blois, et par les François faisans la guerre en Bretagne du temps du roy Charles huictiesme du nom et du duc [de Bretagne] François second : lesquels François prindrent le chasteau de Montauban l'an 1487 et, entre autres desgasts et ruines qu'ils y firent, ils mirent les tiltres et lettres au feu, comme j'ay leu en une enqueste estant au chasteau du Bois de la Roche. » (Hist. généalog. de plusieurs maisons illustres Bretagne, p. 538-539)], résumant tout au plus quelques traditions douteuses, quelques notes écrites à l’aventure par un feudiste de la famille ; notes qui abondent, on le sait, dans tous les chartriers nobiliaires de la province, et qui ne prouvent que la grande crédulité ou la riche imagination de leurs auteurs.
Voyons donc ce que peuvent nous fournir les actes contemporains authentiques, imprimés ou inédits.
Dans le cartulaire de Saint-Melaine de Rennes existe un acte du 9 juin 1246, contenant un accord entre l'abbé de Saint-Melaine de Rennes et Olivier, seigneur de Montauban (Oliverius dominus de Monte Albano), au sujet d'une rente de six quartiers de froment, à prendre, dit Olivier, « in horreo meo de Monte Albano, ex collatione domini Oliverii de Monteforti, avi mei » c'est-à-dire « dans mon grenier seigneurial de Montauban, par suite de la donation qui en avait été faite à l'abbaye de Saint-Melaine par mon aïeul, Olivier de Moltfort. » (D. Morice, Preuves I, col. 929).
Cet Olivier de Montfort, aïeul d'Olivier sire de Montauban en 1246, était donc lui-même seigneur de Montauban et doit donc être considéré comme le puiné ou juveigneur de la maison de Montfort, en faveur duquel la terre de Montauban fut extraite de la baronnie de Gaël-Montfort et constituée en fief séparé.
Nous retrouvons cet Olivier de Montfort dans plusieurs actes de la seconde moitié du XIIème siècle :
D'abord comme témoin d'une charte du duc de. Bretagne Conan IV en faveur de l'abbaye de Bégar, charte donnée entre les années 1156 et 1171 : « Testibus... 0lliverio de Montfort » [Note : D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne I, 634. Cette charte n'est pas datée ; mais elle ne peut être postérieure à 1171, date de la mort du duc Conan IV, et de plus on trouve parmi les témoins un Étienne, évêque de Rennes, qui ne peut être qu'Étienne I, évêque de Rennes de 1156 à 1166, ou Étienne II (Étienne de Fougères), évêque de Rennes de 1168 à 1178 (Gall. Christ. XIV, 749-751), ce qui enferme l'époque de cette charte entre 1156 et 1171].
Puis, en 1180, comme témoin d'un acte par lequel Geofroi Ier, baron de Montfort, confirme et augmente les donations faites à l'abbaye de Saint-Jacques par Guillaume Ier baron de Montfort, père de ce Geofroi Ier. Or, en ce lieu, Geofroi Ier nous apprend que cet Olivier de Montfort était son oncle paternel : « Laudantibus et approbantibus (dit-il en nommant les témoins de l'acte)... OLLIVERIO PATRUO MEO. » (D. Morice, Preuves I, 822).
Enfin, un acte inédit du même temps (1163 à 1180) désigne ce même Olivier comme bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Jacques et lui donne formellement le titre de sire de Montauban : « Dominus OLIVERIUS DE MONTE ALBANO ». [Note : Bibl. Nat. mss. Blancs-Manteaux, vol. XLI, p. 420. — Cette charte n'est pas datée ; mais elle émane de Bernard, premier abbé de Saint-Jacques de Montfort en 1152, qui l'était encore en 1169, qui ne l'était plus en 1180 ; de plus, on y voit figurer comme vivant et agissant Albert, qui fut évêque de Saint-Malo de 1163 à 1184 (Gall. Christ. XIV, col. 1001-1002 et 1025), ce qui enferme l'époque de notre pièce entre 1163 et 1180].
De ce qui précède, il résulte donc ceci :
1° Lors de la fondation de l'abbaye Saint-Jacques de Montfort, en 1152, Montauban, la paroisse même de ce nom, faisait encore partie de la baronnie de Montfort-Gaël, puisque Guillaume Ier, baron de Montfort, et sa femme Amicie, disposaient librement à cette date des terres de cette paroisse comme de leur domaine ; donc Montauban ne formait pas encore une seigneurie séparée.
2° Mais vers 1180, nous voyons Olivier de Montfort, frère puîné de Guillaume Ier, porter le titre de seigneur de Montauban (dominus de Monte Albano) ; donc la seigneurie de Montauban avait dû être démembrée de Gaël-Montfort après Guillaume Ier mort en 1157, et constituée en fief séparé pour former le partage d'Olivier de Montfort, frère puiné de ce Guillaume et oncle paternel de Geofroi Ier baron de Montfort, lui-même fils et successeur du même Guillaume Ier.
Voilà donc, bien constatée, l'origine de la seigneurie et des seigneurs de Montauban, lesquels sont une branche cadette des Gaël-Montfort ou Montfort-Gaël.
Voyons maintenant si nous pourrons retrouver la suite des sires de Montauban entre Olivier Ier du nom, sire de Montauban avant 1180, et Olivier II, son descendant et son successeur en 1246.
Cet Olivier Ier eut trois fils : Raoul, Amauri, Josselin. Raoul est le seul que nous voyons dans les actes porter le nom de Montauban : ce qui prouve qu'il hérita de son père cette seigneurie et par conséquent qu'il était l’aîné, encore que dans quelques pièces le nom de ses frères soit placé avant le sien. On trouve Amauri nommé seul dans un acte antérieur à 1200; — avec son frère Raoul dans un acte de 1204 ; — en 1210 avec son fils Philippe ; — en 1215 avec ses cieux frères Josselin et R. (Raoul), et en outre avec sa femme, son fils Philippe et trois autres enfants. Dans toutes ces pièces, Amauri ne porte d'autre nom que celui de Montfort : Almaricus, Amauricius de Monteforti ; dans le titre de 1215 Raoul est dit : R. de Monte Albano [Note : Voici les textes. — (Vers 1198). « Amauri de Monteforti » est témoin à la renonciation faite par la duchesse Constance à toute prétention sur la baronnie de Vitré (D. Morice, Preuves I, 131). — 1204. « Almaricus de Monteforti et Radulfus frater ejus, » sont témoins d'une donation faite par Païen de Malestroit à l'abbaye de Marmoutier pour le prieuré de la Magdeleine de Malestroit (Ibid. 800). — 1210. « Amauricus de Monteforti, » avec l'assentiment de son fils « Philippus, » donne une mine de froment de rente annuelle au prieuré de Montreuil près Montauban, dépendant de l'abbaye de Saint-Méen (Ibid. 819). — 1215. « Ego Amauricius de Monteforti, concedente Hermina uxore mea et filiis meis Philippo, Will., A., O., dedi abbatiæ de Bona Requie etc.., testibus his : Josselino et R. DE MONTE-ALBANO, fratribus meis. » (Ibid. 829-830). — Il s'agit de l'abbaye de Bonrepos en Cornouaille, paroisse de Laniscat].
Mais ce Raoul n'eut pas d'enfants, et la série des seigneurs de Montauban se poursuivit par les enfants d'Amauri, qui, d'une femme appelée Hermine, eut quatre fils, mentionnés avec leur mère dans un acte de 1215. cité à la note précédente : les deux premiers nommés Philippe et Guillaume, les deux autres désignés seulement par leurs initiales A. et O., André et Olivier probablement.
Philippe, fils d’Amauri de Montfort, fut le troisième seigneur de Montauban ; il prend ce titre dans deux actes, l'un de 1228 à 1232, où il figure ainsi : « Domino P. (Philippo) de Montauban » [Note : Échange entre Roger de la Zouche et Alain, vicomte de Rohan, qui reçoit de La Zouche la paroisse de Plemieuc, aujourd'hui Plumieuc ou Plumieux, commune du canton de La Chéze, arrondissement de Loudéac (Côtes-du-Nord), et lui cède en retour un manoir et une terre situés en Angleterre : « Ego Rogerus de la Zuche dedi Alano vicecomiti de Rohan parochiam Plemieuc, in escambium manerii sui de Weswasseya et terræ suæ de Foleborne, tenendam et habendam sibi et heredibus suis de domino E. (Eudone) filio Comitis, » etc... His testibus : domino Bonabe de Rogé, domino P. (Philippo) de Montauban, » etc. (D. Morice, Preuves I, 783.). — Cette charte n'est pas datée. Dom Morice l'a placée immédiatement avant une charte de 1200. C'est une très mauvaise place: car D. Morice constate lui-même, dans sa généalogie des La Zouche (branche des vicomtes de Porhoët), que ce Roger vivait vers 1229 (Morice, Hist. de Bret. I, p. XXI) et ne pouvait par conséquent être contemporain d'Alain IV de Rohan, mort en 1205, mais bien d'Alain V, qui fut vicomte de Rohan de 1228 à 1232 (Ibid. p. XXIII). D'ailleurs, l'allusion faite à l'alliance de l'Alain de Rohan mentionné dans cette charte avec « Eudon fils du Comte, » c'est-à-dire fils du célèbre Eudon II de Porhoët, comte ou duc de Bretagne, — cette allusion ne peut concerner Alain IV, mais désigne au contraire Alain V, qui avait épousé Aliénor, fille d'Eudon III de Porhoët et petite-fille d'Eudon II. La date 1228-1232, assignée par nous à cette mention de Philippe sire de Montauban, est donc incontestable] l'autre de 1230, qui est un échange conclu entre lui et l'abbaye de Saint-Méen, et qui commence par ces mots : « Universis etc. Philippus de Monte Albano salutem in Domino... Ego, cum consensu Oliverii et Reginaldi filiorum meorum, dedi in excambium abbati et conventui S. Mevenni XXXVII solidos currentis monetæ in costuma mea de Sancto Eligio annuatim ». etc. (D. Morice, Preuves I, 866). Dans ce titre, ou le voit, Philippe agit nettement comme seigneur de Montauban, puisqu’il appelle ma coutume les droits levés sur les marchandises en la paroisse Saint-Éloi qui lest Montauban, et puisqu'il dispose en maître des revenus de cette coutume.
Ce Philippe avait deux fils ici mentionnés, Olivier et Renaud, Le premier nommé est evidemment Olivier II, dont on a parlé plus haut comme vivant en 1246, comme sire de Montauban en cette année même, et transigeant à cette date sur une rente de froment avec les moines de Saint-Melaine, dans un acte où il réclame pour son aïeul (avus) cet Olivier. de Montfort de 1180 qui fut le premier seigneur de Montauban (voir ci-dessus).
Voici donc comme s'établit, entre ces deux Olivier, la suite des seigneurs de Montauban :
I. — Avant 1180, OLIVIER Ier, frère puîné dé Guillaume Ier baron de Montfort-Gaël.
II. — RAOUL, fils d'Olivier, désigné en 1215 comme seigneur de Montauban ; mourut sans enfants ; eut pour successeur un neveu, fils de son frère Amauri, savoir :
III. — PHILIPPE, seigneur de Montauban, nommé dans des actes de 1230 et de 1228 à 1232, père du suivant.
IV. — OLIVIER II, seigneur de Montauban en 1246.
On verra peut-être une difficulté en ce que Olivier II qualifie, en 1246, Olivier Ier avus meus, c'est-à-dire à proprement parler « mon aïeul, » tandis qu'Olivier Ier était en réalité, d'après le tableau ci-dessus, le bisaïeul d'Olivier. Mais avus est souvent pris dans le sens générique d'ancêtre sans désignation précise du degré, surtout dans le latin flottant du moyen-âge, et Olivier II pouvait par conséquent l'appliquer tout aussi bien à son bisaïeul qu'à son aïeul. Donc cette difficulté n'est pas sérieuse, et la suite des premiers seigneurs de Montauban doit être maintenue comme nous venons de l'établir.
Pour montrer nettement en quoi elle diffère de celle qui a été
donnée par Du Paz et adoptée jusqu'ici par tous les auteurs [Note : Entre autres
par la généalogie des Montauban qui figure dans le Dictionnaire de
Moréri, édit. 1759, t. VII, p. 696], nous allons
dresser en face l'une de l'autre ces deux généalogies.
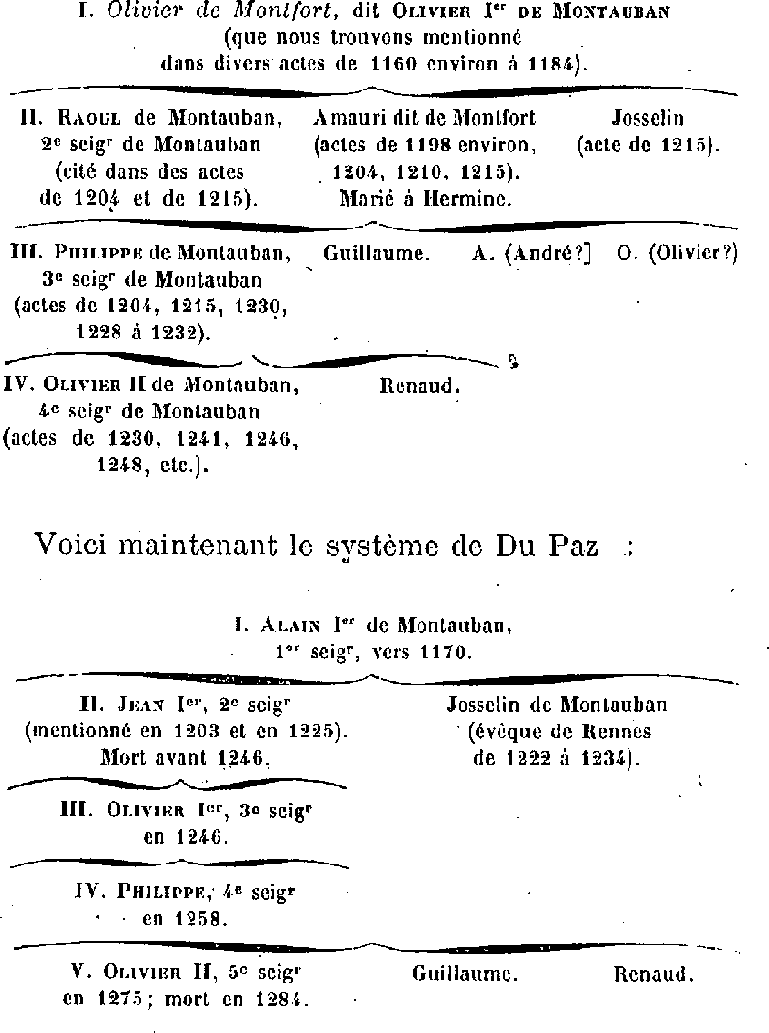
Ces deux suites généalogiques ne se ressemblent guère, et ce qui les distingue encore essentiellement, c'est que la nôtre est constamment appuyée sur des actes authentiques dont nous avons établi les dates, au lieu que celle du P. Du Paz reste en l’air sans aucune preuve, si ce n'est pour deux personnages : Jean Ier, seigneur de Montauban, et Josselin, évêque de Rennes.
Pierre Le Baud donne, une assez longue liste des seigneurs bretons venus aux Etats de Vannes, en 1203, pour s'entendre sur les moyens de venger l'odieux assassinat de leur duc Arthur de Bretagne. Dans cette liste figure « Jean sire de Montaulban » [Note : Le Baud, Histoire de Bretagne, p. 210].
En 1225, dans la charte de fondation de Saint-Aubin du Cormier par le duc Pierre de Dreux, parmi les seigneurs bretons fort nombreux qui approuvent et confirment les privilèges concédés aux habitants de la nouvelle ville, nous trouvons aussi un « Johannes de Montauban » [Note : D. Morice, Preuves I, 854].
L'existence d'un seigneur de Montauban, appelé Jean, en 1203 et en 1225, est formellement repoussée par les textes et les actes authentiques que nous avons cités plus haut.
Olivier Ier de Montauban, premier seigneur de cette terre, qui paraît entre 1156 et 1171, qu'on trouve encore dans un acte de 1184 ou environ, dut vivre jusqu'à la fin du XIIème siècle. Immédiatement après lui, avant l'an 1200, nous voyons paraître ses fils, Raoul, Amauri, Josselin, dont le premier possède la terre après son père et que nous trouvons en 1215 formellement qualifié seigneur de Montauban. Et ce Raoul, nous le savons, eut pour héritier immédiat dans sa seigneurie le fils de son frère Amauri, Philippe, que les actes nous montrent à son tour sire de Montauban en 1230, en 1228-1232, et père d'Olivier qui lui succéda, qui fut Olivier II de Montauban et qui, selon le premier acte cité par nous, gouvernait à son tour cette baronnie en l'an 1246.
Dans une succession si serrée, si bien prouvée, impossible, on le voit, d'intercaler le prétendu Jean de 1203 et de 1225. Comment expliquer la présence de ce nom dans l'Histoire de Le Baud et dans la charte de Saint-Aubin du Cormier ?
Les scribes du moyen-âge écrivaient fréquemment les noms propres, surtout les prénoms, en abrégé, ou en les exprimant par une ou deux des lettres initiales seulement. Ainsi très souvent pour Johannes on mettait Jo. ; pour Jocelinus ou Joscelinus, nom fréquent en Bretagne, Jo. aussi. Dans ces conditions, une confusion entre ces deux noms était fort aisée.
Nous n'avons plus l'original de la chronique d'où Le Baud a tiré l'histoire des Etats de Vannes de 1203, nous n'en avons même pas le texte. De même, la charte originale de Saint-Aubin du Cormier n'existait plus au XVIIème siècle, et les Bénédictins l'ont imprimée d'après une copie de 1409 [Note : D'après la pièce cotée E. E. 18 dans l'ancien Inventaire des Titres du château de Nantes (voir D. Morice, Preuves I, col. 855, ligne 3) ; or, suivaut cet Inventaire, la pièce E. E. 18 est une copie exécutée le 6 janvier 1408 vieux style]. Ces deux documents portaient sans doute : Jo. de Monte Albano, Jo. de Montauban, — mention qui se rapportait à ce Joscelin dont nous avons parlé, frère d'Amauri et de Raoul de Montauban. Mais au XVème siècle, ce prénom de Joscelin, fort en vogue aux XIIème et XIIIème siècles, était presque inconnu. Le Baud et le copiste de 1409 ne durent pas hésiter à voir dans ces deux lettres Jo. le nom de Johannes, remplaçant ainsi le Joscelin très authentique par un Jean de Montauban très fabuleux.
Alors, dira-t-on peut-être, comment rattacher à la maison de Montauban cet évêque Joscelin, à qui tous les écrivains bretons — du moins depuis Du Paz — donnent le nom de Montauban, et qui gouverna l'église de Rennes de 1222 à 1234 ?
D'abord, pour maintenir tout ce que j'ai établi sur l'origine de la dynastie féodale de Montauban, je ne suis nullement obligé d'indiquer le lien qui y rattachait ce prélat, — et de fait je ne l'y rattache pas du tout.
J'ai cherché et retrouvé, quoique inédites, à peu près toutes les pièces dans lesquelles le Gallia Christiana (XIV, 753) indique la présence du nom de cet évêque ; dans toutes, il est appelé simplemente Joscelinus Redonensis episcopus, nulle part on ne lui donne le nom de Montauban. Pour les chartes émanées de lui, cela se concevrait encore, puisque l'usage des évêques est de se désigner seulement par leur prénom ; mais dans les chroniques et les nécrologes, on donne habituellement le nom de famille, surtout quand il est noble : eh bien, pas plus là qu'ailleurs Joscelin, évêque de Rennes, n'est qualifié de Montauban [Note : Voir, pour les chroniques, D. Morice, Preuves I, 6 et 108. — Pour les nécrologes, voir Guillotin de Corson, Pouillé historique de Rennes, I, p. 64, note 2].
On a dit et répété que l'obit de cet évêque figurait à l'obituaire de l'abbaye Saint-Jacques de Montfort : dans les extraits de cet obituaire que les Bénédictins bretons nous ont conservés, on n'en trouve pas trace [Note : Voir Bl. - Mx XLI, p. 433]. Dans la salle capitulaire de ce monastère il y avait une tombe épiscopale sans inscription, qui passait pour celle de Joscelin, évêque de Rennes. Le P. Du Paz, qui avait trouvé ce nom de Joscelin dans les traditions généalogiques des Montauban, et qui, comme tous les généalogistes, était toujours en quête d'illustration pour ses clients, — ce digne Père s'avisa le premier, je pense, de donner le surnom de Montauban à l'évêque qui jusque-là s'était appelé Joscelin tout court. Ce qui le prouve, c'est que d'Argentré, qui le mentionne dans son catalogue des évêques de Rennes, le nomme simplement Josselin sans la moindre mention de Montauban [Note : D'Argentré, Hist. de Bret., édit. 1618, p. 43].
En tout cas, s'il était prouvé que cet évêque appartenait à la maison de Montauban, rien de plus aisé que de l'y rattacher au moyen d'une conjecture très plausible, qui ferait de lui, par exemple, le fils du premier Joscelin, frère d'Amauri et de Raoul de Montauban.
Enfin, ce qui reste établi par nos recherches, outre la généalogie ci-dessus des quatre premiers seigneurs de Montauban, c'est que ceux-ci sortaient de la maison de Gaël-Montfort et nullement de celle de Rohan, comme on l'a un peu partout affirmé jusqu'ici [Note : Entre autres, outre Du Paz, dans le Nobiliaire de M. de Courcy, la Biographie Bretonne, etc.].
(Arthur de la Borderie).
© Copyright - Tous droits réservés.