|
Bienvenue ! |
Les Jésuites quittent le Collège de Rennes et y sont remplacés. |
Retour page d'accueil Retour page "Ville de Rennes"
I. — Le départ des Jésuites : Le Parlement de Paris s'attaque aux Jésuites. Le Parlement de Rennes suit son exemple. Compte rendu des constitutions par La Chalotais. Arrêt du 23 décembre 1761, La Chalotais est reçu appelant comme d'abus. Inventaire et pose des scellés au collège. Deuxième compte rendu de La Chalotais. Arrêt du 27 mai 1762 et ses suites. Départ des Jésuites. Vente mobilière.
II. — Les Jésuites sont remplacés au collège : Initiative du Parlement en matière d'instruction. Avec la Faculté de Droit et le Présidial, la Communauté de ville lui adresse l'exposé de ses idées sur la réforme de l'enseignement, mais elle réclame ses anciennes prérogatives. Un arrêt de la Cour du 19 août 1762 lui en laisse une partie. Un édit royal de février 1763 les lui enlève. Le collège de Rennes cesse d'être un collège municipal. Le collège de Rennes après le départ des Jésuites.
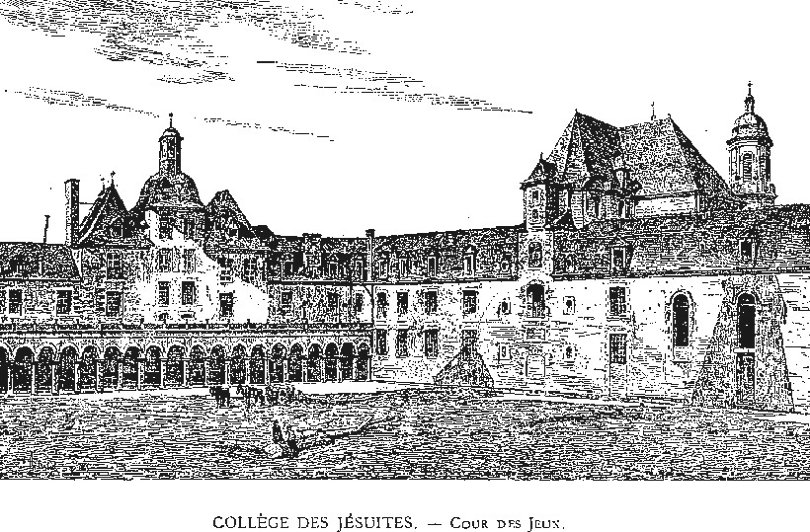
Du 18 octobre 1604 au 2 août 1762, les Jésuites travaillèrent au collège Saint-Thomas à l'éducation intellectuelle et morale de la jeunesse ; d'autres objets, tout en prenant une moindre part de leur activité, sollicitèrent aussi, à Rennes, leur zèle ; instituteurs, ils y furent également prédicateurs, confesseurs, directeurs de congrégations [Note : Les Jésuites, nous l'avons dit, avaient à Rennes une maison de retraites spirituelles qui fut fondée par le Père Jegou (Recteur du collège de 1672 à 1677). Ils y dirigeaient une congregation d'artisans et une autre congrégation, appelée « congrégation des messieurs ». (Les Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine, série D, conservent un registre de délibérations et 3 cahiers de comptes du conseil de la congrégation des artisans ; deux cahiers de comptes de la congrégation des messieurs. M. Pocquet (article de la Revue de Bretagne, 1904) croit, sans pouvoir le démontrer, qu'il y a un lien entre la congrégation des messieurs et la Compagnie du Saint-Sacrement). Les Jésuites prêchaient à Rennes. Bourdaloue y résida pendant un an (1667-1668) et y fit entendre la parole sacrée. Il donna un sermon le 18 juin 1668 pour les fêtes de la canonisation de saint François de Sales. Certains détails de ce sermon prouvent que Bourdaloue avait déjà parlé aux Rennais (Griselle, Histoire critique de la prédication de Bourdaloue, Lille 1901, t. I, p. 257. à 267). Les bourgeois de Rennes virent donc exaucé leur désir de 1606 ; les Jésuites n’avaient pas voulu s'obliger civilement à remplir des ministères sacrés, mais ils en remplirent ; le collège, toutefois, fut leur principale œuvre]. La dernière année qu'ils passèrent dans la ville fut fort troublée : ils purent prévoir la ruine de leurs œuvres, leur départ et la destruction de leur Compagnie ; au milieu de cette agitation et de ces inquiétudes, ils vaquérent cependant à tous leurs exercices habituels.
I
Les Jésuites, au nombre de 4.000 en France, en 1761, y dirigeaient 88 collèges et 32 séminaires ; ils jouissaient d'une grande influence et avaient de nombreux amis, mais ils avaient aussi des ennemis, surtout dans le parti philosophique et parlementaire si puissant sur l'opinion ; la part qu'ils avaient prise aux luttes contre le jansénisme, l'inimitié de Choiseul et de Mme de Pompadour, l'influence qu'ils possédaient (on leur en voulait d'avoir donné des confesseurs à Louis XIV et à Louis XV) avaient contribué à leur créer des adversaires. L'affaire du Père de Lavalette mit le feu aux poudres et donna au Parlement de Paris l'occasion d'étudier les constitutions de la Compagnie de Jésus. Le roi, qui ne voulait point la destruction de l'ordre, enjoignit, le 2 août 1761, au Parlement, de surseoir pendant un an et aux Jésuites, de remettre au Conseil les titres d'établissement de leurs maisons. Par une subtilité de procédure, la campagne contre les Jésuites ne tarda pas à reprendre bien avant l'expiration du terme fixé ; dès le 6 août 1761, le Parlement reçut l'appel comme d'abus du Procureur général contre les Bulles et Brefs autorisant les Jésuites en France, les proclama ennemis de l'Eglise, du Saint-Siège et des libertés gallicanes. Le 1er avril 1762, était prononcée la fermeture des collèges du ressort de la Cour et le 6 août était rendu un arrêt ordonnant l'expulsion des religieux de la Compagnie de Jésus. Les Parlements de province obéirent sans peine aux encouragements et conseils que leur donnèrent des ennemis des Jésuites et suivirent l'impulsion partie de celui de Paris ; parmi eux se comptaient de nombreux adeptes du Jansénisme.
Le Parlement de Rennes agit l'un des premiers [Note : Barth. Pocquet, Le duc d'Aiguillon et La Chalotais, t. I, p. 175 à p. 180]. Un arrêt du 14 août 1761 ordonna au supérieur des Jésuites, le Père du Pays, « de déposer dans les trois jours au Greffe un exemplaire des constitutions de la Société dite de Jésus ». Dès le lendemain, il obéit à cette injonction et remit deux volumes petit in-folio intitulés « institutum Societatis Jesu », imprimés à Prague en 1757, qui, à la suite d'un arrêt du 17 août, furent transmis au Procureur général du roi, M. de Caradeuc de la Chalotais, pour que, le 1er décembre suivant, il en donnât le compte rendu à la Cour [Note : Préambule de l'arrêt du Parlement de Bretagne du 23 décembre, 1761].
La Chalotais, qui, nous l'avons dit, était, sans doute, un ancien élève du collège de Rennes, s'était montré jusque-là assez indifférent aux luttes religieuses ; quand il se vit en présence de la nouvelle charge que lui imposait son office de procureur général, il s'effraya de la longueur du travail qu'il avait à entreprendre et eut peine à croire, dit son gendre, M. de la Fruglaye, que le roi permit jamais l'examen des constitutions des Jésuites. Quand il fut persuadé que le parti hostile à la Compagnie de Jésus était assez puissant pour que l'on pût agir contre les sentiments personnels du Souverain, il se mit à l'oeuvre et en six semaines fit son compte rendu [Note : Barth. Pocquet, op. cit., t. I, p. 181 à p. 185. Sur l'authenticité du compte rendu de La Chalotais, v. M. Pocquet, op. cit., « qui est très net sur l'affirmative » ; en sens contraire, v. M. Marion « La Bretagne et le duc d'Aiguillon » ; M. H. Carré (« Correspondance du chevalier de Fontette, Paris 1893 », introduction, p. 14) dit que La Chalotais put travailler sur des notes qu'on lui avait fournies, sans avoir vu par lui-même tous les documents qu'il cita. Le chevalier de Fontette (v. p. 159 de sa correspondance) dit que d'Alembert était l'auteur du compte rendu ; mais il est au moins possible que son opinion n'était pas établie sur des preuves solides et une sérieuse étude de la question. Si intéressant que soit le problème, nous n'avons ici qu'à le signaler].
Le mardi 1er décembre 1761, il en commença la lectura devant la Cour et la continua les 3, 4 et 5 du même mois. Œuvre systématique, claire et construite avec logique, le compte rendu de la Chalotais ne pouvait manquer de faire grande impression, surtout sur des hommes, à l'avance favorablement prévenus et qui n'avaient pas fait une étude particulière de la question ; la question, du reste, était délicate en soi : certaines institutions religieuses ou quelques-unes de leurs coutumes, risquent de n'être pas comprises suivant leur vrai sens par ceux qui ne vivent pas intensément de la foi qui les inspire et qui pourrait les expliquer ou amener à s'incliner devant elles.
L'intérêt de l'état, celui même des Jésuites, demandaient, dit la Chalotais, cet examen des constitutions : l'Etat ne peut admettre dans son sein des Sociétés sans rechercher si elles ne vont point contre les lois établies, les Jésuites ne peuvent rester sous le poids des accusations qui les assaillent de toutes parts, qu'ils s'en justifient si elles ne correspondent pas à la réalité. Entrant directement dans la question qu'il avait à traiter, le Procureur général examinait quelles étaient les lois de l'ordre des Jésuites, quelles différentes catégories de membres le composaient et, dévoilant son sentiment personnel, il déclarait que le régime du gouvernement des Jésuites était établi sur l'enthousiasme et le fanatisme qui inspiraient les deux principes suivants, base de leurs constitutions : 1° le Pape jouit d'un pouvoir absolu au spirituel et au temporel et peut priver les souverains de leur royaume ; 2° le Pape communique au Général de la Société un pouvoir absolu pour la conservation et l'accroissement du bien spirituel et temporel de l'ordre.
Et la Chalotais montrait que toutes les règles et coutumes des Jésuites étaient fondées sur ces deux maximes, aussi bien l'indépendance à l'égard de l’Etat, des ordinaires de l'Eglise, le « pouvoir despotique » « injurieux à Dieu » du Général, que la « morale versatile…, sévère ou relâchée suivant les circonstances », que les défauts de l'éducation donnée à la jeunesse.
Et, considérant cet ordre dont le régicide était, disait-il, « une doctrine ancienne et commune », ordre de 20.000 hommes, connus par leur chef, en relations étroites avec lui, très dépendants à son égard, animés d'un puissant esprit de corps, la Chalotais, en déposant ses conclusions le 7 décembre 1761, déclarait : « Je requiers pour le roi... Je requiers tant pour la sûreté de sa personne sacrée que pour le bien de l'Eglise et de l'Etat, la tranquillité publique et pour l'honneur et la manutention des lettres et des sciences qu'il me soit décerné acte de l'appel comme d'abus que j'entends interjeter de toutes les Bulles, Brefs, Lettres apostoliques, concernant la Société se disant de Jésus, constitutions d'icelle, déclarations sur lesdites constitutions, formules de vœux, décrets des Généraux ou des Congrégations générales de ladite Société et généralement de tous autres règlements et actes semblables, même des vœux et serments faits par les membres d'icelle, de se soumettre et conformer aux règles de ladite Société ».
« Qu'il me soit permis de faire intimer le Général et la Société sur ledit appel comme d'abus lors du jugement duquel seront rapportés à la Cour tous autres prétendus règlements, notamment ceux qui sont appelés « oracles de vive voix » et tout ce qui a force de loi dans ladite Société » [Note : La Chalotais dit que le régicide était « une doctrine ancienne et commune » chez les Jésuites. « Au XVIème siècle, quelques théologiens, poussant à la dernière rigueur, les déductions scolastiques, crurent pouvoir soutenir qu'il était licite, dans certains cas, de mettre à mort un tyran devenu pour son peuple un fléau et un danger... [cette théorie] fut reprise par deux Jésuites étrangers, Mariana et Busembaum, mais ils furent aussitôt condamnés par le Père Général Aquaviva, qui interdit formellement d'enseigner cette doctrine perverse... Depuis 30 ans [disait, en 1603, Henri IV, répondant aux remontrances du premier président de Harlay] qu'ils [les Jésuites] enseignent la jeunesse en France, 100.000 écoliers de toute condition sont sortis de leurs collèges, ont vécu avec eux et comme eux : qu'on en trouve un seul de ce nombre qui soutienne de leur avoir ouï tenir un tel langage ni autre approchant de ce qu'on leur reproche ». — (Barth. Pocquet, op. cit., t. I, p. 201-202). (Voir dans le premier compte rendu de La Chalotais les subtilités auxquelles il a recours pour atténuer la portée de la condamnation formulée par le Père Aquaviva). Il est intéressant de remarquer que le 12 janvier 1758 un arrêt de la Cour, à la demande des supérieurs des Jésuites de Rennes, Vannes, Quimper, Brest et Nantes, leur avait donné acte de la déclaration, par eux faite, de ne point adhérer à l'ouvrage de Busembaum, au commentaire de la Croix et d'être entièrement soumis à la déclaration de 1682 qu'ils continueraient de soutenir et d'enseigner. (Arrêt du Parlement de Bretagne, 12 janvier 1758). La Chalotais, requérant d'être reçu appelant comme d'abus, demandait encore que la théologie morale de Busembaum (édition de Cologne 1757) et le Journal clé Trévoux (août 1729) qui en faisait l'éloge fussent lacérés et brûlés par l'exécuteur de la haute Justice ; il voulait qu'on empêchât la circulation et la lecture d'autres ouvrages composés par des Jésuites, et, exposant, disait-il, la même « doctrine détestable » que Busembaum « doctrine meurtrière et abominable, non seulement contre la sûreté de la vie des citoyens, mais même contre celle de la personne sacrée des souverains ». Il insistait sur la nécessité de signer la déclaration du clergé de 1682, pour être ordonné prêtre ou pour être pourvu de bénéfices, sur l'importance d'une réforme de l'enseignement et souhaitait, enfin « par provision, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ledit appel comme d'abus, qu'il soit fait inhibitions et défenses à tous sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sous telles peines qu'il appartiendra, de s'assembler avec lesdits prêtres et autres de ladite société, en leurs maisons ou ailleurs, sous prétexte de congrégations ou associations et retraites » (Compte rendu des constitutions des Jésuites par M. Louis-René de Caradeuc de La Chalotais, Procureur général du roi au Parlement de Bretagne, les 1, 3, 4 et 5 décembre 1761, en exécution de l'arrêt de la Cour du 17 août précédent)].
Le compte rendu de la Chalotais eut un grand succès, « il est [dit Barbier] entre les mains de tout le monde, c'est le plus savant et le meilleur ouvrage qu'on ait encore fait contre eux » [les Jésuites] [Note : Journal de Barbier, 1762, t. VIII, p. 18, cité par Barth. Pocquet, op. cit., t. I, p. 204] ; il valut a son auteur les éloges de Voltaire.
Après avoir entendu La Chalotais, après avoir, les 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 18 décembre, examiné les constitutions de la Compagnie de Jésus, lu les « propositions et assertions insérées dans différens et plusieurs auteurs de la Société des soi-disant Jésuites », le Parlement ordonna « que lesdits livres seraient communiqués au Procureur général du roi, pour, sur ses conclusions, être ordonné ce qu'il apartiendroit ». En conséquence, le 22 décembre 1761, la Chalotais requit pour le roi que divers livres de Bellarmin, Beccan, Pirot, Mariana, Escobar, Horace Turcelin fusent « lacérés et brûlés en la cour du palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la haute-justice, comme séditieux, destructifs de la morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non seulement contre la sûreté de la vie des citoyens, mais même contre celle des personnes sacrées des souverains », il demanda que la circulation et la lecture en fussent interdites [Note : Conclusions jointes au premier compte rendu de la Chalotais. Voici le titre des livres auxquels s'attaquait le Procureur général : « Disputationum Roberti Bellarmini Societatis Jesu, de controversiis christianæ fidei adversus hujus temporis hæreticos ». — « Tractatus de potestate papæ in rebus temporalibus libri de romano pontifice ». — « De translatione imperii romani, Mediolani 1721, superiorum permissu ». — « Martini Beccani, Societatis, de jure et justitia, Parisiis 1658 ». — Apologie pour les casuistes attribuée à Edmond Pirot, Paris 1657. — Joannis Mariana, Societatis Jesu, de rege et regis institutione, Moguntiæ 1605. — Liber theologiæ moralis, viginti quatuor Societatis. Jesu doctoribus reseratus, quem R. P. Antonius de Escobard et Mendoza, Vallisoletanus in examen confessariorum digessit, addidit, illustravit, Lugduni 1659. — Historiæ sacræ et profanæ epitome, ab Horatio Turcellino, Rothomagi 1714 et Rhedonis 1732. — Francisci Toleti, Societatis Jesu, instructio sacerdotum, Rothomagi 1628].
Le 23 décembre 1761, le Parlement de Bretagne rendit son arrêt ; M. de la Briffe d'Amilly, premier président, occupait le fauteuil, assisté de René le Prestre, Gabriel de Boisgelin, Jacques le Prestre, Annibal de Farcy, présidents à mortier, Claude de Guerry était rapporteur. La Chalotais était reçu appelant d'abus et les parties auraient sur cet appel « audience au premier jour ; lors du jugement duquel appel comme d'abus, seront raportés à la Cour tous édits, déclarations et lettres patentes, duement vérifiées en icelle, concernant ladite Société pour être sur le tout conjointement statué et ordonné ce qu'il apartiendra ». En attendant qu'il fût statué sur l'appel comme d'abus, défense était faite à tout sujet du roi et à tout étranger d'entrer chez les Jésuites ; à partir du 2 août 1762, sous peine de saisie du temporel, il était interdit aux membres de la Compagnie de Jésus de continuer à donner des leçons publiques dans les collèges, écoles ou séminaires du ressort de la Cour ; le cas était prévu ou des jeunes gens seraient envoyés dans des collèges de la Compagnie, situés hors du ressort de la Cour et il était déclaré que, sous peine de poursuites, de ne pouvoir prendre les degrés universitaires, d'être jugé incapable de toutes charges civiles ou municipales, offices ou fonctions publiques, on ne devrait pas recourir à ce moyen d'être instruit par des Jésuites [Note : Arrêt du Parlement de Bretagne, 23 décembre 1761. — Les ouvrages des Jésuites contre lesquels La Chalotais avait requis devaient être lacérés et brûlés ; la lecture et la vente en seraient interdites. La Cour « désirant pourvoir suffisamment à l'éducation de la jeunesse » ordonnait aux maires et échevins des villes, aux officiers des sénéchaussées et sièges royaux, aux membres de l'Université, d'envoyer dans trois mois au Procureur du roi des « mémoires contenant ce qu'ils estimeraient convenable à ce sujet »].
Le Parlement ordonna de signifier sans délai cet arrêt aux Jésuites de Rennes et « dans quinzaine au plus tard » aux autres maisons de la Compagnie de Jésus situées dans le ressort de la Cour. Le 2 janvier 1762, Mathurin-Julien Bouchard, huissier, notifia l'arrêt au Père du Pays, supérieur du collège et, le même jour, en adressa copie au Général des Jésuites avec ordre de comparaître deux mois plus tard [Note : Arrêts du 23 décembre 1761 et du 27 mai 1762].
Les Jésuites ne crurent pas devoir se présenter en justice. Pour toute défense, quelques brochures furent lancées, entre autres, celle du Père Griffet « Remarques sur le réquisitoire de M. de la Chalotais », solide et alerte et une autre qui lui fut attribuée : « Mémoire concernant l'Institut, la doctrine et l'établissement des Jésuites en France » [Note : B. Pocquet, op. cit., pp. 206-207 « Remarques sur le réquisitoire de M. de La Chalotais » ; « Mémoire concernant l'Institut... ». Le Parlement de Rennes sur dénonciation violente de l'avocat général du Parc Porée ordonna (arrêt du 27 avril 1762) de brûler la brochure du Père Griffet. comme injurieuse à la magistrature et contraire à l'ordre public].
La Chalotais, quand fut expiré le terme au-delà duquel les Jésuites ne pouvaient plus venir en justice « prit défaut au greffe » ; il lui en fut délivré acte le 7 avril 1762 [Note : Compte rendu de mai 1762]. Le 27 avril, Claude de Guerry, chevalier, seigneur du Boishamon, conseiller doyen du Parlement de Bretagne, accompagné du greffier le Clavier, et des huissiers le Bel, Pottier, Barbier, se présenta au collège ; il se trouva, dans la première salle, en face du Père Recteur, du Procureur et de quelques autres religieux auxquels il fit décliner leurs noms et prénoms, puis il réclama les registres de recettes et dépenses, exigea qu'on lui fit connaître le revenu annuel des immeubles, le passif et l'actif du collège. Il voulut aussi être mis au courant des biens des diverses congrégations établies chez les Jésuites (celle des écoliers, celle des messieurs, celle des artisans) et de ce que possédait la maison de la retraite. Jean-François le Meur, syndic et procureur du roi à la ville et communauté de Rennes, le doyen des échevins le Masson des Longrais étaient présents ; sur leur demande, acte leur fut donné de leur comparution pour la défense des droits de la Communauté et ils reçurent promesse qu'on les appellerait à l'inventaire des meubles.
Ce n'est pas sans inquiétude, on peut le résumer, qu'ils voyaient la Cour mettre la main sur l'établissement qu'ils avaient fondé, qu'ils entretenaient depuis de longues années et qui leur avait coûté des sommes considérables. Le lendemain 28, le Père le Petit, Procureur, remit à M. de Guerry l'état des recettes et dépenses annuelles du collèges, l'état des dettes actives et passives (voir en Annexe) ; le total des recettes était de 18.140 livres 3 sols 8 deniers, celui des charges se montait à 5.109 livres 4 sols 4 deniers ; le collège devait 2.394 livres 9 sols ; il lui était dû 2.959 livres 1 sol.
On commença ensuite, le jour même, de vaquer à l'inventaire des meubles de l'établissement et d'apposer les scellés pour continuer les 28, 29, 30 avril, 3, 4 et 5 mai. A chacun des religieux, sur sa demande, on délivra une aube, un amict, un purificatoire. Le 4 mai, le Doyen des échevins, le Masson des Longrais, avait fait remarquer que les meubles du collège représentaient ceux qu'avait fournis la ville en 1606 et s'était opposé à ce qu'aucun d'eux fût enlevé de la maison ; sur sa réclamation d'être mis en possession de divers objets figurant à l'inventaire pour les employer à « l'utillité dudit collège », M. de Guerry ordonna de lui reconnaître « treize chambres garnies les plus propres et les plus commodes », divers vases sacrés, ornements d'église, livres, instruments d'étude, le cabinet de physique [Note : B. 66, Procès-verbal de l'inventaire. — François Vatar, imprimeur du roi et du Parlement, fit l'inventaire de la bibliothèque ; elle contenait de nombreux ouvrages de piété, de théologie, d'histoire sacrée et profane (Catalogue de la bibliothèque du collège B. 66, Procès-verbal de l'inventaire. — François Vatar, imprimeur du roi et du Parlement, fit l'inventaire de la bibliothèque ; elle contenait de nombreux ouvrages de piété, de théologie, d'histoire sacrée et profane (Catalogue de la bibliothèque du collège de Rennes). L'inventaire se fit à la maison de Bellevue, le 10 mai 1762. Les opérations furent conduites avec rigueur ; écoutons le procès-verbal : « Interpellé le dit frère Petit de nous déclarer précisément et positivement si. c'est tout ce qu'il a à dire touchant le gouvernement et la manutention qu'il a eu des affaires de la maison et s'il n'a point connaissance qu'il ait été déposé, enlevé, vendu et recélé des objets de toute espèce et si à sa connaissance tout a été exactement déclaré, s'il n'a point de lieu de dépôt en ladite maison ou autres lieux où il puisse y avoir soit titres, livres, papiers, registres, journaux, actes... argent et argenterie et autres effets appartenans aux dittes maisons, retraites, collège et congrégation et de déclarer quelle somme il a actuellement entre mains ou peut avoir pour le restant de cette année. A été dit par ledit frère Petit que tous les titres, actes et papiers concernant son administration temporelle sont tous dans sa chambre sous le scellé, qu'il n'en a recélé aucun, qu'il n'a aucune connaissance qu'il ait été détourné aucuns effets... apartenant aux dites maisons... et a déclaré avoir actuellement en caisse environ 2.000 livres laquelle ditte somme lui est restée entre les mains pour frayer aux dépenses de la ditte maison... Et mandé le frère du Pays recteur, et entré, et après lui avoir donné lecture des interpellations faites au frère Petit cy-dessus, a déclaré qu'il ne connoist autres biens apartenant à la date maison, collège, que ce qu'a déclaré le frère Petit, procureur, et quant à la retraite il ne connaît que ce qu'il en a déclaré lui-même... et qu'il assure que depuis l'arrest il n'a disposé ni n'a été disposé de rien a sa connaissance ; mais qu'avant l'arrest, il a disposé en faveur de quelques-uns de la maison de quelques livres pour leur usage dans le cas de la dispersion. Interpellé le dit frère du Pays de nous nommer, les frères à qui il a donné les livres dont il vient de parler et de spécifier lesdits livres, a dit ne pouvoir spécifier, les livres, qu'il en a donné au frère Moellien, aux Régents des basses classes, au frère Blondel, père spirituel »].
Le 10 mai 1762, un arrêt du Parlement nommait René l'Hermite économe-séquestre « pour la régie et administration des biens des soi-disans Jésuites situés dans la ville et fauxbourgs de Rennes » ; au cas où les personnes qui avaient à acquitter des rentes viendraient à offrir un remboursement de capital, l'économe séquestre devrait se faire autoriser par le Parlement pour le recevoir [Note : Arrêt du Parlement de Bretagne du 10 mai 1762]. La ville dut être fort sensible à ces mesures, elle se voyait enlever la possession d'anciens droits.
Pendant que s'exécutaient ces diverses opérations, La Chalotais préparait le compte rendu sur l'appel comme d'abus qu'il lut à la Cour les 21, 22, 24 mai 1762. « Puisque [dit-il] des raisons que je ne cherche point à pénétrer éloignent le Général et la Société de comparaître au jugement, le ministère public doit suppléer à leur défaut... il est le défenseur né de ceux qui n'en ont point et lors même qu'il est forcé de conclure à leur condamnation, ses conclusions comme celles des particuliers doivent être justes et duement vérifiées... ». Après avoir exposé les griefs les plus communs contre les Jésuites (le reproche qu'on leur faisait d'une morale « arbitraire et pernicieuse », de leur ambition pour l'accroissement de la Compagnie de Jésus), il montrait avec véhémence les abus de l'Institut : le « pouvoir despotique » du Général, l'uniformité des sentiments prescrite à tous les membres de l'ordre, «, les vœux illégitimes d'obéissance à une puissance étrangère pour rester dans les Etats du roi ou pour en sortir sans sa permission ».
Aussi, ajoutait-il, « répétant ce que j'ai dit dans mon premier rapport, puisque la Société s'annonce comme irréformable, on doit la dissoudre. Il est impossible que les Jésuites en France soient citoyens et bons français ». Le Procureur général se refusait à voir livrés au besoin « des hommes qui ont consumé leurs jeunes années dans des travaux pénibles » et il demandait « qu'en dissolvant le régime on assurât aux particuliers, clercs, étudiants et prêtres au-dessus de l'âge de 33 jusqu'à 50 ans une pension congrue, viagère de 500 livres, une de 600 livres à ceux qui ont passé 50 ans, de 700 livres à ceux qui ont passé 60 ans ». Toutefois, pour obtenir ces pensions, les Jésuites seraient tenus « de présenter leurs requêtes à la Cour, d'y attacher les pièces nécessaires et d'y déclarer leur adhésion aux quatre propositions de l'Assemblée du clergé de France de 1682 et aux libertés de l'Eglise gallicane, et leur renoncement à toute opinion contraire à la saine morale et aux maximes de France, et notamment sur l'indépendance des rois de quelque personne ecclésiastique que ce soit et l'inviolabilité de sa personne sacrée » [Note : Compte rendu sur l'appel comme d'abus. La Chalotais désirait que la Cour, en accord avec l'évêque de Rennes, prit des mesures pour que le service sacré de la paroisse Saint-Germain se fit à l'église des Jésuites. Cette église, disait-il, était trop grande pour le collège ; les deux chapelles latérales suffisaient et, d'autre part, l'église Saint-Germain, étayée depuis plus de 30 ans, menaçait ruine].
« On attendait avec anxiété le prononcé de l'arrêt définitif qui allait fixer le sort des Jésuites. Aucun autre n'avait encore été rendu en France ; après le retentissant succès qu'avait obtenu le réquisitoire, l'arrêt de Bretagne devait évidemment faire loi et décider de l'avenir de la Compagnie. Il n'était guère douteux » [Note : Barth. Pocquet, op. cit., t. I, p. 209]. La Cour, après avoir délibéré les 24, 25 et 26 mai 1762, se réunit le jeudi 27 à trois heures, en audience solennelle, toutes chambres assemblées et déclara qu'il y avait abus dans les constitutions des Jésuites, dans tous les actes et règlements concernant la Compagnie de Jésus, dans les bulles, lettres apostoliques, brefs donnés à son sujet, dit que « la règle et régime contenus au recueil de leurs constitutions [étaient] injurieux à la majesté divine, en transférant à un homme l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul, en égalant les ordres d'un supérieur aux préceptes de Dieu et de Jésus-Christ, et exigeant le même sacrifice de sa raison et de son jugement, injurieux à la majesté souveraine des rois, attentatoire à leurs personnes sacrées et à leurs autorités, injurieux à l'Eglise, aux Conciles, aux Papes aux Evêques, au second ordre de l'Eglise et à tous les corps de l’Etat, destructifs de la liberté naturelle des esprits et des consciences, contraires au droit naturel et au droit divin, au droit des gens et à celui de toutes les nations, au bien et à la paix des Etats, à la sûreté des contrats et des conventions des particuliers ».
En conséquence, la Société de Jésus était dissoute dans le ressort du Parlement de Bretagne ; au 2 août, toutes les maisons en devaient être fermées ; les anciens membres de la Compagnie ne pourraient « se réunir en société entr'eux » ni correspondre avec le Père Général ; ils ne seraient admis à la jouissance d'aucun bénéfice, à l'occupation d'aucune fonction ou emploi avant d'avoir fait serment « par devant le Juge royal des lieux d'être inviolablement fidèle au roi, de tenir et enseigner les quatre propositions de l'Assemblée du clergé de France en 1682 et les libertés de l'Eglise gallicane, d'abjurer le régime et l'enseignement de ladite Société, de détester et combattre en tous temps et en touttes occasions la morale pernicieuse contenue dans le recueil des assertions [émises par des Jésuites] imprimées de l'ordre du Parlement séant à Paris ». Il appartenait à M. de Guerry, conseiller, de dresser « un état exact de tous les prêtres, écoliers et autres qui sont dans chacune desdites maisons de la Société situées dans le ressort de la Cour » [Note : « Dans lesquels procès-verbaux [ajoute l'arrêt du 27 mai] seront insérés leurs noms, surnoms, lieux de naissance, tems de leur, entrée dans ladite Société, nature des vœux par eux faits, maisons ou provinces où lesdits vœux ont été faits, fonctions et grades qu'ils remplissent dans lesdites maisons et depuis quel temps ils y sont, distinction des profès de trois ou de quatre vœux... ordonne ladite Cour que les deux volumes apartés au Greffe de la Cour le 15 août dernier par le frère du Pays... demeureront au Greffe de la Cour pour servir de titres et monumens perpétuels des vices dudit Institut, fait défenses au greffier et à ses commis de les communiquer à qui que ce soit sans une ordonnance de la Cour ». (Arrest du Parlement de Bretagne qui juge l'appel comme d'abus, interjetté par M. le Procureur général du roi des brefs, bulles, constitutions... concernant les soi-disant Jésuites, 27 mai 1762) Le registre secret ne porte que 33 membres, présents à l'audience où fut rendu l'arrêt ; le Parlement comprenait alors 18 présidents et 94 conseillers. « Quand j'ai signé l'arrêt [écrivit le président d'Amilly au duc d'Aiguillon] j'ai cru rêver, je ne pouvais me persuader qu'une Société aussi puissante et même si redoutable eût pu être détruite légalement, après bien des délais, enfin anéantie comm e une confrérie d'artisans ». (Arch. du Min. de la Justice, d'Amilly à d'Aiguillon, 30 mai 1762, cité par B. Pocquet, op. cit., t. I, p. 213)].
Le 2 juin, notification fut faite de cet arrêt au Père du Pays, Recteur du collège ; le même jour, il était signifié au Général de la Compagnie de Jésus [Note : B. 66, procès-verbaux de notification]. Le 18, en exécution d'une des clauses de l'arrêt, M. de Marnière de Guer, conseiller commis par le Parlement, assisté de M. Gault substitut, du greffier le Clavier de la Pajotière et des deux huissiers, Bouvier et Pottier, se transporta au collège, fit sommation au Recteur de « représenter les registres justifiant le nombre de tous les prêtres, écoliers et aultres qui sont dans laditte maison » ; il prit le nom, l'âge, la date de profession de chaque Jésuite. Quinze profès des quatre vœux et six coadjuteurs temporels furent ainsi inscrits sur sa liste : les Pères du Pays recteur, de Langle de la Boullais, ministre du collège et régent de théologie morale, de Kersaintgily, deuxième confesseur de la maison, le Pape de Kerminy, premier directeur de la retraite des hommes, Blondel, premier confesseur de la maison, de Moëllien, directeur de la Congrégation des Messieurs, de l'Abbaye, préfet des hautes études et directeur de la Congrégation des écoliers, de Carheil, régent de théologie scolastique, Duchet, second directeur de la retraite des hommes, Billardon, régent de théologie scolastique, de Marolles, prédicateur du collège, le Petit, procureur du collège, le Forestier, préfet des classes et directeur de la Congrégation des artisans, de Gramusse, troisième directeur de la retraite des hommes, Picard, régent de physique, les frères Gautrin, Dubois, Guillaumette, Charlet, Plumetot et Livorel (ces deux derniers résidaient à Livré) [Note : B. 66, Procès-verbal de la descente au collège de M. de Marnière de Guer. — Chaque Père et chacun des frères qui étaient présents fit lui-même sa déclaration, l'affirma véridique et la signa. Voici les points essentiels des déclarations des Pères : 1° Pierre-Louis du Pays, né à Gourin, 70 ans depuis le 20 février dernier ; entré dans la Compagnie le 1er octobre 1707 — profes des quatre vœux — réside au collège de Rennes depuis le 15 janvier 1747, supérieur depuis le 1er décembre 1760. 2° Louis-Xavier de Langle de la Boullais, né à Auray, le 12 février 1712, entré dans la Compagnie le 4 octobre 1731, profès dès quatre vœux, réside au collège depuis 1755 et, depuis cette époque, y est ministre et régent de théologie morale. 3° Xavier de Kersaintgily, né à Morlaix, le premier décembre 1687, entré dans la Compagnie le 3 septembre 1699, profès des quatre vœux, second confesseur de la maison depuis 1760, y reside depuis 1730. 4° Bernard le Pape de Kerminy, né à Hélian, le 4 avril 1688, entré dans la Compagnie le 14 septembre 1705, profès des quatre vœux, premier directeur de la retraite des hommes. « réside depuis 14 à 15 ans dans la maison à ce qu'il croit ». 5° Onuphre Blondel, né à Arras, le 13 janvier 1706, entré dans la Compagnie le 13 sept ombre 1723, profès des quatre vœux, premier confesseur de la maison, y réside depuis le mois de janvier 1761. 6° Gabriel-François de Salle Corentin de Moëllien, né à Moëllien, paroisse de Plounévé-Porzay, le 27 février 1706, entré dans la Compagnie le 19 novembre 1722, profès des quatre vœux, directeur de la Congrégation des Messieurs, réside dans la maison depuis mai 1753. 7° François Olivier de l'Abbaye, né à Châteauneuf-du-Faou, le 4 octobre 1704, entré dans la Compagnie le 19 février 1727, profès des quatre vœux, réside au collège depuis octobre 1747, y est préfet des hautes-études et directeur de la Congrégation des écoliers. 8° Jacques-Marie de Carheil, né à Carentoir, le 24 février 1702, entré dans la Compagnie le 13 octobre 1724, profès des quatre vœux, régent de théologie scolastique, réside au collège depuis 1757. 9° François-Xavier Duchet, né à Saint-Amand, le 29 juillet 1709, entré dans la Compagnie le 13 septembre 1727, profès des quatre vœux, second directeur de la retraite des hommes, réside dans la maison depuis 1749. 10° Gilles-François Billardon, né à Vignol (évêché d'Autun), le 24 février 1708, entré dans la Compagnie le 1er octobre 1725 profès des quatre vœux, régent de théologie scolastique, réside au collège depuis 1759. 11° Claude-François de Marolles, né le 23 avril 1712, profès des quatre vœux, entré dans la Compagnie le 2 décembre 1726, prédicateur du collège, y réside depuis le 17 octobre 1761. 12° Jean le Petit, né à Saint-Bénigne, paroisse dudit nom, évêché de Bayeux, 25 mars 1710, entré dans la Compagnie le 14 janvier 1731, profès des quatre vœux, procureur du collège depuis juin 1757, y réside depuis 1753. 13° François le Forestier, né le 30 mars 1716, à Pontivy, entré dans la Compagnie le 26 août 1735, préfet des classes et directeur de la Congrégation des artisans, réside à Rennes depuis 1754, profes des quatre vœux. 14° Augustin-Paul Martin de Gramusse, né à Loudéac, le 17 octobre 1715, entré dans la Compagnie le 2 octobre 1736, profès des quatre vœux, troisième directeur de la retraite, réside au collège depuis 1755. 15° Antoine-Joseph Picard, né à Hesdin, le 29 novembre 1726, entré dans la Compagnie le 14 septembre 1743, profès des quatre vœux, régent de physique, réside au collège depuis le 10 octobre 1760].
Un état du personnel du collège, remis le 4 mai 1762 à M. de Guerry par le Père du Pays, nous permet d'ajouter à ces noms ceux du Père Fleury, régent de logique et du Père Moutié, régent de rhétorique (tous les deux prêtres, mais non encore profès), des Mes Berrey, régent de seconde, Rannou, régent de troisième, Cuissot, régent de quatrième, Geffrier, régent de cinquième, Bernard, régent de sixième [Note : B. 66. Noms des personnes qui composaient le collège de Rennes le 25 avril 1762. Les indications que contient ce document nous permettent de donner l'état du personnel en juin 1762. Cinq domestiques venaient en aide aux frères coadjuteurs : Julien, portier ; Joseph, garçon de basse-cour ; Antoine, garçon de la couturerie ; Pierre, jardinier ; Toussaint, garçon de la retraite ; « de plus, il y a un petit écolier qui sert à la sacristie, à qui l'on donne des gages, quoiqu'il ne soit ni logé, ni ordinairement nourri dans la maison; il en est de même du porteur d'eau. »].
Le 23 juillet 1762, Louis Florand des Nos, chevalier, seigneur des Fossés, conseiller en la Cour de Parlement de Bretagne, procéda, en vertu d'un arrêt du 23 juin, au levé des scellés; il remit les clefs et les pièces concernant les biens du collège à l'économe-séquestre, René l'Hermite [Note : B. 66. Procès-verbal de la descente au collège de M. des Nos. 23 juillet 1762]. L'heure du départ approchait pour les Jésuites ; la veille même avait eu lieu leur distribution de prix qu'avait fixée à cette date un arrêt du Parlement du 19 juillet ; le 2 août, obéissant à l'ordre de la Cour, ils quittèrent le collège où 158 ans auparavant leur Compagnie avait été appelée par les bourgeois de Rennes. En cette dernière journée, les Jésuites, pour leur dire adieu, réunirent solennellement leurs élèves ; le Père Duchet célébra à onze heures une messe à laquelle tous les Pères assistèrent en surplis ; quand elle fut achevée, le célébrant ouvrit le tabernacle, emporta le ciboire, laissant le tabernacle vide, puis il éteignit la lampe du sanctuaire et sortit, suivi de tous les Pères et accompagné de beaucoup d'élèves [Note : B. Pocquet, op. cit., pp. 212-213. Ogée et Marteville, Rennes ancien, Rennes moderne, t. I, p. 239. Ducrest de Villeneuve, Histoire de Rennes (pp. 369-370-371). A ces adieux des Jésuites, la haine, dit Ducrest de Villeneuve « mêla sans doute beaucoup d'aigreur ; ils cherchèrent à exalter les jeunes têtes qui leur étaient confiées [le grand-père de l'auteur se serait trouvé parmi les jeunes auditeurs d'alors et lui aurait transmis ces détails]. Ils menacèrent leurs ennemis et surtout le Procureur général. Il va sans dire que les proscrits n'épargnèrent pas les prédictions, dont ils rendirent le ciel garant et qu'ils jurèrent à leurs auditeurs d'être immortels... La population prit sans doute une part très active à tous ces débats. Sollicitée par les bons Pères, elle brûla en effigie dans les carrefours le Procureur général, et le chansonna à sa manière sur tous les tons. Les libelles se succédèrent et passaient des mains avides du public dans celles du bourreau, qui en faisait autant d'auto-da-fé au pied du grand escalier. — Des assemblées nocturnes, des menaces, des calomnies entretenaient l'effervescence, qu'on eût bien voulu voir changer en guerre civile ». Par un arrêt du 21 juillet 1762, le Parlement avait ordonné de délivrer incessamment « à chacun des prêtres et écoliers des ci-devant se disans Jésuites qui ont atteint l'âge de 33 ans, la somme de 400 livres pour vestiaire, 200 livres de secours et 20 sols par livre pour se rendre au lieu de leur naissance, et aux coadjuteurs temporels ayant atteint ledit âge de 33 ans la somme de 150 livres pour vestiaire, de 100 livres pour secours et 10 sols par lieue pour se rendre au lieur de leur naissance »].
Le 4 août, date fixée par un arrêt du Parlement du 21 juillet 1762, Jean-Marie le Clavier, écuyer, sieur de la Pajottière, conseiller du roi, greffier en chef, en présence de Pierre Michel Gault, substitut du Procureur général du roi, de René l'Hermite, économe séquestre et de Jean-François le Barbier, huissier, commença de vaquer dans la cour du collège à la vente des meubles qui « fut bannie et affichée aux carfours et places publiques » et qu'un « inventaire et prisage » fait en juillet avait préparée [Note : B. 66. Procès-verbal de l'inventaire et procès-verbal de la vente. — A l'inventaire, s'était encore présenté Guillaume le Masson des Longrais, doyen des échevins, pour veiller à la conservation des droits de la ville, fondatrice du collège. Il requérait qu'aucun des meubles ne fût vendu, qu'au cas où ils le seraient, le produit de la vente vint accroître le revenu du collège. Le substitut du Procureur du roi, Julien Jousselin, consentit qu’il « fut donné acte audit le Masson de ses dire et raisons pour servir ainsi qu'il sera vu apartenir ». Jamais les fondateurs n'avaient été si peu maîtres à leur collège]. Cette vente dura jusqu'au 18 septembre, le produit brut se monta à 29.534 livres 4 sols 6 deniers, le produit net à 28.627 livres 13 sols 6 deniers [Note : B. 66. Procès-verbal de la vente. — Dans cette somme était compris le produit de la vente des meubles du collège, de ceux de la maison de Bellevue et de la maison de la retraite, de ce qui appartenait aux diverses congrégations établies chez les Jésuites. La bibliothèque, estimée 3.473 livres, fut vendue plus tard. Le comte de la Garlaye eut l'idée d'acheter l'argenterie d'église (qui pesait 453 marcs et avait été estimée 21.957 livres) pour la rendre plus tard aux Jésuites s'ils étaient rétablis. Dans ce but, il avança 20.000 livres à l'Evêque de Rennes pour que celui-ci fit l'acquisition en son nom. L'argenterie fut achetée et déposée au Séminaire de Rennes (B. Pocquet, op. cit., t. I, p. 227). — Arch. mun., liasse 287 « état de l'argenterie remise à Mgr l'Evêque de Rennes le 11 août 1762 ». Quittance de René l'Hermite].
Deux mois plus tard, le 26 octobre 1762, aux Etats de Bretagne, réunis depuis le 1er septembre, quelques députés de la noblesse, particulièrement MM. de Coëtanscours et de Pontual, proposèrent de demander au roi le rétablissement des Jésuites dans les collèges de la province ; le clergé adhéra à cette proposition, le tiers s'y montra hostile, les membres de la noblesse se divisèrent entre les deux opinions ; la séance, ainsi que celle du lendemain, fut orageuse ; politiquement, et dans un esprit de stricte nentralité (La Chalotais le reconnut au cours de son procès) le duc d'Aiguillon ramena le calme, arrêta, sur un sujet brûlant, une discussion qui n'avait aucune chance d'amener le retour des Jésuites et n'aurait servi, fit-il observer, qu'à entraîner des difficultés entre les Etats et le Parlement [Note : M. Marion, la Bretagne et le duc d'Aiguillon, p. 181 et suiv. B. Pocquet, op. cit., t. I, p. 249 et suiv. Le Parlement de Bretagne et le pouvoir royal au XVIIIème siècle, A. Le Moy, Angers 1909. Dictionnaire de l'administration de Bretagne, t. II, f° 124v° f° 125].
Deux ans avant que le roi, malgré ses répugnances, eût interdit la Compagnie de Jésus en France, le collège de Rennes était fermé aux Jésuites sans espoir de retour [Note : Dès le lendemain de la clôture des Etats, le 27 novembre 1762, le Parlement rendit un nouvel arrêt par lequel il défendait « de solliciter ou demander en aucune occasion le rétablissement de la Société de Jésus, à peine de poursuites » ; il y dénonçait les assemblées qu'avec des amis tenaient dans la ville « plus de 50 de ces clercs dissous qui décriaient les Cours souveraines du royaume ». (Arrêt du Parlement de Bretagne du 27 novembre 1762). Des Jésuites demeurèrent à Rennes pendant plusieurs années après la dissolution de l'ordre. (B. 65). Dans le cours de son procès, La Chalotais (ainsi que son parti) affirma qu'il était victime d'une conspiration de religieux de la Compagnie de Jésus acharnés à se venger. (Sur cette affaire, v. la correspondance du chevalier de Fontette publiée par H. Carré et aux pièces annexes, p. 518, le « tableau des assemblées fréquentes des Jésuites et leurs affiliés à Rennes ». L'introduction mise à cette correspondance par M. Carré donne des détails intéressants sur cette affaire et raconte par quel concours d'incidents bizarres, fruits, en grande partie, de l'imagination et du bavardage de quelques personnes, le directeur de l'Hôpital Saint-Méen, Clémenceau, qui avait, été membre de la Compagnie de Jésus jusqu'en 1740, fut accusé d'avoir cherché à empoisonner La Chalotais)].
II
La Chalotais, dès son premier compte rendu, n'avait pas ménagé les critiques à l'éducation que donnaient les Jésuites ; le Parlement, à sa suite, appela une réforme de l'enseignement et, par, son arrêt du 23 décembre 1761, ordonna que « dans trois mois..., les maires et échevins des villes du ressort de la Cour, comme aussi les officiers des sénéchaussées et sièges royaux, ensemble les membres de l'Université seront tenus d'envoyer au Procureur général du roi... mémoires contenant ce qu'ils estimeront convenable à ce sujet » [Note : Arrêt du 23 décembre 1761].
En même temps, le Parlement se montrait soucieux de voir l'instruction continuer, sans interruption, à se distribuer au collège et, pour y arriver, le Procureur général devait, besoin échéant, présenter à la Cour, pour qu'elle fit son choix, une liste contenant les noms des ecclésiastiques séculiers ou des laïques qui paraîtraient les plus dignes et les plus capables d'enseigner les humanités, la rhétorique, la philosophie. Les nominations ainsi faites par la Cour seraient valables jusqu'à ce que les chaires du collège fussent définitivement occupées, après qu'un concours, ou tout autre moyen choisi par le Parlement, aurait décidé de leurs titulaires [Note : Extrait des registres du Parlement, 28 mai 1762].
C'était donc le Parlement qui, en matière d'instruction, prenait l'initiative. Le Corps de ville, avec la Faculté de Droit et le Présidial, lui présenta un mémoire sur l'instruction à donner à la jeunesse, mais nous verrons qu'il lutta contre la mainmise des parlementaires sur ses droits de fondateur.
Le 3 juin 1762, pour obéir à l'ordonnance du Parlement du 23 décembre 1761, une Assemblée générale de la Communauté se réunit ; M. Le Meur, Procureur du roi, syndic, pour la mettre en état de délibérer sur un sujet aussi important, présenta un rapport qu'il avait rédigé.
Il s'unissait au Présidial et à la Faculté de Droit pour critiquer l'ancien état de choses, dans le domaine de l’enseignement [Note : « Quoy de plus fripant que les deffaults monstrueux de la méthode admise dans les écoles ? [dit le Meur]. Le ministère public n'a rien laissé à désirer sur cet objet, il les a peints ces deffaults avec autant de vérité que de force ». B. 66. « Les citoyens éclairés désiraient une réforme dans les collèges destinés à l'instruction de la jeunesse, mais ils n'osaient l'espérer... ce n'est pas remplir le vœu de la société que d'apprendre imparfaitement à la jeunesse une langue morte quelque nécessaire que soit la connaissance de cette langue pour touttes les professions savantes ». (Mémoire des Facultés de Droit de Rennes, B. 66)]. Faculté, bureau de ville et Présidial s'accordaient pour vouloir un enseignement religieux, pour désirer que les élèves fussent avec soin instruits de la langue française, pour prescrire l'étude de l'histoire et de la géographie. Dans la pensée de la ville et des universitaires qui, plus à fond que le Présidial, étudièrent la question, l'enseignement devait être classique, il fallait que les élèves entretinssent avec les auteurs latins un commerce assidu ; les maîtres avaient à développer avant tout chez leurs écoliers la rectitude de l'esprit ; les études, surtout l'étude de la philosophie, devaient être allégées du fardeau des abstractions et des subtilités et, pour cela, il fallait secouer le joug scolastique ; il convenait de ne point négliger les mathématiques ni la physique [Note : L'essai d'éducation nationale de La Chalotais présenté à la Cour en mars 1763 offre beaucoup de traits communs avec ces mémoires ; il parle en plus de l'étude des langues vivantes. Les critiques que formule La Chalotais s'appliquent aussi bien, dit-il, à l'enseignement de l'Université qu'à celui des Jésuites ; tous les établissements d'éducation doivent, dans sa pensée, subir une réforme. « Essai d'éducation nationale », La Chalotais. « La Chalotais éducateur », par J. Delvaille].
M. le Meur, après avoir exprimé le souhait que fût transféré de Nantes à Rennes le siège de l'Université, insistait sur la nécessité de conserver à la ville ses droits ; « en sa qualité de fondatrice [disait-il] la Communauté de Rennes continuera de jouir des mêmes droits, honneurs, préémidences dont elle jouissait avant la jonction de l'Université. La ville nommera pareillement des administrateurs des revenus attachés au collège qui ne pouront se dessaisir d'aucuns deniers qu'en vertu de délibérations de la Communauté et seront tenus de luy rendre compte de leur administration » [Note : B. 66. Rapport présenté à l'Assemblée générale de la Communauté par le Meur].
Les députés nommés par l'Assemblée générale pour examiner le mémoire du Procureur syndic y donnèrent leur pleine approbation, se montrèrent soucieux de voir la Communauté de ville prendre part à l'élection des maîtres du collège, à l'administration temporelle, au maintien de la discipline, par au moins six de ses membres qui « avec MM. le Maire, le Procureur du roy sindic pourvoiront aux choses de nécessité plus urgente et déféreront au corps les matières plus importantes et plus sérieuses sous les auspices du ministère public et de Nosseigneurs du Parlement ». La Communauté de Rennes, ajoutaient les députés, devait garder toutes ses prérogatives et tous ses droits : se faire remettre chaque année la liste des livres à expliquer et des leçons à donner, se voir présenter les clefs du collège au premier jour de l'an, se faire, au cours d'une messe solennelle, lors de la rentrée des classes, offrir un cierge d'une livre à ses armes, être invitée à assister aux prix et jeux théâtraux de la fin de l'année [Note : B. 66. Rapport lu dans l'assemblée de la Communauté le 12 juin 1762. Nous avons dit comment les Jésuites n'avaient pas eu à présenter les clefs au premier de l'an].
Cependant, à ce moment même, le Corps de ville courait risque d'être atteint dans ses anciens privilèges et de voir lui échapper l'organisation de l'établissement qu'il avait fondé.
Le 23 juin 1762, la Cour ordonnait que chaque collège, fût pourvu d'un principal, de deux sous-principaux et de professeurs en même nombre qu'antérieurement au départ des Jésuites ; elle fixait le traitement du personnel et en déterminait les devoirs [Note : Arrêt du Parlement du 23 juin 1762. — Le traitement du principal était fixé à 2.000 livres, de plus 400 livres lui seraient allouées annuellement pour menues dépenses d'entretien et charge de fournir le luminaire des classes ; les sous-principaux, le professeur de théologie, celui de philosophie, celui de rhétorique recevraient chacun 1.200 livres ; le régent d'humanités en aurait 1,000, chacun des autres régents 900 et chacun des deux valets 20. La Cour « ordonne que lesdits principaux, soit ecclésiastiques ou laïques non mariés demeureront dans lesdits collèges, leur fait très expresses inhibitions et défenses ainsi qu'aux sous-principaux, professeurs et régens de rien exiger des écoliers sous quelque prétexte que ce soit, leur enjoint, d'être exacts à l'heure convenue pour l'ouverture des classes, de n'y manquer si ce n'est en cas de maladie ou autres empêchements légitimes, auquel cas les sous-principaux et même les principaux seront tenus de supléer les professeurs et régens, sauf par ci après être fait pour le plan des études et administration desdits collèges tels règlements qu'il sera vu apartenir ». Le Parlement réclamait de chaque écolier une contribution scolaire, les revenus du collège étant insuffisants pour fournir aux divers frais de l'entretien de l'établissement, et aux pensions servies aux Jésuites qui avaient atteint l'âge de 33 ans. Cette rétribution scolaire fut fixée à 12 livres par an. Les élèves du petit séminaire et de l'hôtel des gentilshommes continueraient seuls à jouir de l'éducation gratuite] ; elle choisirait elle-même les titulaires des chaires ou les ferait désigner par voie de concours après que les juges présidiaux et royaux, les Facultés de Droit, la Communauté de ville auraient adressé au Procureur général du roi des listes de sujets dignes par leurs mœurs et leurs talents de remplir les diverses fonctions du collège [Note : Arrêt du 23 juin 1762. Les mesures dont nous parlons valaient toutes pour chacun des collèges du ressort, mais nous ne nous occupons que de celui de Rennes]. Les Facultés de Droit, après avoir fait subir aux candidats un examen, envoyérent au Parlement la liste qui leur était demandée [Note : B. 66. « Précis des opérations des Facultés de Droit en exécution de l'arrêt du 23 juin 1762 » et compositions des candidats] ; le Présidial ne donna pas de noms de professeurs, mais recommanda comme principal M. Pierre Thé du Châtellier, chanoine de la cathédrale de Saint-Malo [Note : B. 66. « Avis du Présidial de Rennes sur le choix d'un principal »], que désigna également la Faculté.
Le bureau de la Communauté de Rennes jugea que « cette disposition... de l'arrêt du Parlement portait préjudice aux droits de la Communauté dans sa qualité de fondatrice du collège… » ; « après une recherche exacte des titres qui établissent les droits, la pocession non interrompue où était la Communauté, avant l'admission des Jésuites au collège, de nomer aux places de principal, sous-principaux, professeurs, régents du collège [elle] dressa un mémoire » et présenta requête au Parlement. Le Parlement, le 17 juillet, déclara qu'il la maintenait dans ses droits de fondatrice ; le lendemain, l'Assemblée générale, par acclamation, nomma « d'une voix unanime » M. Thé du Châtellier principal du collège ; le 16 août, après s'être entourée des renseignements les plus sérieux sur les candidats, elle élut aux diverses charges du collège [Note : Arch. mun., 540 A f°s ,26v°, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Extrait des registres du Parlement, 17 juillet 1762. Arch. mun., liasse 287, procès-verbal de la nomination du principal, 18 juillet 1762. Les nominations, faites par la ville furent homologuées par la Cour le 19 août 1762. (Arch. mun., liasse 287. Homologation par le Parlement des nominations aux charges du collège)].
Cependant le Parlement n'entendait pas que l'autorité de la ville sur le collège fût entière comme elle l'avait été jusqu'à ce que, en 1604, les bourgeois de Rennes eussent été conduits à en abandonner une partie, dans leur désir d'avoir des Jésuites dans leur maison de Saint-Thomas. Un arrêt de la Cour du 19 août 1762 ordonna que l'administration des biens, la surveillance des études et de la discipline appartiendraient à un bureau composé des commissaires du Parlement, de deux députés de l'Eglise, de deux gentilshommes ayant maison dans la ville, d'un des greffiers en chef ayant entrée à la Communauté, du Maire et de deux échevins, d'un secrétaire à la chancellerie, d'un capitaine centenier, de deux avocats, d'un notable, d'un des Pères des pauvres et du principal du collège, tous élus par le corps auquel ils appartenaient [Note : Arrêt de la Cour, 19 août 1762].
La Communauté de Rennes, non sans peine, on peut le penser, se soumit à cette ordonnance [Note : Arch. mun., 540 A f° 35v° 36r°. A l'assemblée générale du 24 septembre 1762, la Communauté élit les membres du bureau qu'elle avait à choisir. Les Archives municipales de Rennes (n° 569) conservent le registre des délibérations du bureau d'administration du collège. Il est chiffré et paraphé de la main de « Messire Anthoine Arnauld de la Briffe d'Amilly, Conseiller du Roi en tous ses Conseils et d'Etat, premier Président au Parlement de Bretagne ». On y lit au folio 2 : « M. le premier Président a dit que la quantité des bastiments qui dépendent du collège étant plus que suffisante, plusieurs membres de la Communauté de Rennes lui auroient représenté qu'il seroit avantageux pour elle de disposer dans le nombre de ces édifices d'une salle académique pour tenir les écoles de droit, d'un appartement pour les différentes écoles de chirurgie et d'une salle pour l'école de mathématiques et de dessein — sur quoy délibéré — le Bureau a arresté, qu'il sera disposé de la salle qui servoit cy devant de chapelle de Congrégation des messieurs pour tenir les écoles des facultés de droit, que les chirurgiens disposeront pour tenir leur cours académique des deux salles qui servoient cy devant de réfectoire et cuisine pour le service de la maison de la retraitte, qu'ils disposeront pareillement du jardin dépendant de la ditte maison pour y cultiver des plantes »]. Ses droits devaient être encore restreints ; au mois de février 1763, Louis XV, ordonnait qu'on lui rendît compte de l'état financier et de l'organisation des divers collèges de son royaume, afin de voir quels étaient ceux qu'il serait bon de conserver ; il donnait, dans les villes de Parlement, la haute main sur les établissements scolaires et la nomination du principal, à un bureau composé de l'Archevêque ou Evêque, du premier Président de la Cour, du Procureur général, des deux premiers officiers municipaux, de deux notables de la ville choisis par le bureau même d'administration et du principal du collège. S'il était jugé nécessaire de faire quelque règlement général « pour la police et l'avantage » de la maison, le bureau devrait l'envoyer au Procureur général pour en avoir homologation. C'était bien en vain que le roi déclarait n'entendre, par cet édit, préjudicier « aux droits des fondateurs ni aux charges et conditions primitives des fondations bien et duement faites dans le contrat » [Note : Edit royal de février 1763. Le principal choisirait ses subordonnés et les domestiques du collège].
La Communauté de Rennes s'appuya cependant, mais inutilement, sur cette phrase pour faire valoir ses droits à nommer le personnel du collège, après que, malgré ses réclamations, l'édit eût été enregistré [Note : Arrêt du Parlement du 23 août 1763 ordonnant que l'édit de février 1763 soit « bien et duement exécuté ». Arch. mun., liasse 289. Supplique de la Communauté de Rennes au Roi, pièce non datée. « Les circonstances où se trouve la Communauté de Rennes sont bien dignes d'attention. Le droit de fondation du collège lui est acquis à titre plus qu'onéreux, puisque cet établissement lui a coûté des sommes énormes, tant pour dotation que pour acquisition et constructions d'édifices. Elle paye même encore sur ses deniers d'octrois une rente foncière de 2.000 livres au collège pour supplément de dotation ». Les bénéfices du collège de Rennes furent administrés par un économe séquestre jusqu'au 1er janvier 1768 ; cet économe n'avait à en verser tout ou partie du produit que quand les autres sources de revenu ne suffisaient pas à l'entretien de la maison ; à partir de 1768, l'administration en incomba au bureau du collège. (Lettres patentes du 2 février 1763 et du 25 juin 1767)].
Ce n'était plus, dès lors, avec des religieux qu'elle avait librement appelés et qui lui devaient une grande reconnaissance que la ville partageait ses anciens privilèges sur le collège ; elle en avait été dépossédée malgré ses efforts ; il y avait toujours un collège à Rennes, ce n'était plus, a proprement parler, « le collège de la ville ».
Après le départ des Jésuites, le nombre des écoliers diminua considérablement ; au mois de janvier 1763, l'établissement Saint-Thomas ne comptait que 500 élèves [Note : Arch. mun., 569 f° 11r°]. L'obligation de payer une rétribution scolaire contribuait à cet abaissement du chiffre des étudiants [Note : Arch. mun., liasse 289], mais n'en était sans doute pas la seule cause, il est probable que bien des familles regrettaient les Jésuites. Les commencements du nouveau collège furent donc pénibles et nous ne savons pas s'il eut jamais, comme du temps des Jésuites, des milliers d'écoliers. Il semble toutefois que, grâce aux vertus et au zèle habile du « principal » Thé du Châtellier, la maison Saint-Thomas n'ait pas eu à souffrir au point de vue des études et de la discipline [Note : Arch. num., 569 f° 61 ; id., liasse 289] ; mais, en 1784, le bureau d'administration s'aperçut que le niveau de l'enseignement s'abaissait au collège ; il prit des mesures pour remédier à cet état de choses [Note : Arch. mun., 570 f°s 31, 32, 48v°, 59r°].
Malgré toutes les critiques qui avaient été adressées au système d'éducation des Jésuites, l'enseignement ne subit pas, semble-t-il, une réforme profonde au collège de Rennes. Le latin et le grec continuèrent d'être les principaux objets d'études ; pour les « actes et exercices de philosophie » (excepté pour les « exercices de mathématique et physique expérimentales »), on usa de la langue latine ; comme avant 1762, les sciences ne furent enseignées qu'en philosophie. Il avait été reproché aux religieux de la Compagnie de Jésus de négliger l'histoire ; on se contenta, au nouveau collège, de « faire entrer souvent des morceaux d'histoire ancienne ou moderne, sacrée [ou] profane » « dans les compositions » dans certains de leurs collèges, nous le savons, les Jésuites avaient poussé beaucoup plus loin l'enseignement historique. Une part fut faite à l'étude du français ; les éléments de la langue maternelle furent enseignés en quatrième, en cinquième, en sixième [Note : C'est dans un « règlement pour le collège de Rennes » (Arch. mun., 569 f°s 65, 66, 67) que nous puisons ces renseignements. Ce règlement fut élaboré par l'évêque de Rennes et approuvé, le 17 novembre 1771, par le bureau d'administration du collège ; il correspond sans doute, à peu près, au régime suivi à l'établissement depuis le départ des Jésuites. En 1791, l'école gratuite de mathématiques qu'avaient fondée en 1754 les Etats de Bretagne fut fermée ; le professeur, M. Thébault, fut appelé à enseigner au collège de Rennes qui, sans cela, aurait été « absolument dénué de l'enseignement le plus propre à former des hommes ». Arch. mun., 570 f° 75 f° 77)] ; mais en 1784 encore, certains régents se prétendaient dispensés de faire apprendre la grammaire par principes [Note : Arch. mun., 570 f° 48].
Après 1762, le programme des études ne subit donc que peu de changements ; en fut-il de même pour les méthodes ? nous ne le savons pas ; on nous dit, il est vrai, qu'une bonne méthode fut substituée à « l'ancienne routine » [Note : Note : Arch. mun., liasse 289] ; l'enseignement des Jésuites ne méritait pas cette appréciation dédaigneuse, il est fréquent de voir poursuivre de reproches injustes ou exagérés les hommes qui, accablés par la mauvaise fortune, sont chassés de leur situation et d'entendre prôner plus que de raison ceux qui viennent les remplacer.
Annexe
B. 66,
procès-verbal de la descente de M. de Guerry au collège. Voici une
copie de l'état des recettes et dépenses remis par le Père le Petit et qui est
conservé aux Archives du Parlement. B. 66 :
ETAT DU REVENU DU COLLÈGE DE RENNES.
Du
prieuré de Brégain, diocèse de Dol, dépendant
de Saint-Florent de Saumur....... 1.700 livres.
Du prieuré de Livré, diocèse de
Rennes, dépendant de Saint-Florent, environ ...... 4.000 livres.
Du prieuré
de Noyal-sur-Vilaine, dépendant de Saint-Melaine ...... 1.014 livres 3 sols 8
deniers.
En tout : 6.714 livres 3 sols 8 deniers.
Du fief de Saint-Thomas
donné par la maison de ville ..... 374 livres.
Du loyer des maisons et
buanderie en Rennes ...... 948 livres.
De la maison de ville, rente de 40.000 livres
empruntées par les Jésuites pour finir l'église ...... 2.000 livres.
Des lods et
ventes sur les fiefs de Livré, Noyal et Saint-Thomas, année commune ........ 300
livres.
Sur deux maisons de la rue haute, rente accordée aux
Jésuites ..... 20 livres.
En tout : 3.642 livres.
Sur la ferme de
l'impôt et billots pour le droit des papegauts accordé aux Jésuites .......
3.000 livres.
De la métairie du Clos billet, d'acquêt ........ 300 livres.
De Bellevue, en la
Touche, d'acquêt ....... 300 livres.
D'une petite métairie au tertre de Joué, donnée aux
Jésuites ...... 122 livres.
D'un pré ou les clôtures noblet en
prévalais, venu d'un échange avec le moulin de Brégain ........ 140 livres.
En tout : 3.852 livres.
Des pensions des directeurs de la retraite et
du frère et loyer des deux maisons de la retraite ...... 2.272 livres.
Des chaises de
l'église, années communes ....... 1.200 livres.
De la maison de ville, indemnité pour les
entrées, accordée depuis le dernier bail des octrois .......... 450 livres.
En tout : 3.922 livres.
Total du revenu du collège tout
compris : 18.140 livres 3 sols 8 deniers.
CHARGES ANNUELLES DU COLLÈGE.
Décimes à Rennes
........ 888 livres.
Décimes à Dol, plus
de ........ 269 livres 2 sols.
Au recteur de Livré pour sa portion congrue et ses
novales ....... 360 livres.
Au curé de Livré ......... 150 livres.
Pour les
messes, de fondation à Livré, deux par semaine ...... 62 livres 8 sols.
Pour les messes de Brégain, trois par semaine ........ 93 livres 12 sols.
Au
chapelain de Noyal, outre son logement, un jardin et
chauffage ...... 52 livres.
Au recteur de Chantepie, notre part de sa
portion congrue ...... 80 livres.
Au recteur de Nouvoitou, notre part de
sa portion-congrue ....... 49 livres 3 sols 4 deniers.
Au chapelain de Sainte-Anne en
Saint-Sauveur fondé sur le tertre de Joué ........ 22 livres.
Au recteur
d'Epiniac, pour un trait de dismes, portion congrue ...... 3 livres.
A
la confrérie du Saint-Esprit en Saint-Germain sur une maison rue
Saint-Germain ........ 2 livres 2 sols.
Réparations, années communes ........ 2.000
livres.
A Jeanne Touzé, rente viagère ....... 154 livres.
Aux pauvres écoliers ; rente
annuelle ...... 100 livres.
Au petit séminaire pour les vespres de l'église
....... 75 livres.
A l'organiste .......... 30 livres.
A la bibliothèque, rente fondée par le
Père Eon ....... 100 livres.
Deux retraites aux Ursulines de Saint-Malo
fondées ........ 60 livres.
Pour trois lampes fondées dans
l'église ....... 60 livres.
Rentes seigneuriales ........ 25 livres.
Droit de quittance
de nos rentes ........ 12 livres 7 sols.
Au Sr de la Province pour frais communs à
Paris ....... 330 livres.
Gages et capitation de nos domestiques ....... 201
livres 10 sols.
A la Préfecture pour aider aux prix de l'année ........ 30 livres.
Total des charges annuelles : 5.109 livres 4 sols 4 deniers.
Le revenu cy-dessus est
de : 18.140 livres 3 sols 8 deniers.
Les charges sont de : 5.109 livres 4
sols 4 deniers.
Reste pour nourriture, entretien, frais de maladie et
voyages : 13.030 livres 9 sols 4 deniers.
Je n'ay pas fait mention de la maison et chapelle de Saint-Aaron
en Saint-Malo qui nous a été donnée parce que nous n'en retirons rien.
(B.
66. Cette pièce est signée de M. de Guerry, de M. de la Haye-Jousselin, des
PP. du Pays et le Petit).
La chapelle de Saint-Aaron à Saint-Malo avait, en 1662, été donnée aux Jésuites par les Ursulines de Saint-Malo qui voulaient faire leur retraite annuelle sous leur direction. (Arch départ., Hist. de la fondation, p. 172 et suiv.).
Quelques-unes de ces sources de revenu offrent l'occasion de remarques.
La possession du prieuré de Brégain fut disputée à deux reprises au moins aux Jésuites. A l'Assemblée du clergé de 1625, qui se montra toute disposée à resserrer les exemptions des réguliers au bénéfice des ordinaires et des curés, le curé de La Boussac présenta requête. Il contestait aux Jésuites le droit d'exercer des fonctions sacerdotales dans l'église du prieuré de Brégain, droit qu'une Bulle leur avait accordé en leur imposant l'obligation de la desservir. Le curé de La Boussac avait été auparavant débouté de ses prétentions par le Parlement de Rennes ; l'Assemblée du clergé arrêta qu'elle se joindrait à lui pour obtenir la cassation des arrêts du Parlement et l'évocation au conseil de tous les procès et différends mus et à mouvoir entre « lesdits Jésuites du collège de Rennes et ledit Recteur de La Boussac ». (Prat, Recherches..., t. IV, p. 632 à 651). En 1674, nouvelles réclamations de la part du Recteur de La Boussac contre les Jésuites. « La bibliothèque de Nantes possède un curieux factum pour J.-B. Arnous, Recteur de la paroisse de La Boussac, diocèse de Dol en Bretagne, contre les Jésuites du collège de Rennes comme soy-disans prieurs du prieuré de Brégain scis dans ladite paroisse de La Boussac. Rennes 1674, in-4°, 12 p. ». (Kerviler, Bio-Bibliographie bretonne, 2ème fascicule, p. 282). Les Jésuites n'en jouirent pas moins du prieuré jusqu'en 1762.
A Livré, le Recteur des Jésuites était seigneur spirituel et temporel, jouissait de juridiction séculière et ecclésiastique. Au spirituel, le prieuré était exempt ou « nullius diœcesis » et relevait directement du Pape. Au temporel, le Recteur avait sur le fief de Livré qu'il tenait prochement du roi, haute, basse et moyenne justice, jouissait du droit de chasse, du droit de marché (le samedi et à quatre foires par an) et de plusieurs autres droits féodaux. Antérieurement à la prise de possession du prieuré par les Jésuites, chaque année, le dimanche de Quasimodo, les nouveaux mariés devaient comparaître à Livré avec leur femme et donner un baiser et une chanson au prieur, ils étaient ensuite tenus de courir en frappant la quintaine. Mais lorsque les Jésuites devinrent maîtres du prieuré de Livré, ils convertirent, avec le consentement des paroissiens, ce droit seigneurial qui avait fait son temps, en la remise, par les derniers mariés de la paroisse, d'un quart de livre de cire, valant 5 sols tournois, pour l'usage de l'église. Ce changement fut confirmé par un arrêt du Parlement de Bretagne du 21 janvier 1609. — (G. de Corson, Pouillé de Rennes, t. II, pp. 486-487. — Aveux du prieuré de Livré, Arch. départ., série D. — Arch. mun., liasse. 290).
Les Jésuites, dans les premières années de leur établissement, réunirent au prieuré de Livré plusieurs pièces de terre qui en avaient dépendu et qui avaient été aliénées avant leur mise en possession. En 1609, ils achetèrent le pré des Aulnais, le courtil de la croix, le pré des fresnais (ce dernier pour 1.050 livres). (Arch. départ., série D. contrats).
Le prieuré de Noyal, tenu ligement du roi en fief amorti, jouissait, d'un droit fort singulier appelé « sault de gerbes » qui ne rapportait pas moins de 1.600 livres de rente en 1790. Voici comment un bail à ferme passé en 1764 décrit ce droit : le droit de grange ou de sault de gerbe consiste en ce que « les religieux de Saint-Melaine, gros décimateurs et le vicaire perpétuel de Noyal sont obligés de mener dans la grange étant en la cour d'iceluy prieuré toutes les dîmes, même novales, pour estre déchargées une à une à pleine terre dans ladite grange et les grains qui tombent au sault de la gerbe et les épis qui se rompent appartiennent au prieuré aussi bien que ce qui reste dans la grange sous les gerbes ; comme aussi, après que lesdites dîmes sont battues dans l'aire de la cour dudit prieuré, toutes les pailles, balles et sons et vanures appartiennent au prieur sans qu'on puisse rebattre les épis rompus ; et de plus tant et si longtemps qu'il y a des gerbes dans la grange ou dans l'aire, le prieur a droit de faire nourrir de grain quatre pourceaux sur les dîmes du grand trait, et pareil droit que dessus sur les grosses dîmes, mêmes novales, de Gouezé pour la nourriture de deux pourceaux ». (Arch. du Chapitre de Rennes provenant de l'ancien fonds de Saint-Melaine, cité. par G. de Corson, Pouillé de Rennes, t. II, p. 109).
En 1621, les Jésuites se firent adjuger par retrait féodal la maison du Clos-Pilet, proche de Bellevue et dépendant du fief de Saint-Thomas. Dans la suite, ils agrandirent leur propriété sur ce point, en échangeant, pour des pièces de terrain qui en étaient voisines, leur terre des Ecotays, seigneurie de la Prévalaye, achetée en 1617 et en faisant des acquisitions avec les 2.400 livres, produit de la vente (en 1638) d'une métairie de Quédillac donnée aux Jésuites par les Ursulines de Saint-Malo qui voulaient leur ministère. (Arch. départ., Hist. de la fondation, p. 172 et suiv.).
En 1617, les Jésuites échangèrent deux champs qu'ils possédaient sur le fief de Saint-Georges pour un terrain, près du tertre de Joué, sur lequel ils se proposaient de bâtir ; ils y élevèrent, en effet, leur maison de campagne qui fut appelée Clairlieu, puis Beauregard, enfin Bellevue ; dans les titres de propriété, on la nomme Saint-Louis, comme la chapelle en était dédiée à ce saint. En 1636, les Jésuites acquirent la métairie de la Touche entre Bellevue et le tertre de Joué ; l'abbesse de Saint-Georges, qui ne voulait pas d'amortissements sur son fief, mit des obstacles à l'exécution de leurs contrats, le Parlement la débouta de ses prétentions. (Arch. départ., Hist. de la fondation, p. 139 et suiv.). (Arch. mun., liasse 285, lettre de Françoise de la Fayette, abbesse de Saint-Georges, aux bourgeois de Rennes, 1er octobre 1618).
La propriété du tertre de Joué dépendait de Saint-Georges et du marquisat de Cucé ; elle fut donnée en 1679 aux Jésuites par Nicolle Monneraye, veuve de noble homme Etienne du Lourdel. (Arch. mun., liasse 290, acte de donation).
Les clôtures Noblet, seigneurie de la Prévalaye, furent acquises en 1617 par le Père de la Salle. Recteur du collège, qui, faisant un échange, avait donné pour les avoir le moulin de Brégain ; sur la même seigneurie, il achetait la même année pour 2.500 livres la terre des Ecotays qu'il échangea plus tard, comme nous l'avons dit. (Arch. départ. Série D. contrat de 1617).
Jusque vers 1640, les Jésuites firent donc un certain nombre d'acquisitions.
Dans la liasse 289 des Archives municipales de Rennes se trouve un état des revenus et charges calculé après le départ des Jésuites, au début du nouveau collège. L'état des dépenses est beaucoup plus élevé que celui qu'avait fourni le Père le Petit ; il se monte à 21.922 livres 6 sols 5 deniers ; cette différence s'explique surtout par le fait qu'à partir de 1762 il fallut donner des honoraires au personnel enseignant.
L'état des revenus est sensiblement le même ; on trouve en moins la somme de 2.272 livres versée annuellement par la maison des retraites au collège ; on trouve en plus la somme de 300 livres de rente franchissables au denier 20 que le 5 octobre 1741, les sieurs et demoiselle de la Josserie du Maine s'obligèrent à payer aux Jésuites. Cette rente n'est à compter dans les revenus du collège que depuis 1762, car elle fut fondée au profit de la maison des retraites dont le Père de Charleval était alors directeur. (Arch. mun., liasse 287, contrat de constitution de rente, 5 octobre 1741. — B. 66, état de la maison de la retraite).
De plus, nous lisons dans l'état des revenus du collège en 1762 (liasse 289) : « Suivant une note remise en l'année 1761 à M. de Guerri, commissaire du Parlement par frère Petit, Procureur des Jésuites, il paraît que les Jésuites établis à Rennes devaient être porteurs de différents contrats de constitution sur le domaine et la ville de Paris et sur les Etats de Bretagne qui pouvaient rapporter 2.000 livres de rente ; dans le nombre de ces contrats, se trouve compris un contrat de 10.000 livres de principal sur les Etats de Bretagne passé en 1757 par devant Meslin, notaire à Paris. — Ce contrat est au nom des Jésuites du collège d'Eu, mais bien au profit des Jésuites de Rennes. Feu M. de Guerri, à qui le frère Petit le présenta lors de l'inventaire, après l'avoir chiffré, engagea ce dernier de l'envoyer à Paris au Procureur de la province, afin qu'il certifiât au pied du contrat qu'il était au profit des Jésuites de Rennes ; dans le temps que le Procureur de la province remit ce contrat, MM. les Commissaires du Parlement de Paris étaient chez lui à faire l'inventaire de ses papiers, le contrat fut mis avec les autres pièces. L'économe séquestre des biens des Jésuites fait ses diligences pour recouvrir ces contrats, mais toutes ses recherches ont été inutiles, ainsi on n'en fera note au présent que pour mémoire cy mémoire ».
La déclaration faite par le Père le Petit au sujet du contrat de 1757 sur les Etats de Bretagne se trouve dans le procès-verbal de l'inventaire du collège. (B. 66).
Par une lettre de juillet 1763 ; « M. Petit, Procureur des ci-devant Jésuites » dit à la Communauté de Rennes que ce constitut de rente au capital de 10.000 livres fondé en 1757 sur les Etats de Bretagne et pour lequel le collège d'Eu était prête-nom, était, dans l'intention du donateur, destiné à entretenir un Père chargé de missions spirituelles. Cette rente, elle non plus, ne profitait donc pas au collège.
Les différents contrats de rente dont parle l'état des revenus en 1762 (liasse 289, Arch. mun.) furent réclamés en 1768 par le bureau d'administration du collège qui en fut mis en possession en 1769. (Arch. mun., reg. 569. Séances du bureau du collège tenues le 10 février 1768 et le 21 juin 1769). Nous avons le détail de ces contrats : 1° contrat sur le domaine de Paris de 12.000 livres de principal ; 2° contrat sur la ville de Paris de 12.000 livres de principal ; 3° contrat sur la ville de Paris de 1.100 livres de principal ; 4° contrat sur les tailles de la province de Bretagne dont on ne sait ni la date ni le montant ; 5° contrat de 177 livres de rente au denier 50 sur les tailles de la généralité de Paris, en vertu d'une quittance de finance du 31 octobre 1722 ; 6° contrat en date du 20 juillet 1719 de 80 livres de rente sur les Etats de Bretagne ; 7° contrat en date du 24 juillet 1719 de 146 livres de rente sur les Etats de Bretagne ; 8° le contrat de 10.000 livres de rente, dont nous avons parlé, pour lequel le collège d'Eu était prête-nom. (Arch. mun., 569. Séance du bureau du collège, 10 février 1768).
Les sept autres contrats devaient eux aussi avoir été passés au profit de la maison des retraites ou d'autres œuvres des Jésuites ; en tout cas, ils ne rapportaient rien au collège.
Le 3 juin 1762, dans une assemblée générale de la Communauté, le Procureur du roi syndic le Meur donna l'état des revenus du collège, d'après des renseignements que lui avaient fournis les Jésuites. Le Meur s'étonne que les Jésuites ne comptent pas les revenus de la Retraite parmi ceux du collège et ne mentionnent que les 2.272 livres versées annuellement au collège par la maison de la Retraite ; « cette omission [dit-il] devient encore plus frappante lorsqu'on voit employer en dépense 120 livres pour deux retraites fondées à Saint-Malo ». Le Meur n'accuse pas les Jésuites de manquer d'honnêteté en cette affaire, il attend que la Cour, après l'examen des titres de propriété, fasse la lumière sur ce point. (B. 66).
L'examen des pièces nous apprend que les Ursulines de Saint-Malo avaient donné aux Jésuites, pour s'assurer leur ministère, une métairie près de Quédillac. En 1638, les Jésuites vendirent cette métairie et consacrèrent les 2.400 livres, produit de la vente, à l'achat de terres au Clos-Pilet où ils avaient déjà une propriété. Si les Jésuites portent aux dépenses du collège les frais d'une retraite à Saint-Malo, ils portent aussi aux recettes du collège le revenu de la fondation affectée à cette dépense. (Hist. de la fondation, Arch. départ., p. 172 et sqq.) — De plus les Ursulines demandèrent cette retraite annuelle et donnèrent la métairie de Quédillac, alors que la maison des retraites n'existait pas encore à Rennes.
Par ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à ce que les revenus de la maison des retraites n'aient pas été comptés avec ceux du collège ; les deux oeuvres étaient distinctes, les Pères de la retraite payaient seulement un loyer et une pension à l'économe du collège, l'indemnisant ainsi des dépenses faites pour eux.
C'est
donc à tort que M. Delvaille, citant pour
justifier son assertion le mémoire de Le Meur, dont nous venons de parler, dit :
« Les Jésuites donnaient sur leurs revenus des comptes inexacts et dissimulaient
des propriétés qu'ils avaient ». — J. Delvaille, « La Chalotais éducateur »,
Paris 1910, thèse de doctorat ès-lettres.
(Geneviève Durtelle de Saint-Sauveur).
© Copyright - Tous droits réservés.