|
Bienvenue chez les Stéphanais |
SAINT-ETIENNE-EN-COGLES |
Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Brice-en-Coglès
La commune de
Saint-Etienne-en-Coglès ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-ETIENNE-EN-COGLES
Saint-Etienne-en-Coglès vient du breton "coglez" (nord).
La paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès est mentionnée dès le Xème siècle sous le nom de " ecclesia sancti stephani de Cogles ". La première église, dédiée à saint Etienne (premier martyr), est édifiée au XIème siècle. Elle est citée dans un acte de 1093, qui déclare qu'elle sera desservie par les moines de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers.
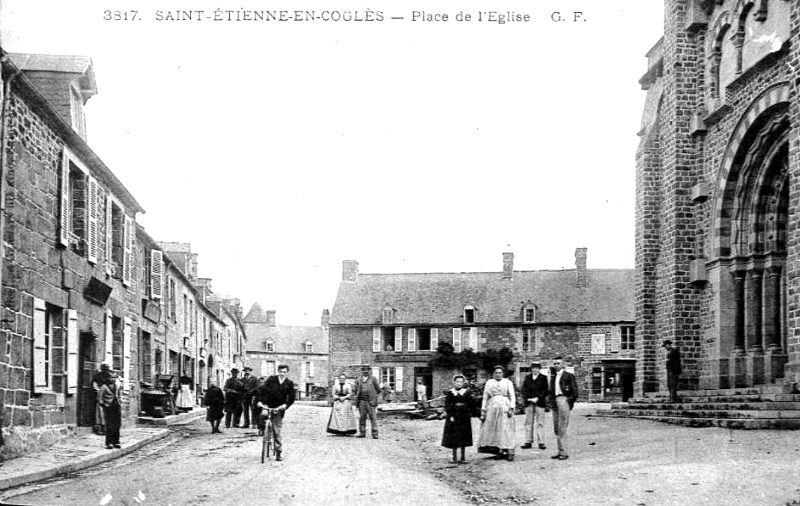
Dans le courant du XIème siècle, l'église de Saint-Etienne appartenait aux héritiers d'un seigneur nommé Renier de Taillie, qui avait possédé la chapelle de Bréal-sous-Vitré. Renier ayant donné cette dernière à l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, des difficultés à la naissance desquelles ses héritiers, Méril de Taillie et Juhel, ne demeurèrent pas étrangers, s'élevèrent entre les religieux de cette abbaye et ceux de Saint-Jouin-de-Marne, qui, possesseur de l'église du Pertre, prétendaient également avoir des droits sur Bréal. Ces seigneurs finirent plus tard par reconnaître leurs torts et confirmèrent les religieux de Saint-Serge dans la possession de la chapelle de Bréal. De plus, pour les dédommager des contrariétés qu'ils leur avaient suscitées, ils s'engagèrent, dans le cas où ils appelleraient des religieux pour desservir l'église de Saint-Etienne-en-Coglais, à ne pas les prendre dans une autre abbaye (« Sancto Sergio promiserunt ut si aliquando mitterent monachos in ecclesia Sancti Stephani de Cogles Sancti Sergii monachi mitterentur » - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 477). Ces faits se passèrent du temps d'Achard, abbé de Saint-Serge de 1082 à 1093. Cet engagement se fut pas tenu, parce que l'église de Saint-Etienne fut remise entre les mains de l'ordinaire par Méril et Juhel ou par les héritiers. Nous voyons, en effet, dans le siècle suivant, Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donner cette église aux chanoines réguliers de Toussaints d'Angers. Ceux-ci fondèrent à Saint-Etienne un prieuré-cure.
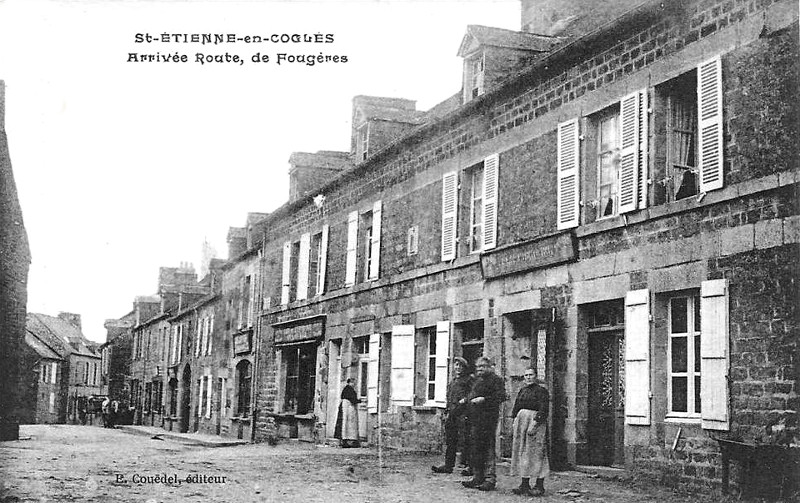
Au XVème ou XVIème siècle, un château se dresse, au nord-est du bourg, sur les bords de La Loisance (ou Loyance). Saint-Etienne, cité dès 1146, était le gage féodé de la sergentise du Coglès et exerçait au bourg de Saint-Brice-en-Coglès un droit de haute justice. On voyait autrefois les cep et collier de la seigneurie de Saint-Etienne au bourg de Saint-Etienne-en-Coglès. Le gibet de la seigneurie de Saint-Etienne se dressait au XVIIème siècle au haut de la lande de Saint-Eustache et au sud de la chapelle Saint-Eustache (Pouillé de Rennes). C'est vers 1880 que Saint-Etienne-en-Coglais change de nom et s'appelle Saint-Etienne-en-Coglès.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia Sancti Stephani de Cogles (au XIème siècle), Sanctus Stephanus Fulgeriensis (au XIIème siècle).
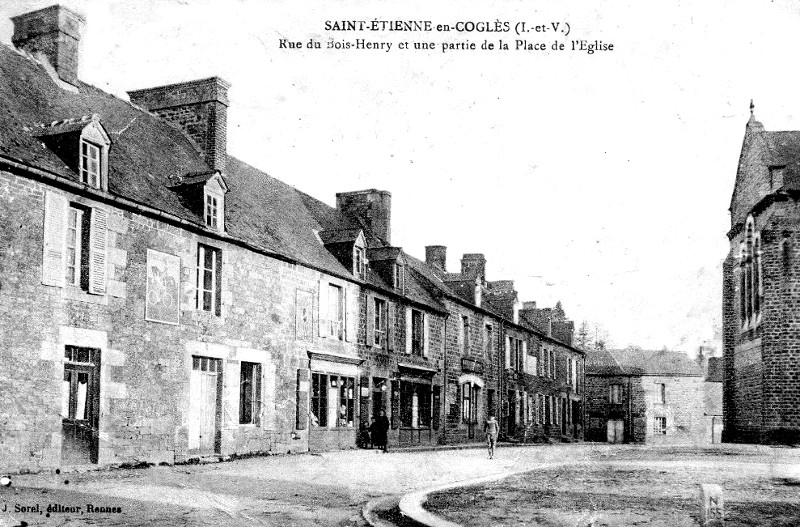

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès : Raoul Le Déour (chanoine régulier, en 1419). Sébastien Thomé (trésorier et chanoine de Rennes, il rendit aveu au roi le 25 juin 1543 pour le prieuré-cure qu'il tenait en commende). Nicolas Dupont (en 1581). Jean Pichot (en 1602). François Martin (en 1606). Jean Pellier (en 1632, il rendit aveu au roi le 5 décembre 1662 pour son prieuré-cure qu'il tenait également en commende). Jean Le Tourneulx (en 1674 ; décédé en 1681). Jean de Botherel (prêtre du diocèse, bachelier en théologie, il rendit aveu le 30 janvier 1683 ; il devint prieur de Notre-Dame de Fougères et résigna en faveur du suivant). Louis-Pierre Broc de la Tuvelière (prêtre du diocèse, pourvu le 13 septembre 1724, il résigna en faveur de son fils, qui se fit chanoine régulier ; décédé en 1748). Frère Honorat-Pierre Broc de la Tuvelière (il fut pourvu le 11 septembre 1748 ; décédé en 1764). Frère André Pitat (chanoine régulier comme le précédent et comme les suivants, il fut pourvu le 29 mars 1764 ; décédé peu après). Frère Jean-Baptiste Le Page de Varancé (pourvu le 18 janvier 1765, il se démit au bout de l'année). Frère François Richer (pourvu le 2 janvier 1766, il gouverna jusqu'à la Révolution). Pierre Laignier (1803, décédé en 1824). Julien-François Geffroy (1824-1838). N... Hardy de la Largère (1838-1850). Louis Leverrier (1850, décédé en 1872). Jean-Marie Garnier (1872-1878). Julien Dibou (à partir de 1878), ....
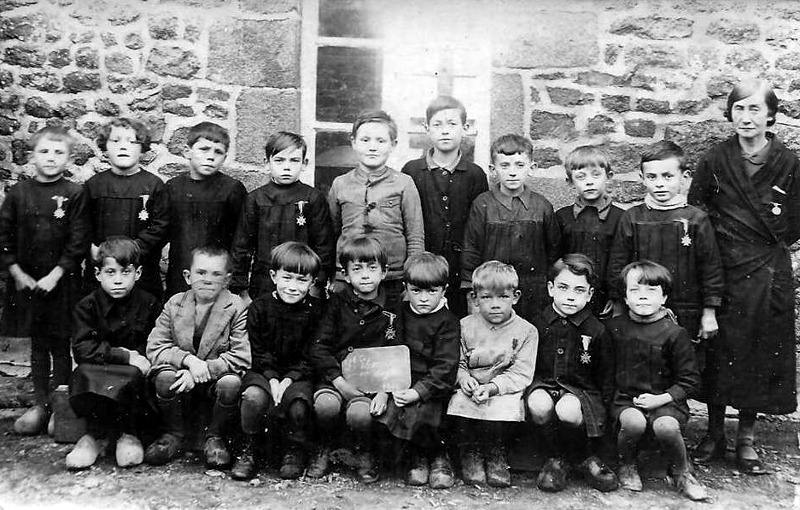
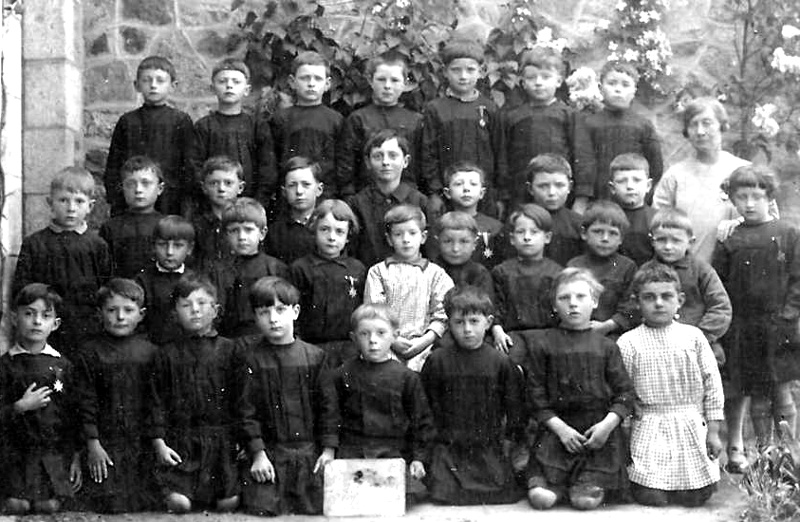
Voir
![]() "
Les
origines de la paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès
".
"
Les
origines de la paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès
".
![]()
PATRIMOINE de SAINT-ETIENNE-EN-COGLES
![]() l'église
Saint-Etienne (1895), oeuvre de l'architecte Henri Mellet. La première église est construite au XIème siècle.
L'église romane comprenait une nef, une abside et une tour en pierre à
l'entrée de l'abside : un transept y avait été ajouté en 1615, et
l'abside avait été démolie en 1778. Cette église primitive, remaniée en 1615,
est restaurée en 1833 puis démolie. Dédiée à saint Etienne, martyr, fêté le 3 août, cette église
était au commencement du XVIIème siècle un remarquable spécimen de
l'architecture romane. Elle se composait d'une nef terminée par une abside
en cul-de-four, à l'entrée de laquelle s'élevait une belle tour. Ce plan
a été malheureusement modifié par l'adjonction, en 1615, de deux
transepts et par la destruction bien regrettable de l'abside en 1778. A la
fin du XIXème siècle, l'on voit encore avec intérêt ce qui subsiste de
cette antique construction. « La façade occidentale est d'une extrême
simplicité et remarquable surtout par la pureté et la régularité de ses
lignes. Elle est construite tout entière en moellons mêlés de briques et
noyés dans un mortier de chaux ; elle est butée à chacun de ses angles
par un contrefort en pierres de grand appareil, saillant de 15 à 16 centimètres.
Ces contreforts se terminent, à la naissance du toit, par une sorte de
larmier qui se prolonge dans toute la longueur de la façade et qui est formé
par un simple retrait du mur dans la partie supérieure. Cette façade ne présente
d'autre ouverture que la porte, au-dessus de laquelle se trouve un œil-de-boeuf.
Cette porte, étroite et peu élevée, et dont l'arcade est en plein cintre,
s'ouvre au milieu d'un massif en maçonnerie qui fait saillie sur le plein
du mur et dont les jambages extérieurs viennent se rattacher à leur sommet
au larmier susdit. Cette avancée repose, des deux côtés de la baie
proprement dite, sur deux colonnes demi-engagées, en pierre de granit
grossièrement travaillée, dont la base est formée par un simple
renflement du fût avec un petit filet, et les chapiteaux par un léger évasement
de leur partie supérieure, résultant de l'aplatissement de ce même fût
avec un simple chanfrein en guise de tailloir. La face de l'un de ces
chapiteaux est relevée par deux filets croisés en diagonale en forme d'X ;
l'autre par deux figurines qui sont presque entièrement effacées. La porte
proprement dite s'ouvre en retrait de ce massif. Elle présente une
archivolte formée par deux voussures à plein cintre et à vives arêtes.
Il n'en est pas de même de ses jambages, dont les angles sont rabattus, et
sur la surface desquels est creusée, dans toute la longueur, une rainure
qui donne naissance à deux colonnettes surmontées par un chanfrein se
reliant avec le tailloir des colonnes du massif dans lequel la porte est
encadrée, et faisant corps avec lui » (M. Maupillé, Notices
historiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice, 59). La nef conserve
encore à la fin du XIXème siècle une partie de ses contreforts plats et
de ses fenêtres en meurtrières, mais on l'a ajourée d'autres fenêtres
modernes. « La tour s'élevait à l'arrière de la nef et au-devant de
l'abside ; elle reposait sur deux grandes arcades qui se dressaient entre
ces deux parties de l'édifice. Aujourd'hui que l'abside est détruite, elle
se trouve à l'extrémité du chevet, et l'autel est engagé sous la première
arcade. La seconde, qui est murée, est à découvert extérieurement et
laisse encore apercevoir dans son archivolte quelques traces des peintures
dont elle était autrefois décorée. Cette tour, dont l'élévation peut être
de 16 à 17 mètres et qui est entièrement construite en pierres, repose
sur une base quadrangulaire qui atteint jusqu'à la hauteur du faîte de l'église
; elle présente sur chacune de ses faces, disposées par étage, mais en
nombre inégal sur chacune d'elles, de petites ouvertures larges de 12 à 15
centimètres sur une hauteur de 50 à 55 centimètres, dont l'amortissement
est en plein cintre, et qui sont destinées à l'émission du son des
cloches placées vis-à-vis d'elles dans l'intérieur. Ce soubassement se
termine par un simple tore qui tient lieu de corniche et repose sur une
ligne de modillons entièrement frustres. Au-dessus de l'édifice, construit
en moellons parfaitement appareillés, s'élève le clocher en forme de
pyramide octogone. Sur la plate-forme résultant de l'abbatue des angles,
aux quatre coins de la tour, se dressent quatre clochetons hexagones ;
quatre pinacles, ajourés par une baie longue et étroite en forme de
meurtrière, couvrent autant que possible la nudité des faces intermédiaires
» (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de
Saint-Brice, 60). Il ne nous reste à signaler dans cette église que les
peintures sur bois qui couvrent le plafond de la chapelle septentrionale, dédiée
à la Sainte Vierge. Ces peintures, oeuvre du XVIIème siècle, représentent
en cinq caissons la grande scène du jugement dernier. Au centre au voit
N.-S. Jésus exerçant les fonctions de juge souverain des vivants et des
morts, et encensé par deux anges. Dans les médaillons latéraux sont saint
Etienne agenouillé au milieu des pierres qu'on lui a jetées, et saint
Jean-Baptiste avec son agneau, l'un et l'autre suppliant le Seigneur,
pendant que des anges sonnent de la trompette pour réveiller les morts ;
les deux autres médaillons représentent, l'un les élus dans le bonheur du
ciel, et l'autre les damnés refoulés par un ange dans les flammes éternelles.
Enfin, aux quatre coins du plafond sont les évangélistes avec leurs emblèmes
; tous les interstices de ce plafond sont occupés par des arabesques très-variées.
Le seigneur de Saint-Etienne était supérieur, fondateur et prééminencier
en cette église. En 1623 on voyait autour de l'édifice, « par dehors
et par dedans, une très-ancienne litre ou ceinture chargée d'escussons
apparaissant fort peu en dehors mais fort apparents en dedans, les
principaux desquels sont d'argent à la quintefeuille de gueules à l'orle
d'hermines et my-party desdites armes et de diverses alliances, lesquelles
armes sont celles des seigneurs de Sainct-Estienne auparavant que ladite
seigneurie fût tombée ès maisons de Lorgeril, Rohan et Maure ». A la
même époque apparaissait « en une vitre qui est au costé du grand
autel vers l'épître une bannière des armes de Maure escartelées de
Rohan, le tiers contrescartelé de Navarre et d'Evreux, le quart du Plessix-Anger,
et sur le tout d'hermines party de Milan ». Un écusson presque
semblable était sur un banc « joignant les marches du grand autel, du
costé de l'évangile » ; un autre grand banc était dans la nef,
devant l'autel de Notre-Dame, et « contre les fonts baptismaux » étaient
sculptés en pierre quatre écussons portant les armes de Saint-Etienne, de
Lorgeril et de Parthenay. Enfin, il existait alors « une chapelle estant
en la nef ducosté de l'espitre », présentant sur sa muraille «
deux grandes bannières de pierre dure » aux armes et alliances de
Maure (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré, et
Pouillé de Rennes). Quatre écussons aux armes des seigneurs de Saint-Etienne, des de
Partenay et de Lorgeril se voyaient jadis contre les fonts baptismaux. Les
armes des seigneurs de Saint-Etienne ornaient également les vitres et une
litre intérieure et extérieure. La nef de l'église actuelle date de 1895. Les stalles datent de 1953. Les fonts
baptismaux datent de 1767. L'autel de la Vierge provient de la cathédrale
de Senlis. Les stalles, oeuvres du sculpteur Théodore Herbel, datent de
1953. Le vitrail représentant Saint Julien, oeuvre du maître verrier
Félix Gaudin, date de 1895. On y trouve une pierre tombale du XII-XIIIème siècle ;
l'église
Saint-Etienne (1895), oeuvre de l'architecte Henri Mellet. La première église est construite au XIème siècle.
L'église romane comprenait une nef, une abside et une tour en pierre à
l'entrée de l'abside : un transept y avait été ajouté en 1615, et
l'abside avait été démolie en 1778. Cette église primitive, remaniée en 1615,
est restaurée en 1833 puis démolie. Dédiée à saint Etienne, martyr, fêté le 3 août, cette église
était au commencement du XVIIème siècle un remarquable spécimen de
l'architecture romane. Elle se composait d'une nef terminée par une abside
en cul-de-four, à l'entrée de laquelle s'élevait une belle tour. Ce plan
a été malheureusement modifié par l'adjonction, en 1615, de deux
transepts et par la destruction bien regrettable de l'abside en 1778. A la
fin du XIXème siècle, l'on voit encore avec intérêt ce qui subsiste de
cette antique construction. « La façade occidentale est d'une extrême
simplicité et remarquable surtout par la pureté et la régularité de ses
lignes. Elle est construite tout entière en moellons mêlés de briques et
noyés dans un mortier de chaux ; elle est butée à chacun de ses angles
par un contrefort en pierres de grand appareil, saillant de 15 à 16 centimètres.
Ces contreforts se terminent, à la naissance du toit, par une sorte de
larmier qui se prolonge dans toute la longueur de la façade et qui est formé
par un simple retrait du mur dans la partie supérieure. Cette façade ne présente
d'autre ouverture que la porte, au-dessus de laquelle se trouve un œil-de-boeuf.
Cette porte, étroite et peu élevée, et dont l'arcade est en plein cintre,
s'ouvre au milieu d'un massif en maçonnerie qui fait saillie sur le plein
du mur et dont les jambages extérieurs viennent se rattacher à leur sommet
au larmier susdit. Cette avancée repose, des deux côtés de la baie
proprement dite, sur deux colonnes demi-engagées, en pierre de granit
grossièrement travaillée, dont la base est formée par un simple
renflement du fût avec un petit filet, et les chapiteaux par un léger évasement
de leur partie supérieure, résultant de l'aplatissement de ce même fût
avec un simple chanfrein en guise de tailloir. La face de l'un de ces
chapiteaux est relevée par deux filets croisés en diagonale en forme d'X ;
l'autre par deux figurines qui sont presque entièrement effacées. La porte
proprement dite s'ouvre en retrait de ce massif. Elle présente une
archivolte formée par deux voussures à plein cintre et à vives arêtes.
Il n'en est pas de même de ses jambages, dont les angles sont rabattus, et
sur la surface desquels est creusée, dans toute la longueur, une rainure
qui donne naissance à deux colonnettes surmontées par un chanfrein se
reliant avec le tailloir des colonnes du massif dans lequel la porte est
encadrée, et faisant corps avec lui » (M. Maupillé, Notices
historiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice, 59). La nef conserve
encore à la fin du XIXème siècle une partie de ses contreforts plats et
de ses fenêtres en meurtrières, mais on l'a ajourée d'autres fenêtres
modernes. « La tour s'élevait à l'arrière de la nef et au-devant de
l'abside ; elle reposait sur deux grandes arcades qui se dressaient entre
ces deux parties de l'édifice. Aujourd'hui que l'abside est détruite, elle
se trouve à l'extrémité du chevet, et l'autel est engagé sous la première
arcade. La seconde, qui est murée, est à découvert extérieurement et
laisse encore apercevoir dans son archivolte quelques traces des peintures
dont elle était autrefois décorée. Cette tour, dont l'élévation peut être
de 16 à 17 mètres et qui est entièrement construite en pierres, repose
sur une base quadrangulaire qui atteint jusqu'à la hauteur du faîte de l'église
; elle présente sur chacune de ses faces, disposées par étage, mais en
nombre inégal sur chacune d'elles, de petites ouvertures larges de 12 à 15
centimètres sur une hauteur de 50 à 55 centimètres, dont l'amortissement
est en plein cintre, et qui sont destinées à l'émission du son des
cloches placées vis-à-vis d'elles dans l'intérieur. Ce soubassement se
termine par un simple tore qui tient lieu de corniche et repose sur une
ligne de modillons entièrement frustres. Au-dessus de l'édifice, construit
en moellons parfaitement appareillés, s'élève le clocher en forme de
pyramide octogone. Sur la plate-forme résultant de l'abbatue des angles,
aux quatre coins de la tour, se dressent quatre clochetons hexagones ;
quatre pinacles, ajourés par une baie longue et étroite en forme de
meurtrière, couvrent autant que possible la nudité des faces intermédiaires
» (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de
Saint-Brice, 60). Il ne nous reste à signaler dans cette église que les
peintures sur bois qui couvrent le plafond de la chapelle septentrionale, dédiée
à la Sainte Vierge. Ces peintures, oeuvre du XVIIème siècle, représentent
en cinq caissons la grande scène du jugement dernier. Au centre au voit
N.-S. Jésus exerçant les fonctions de juge souverain des vivants et des
morts, et encensé par deux anges. Dans les médaillons latéraux sont saint
Etienne agenouillé au milieu des pierres qu'on lui a jetées, et saint
Jean-Baptiste avec son agneau, l'un et l'autre suppliant le Seigneur,
pendant que des anges sonnent de la trompette pour réveiller les morts ;
les deux autres médaillons représentent, l'un les élus dans le bonheur du
ciel, et l'autre les damnés refoulés par un ange dans les flammes éternelles.
Enfin, aux quatre coins du plafond sont les évangélistes avec leurs emblèmes
; tous les interstices de ce plafond sont occupés par des arabesques très-variées.
Le seigneur de Saint-Etienne était supérieur, fondateur et prééminencier
en cette église. En 1623 on voyait autour de l'édifice, « par dehors
et par dedans, une très-ancienne litre ou ceinture chargée d'escussons
apparaissant fort peu en dehors mais fort apparents en dedans, les
principaux desquels sont d'argent à la quintefeuille de gueules à l'orle
d'hermines et my-party desdites armes et de diverses alliances, lesquelles
armes sont celles des seigneurs de Sainct-Estienne auparavant que ladite
seigneurie fût tombée ès maisons de Lorgeril, Rohan et Maure ». A la
même époque apparaissait « en une vitre qui est au costé du grand
autel vers l'épître une bannière des armes de Maure escartelées de
Rohan, le tiers contrescartelé de Navarre et d'Evreux, le quart du Plessix-Anger,
et sur le tout d'hermines party de Milan ». Un écusson presque
semblable était sur un banc « joignant les marches du grand autel, du
costé de l'évangile » ; un autre grand banc était dans la nef,
devant l'autel de Notre-Dame, et « contre les fonts baptismaux » étaient
sculptés en pierre quatre écussons portant les armes de Saint-Etienne, de
Lorgeril et de Parthenay. Enfin, il existait alors « une chapelle estant
en la nef ducosté de l'espitre », présentant sur sa muraille «
deux grandes bannières de pierre dure » aux armes et alliances de
Maure (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré, et
Pouillé de Rennes). Quatre écussons aux armes des seigneurs de Saint-Etienne, des de
Partenay et de Lorgeril se voyaient jadis contre les fonts baptismaux. Les
armes des seigneurs de Saint-Etienne ornaient également les vitres et une
litre intérieure et extérieure. La nef de l'église actuelle date de 1895. Les stalles datent de 1953. Les fonts
baptismaux datent de 1767. L'autel de la Vierge provient de la cathédrale
de Senlis. Les stalles, oeuvres du sculpteur Théodore Herbel, datent de
1953. Le vitrail représentant Saint Julien, oeuvre du maître verrier
Félix Gaudin, date de 1895. On y trouve une pierre tombale du XII-XIIIème siècle ;

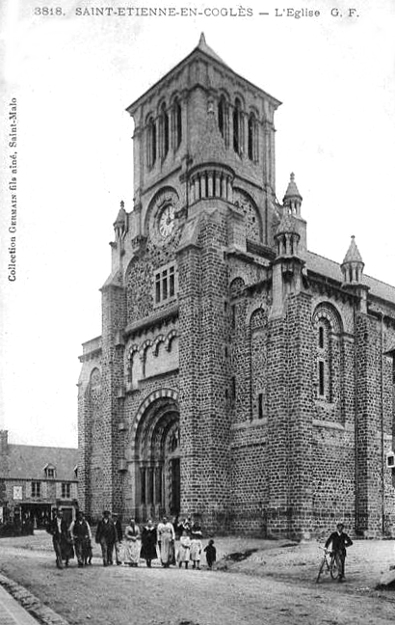
![]() la
chapelle Saint-Eustache (XVIIème siècle). Cette chapelle est restaurée en
1955. Cette chapelle frairienne, située sur le bord de la route de Fougères,
devait exister en 1623, puisqu'il est alors fait mention de l'ancien gibet
seigneurial de Saint-Etienne, élevé « au haut de la lande de Sainct-Eustache
». L'édifice actuel semble du XVIIème siècle et n'offre aucun intérêt
; à la porte est rejetée une vieille table d'autel composée d'une énorme
dalle reposant sur deux colonnes, et vraisemblablement à l'origine sur un
massif triangulaire central. Saint-Eustache était jadis le but d'un pèlerinage
très-fréquenté, le jour du Vendredi-Saint, par les habitants de toutes
les paroisses voisines, non seulement de Bretagne, mais encore de Normandie
et du Maine, qui viennent s'y faire évangéliser. A noter que la paroisse
de Saint-Etienne est la patrie de saint Hamon, moine de Savigny-le-Vieux. Ce dernier
naquit dans les dernières années du XIème siècle au village de Landécot,
qui subsiste encore de nos jours (Pouillé de Rennes) ;
la
chapelle Saint-Eustache (XVIIème siècle). Cette chapelle est restaurée en
1955. Cette chapelle frairienne, située sur le bord de la route de Fougères,
devait exister en 1623, puisqu'il est alors fait mention de l'ancien gibet
seigneurial de Saint-Etienne, élevé « au haut de la lande de Sainct-Eustache
». L'édifice actuel semble du XVIIème siècle et n'offre aucun intérêt
; à la porte est rejetée une vieille table d'autel composée d'une énorme
dalle reposant sur deux colonnes, et vraisemblablement à l'origine sur un
massif triangulaire central. Saint-Eustache était jadis le but d'un pèlerinage
très-fréquenté, le jour du Vendredi-Saint, par les habitants de toutes
les paroisses voisines, non seulement de Bretagne, mais encore de Normandie
et du Maine, qui viennent s'y faire évangéliser. A noter que la paroisse
de Saint-Etienne est la patrie de saint Hamon, moine de Savigny-le-Vieux. Ce dernier
naquit dans les dernières années du XIème siècle au village de Landécot,
qui subsiste encore de nos jours (Pouillé de Rennes) ;
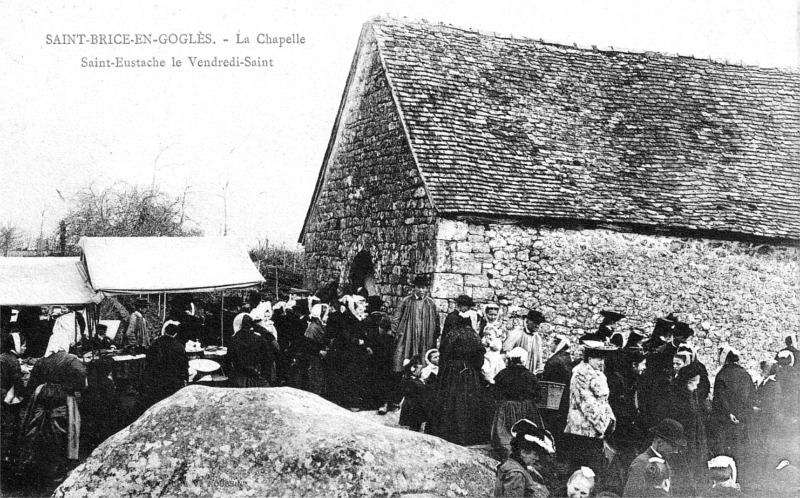
![]() l'ancien
prieuré-cure de Saint-Etienne-en-Coglais (ou Saint-Etienne-en-Coglès).
Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donna aux chanoines réguliers de
Toussaints l'église de Saint-Etienne de Fougères ; il s'agit évidemment
ici de Saint-Etienne-en-Coglais (Saint-Etienne-en-Coglès). Ce prélat avait
commencé par être abbé de Saint-Aubin d'Angers (abbaye, située dans un
faubourg d'Angers et fondée en 1108 par Regnaud, évêque de cette ville),
et avait dû connaître en cette ville Robert, premier abbé de Toussaints,
auquel il fit ce don. Son successeur sur le siège de Rennes, Alain Ier,
confirma au même abbé Robert, vers 1145, la donation de l'église de
Saint-Etienne (Gallia christiana, XIV, 710). C'est probablement vers cette
époque que fut construite l'église tout à la fois priorale et paroissiale
de Saint-Etienne-en-Coglès, l'un des spécimens les plus intéressants de
l'architecture romane dans notre diocèse. Le prieuré-cure de Saint-Etienne,
tombé en commende vers le XVIème siècle, demeura en cet état jusqu'au
milieu du XVIIIème siècle. A cette dernière époque, Louis-Pierre Broc de
la Tuvelière, prieur-recteur, résigna son bénéfice en faveur de son fils
Hongré-Pierre Broc de la Tuvelière, qui se fit chanoine régulier vers
1750. Les successeurs de ce dernier continuèrent jusqu'au temps de la Révolution
à appartenir à la Congrégation de Sainte-Geneviève (Registre des
insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). En 1543, le prieur
commendataire Sébastien Thomé, trésorier et chanoine de Rennes, déclara
au roi, le 21 juin, que son prieuré se composait « d'une maison
priorale avec cour, jardin et herbrégement, et de quatre pièces de terre,
le tout contenant environ 8 journaux » (Archives départementales de la
Loire-Inférieure). Mais, en 1790, les dépendances du prieuré avaient
augmenté un peu, et frère François Richer, chanoine régulier, alors
prieur-recteur, jouissait : du presbytère et de son pourpris, estimés 250
livres de revenu ; — de deux jardins et de 13 journaux de terre, estimés
ensemble 328 livres de rente ; — de la totalité des dîmes de la
paroisse, évaluées à 4 000 livres ; total du bénéfice, 4 578 livres de
rente. Cette estimation des revenus fut celle de la municipalité de
Saint-Etienne à cette époque ; toutefois le prieur François Richer prétendit,
le 24 février 1790, n'avoir en réalité que 10 journaux de terre et 4 000
livres de rente ; il ajouta que ses charges montaient à environ 1 200
livres ayant deux vicaires à entretenir, des décimes à payer, etc.
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1, V, 27).
l'ancien
prieuré-cure de Saint-Etienne-en-Coglais (ou Saint-Etienne-en-Coglès).
Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donna aux chanoines réguliers de
Toussaints l'église de Saint-Etienne de Fougères ; il s'agit évidemment
ici de Saint-Etienne-en-Coglais (Saint-Etienne-en-Coglès). Ce prélat avait
commencé par être abbé de Saint-Aubin d'Angers (abbaye, située dans un
faubourg d'Angers et fondée en 1108 par Regnaud, évêque de cette ville),
et avait dû connaître en cette ville Robert, premier abbé de Toussaints,
auquel il fit ce don. Son successeur sur le siège de Rennes, Alain Ier,
confirma au même abbé Robert, vers 1145, la donation de l'église de
Saint-Etienne (Gallia christiana, XIV, 710). C'est probablement vers cette
époque que fut construite l'église tout à la fois priorale et paroissiale
de Saint-Etienne-en-Coglès, l'un des spécimens les plus intéressants de
l'architecture romane dans notre diocèse. Le prieuré-cure de Saint-Etienne,
tombé en commende vers le XVIème siècle, demeura en cet état jusqu'au
milieu du XVIIIème siècle. A cette dernière époque, Louis-Pierre Broc de
la Tuvelière, prieur-recteur, résigna son bénéfice en faveur de son fils
Hongré-Pierre Broc de la Tuvelière, qui se fit chanoine régulier vers
1750. Les successeurs de ce dernier continuèrent jusqu'au temps de la Révolution
à appartenir à la Congrégation de Sainte-Geneviève (Registre des
insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). En 1543, le prieur
commendataire Sébastien Thomé, trésorier et chanoine de Rennes, déclara
au roi, le 21 juin, que son prieuré se composait « d'une maison
priorale avec cour, jardin et herbrégement, et de quatre pièces de terre,
le tout contenant environ 8 journaux » (Archives départementales de la
Loire-Inférieure). Mais, en 1790, les dépendances du prieuré avaient
augmenté un peu, et frère François Richer, chanoine régulier, alors
prieur-recteur, jouissait : du presbytère et de son pourpris, estimés 250
livres de revenu ; — de deux jardins et de 13 journaux de terre, estimés
ensemble 328 livres de rente ; — de la totalité des dîmes de la
paroisse, évaluées à 4 000 livres ; total du bénéfice, 4 578 livres de
rente. Cette estimation des revenus fut celle de la municipalité de
Saint-Etienne à cette époque ; toutefois le prieur François Richer prétendit,
le 24 février 1790, n'avoir en réalité que 10 journaux de terre et 4 000
livres de rente ; il ajouta que ses charges montaient à environ 1 200
livres ayant deux vicaires à entretenir, des décimes à payer, etc.
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1, V, 27).
![]() la
croix Gourgou (XVI-XVIIème siècle) ;
la
croix Gourgou (XVI-XVIIème siècle) ;
![]() le
manoir de Vaugarny (XIV-XVIIIème siècle). Ce manoir est restauré au
XVIIIème siècle par la famille du Pontavice.
Propriété de la famille de la Vieuville seigneurs du Frétay en 1390 et en
1427, puis des familles de la Bouëxière seigneurs du Frétay, Pinel
seigneurs de Chaudeboeuf (en 1470 et en 1513), Tuffin seigneurs de la
Rouairie (en 1533), Pouriel seigneurs de Chapifeu (en 1635), de Bregel
seigneurs de Mesguérin (avant 1723), du Pontavice seigneurs de
Saint-Laurent de Terregaste (en 1723 et en 1789) ;
le
manoir de Vaugarny (XIV-XVIIIème siècle). Ce manoir est restauré au
XVIIIème siècle par la famille du Pontavice.
Propriété de la famille de la Vieuville seigneurs du Frétay en 1390 et en
1427, puis des familles de la Bouëxière seigneurs du Frétay, Pinel
seigneurs de Chaudeboeuf (en 1470 et en 1513), Tuffin seigneurs de la
Rouairie (en 1533), Pouriel seigneurs de Chapifeu (en 1635), de Bregel
seigneurs de Mesguérin (avant 1723), du Pontavice seigneurs de
Saint-Laurent de Terregaste (en 1723 et en 1789) ;
![]() le
manoir de La Mariais (XVII-XVIIIème siècle), propriété de la famille
Boivent du XVIIème siècle jusqu'en 1791. On y trouve une croix portant la
date de 1707 et le nom de "Boivent" ;
le
manoir de La Mariais (XVII-XVIIIème siècle), propriété de la famille
Boivent du XVIIème siècle jusqu'en 1791. On y trouve une croix portant la
date de 1707 et le nom de "Boivent" ;
![]() la
maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Dancerie ;
la
maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Dancerie ;
![]() la
maison à tourelle (XVI-XVIIIème siècle), située 28 rue
Charles-de-Gaulle. Cette maison est remaniée au XVIIIème et au XXème siècles ;
la
maison à tourelle (XVI-XVIIIème siècle), située 28 rue
Charles-de-Gaulle. Cette maison est remaniée au XVIIIème et au XXème siècles ;
![]() la
maison de prêtre (1647) ;
la
maison de prêtre (1647) ;
![]() l'ancien
relais de Poste (XVIIème siècle) ;
l'ancien
relais de Poste (XVIIème siècle) ;
![]() les
piliers de porche (1766) de l'ancien presbytère ;
les
piliers de porche (1766) de l'ancien presbytère ;
![]() le
puits (XVIIIème siècle), situé au lieu-dit La Courtine ;
le
puits (XVIIIème siècle), situé au lieu-dit La Courtine ;
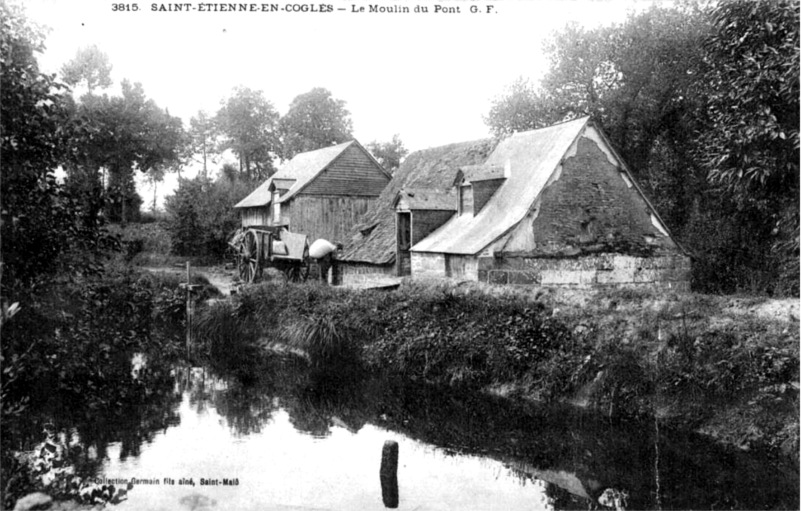
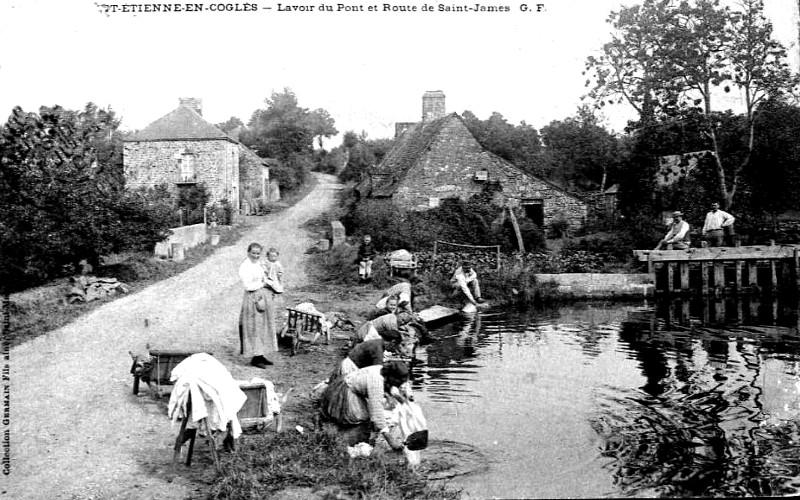
A signaler aussi :
![]() la
pierre à bassin (de l'époque primaire) ;
la
pierre à bassin (de l'époque primaire) ;
![]() la découverte
d'un ancien habitat daté du premier quart du 5ème millénaire avant Jésus-Christ ;
la découverte
d'un ancien habitat daté du premier quart du 5ème millénaire avant Jésus-Christ ;
![]() les
monuments présumés mégalithiques et situés au village du Rocher-Cutesson ;
les
monuments présumés mégalithiques et situés au village du Rocher-Cutesson ;
![]() les
maisons du XVIIème siècle situées au village du Croizé. Une maison date
de 1613 et une autre date de 1653 ;
les
maisons du XVIIème siècle situées au village du Croizé. Une maison date
de 1613 et une autre date de 1653 ;
![]() l'ancien
château de Saint-Etienne, situé route de Montours. Il était déjà ruiné
en 1623. Saint-Etienne est mentionné dès 1146. Il était le gage féodé
de la sergentise du Coglès et exerçait au bourg de Saint-Brice-en-Coglès
un droit de haute justice : son gibet se dressait sur la lande de
Saint-Eustache. C'était la maison seigneuriale de la paroisse de
Saint-Etienne-en-Coglès. Propriété successive des familles de la Bouëxière
seigneurs de Parigné, de Parthenay (en 1462), de Lorgeril (en 1488), de
Rohan (avant 1513), du comtes de Maure (en 1513), Rochechouart marquis de
Mortemart (à la fin du XVIème siècle), de Volvire marquis de Saint-Brice
(en 1654). Les seigneurs de Saint-Brice possédaient encore la demeure en 1789 ;
l'ancien
château de Saint-Etienne, situé route de Montours. Il était déjà ruiné
en 1623. Saint-Etienne est mentionné dès 1146. Il était le gage féodé
de la sergentise du Coglès et exerçait au bourg de Saint-Brice-en-Coglès
un droit de haute justice : son gibet se dressait sur la lande de
Saint-Eustache. C'était la maison seigneuriale de la paroisse de
Saint-Etienne-en-Coglès. Propriété successive des familles de la Bouëxière
seigneurs de Parigné, de Parthenay (en 1462), de Lorgeril (en 1488), de
Rohan (avant 1513), du comtes de Maure (en 1513), Rochechouart marquis de
Mortemart (à la fin du XVIème siècle), de Volvire marquis de Saint-Brice
(en 1654). Les seigneurs de Saint-Brice possédaient encore la demeure en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Cour de Saint-Etienne, situé route de Montours. Ses fourches
patibulaires à trois pots se dressaient sur la lande de Saint-Eustache.
Propriété de la famille de Botherel seigneurs de la Bretonnière en 1717.
Le manoir est afféagé en 1654 par le comte de Maure aux Recteurs de Saint-Etienne ;
l'ancien
manoir de la Cour de Saint-Etienne, situé route de Montours. Ses fourches
patibulaires à trois pots se dressaient sur la lande de Saint-Eustache.
Propriété de la famille de Botherel seigneurs de la Bretonnière en 1717.
Le manoir est afféagé en 1654 par le comte de Maure aux Recteurs de Saint-Etienne ;
![]() l'ancien
manoir de la Baucerie, situé route de Montours. Propriété de Jeanne du
Tiercent dame des Flégés en 1427 et en 1435, puis des familles Ferron
seigneurs des Flégés (en 1466 et en 1513), de Porcon, de la Marzelière,
et des seigneurs du Fail jusqu'en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Baucerie, situé route de Montours. Propriété de Jeanne du
Tiercent dame des Flégés en 1427 et en 1435, puis des familles Ferron
seigneurs des Flégés (en 1466 et en 1513), de Porcon, de la Marzelière,
et des seigneurs du Fail jusqu'en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Touche, situé route de Fougères. Propriété successive des
familles le Gaigneur seigneurs de Landecot (en 1435 et en 1513), du Feu
seigneurs de Landecot (en 1602). Il reste entre les mains des seigneurs de
Landecot jusqu'en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Touche, situé route de Fougères. Propriété successive des
familles le Gaigneur seigneurs de Landecot (en 1435 et en 1513), du Feu
seigneurs de Landecot (en 1602). Il reste entre les mains des seigneurs de
Landecot jusqu'en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir du Bois-Henry. Propriété de Guillemette le Bret dame de
Saint-Etienne, épouse de Guillaume le Bouteiller seigneur de la Chesnaye en
1427, puis des familles le Bouteiller, Marquet (en 1463), de Rohan (en
1513), de Maure (en 1545), de Rochechouart comtes de Maure (avant 1654), de
Bregel seigneurs de Mesguérin (en 1654), du Pontavice seigneurs de
Saint-Laurent de Terregaste (vers 1722) ;
l'ancien
manoir du Bois-Henry. Propriété de Guillemette le Bret dame de
Saint-Etienne, épouse de Guillaume le Bouteiller seigneur de la Chesnaye en
1427, puis des familles le Bouteiller, Marquet (en 1463), de Rohan (en
1513), de Maure (en 1545), de Rochechouart comtes de Maure (avant 1654), de
Bregel seigneurs de Mesguérin (en 1654), du Pontavice seigneurs de
Saint-Laurent de Terregaste (vers 1722) ;
![]() l'ancien
manoir de la Cocheraye ou de la Cottelais, situé route de
Saint-Marc-sur-Couësnon. Propriété successive des familles de Poulle, de
Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), Houduce (en 1431 et en 1461), Hochet (en 1773) ;
l'ancien
manoir de la Cocheraye ou de la Cottelais, situé route de
Saint-Marc-sur-Couësnon. Propriété successive des familles de Poulle, de
Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), Houduce (en 1431 et en 1461), Hochet (en 1773) ;
![]() l'ancien
manoir du Rocher-Hullé ou du Rochullé. Propriété successive des familles
Blanchard (en 1412), de la Lande (en 1545), Pierrard seigneurs du Pré (à
la fin du XVIème siècle), de Bonnefosse seigneurs de la Massonnaye (vers
1618), le Jeune seigneurs de la Tendraye, de Scelles seigneurs des
Champs-Bulant (en 1677), des Nos seigneurs de la Motte-Valory (en 1731) ;
l'ancien
manoir du Rocher-Hullé ou du Rochullé. Propriété successive des familles
Blanchard (en 1412), de la Lande (en 1545), Pierrard seigneurs du Pré (à
la fin du XVIème siècle), de Bonnefosse seigneurs de la Massonnaye (vers
1618), le Jeune seigneurs de la Tendraye, de Scelles seigneurs des
Champs-Bulant (en 1677), des Nos seigneurs de la Motte-Valory (en 1731) ;
![]() l'ancien
manoir de Landescot. Propriété des seigneurs de Landescot en 1150, puis
des familles de Poulle, de Porcon seigneur de Bonne-Fontaine (en 1427), le
Gaigneur (en 1435), du Feu seigneurs de la Hunelaye (vers 1602), le Saige
seigneurs de la Villesbrunes (en 1673 et en 1789) ;
l'ancien
manoir de Landescot. Propriété des seigneurs de Landescot en 1150, puis
des familles de Poulle, de Porcon seigneur de Bonne-Fontaine (en 1427), le
Gaigneur (en 1435), du Feu seigneurs de la Hunelaye (vers 1602), le Saige
seigneurs de la Villesbrunes (en 1673 et en 1789) ;
![]() l'ancien
manoir de la Frénouze. Propriété de Jeanne du Tiercent dame des Flégés
en 1427, puis de la famille Ferron seigneurs des Flégés en 1454 ;
l'ancien
manoir de la Frénouze. Propriété de Jeanne du Tiercent dame des Flégés
en 1427, puis de la famille Ferron seigneurs des Flégés en 1454 ;
![]() l'ancien
manoir du Fail ou du Feuil. Il relevait autrefois de la seigneurie de
Saint-Etienne et exerçait un droit de haute justice au bourg de
Saint-Hilaire des Landes. Propriété des seigneurs du Fail en 1157, puis
des familles de Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), de la Marzelière
(vers 1545), de la Haye seigneurs de la Haye en Saint-Hilaire, le Pelletier
seigneurs de Rosambo, de Montmorency (vers 1750), de la Haye seigneurs de la
Haye en Saint-Hilaire (en 1767) ;
l'ancien
manoir du Fail ou du Feuil. Il relevait autrefois de la seigneurie de
Saint-Etienne et exerçait un droit de haute justice au bourg de
Saint-Hilaire des Landes. Propriété des seigneurs du Fail en 1157, puis
des familles de Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), de la Marzelière
(vers 1545), de la Haye seigneurs de la Haye en Saint-Hilaire, le Pelletier
seigneurs de Rosambo, de Montmorency (vers 1750), de la Haye seigneurs de la
Haye en Saint-Hilaire (en 1767) ;

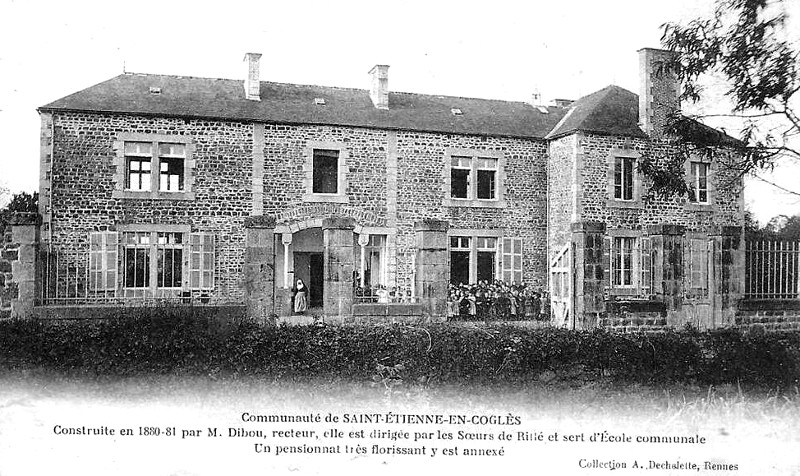
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-ETIENNE-EN-COGLES
La seigneurie de Saint-Etienne s'étendait en une douzaine de paroisses ; son château se trouvait au bord de la Loisance, près du village actuel de la Cour et des moulins de Saint-Etienne; « c'estoit — est-il dit en 1623 — une maison seigneurialle fermée de fossés qui apparoissent encore proche du bourg, laquelle maison est de longtemps en ruyne ». Cette seigneurie appartint successivement aux familles de Saint-Etienne, Le Bret, Le Bouteiller, de Parthenay, de Lorgeril, de Rohan, de Maure, de Rochechouart, de Volvire et Guérin de la Grasserie. Le seigneur de Saint-Etienne avait droit de coutumes sur les assemblées de Saint-Etienne qui s'y tenaient aux fêtes du 3 août et du 26 décembre.
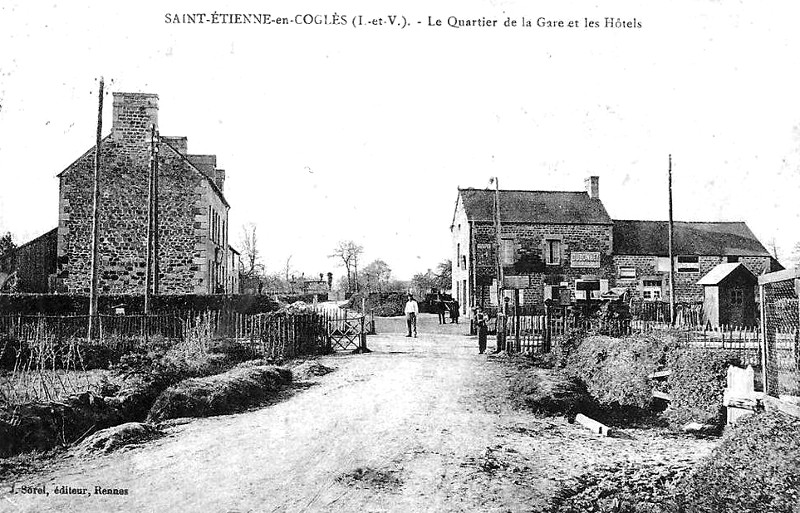
Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Jean Radouillet et Jean le Gendre, plusieurs nobles sont mentionnés à Saint-Etienne-en-Coglès :
![]() le
manoir de Saint Etienne appartenant à la dame du lieu ;
le
manoir de Saint Etienne appartenant à la dame du lieu ;
![]() le
manoir du Boishenry (Bois-Henry) à la susdite dame ;
le
manoir du Boishenry (Bois-Henry) à la susdite dame ;
![]() le
manoir de Vaugarin (Vaugarny) au sieur du Fretay ;
le
manoir de Vaugarin (Vaugarny) au sieur du Fretay ;
![]() le
manoir du Fail appartenant au sr. de Bonne-Fontaine ;
le
manoir du Fail appartenant au sr. de Bonne-Fontaine ;
![]() l'hôtel
de la Cocheraye et celui de Landescot qui furent à feu Robin de Poulle ;
l'hôtel
de la Cocheraye et celui de Landescot qui furent à feu Robin de Poulle ;
![]() l'hôtel
de la Daucerie (Baucerie) et celui de la Fresnouse appartenant à la dame de Flaige (Flégés).
l'hôtel
de la Daucerie (Baucerie) et celui de la Fresnouse appartenant à la dame de Flaige (Flégés).
Voir
![]() "
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de Saint-Etienne-en-Coglès
".
"
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de Saint-Etienne-en-Coglès
".
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "St Estienne en Coglais" :
- Gilles de La Roche : "Il est raporté par Gilles de La Roche que Gilles Le Gaigneux seigneur de Landécot est mort et décebdé, et a relaissé enffens myneurs et leurs héritaiges estre en baill à Foulgères. Et pour en informer il produict : Julian Le Vayer, Gilles du Feu qui ainsi l'ont par serment raporté. Et pour ce lesdictz myneurs excuséz.
Ce que a esté ordonné estre rédigé par escript. Et en estre délivré acte pour servir ausdictz myneurs. Et ce sauff au procureur du Roy et Duc à rechargez lesdictz myneurs, le baill finy".
(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.