|
Bienvenue chez les Malganais |
SAINT-MAUGAN |
Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Méen-le-Grand
La commune de
Saint-Maugan ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MAUGAN
Saint-Maugan vient de Malgand ou Maugand, abbé de Saint-Méen-le-Grand.
Saint-Maugan est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive d'Iffendic. Vers 1152, le territoire de Saint-Maugon appartient à l'abbaye Saint-Jacques de Montfort qui érige un prieuré sur les terres données par Geffroy Ferrier ou Fevrier, propriétaire du château de Vauferrier.

La paroisse de Saint-Maugand semble remonter tout au moins au XIIème siècle, car elle existait déjà en 1152, lorsque fut fondée l'abbaye de Montfort. Les religieux de ce monastère créèrent à Saint-Maugand un prieuré-cure. Le prieur-recteur est choisi à l'origine parmi les chanoines réguliers de Montfort et présenté à l'évêque par leur abbé. Les dîmes de la paroisse appartenaient au XVIIIème siècle, pour un tiers seulement, au prieur-recteur, et pour le reste au seigneur du Vauferrier (Pouillé de Rennes).
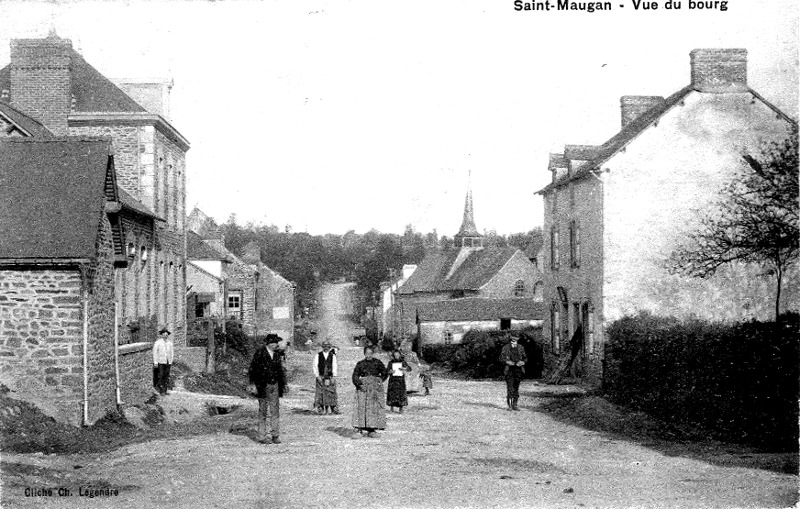
En 1642 Jean-Baptiste d'Andigné achète d'avec le duc de la Trémoille les fiefs de la Vairie d'Iffendic, s'étendant en Iffendic, Saint-Gonlay et Saint-Maugan, et faisant auparavant partie du comté de Montfort.Louis XIV, par lettres datées d'avril 1707, unit, en faveur de Charles-René d'Andigné, capitaine au régiment de la reine, les trois châtellenies de la Châsse, de Saint-Malon et de Cahideuc en une seule et même châtellenie sous le nom de la Châsse ; celle-ci étend alors sa haute justice en dix paroisses : Iffendic, Bléruais, Saint-Malon, Saint-Maugan, Saint-Gonlay, le Boisgervily, Monterfil, Paimpont, Saint-Jean de Montfort et Coulon (Archives du Parlement de Bretagne). La paroisse de Saint-Maugan dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. Les manoirs du Vauferrier, de la Houssaye, de la Haye, des Hêtres, etc ... sont connus dès 1370.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia de Sancto Magaldo (au XIIème siècle), ecclesia de Sancto Maugand (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Maugan : Guillaume Eberard (chanoine de Saint-Malo, décédé vers 1562). Frère Jean Hubert (chanoine régulier de Montfort, pourvu le 26 janvier 1562, résigna l'année suivante). Jean Faverays (prit possession en 1563 et résigna en 1565). Pierre Odye (fut pourvu en cour de Rome en 1565). Pierre Eder (décédé vers 1591). Frère Jean Corbes (religieux de Montfort, fut pourvu le 23 novembre 1591). Olivier Orain (prit possession le 24 janvier 1601 ; décédé en 1603). Frère Daniel Chorin (moine de Paimpont, prit possession le 1er juin 1603). Frère Olivier-Guillaume Desbois (en 1623, résigna en 1635). Frère Guy Le Moine (chanoine régulier de Paimpont, fut pourvu le 2 octobre 1635). Nicolas Le Feubvre (précéda le suivant). Jean Aussant (prêtre de Rennes, pourvu en 1641, résigna en faveur du suivant). Jean Le Tourneux (prêtre de Saint-Malo, fut pourvu en 1642 ; décédé vers 1667). Frère Michel Le Camus (fut pourvu le 16 février 1667). Louis Le Tanneux (rendit aveu au roi en 1679 et résigna en faveur du suivant). Marc Jollive (fut pourvu le 2 septembre 1682 ; décédé en 1719). Julien Macé (fut pourvu le 31 mars 1719 ; décédé vers 1744). Jean-Baptiste Foucher ( fut pourvu le 21 janvier 1744 ; décédé en 1758). Michel Foucher (fut pourvu le 24 octobre 1758 ; décédé en 1786). Pierre Rolland (chapelain de la Châsse, fut pourvu le 17 avril 1786 ; il gouverna jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en 1803 ; décédé en 1814). Pierre Courtel (1814-1831). Julien Denieul (1832-1840). Joseph Depoix (1840-1864). N... Lefranc (1864-1873). Guillaume Rolland (à partir de 1873), .....
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances de Saint-Maugan en 1789
".
"
Le
cahier de doléances de Saint-Maugan en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de SAINT-MAUGAN
![]() l'église
Saint-Maugan (XII-XIXème siècle), restaurée entre 1830 et 1836 par le
vicomte du Pontavice. Dédiée à saint Malgand ou Maugan ou Maugand, abbé
breton fêté le 24 septembre, cette église est ancienne, mais sans
architecture. Elle se compose d'une simple nef terminée par un chevet
droit, et ayant au Sud une seule chapelle communiquant avec elle par une
double arcade gothique. Cette partie de l'église, aussi bien que le choeur,
semble des XVème et XVIème siècles, mais le bas de la nef a été
reconstruit en 1719. Les droits de supériorité appartenaient, à
l'origine, en cette église au sire de Montfort ; mais le duc de la Trémoille
ayant vendu, en 1642, son fief de Saint-Maugan à Jean-Baptiste d'Andigné,
seigneur de la Châsse, celui-ci devint premier prééminencier à
Saint-Maugan (Saint-Maugand). Quant au droit de fondateur et aux autres prééminences,
ils appartenaient au seigneur du Vauferrier, à cause, semble-t-il, de son
fief de la Baudonnière ; aussi ce seigneur avait-il en 1682 un banc, un
enfeu, une litre et ses armoiries dans l'église de Saint-Maugan (nota : le
seigneur du Vauferrier jouissait aussi en 1679 d'un droit de quintaine sur
les mariés de la paroisse - Archives Nationales, P. 1710). A la même époque,
le seigneur de la Basse-Ardaine y jouissait aussi de quelques prééminences.
Actuellement on remarque encore dans l'église de SaintMaugan deux
tombeaux arqués, l'un dans le choeur, du côté de l'évangile, et l'autre
dans la nef. La labe du chanceau est ornementée dans le style fleuri du
XVème siècle ; elle renferme une pierre tombale qui porte gravées sous
deux arcatures trilobées une croix et une épée ; mais il n'y a point
d'inscription. Quant à la chapelle placée au Sud de la nef, elle devait être
prohibitive à l'origine et appartenir aux seigneurs du Vauferrier, car on y
voit encore dans une fenêtre les armoiries de cette famille : d'or au
chef de sable. A propos de cette verrière, rappelons qu'il existait
jadis une fabrique de vitraux peints à Saint-Maugan ; elle était tenue en
1654 par le verrier italien Damiano Racheto, qui obtint alors des lettres de
naturalisation (Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
XII, 199). La confrérie du Rosaire fut érigée en cette église, le 8
septembre 1634, par le P. Rolland Doré, dominicain du couvent de Dinan ;
elle a été rétablie en 1818. Une messe matinale fut fondée pour chaque
dimanche, en 1754, par Malo Blanchard et Renée Le Vayer, seigneur et dame
de la Buharaye, ainsi que par leur fils Malo Blanchard, alors diacre. Le
chapelain jouissait de 60 livres de rente (Pouillé de Rennes). L'église se compose d'une nef à chevet
droit accostée au sud d'une chapelle (XV-XVIème siècle) appartenant jadis
aux seigneurs du Vauferrier. Le seigneur de Cahideuc avaient également des prééminences
en l'église de Saint-Maugan. La chapelle communique à l'intérieur avec la
nef par une double arcade en arc brisé reposant sue une colonne centrale.
Le bas de la nef date de 1719. Les vestiges de l'ancien édifice roman,
prieuré-cure fondé par l'abbaye Saint-Jean, sont visibles dans le mur-nord
de la nef. Le mur sud possède un cadran solaire en ardoise aux armes des
seigneurs du Vauferrier et de leurs alliances. La sacristie date de 1730. La
statue de saint Maugan date du XVIIIème siècle. On y trouve un banc seigneurial qui
date du XVIIème siècle. On trouve aussi dans le choeur et dans la nef deux
tombes-arcades et des pierres tombales. Cette église est délabrée en 1925 et rénovée en 1946 ;
l'église
Saint-Maugan (XII-XIXème siècle), restaurée entre 1830 et 1836 par le
vicomte du Pontavice. Dédiée à saint Malgand ou Maugan ou Maugand, abbé
breton fêté le 24 septembre, cette église est ancienne, mais sans
architecture. Elle se compose d'une simple nef terminée par un chevet
droit, et ayant au Sud une seule chapelle communiquant avec elle par une
double arcade gothique. Cette partie de l'église, aussi bien que le choeur,
semble des XVème et XVIème siècles, mais le bas de la nef a été
reconstruit en 1719. Les droits de supériorité appartenaient, à
l'origine, en cette église au sire de Montfort ; mais le duc de la Trémoille
ayant vendu, en 1642, son fief de Saint-Maugan à Jean-Baptiste d'Andigné,
seigneur de la Châsse, celui-ci devint premier prééminencier à
Saint-Maugan (Saint-Maugand). Quant au droit de fondateur et aux autres prééminences,
ils appartenaient au seigneur du Vauferrier, à cause, semble-t-il, de son
fief de la Baudonnière ; aussi ce seigneur avait-il en 1682 un banc, un
enfeu, une litre et ses armoiries dans l'église de Saint-Maugan (nota : le
seigneur du Vauferrier jouissait aussi en 1679 d'un droit de quintaine sur
les mariés de la paroisse - Archives Nationales, P. 1710). A la même époque,
le seigneur de la Basse-Ardaine y jouissait aussi de quelques prééminences.
Actuellement on remarque encore dans l'église de SaintMaugan deux
tombeaux arqués, l'un dans le choeur, du côté de l'évangile, et l'autre
dans la nef. La labe du chanceau est ornementée dans le style fleuri du
XVème siècle ; elle renferme une pierre tombale qui porte gravées sous
deux arcatures trilobées une croix et une épée ; mais il n'y a point
d'inscription. Quant à la chapelle placée au Sud de la nef, elle devait être
prohibitive à l'origine et appartenir aux seigneurs du Vauferrier, car on y
voit encore dans une fenêtre les armoiries de cette famille : d'or au
chef de sable. A propos de cette verrière, rappelons qu'il existait
jadis une fabrique de vitraux peints à Saint-Maugan ; elle était tenue en
1654 par le verrier italien Damiano Racheto, qui obtint alors des lettres de
naturalisation (Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,
XII, 199). La confrérie du Rosaire fut érigée en cette église, le 8
septembre 1634, par le P. Rolland Doré, dominicain du couvent de Dinan ;
elle a été rétablie en 1818. Une messe matinale fut fondée pour chaque
dimanche, en 1754, par Malo Blanchard et Renée Le Vayer, seigneur et dame
de la Buharaye, ainsi que par leur fils Malo Blanchard, alors diacre. Le
chapelain jouissait de 60 livres de rente (Pouillé de Rennes). L'église se compose d'une nef à chevet
droit accostée au sud d'une chapelle (XV-XVIème siècle) appartenant jadis
aux seigneurs du Vauferrier. Le seigneur de Cahideuc avaient également des prééminences
en l'église de Saint-Maugan. La chapelle communique à l'intérieur avec la
nef par une double arcade en arc brisé reposant sue une colonne centrale.
Le bas de la nef date de 1719. Les vestiges de l'ancien édifice roman,
prieuré-cure fondé par l'abbaye Saint-Jean, sont visibles dans le mur-nord
de la nef. Le mur sud possède un cadran solaire en ardoise aux armes des
seigneurs du Vauferrier et de leurs alliances. La sacristie date de 1730. La
statue de saint Maugan date du XVIIIème siècle. On y trouve un banc seigneurial qui
date du XVIIème siècle. On trouve aussi dans le choeur et dans la nef deux
tombes-arcades et des pierres tombales. Cette église est délabrée en 1925 et rénovée en 1946 ;
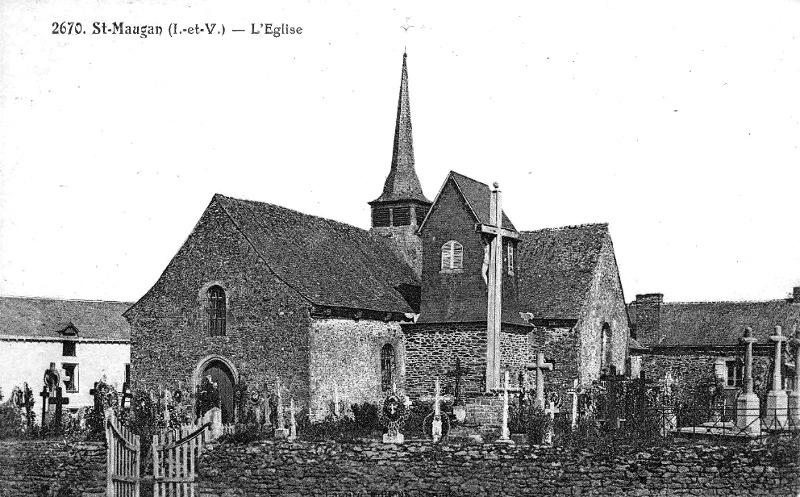
![]() la
chapelle Saint-Antoine (XVII-XIXème siècle), située au lieu-dit Le
Paillouis et restaurée au XIXème siècle. Au dessus de la porte du
transept sud se trouve un écusson martelé et qui porte la date de 1663 ;
la
chapelle Saint-Antoine (XVII-XIXème siècle), située au lieu-dit Le
Paillouis et restaurée au XIXème siècle. Au dessus de la porte du
transept sud se trouve un écusson martelé et qui porte la date de 1663 ;
![]() l'ancien
prieuré de Saint-Maugan (ou Saint-Maugand), aujourd'hui disparu, et jadis
membre de l'abbaye de Montfort. Lorsque fut fondée l'abbaye de Montfort en
1152, Geffroy Fevrier ou Ferrier donna un champ en Saint-Maugan au nouveau
monastère avec le consentement de ses fils ; en même temps, les trois fils
d'un nommé Bernard abandonnèrent aux moines leur dîme, et deux autres
personnages, Gautier et Hervé, engagèrent leur portion en faveur du monastère
pour la somme de 9 sols : « Sancto Magaldo, Gaufridus Fevreri dedit
campum concedentibus filiis suis ; tres filii Bernardi dederunt decimam suam,
duo vero reliqui Gauterius et Herveus in vadimonium tradiderunt suam partem
pro novem solidis ». (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I,
615). C'est de cette famille Ferrier que durent descendre les seigneurs du
Vau-Ferrier (Vauferrier), en Saint-Maugan, qui étaient encore au XVIIIème
siècle seigneurs fondateurs de la paroisse. Cette donation fut probablement
l'origine du prieuré-cure de Saint-Maugan, et de cette paroisse sortit
Guillaume de Saint-Maugand, élu abbé de Montfort vers l'an 1190. Les
comtes de Montfort, naturellement seigneurs supérieurs de ce prieuré établi
dans leur fief, voulurent que le titulaire célébrât « quatre services
solennels aux quatre grandes fêtes de l'année, avec prières nominales »
pour leurs ancêtres (Déclaration du comté de Montfort en 1682). Le 2 mai
1679, le prieur-recteur Louis Le Tanneux rendit aveu au roi pour son bénéfice
; il possédait alors : un logis prioral et presbytéral avec cour, écurie
et pressoir ; — un petit jardin ; — un petit vivier ; — un petit
verger ; — la pièce de la Châtaigneraye ; — le clos de l'Aumône ; —
une prée de 3 journées ; — un petit bois de haute futaie ; — le tiers
des dîmes de toutes espèces de grains, lins et chanvres, en Saint-Maugan ;
— le tiers des dîmes de blateries, comme seigle, avoine et bled noir, en
Iffendic ; — enfin, une rente de 15 deniers sur une maison sise au village
de la Croix-Mahéac (Archives départementales de la Loire-Inférieure).
Tout cela ne rapportait qu'environ 800 livres de revenu au XVIIIème siècle
encore y avait-il tant de charges à remplir, qu'en 1730 le prieur-recteur
Julien Macé déclara au bureau diocésain de Saint-Malo que les revenus de
son bénéfice ne montaient, toutes charges déduites, qu'à la très-minime
somme de 124 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). A cette
époque et depuis quelque temps déjà, les chanoines réguliers de Montfort
avaient abandonné l'administration de Saint-Maugan à des prêtres séculiers
; le dernier prieur-recteur appartenant à leur congrégation fut frère
Michel Le Camus, nommé en 1667 (abbé Guillotin de Corson). Son successeur,
Louis Le Tanneux, fit enregistrer les armoiries suivantes : d'azur au
chevron d'or chargé de trois croisettes d'azur (Armorial général ms. de 1698) ;
l'ancien
prieuré de Saint-Maugan (ou Saint-Maugand), aujourd'hui disparu, et jadis
membre de l'abbaye de Montfort. Lorsque fut fondée l'abbaye de Montfort en
1152, Geffroy Fevrier ou Ferrier donna un champ en Saint-Maugan au nouveau
monastère avec le consentement de ses fils ; en même temps, les trois fils
d'un nommé Bernard abandonnèrent aux moines leur dîme, et deux autres
personnages, Gautier et Hervé, engagèrent leur portion en faveur du monastère
pour la somme de 9 sols : « Sancto Magaldo, Gaufridus Fevreri dedit
campum concedentibus filiis suis ; tres filii Bernardi dederunt decimam suam,
duo vero reliqui Gauterius et Herveus in vadimonium tradiderunt suam partem
pro novem solidis ». (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I,
615). C'est de cette famille Ferrier que durent descendre les seigneurs du
Vau-Ferrier (Vauferrier), en Saint-Maugan, qui étaient encore au XVIIIème
siècle seigneurs fondateurs de la paroisse. Cette donation fut probablement
l'origine du prieuré-cure de Saint-Maugan, et de cette paroisse sortit
Guillaume de Saint-Maugand, élu abbé de Montfort vers l'an 1190. Les
comtes de Montfort, naturellement seigneurs supérieurs de ce prieuré établi
dans leur fief, voulurent que le titulaire célébrât « quatre services
solennels aux quatre grandes fêtes de l'année, avec prières nominales »
pour leurs ancêtres (Déclaration du comté de Montfort en 1682). Le 2 mai
1679, le prieur-recteur Louis Le Tanneux rendit aveu au roi pour son bénéfice
; il possédait alors : un logis prioral et presbytéral avec cour, écurie
et pressoir ; — un petit jardin ; — un petit vivier ; — un petit
verger ; — la pièce de la Châtaigneraye ; — le clos de l'Aumône ; —
une prée de 3 journées ; — un petit bois de haute futaie ; — le tiers
des dîmes de toutes espèces de grains, lins et chanvres, en Saint-Maugan ;
— le tiers des dîmes de blateries, comme seigle, avoine et bled noir, en
Iffendic ; — enfin, une rente de 15 deniers sur une maison sise au village
de la Croix-Mahéac (Archives départementales de la Loire-Inférieure).
Tout cela ne rapportait qu'environ 800 livres de revenu au XVIIIème siècle
encore y avait-il tant de charges à remplir, qu'en 1730 le prieur-recteur
Julien Macé déclara au bureau diocésain de Saint-Malo que les revenus de
son bénéfice ne montaient, toutes charges déduites, qu'à la très-minime
somme de 124 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). A cette
époque et depuis quelque temps déjà, les chanoines réguliers de Montfort
avaient abandonné l'administration de Saint-Maugan à des prêtres séculiers
; le dernier prieur-recteur appartenant à leur congrégation fut frère
Michel Le Camus, nommé en 1667 (abbé Guillotin de Corson). Son successeur,
Louis Le Tanneux, fit enregistrer les armoiries suivantes : d'azur au
chevron d'or chargé de trois croisettes d'azur (Armorial général ms. de 1698) ;
![]() le
manoir ou château du Vauferrier (1370 – XVIIème siècle).
Il est accosté de deux grands pavillons peu saillants. On y trouve les armes de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier.
Propriété de Jehan du Vauferrier (ou Vauferie) en 1480. Il possédait autrefois une chapelle privée désaffectée dès le
XVIIème siècle (elle était abandonnée et presque en ruine dès 1708). Il avait jadis un droit de haute justice et un droit de
quintaine. Propriété de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier (en 1370 et au XVIIIème siècle) ;
le
manoir ou château du Vauferrier (1370 – XVIIème siècle).
Il est accosté de deux grands pavillons peu saillants. On y trouve les armes de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier.
Propriété de Jehan du Vauferrier (ou Vauferie) en 1480. Il possédait autrefois une chapelle privée désaffectée dès le
XVIIème siècle (elle était abandonnée et presque en ruine dès 1708). Il avait jadis un droit de haute justice et un droit de
quintaine. Propriété de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier (en 1370 et au XVIIIème siècle) ;
![]() le
manoir de la Basse-Ardaine (1903). Il possédait jadis une chapelle privée,
signalée en 1682 et fondée de messes. Propriété successive des
familles du Vau-Ferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas
(au XVIIIème siècle), Bésuchet, Pontavice. Propriété de Jehan du Vauferrier
(ou Vauferie) en 1480. Ce manoir est reconstruit en 1903 par la famille Pontavice ;
le
manoir de la Basse-Ardaine (1903). Il possédait jadis une chapelle privée,
signalée en 1682 et fondée de messes. Propriété successive des
familles du Vau-Ferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas
(au XVIIIème siècle), Bésuchet, Pontavice. Propriété de Jehan du Vauferrier
(ou Vauferie) en 1480. Ce manoir est reconstruit en 1903 par la famille Pontavice ;
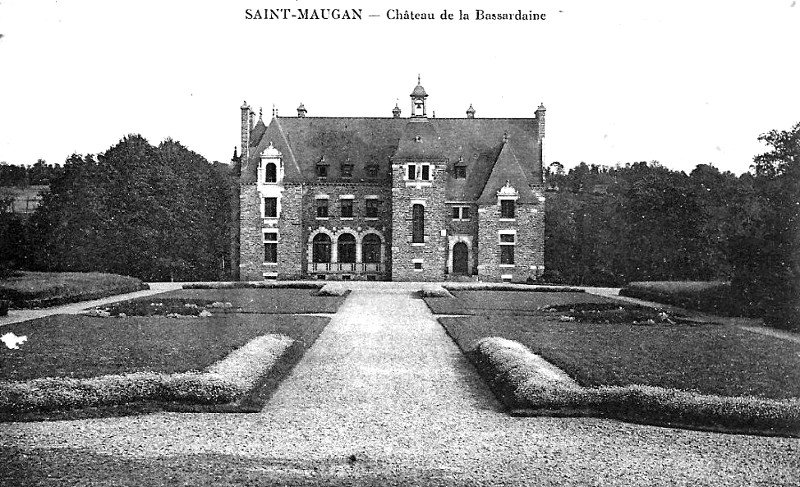
A signaler aussi :
![]() le
manoir de Monteray ou Monterey, situé route de Bois-Gervilly et reconstruit. Il possédait
jadis une chapelle privée reconstruite. L'ancienne chapelle Saint-Augustin de
ce manoir, fondée de messes, n'existe plus. Mais la famille de Farcy, qui
possède à la fin du XIXème siècle Montoray, y a construit une belle
chapelle gothique dédiée à saint Augustin et desservie parfois. Propriété successive des familles
Damont seigneurs de la Régnerais (en 1427), Josses (en 1513), la Pastellière de Lespinay ;
le
manoir de Monteray ou Monterey, situé route de Bois-Gervilly et reconstruit. Il possédait
jadis une chapelle privée reconstruite. L'ancienne chapelle Saint-Augustin de
ce manoir, fondée de messes, n'existe plus. Mais la famille de Farcy, qui
possède à la fin du XIXème siècle Montoray, y a construit une belle
chapelle gothique dédiée à saint Augustin et desservie parfois. Propriété successive des familles
Damont seigneurs de la Régnerais (en 1427), Josses (en 1513), la Pastellière de Lespinay ;


![]() l'ancien
manoir de la Moussardière, situé route de Bois-Gervilly. Propriété de la
famille de Saint-Malon (en 1427 et en 1449), puis de la famille Picart (en 1513) ;
l'ancien
manoir de la Moussardière, situé route de Bois-Gervilly. Propriété de la
famille de Saint-Malon (en 1427 et en 1449), puis de la famille Picart (en 1513) ;
![]() l'ancien
manoir de la Sauvelière, situé route de Muel. Propriété de la famille de la Chasse (en 1427 et en 1513) ;
l'ancien
manoir de la Sauvelière, situé route de Muel. Propriété de la famille de la Chasse (en 1427 et en 1513) ;
![]() l'ancien
manoir de la Piverdière, situé route de Muel. Propriété de la famille Guelier en 1449 ;
l'ancien
manoir de la Piverdière, situé route de Muel. Propriété de la famille Guelier en 1449 ;
![]() l'ancien
manoir de la Haie-des-Hêtres, situé route de Muel. Propriété successive des
familles Vauferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas (au XVIIIème siècle) ;
l'ancien
manoir de la Haie-des-Hêtres, situé route de Muel. Propriété successive des
familles Vauferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas (au XVIIIème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir de la Cognardière. Propriété successive des familles Miniac (en 1427), Roux (en 1449), Ivignac (en 1513) ;
l'ancien
manoir de la Cognardière. Propriété successive des familles Miniac (en 1427), Roux (en 1449), Ivignac (en 1513) ;

![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-MAUGAN
Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à St-Malgaud (Saint-Maugan) les nobles suivants : J. seigneur du Vauferrié, au Vauferrié, y a métaïer et à la Brouce ; Item l'hostel de la houze des hestres. J. du Vauxferrié, seigneur de la Bassardaine. Louys de la Chasse, à la Saunelière. J. fils Damon ou Damien de la Regneraie, à l'hotel de Montorray. G. de St Maslon, à la Moussardière. J. Des Estres, à la Houssaie. J. Deminiac ou Meniac, à la Corgnardière. Geffroy Guetier. Piere Godet, noble. (douteux.) Guillemet Simon, se dit noble et plède avec les Paroissiens. (H. Des Salles).
Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1449 sont mentionnés à Saint-Mangant (Saint-Maugan) les nobles suivants : Le sr. de Vauxferié, aud. lieu. J. de Vauxferier, à la Vassardaine. P. de St Malon, à la Mousardie. J. Pillet, à la Heriesonaye. La veuve J. de Breneuc. Alain Corahi, à la Haye des hestres. Guyon Rouxel, à Cornardie. Gillet Virmon, à la Hissardière. Le sr. de la Chasse, à la Sarfluerière. G. Guelier, à la Puiredière. (H. Des Salles).
Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 6 nobles de Saint-Maugan :
![]() Messire Jehan DU
VAUFERIE de Vauferrier (100 livres de revenu), époux de Renée Le Brun,
remplacé par Jehan et Guillaume : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
Messire Jehan DU
VAUFERIE de Vauferrier (100 livres de revenu), époux de Renée Le Brun,
remplacé par Jehan et Guillaume : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;
![]() Guillaume
DU VAUFERIE (12 livres de revenu) : défaillant ;
Guillaume
DU VAUFERIE (12 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Jehan
DU VAUFERIE de Bassardaine (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
Jehan
DU VAUFERIE de Bassardaine (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;
![]() Briand
GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;
Briand
GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Veuve
de Guillaume GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;
Veuve
de Guillaume GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Guillaume
SIMON (10 livres de revenu) : défaillant ;
Guillaume
SIMON (10 livres de revenu) : défaillant ;
Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Maulgan (Saint-Maugan) les nobles suivants : - Jehan du Vau-Ferrié, a la maison, le manoir et les deux métairies du Vau-Ferrié et de la Brouce, les plus nobles et anciennes de lad. paroisse ; a rentes, juridiction, devoir noble, sergent annuel affranchi, et a quelques rotures adjointes. - Rolland du Vau-Ferrié, noble personne, tient le lieu et domaine de la Bassardaine, y a quelques rot. (rotures). - Jean Picart, noble personne, tient la maison et domaine de la Moussardière, qui est noble. - Olivier Josses, noble personne, tient la maison et métairie de Mont-Horay ; et y acquit Jehan Josses, son ayeul, quatre journaux roturiers, plus deux autres journ. et 1/2. - Jehan de la Chasse, noble homme, possède la maison et métairie de la Saulvelière qui est noble, et y joint quelques rotures. - Jehan d'Evigniac, noble homme, a une maison et métairie noble, nommée la Corgnardière, que tenait autre Jehan, père de celuy-cy. - Jehan Kallouet, a une métairie noble, nommée la Haye, que tenait en son temps noble homme Jean Cogallu, et y ajouta six journaux roturiers. - Gilles Pillet, noble homme, tient une met. (métairie) noble, nommée la Herisaudière, que tenait Jean Belbinou, décédé. - Perrine Bino, damoiselle, veuve de nob. (noble) homme Jean du Vau-Ferrié, possède, elle et ses enfans mineurs, plusieurs terres roturières qu'acquit noble homme Guillaume du Vau-Ferrié, père dud. Jehan, et ledit Jehan de divers particuliers, gens portables. - Thomas Gautier, noble homme, a quelque rot. (rotures). - Gilles Gautier, noble homme, tient six journaux et maison roturière, acquise par Louis Gautier, son père. - Gilles Guellier, et ses frères et sœurs, tiennent par le décès de Guillaume Guellier, leur père, environ sept journaux 1/2, plus deux journaux 1/2, acquis d'un nommé Jean Guellier, le tout roturier, et les ont lesd. frères et sœurs partagez teste à teste (tête à tête). - Guillaume Pynel, homme roturier, portable et mécanique, tient une maison et environ quatre journeaux, et n'en veut rien payer. (H. Des Salles).
© Copyright - Tous droits réservés.