|
Bienvenue chez les Sulpiciens |
SAINT-SULPICE-DES-LANDES |
Retour page d'accueil Retour Canton de Grand-Fougeray
La commune de
Saint-Sulpice-des-Landes ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-SULPICE-DES-LANDES
L'existence de la paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes " sancto Sulpicio " est attestée par un écrit de 1190. En effet vers 1190, vit un nommé Joseph, prêtre ou recteur de Saint-Sulpice "Josephus presbyter de Sancto-Sulpicio". Il est témoin d'une donation faite au prieuré de Béré par Eudes, seigneur de Pontchâteau (Bulletin de la Société archéologique de Nantes, III, 32). Les seigneurs de la Roche-Giffart prétendent être les fondateurs de la paroisse.
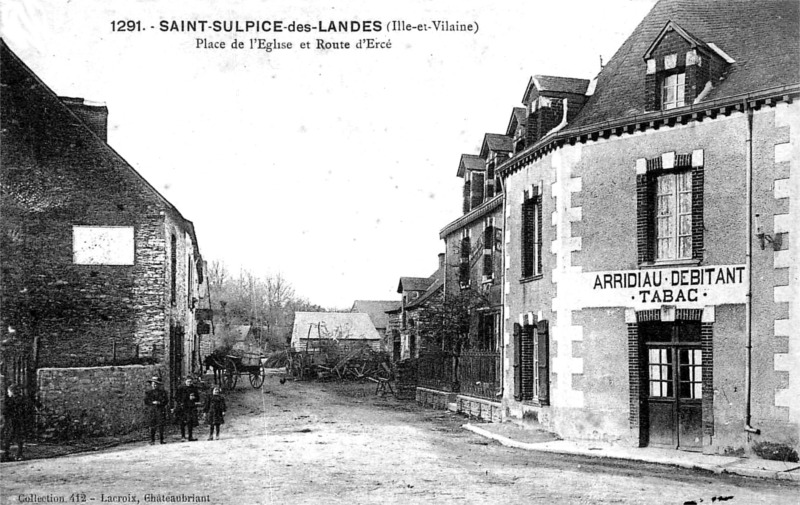
Dans un aveu de 1644, la paroisse de Saint-Sulpice des Landes fait partie de la châtellenie de Fougeray, érigée en marquisat en 1663. La paroisse dépend du doyenné de Bain-de-Bretagne jusqu'en 1802, date à laquelle elle est rattachée à Fougeray. La paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes dépendait jusqu'au XVIIIème siècle de l'ancien évêché de Nantes avant d'être rattachée à celui de Rennes.
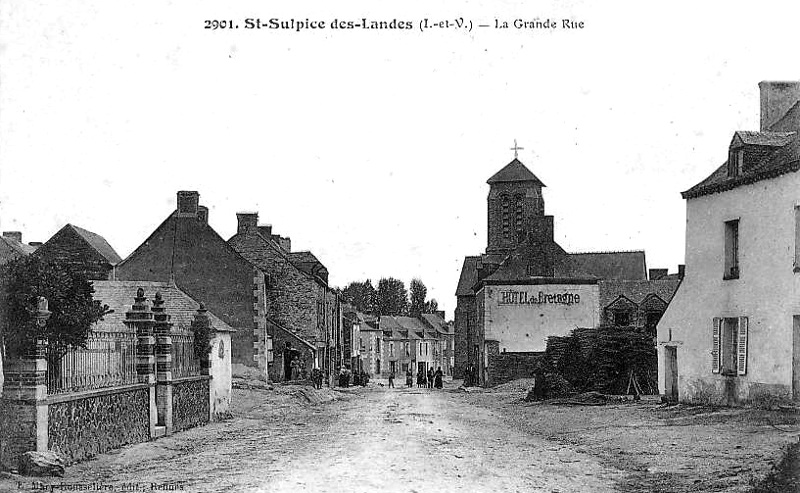
Nous manquons de documents sur cette paroisse dont le recteur, présenté par l'ordinaire, n'avait qu'environ 300 livres de rente, d'après le Rôle ms. diocésain de 1646.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Sancto Sulpicio (en 1190), Parochia Sancti Sulpitii de Landis (en 1516).
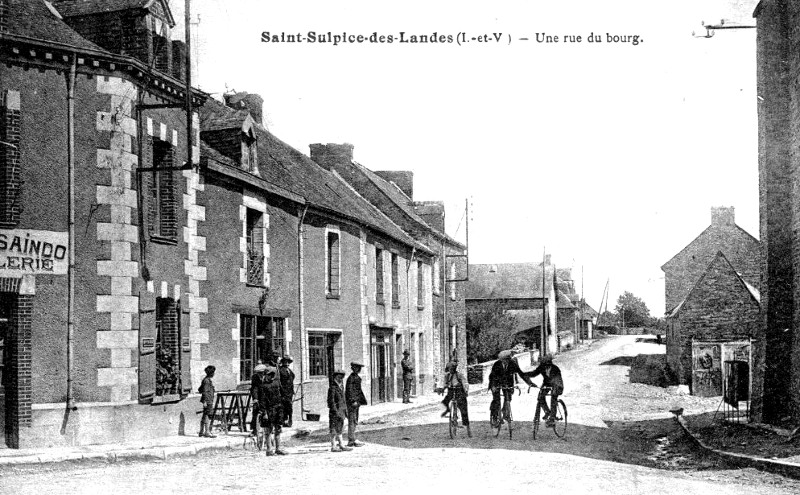
Nota : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes : Joseph, "Josephus presbyter de Sancto Sulpicio", vers 1190, D. Jonet ou N.. Jouet (1513-1536), N... Grigorel (1536-1550), ..., François Bodet (1615-1630), Jean Bodet (1630- 1654), Julien Rouxel (1654-1667), Julien Massicot (1667-167.), Jean Coupel (167.- 1696), Julien Coupel, sieur de la Chapelle (1696-1706), Jean-Baptiste Coupel (pourvu le 23 mai 1705 et jusqu'en 1711), Alain Bonnec ou Le Bocmet (1712-1716), Julien Bosse (1716-1734), Zacharie Le Brun (1734-1740), Pierre Rouxel (1740-1741), René-François Filion (1741-1758), Jean-Baptiste Hautbois (1759-1776), Jean-François Lefeuvre (1776-1783), Michel Gervais (1783-1814), Mathurin Punelle (1814-1849), Pierre Lamy (1849-1867), Louis Thomas (à partir de 1867), ....
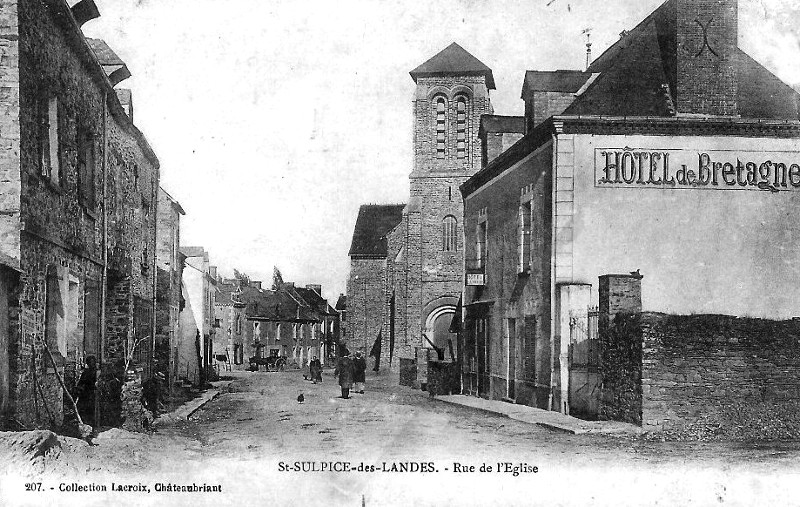
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances de Saint-Sulpice-des-Landes en 1789
".
"
Le
cahier de doléances de Saint-Sulpice-des-Landes en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de SAINT-SULPICE-DES-LANDES
![]() l'église
Saint-Sulpice (1886-1888), oeuvre de l'architecte Arthur Regnault et édifiée à l'emplacement d'une église
primitive fondée par les seigneurs de la Roche-Giffart. Saint Sulpice, évêque de Bourges, est le patron
de cette église. L'ancienne église était un édifice sans grand intérêt, composé d'une
seule nef avec chevet droit. Cependant dans ce temple on retrouvait des traces de style roman :
c'était une meurtrière du XIème siècle, ouverte dans le mur septentrional de la nef. Quant au chevet, ajouré
d'une fenêtre ogivale en partie bouchée, il devait être du XVème ou XVIème siècle. Le reste
de l'édifice, encore plus moderne, était complètement insignifiant. En
1680, Louis de Bourbon, prince de Condé et baron de Châteaubriant, se disait, en qualité de seigneur de Teillay, seigneur
supérieur et fondateur de Saint-Sulpice. Mais le seigneur de la Roche-Giffart prétendait bien avoir en cette église
toutes les prééminences, et de fait il en jouissait au XVIIIème siècle. La confrérie du Rosaire fut érigée
à Saint-Sulpice le 15 août 1682 par le P. Crosnier, prieur de Bonne-Nouvelle, à la requête du recteur Jean Coupel,
qui abandonna aux confrères toutes les oblations auxquelles il avait droit à l'autel de la Sainte-Vierge. Deux ans plus tard, en
1684, fut instituée la confrérie de Saint-Etienne ; elle ne tarda pas à devenir si
nombreuse que sa fête patronale devint un jour d'assemblée, à cause des confrères qui se réunissaient à Saint-Sulpice de
toutes les paroisses voisines. Il y avait aussi dans cette église quelques autres fondations,
telles que celles d'Ardaine, de Lande-Pendue et des Rivières (Pouillé de
Rennes). Sur le maître-autel se voyait jadis les armes de Jean-Sébastien de Kerhoënt
de Kergournadec'h marquis de Coëtenfao, marié vers 1730 à Innocente
Catherine de Rougé, dame de la Roche-Giffart. Les verrières de l'église
actuelle représentant saint Pierre et saint Paul, oeuvre des maîtres-verriers
Lecomte et Colin, datent de 1891. Le maître-autel est une donation de la
famille Récipon (ou Récipron), propriétaire de la Roche-Giffart ;
l'église
Saint-Sulpice (1886-1888), oeuvre de l'architecte Arthur Regnault et édifiée à l'emplacement d'une église
primitive fondée par les seigneurs de la Roche-Giffart. Saint Sulpice, évêque de Bourges, est le patron
de cette église. L'ancienne église était un édifice sans grand intérêt, composé d'une
seule nef avec chevet droit. Cependant dans ce temple on retrouvait des traces de style roman :
c'était une meurtrière du XIème siècle, ouverte dans le mur septentrional de la nef. Quant au chevet, ajouré
d'une fenêtre ogivale en partie bouchée, il devait être du XVème ou XVIème siècle. Le reste
de l'édifice, encore plus moderne, était complètement insignifiant. En
1680, Louis de Bourbon, prince de Condé et baron de Châteaubriant, se disait, en qualité de seigneur de Teillay, seigneur
supérieur et fondateur de Saint-Sulpice. Mais le seigneur de la Roche-Giffart prétendait bien avoir en cette église
toutes les prééminences, et de fait il en jouissait au XVIIIème siècle. La confrérie du Rosaire fut érigée
à Saint-Sulpice le 15 août 1682 par le P. Crosnier, prieur de Bonne-Nouvelle, à la requête du recteur Jean Coupel,
qui abandonna aux confrères toutes les oblations auxquelles il avait droit à l'autel de la Sainte-Vierge. Deux ans plus tard, en
1684, fut instituée la confrérie de Saint-Etienne ; elle ne tarda pas à devenir si
nombreuse que sa fête patronale devint un jour d'assemblée, à cause des confrères qui se réunissaient à Saint-Sulpice de
toutes les paroisses voisines. Il y avait aussi dans cette église quelques autres fondations,
telles que celles d'Ardaine, de Lande-Pendue et des Rivières (Pouillé de
Rennes). Sur le maître-autel se voyait jadis les armes de Jean-Sébastien de Kerhoënt
de Kergournadec'h marquis de Coëtenfao, marié vers 1730 à Innocente
Catherine de Rougé, dame de la Roche-Giffart. Les verrières de l'église
actuelle représentant saint Pierre et saint Paul, oeuvre des maîtres-verriers
Lecomte et Colin, datent de 1891. Le maître-autel est une donation de la
famille Récipon (ou Récipron), propriétaire de la Roche-Giffart ;

![]() l'ancienne
chapelle Saint-Léonard, que les seigneurs de la Roche-Giffart brûlèrent
par haine du catholicisme, en 1659-1661. Saint-Léonard de la Roche-Giffart
se trouvait dans la cour de ce château ; elle avait été fondée de messes
par un prêtre nommé Mathurin Pigeaut ; mais les seigneurs de la Roche-Giffart
ayant embrassé le protestantisme, laissèrent ce sanctuaire tomber en
ruine. Toutefois, en avril 1648, Samuel de la Chapelle, seigneur de Careil et fils du seigneur de la
Roche-Giffart, abjura ses erreurs et entra à l'Oratoire de Paris ; il
devint plus tard prêtre oratorien et prieur de la Chapelle-Glain. Le 17
juillet 1659, cet ecclésiastique fut pourvu par l'évêque de la
chapellenie de la Roche-Giffart ; il s'empressa aussitôt de réparer ce
sanctuaire afin de pouvoir y célébrer le service divin ; mais le 6
novembre suivant, fête de saint Léonard, la chapelle fut livrée aux
flammes, et l'on accusa de ce crime le marquis de Fougeray, frère du
converti, et leur mère, la douairière de la Roche-Giffart, l'un et l'autre
d'un protestantisme ardent. Quoi qu'il en fût, Saint-Léonard ainsi détruit
ne fut plus relevé (Pouillé de Rennes). Plus tard, on construisit un oratoire
privé (dans le château même de la Roche-Giffart) qui disparut avec le
vieux château ;
l'ancienne
chapelle Saint-Léonard, que les seigneurs de la Roche-Giffart brûlèrent
par haine du catholicisme, en 1659-1661. Saint-Léonard de la Roche-Giffart
se trouvait dans la cour de ce château ; elle avait été fondée de messes
par un prêtre nommé Mathurin Pigeaut ; mais les seigneurs de la Roche-Giffart
ayant embrassé le protestantisme, laissèrent ce sanctuaire tomber en
ruine. Toutefois, en avril 1648, Samuel de la Chapelle, seigneur de Careil et fils du seigneur de la
Roche-Giffart, abjura ses erreurs et entra à l'Oratoire de Paris ; il
devint plus tard prêtre oratorien et prieur de la Chapelle-Glain. Le 17
juillet 1659, cet ecclésiastique fut pourvu par l'évêque de la
chapellenie de la Roche-Giffart ; il s'empressa aussitôt de réparer ce
sanctuaire afin de pouvoir y célébrer le service divin ; mais le 6
novembre suivant, fête de saint Léonard, la chapelle fut livrée aux
flammes, et l'on accusa de ce crime le marquis de Fougeray, frère du
converti, et leur mère, la douairière de la Roche-Giffart, l'un et l'autre
d'un protestantisme ardent. Quoi qu'il en fût, Saint-Léonard ainsi détruit
ne fut plus relevé (Pouillé de Rennes). Plus tard, on construisit un oratoire
privé (dans le château même de la Roche-Giffart) qui disparut avec le
vieux château ;
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Jean de la Roche-Giffart. Catherine de Rougé, femme du maréchal
de Créquy, ayant acheté la Roche-Giffart, fit établir dans ce château même
une chapelle que bénit, le 1er août 1688, le recteur Jean Coupel. Dédié
à saint Jean-Baptiste et à sainte Catherine, ce sanctuaire a disparu avec
le vieux château de la Roche-Giffart (Pouillé de Rennes) ;
l'ancienne
chapelle Saint-Jean de la Roche-Giffart. Catherine de Rougé, femme du maréchal
de Créquy, ayant acheté la Roche-Giffart, fit établir dans ce château même
une chapelle que bénit, le 1er août 1688, le recteur Jean Coupel. Dédié
à saint Jean-Baptiste et à sainte Catherine, ce sanctuaire a disparu avec
le vieux château de la Roche-Giffart (Pouillé de Rennes) ;
![]() la
croix (XIXème siècle), située route d'Ercé-en-Lamée ;
la
croix (XIXème siècle), située route d'Ercé-en-Lamée ;
![]() la
croix (1884), située au carrefour des Ecoles ;
la
croix (1884), située au carrefour des Ecoles ;
![]() l'ancien
presbytère (XVIIIème siècle), situé au carrefour des Ecoles ;
l'ancien
presbytère (XVIIIème siècle), situé au carrefour des Ecoles ;
![]() l'ancien
château fort de la Roche-Giffart, situé jadis route de la Forêt de
Teillay. Ce château possédait autrefois deux chapelles privées : l'une,
située dans la cour, a été réparée en 1659, puis incendiée en 1661, la
seconde a été édifiée en 1688 dans l'enceinte même du château.
Propriété successive des familles Giffart (au XIIIème siècle), de la
Lande (en 1301), de la Chapelle (en 1427), Rougé et Créquy (en 1685), de
Kerhoënt de Kergourdanec'h marquis de Coëtenfao, Loquet seigneurs de
Grandville (en 1748), du prince de Gondé seigneur de Châteaubriant, de Lavau ;
l'ancien
château fort de la Roche-Giffart, situé jadis route de la Forêt de
Teillay. Ce château possédait autrefois deux chapelles privées : l'une,
située dans la cour, a été réparée en 1659, puis incendiée en 1661, la
seconde a été édifiée en 1688 dans l'enceinte même du château.
Propriété successive des familles Giffart (au XIIIème siècle), de la
Lande (en 1301), de la Chapelle (en 1427), Rougé et Créquy (en 1685), de
Kerhoënt de Kergourdanec'h marquis de Coëtenfao, Loquet seigneurs de
Grandville (en 1748), du prince de Gondé seigneur de Châteaubriant, de Lavau ;

![]() le
puits (XIXème siècle), situé rue des Préaux ;
le
puits (XIXème siècle), situé rue des Préaux ;
![]() la
fontaine (XXème siècle), située Boulevard Salmon ;
la
fontaine (XXème siècle), située Boulevard Salmon ;
![]() les
moulins
à eau de la Serpaudais, ancien-de-la-Haclais, à foulon de la Pille ;
les
moulins
à eau de la Serpaudais, ancien-de-la-Haclais, à foulon de la Pille ;

A signaler aussi :
![]() des
exploitations de mines de fer à Chatain et à La Galivelais ;
des
exploitations de mines de fer à Chatain et à La Galivelais ;
![]() le
pont de la Planche (XIXème siècle - vers 1900), sur la rivière d'Aron ;
le
pont de la Planche (XIXème siècle - vers 1900), sur la rivière d'Aron ;
![]() l'ancien
manoir d'Aresne, situé route de Sion. Propriété de la famille de la Chapelle en 1513 ;
l'ancien
manoir d'Aresne, situé route de Sion. Propriété de la famille de la Chapelle en 1513 ;

![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-SULPICE-DES-LANDES
La seigneurie de la Roche-Giffart : Le château de la Roche-Giffart, paroisse de Saint-Sulpice-des-Landes, doit son nom à une famille Giffart dont le R. P. du Paz parle en ces termes : « L'an 1218 vivait un Alain Giffart, que je pense avoir été seigneur de la Roche-Giffart ; duquel il y a une lettre d'accord faite entre lui et le prieur du prieuré de Tresbœuf, dépendant de l'abbaye de Saint-Melaine » (Histoire généalogique de Bretagne). Il est encore question dans le Cartulaire de cette abbaye de trois autres seigneurs appartenant à la même maison ; ce sont Geffroy Giffart, dit Buffelin ; Guillaume Giffart, son fils, et Robert Giffart, fils, dudit Guillaume. En 1247, ce Guillaume Giffart donna à l'abbaye de Saint-Melaine, avec le consentement de Robert, son fils aîné, les dîmes qui lui appartenaient à Ventivole et à la chapelle de Calendour, pour la dotation d'un obit ou anniversaire pour lui et son père Geffroy Giffart, dit Buffelin. Ce Robert Giffart, fils de Guillaume, prit part à la croisade de 1248. Geffroy Giffart, chevalier, seigneur de la Roche-Giffart, épousa Aliénor de Boeuvres, dame dudit lieu, paroisse de Messac ; il vivait vers 1280, et laissa trois enfants : Alain, seigneur de la Roche-Giffart ; Amice, mariée à écuyer Jean du Val ; et Agaïce, qui partagèrent sa succession en 1301. Alain Giffart, seigneur de la Roche-Giffart et de Boeuvres, ne laissa que deux filles : Agaïce, l'aînée, dame de la Roche-Giffart et de Boeuvres, qui épousa Guillaume de la Lande, seigneur de Pont-Rouaud ; et Amice, femme de noble écuyer Jean Habel. « Ainsi, ajoute du Paz, le nom de Giffart périt en cette maison de la Roche-Giffart ; mais il fut continué en celles du Plessis-Giffart, paroisse d'Irodouer, qui a toujours été la principale et chef de nom et d'armes des Giffart ». La seigneurie de la Roche-Giffart demeura entre les mains des seigneurs de la Lande jusque vers l'an 1400, époque à laquelle Martine de la Lande, dame de la Roche-Giffart et de Boeuvres, épousa Guillaume de la Chapelle, chevalier. Arthur de la Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart, vivait en 1427. Jean de la Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart, vivait en 1485. Mathurin de la Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart, acheta en 1526 d'avec Claude d'Annebault, mari de Françoise de Tournemine, le château et la châtellenie de Sion, paroisse de ce nom. René de la Chapelle, seigneur de la Roche et de Sion, acquit vers 1562-1567 le château et la châtellenie du Grand-Fougeray ; il épousa Renée Thierry et introduisit le protestantisme dans sa famille et dans ses terres. Louis de la Chapelle, son fils, seigneur de la Roche, de Sion et de Fougeray, fut tué en 1595 sous les murs de son château de Fougeray ; il avait épousé Marguerite Tillon. Samuel de la Chapelle, son fils, seigneur de la Roche, etc., enleva et épousa Françoise de Marec, et fut tué à la chasse avant 1626. Henri de la Chapelle, seigneur de la Roche, etc., marié à Marguerite de Chamballan, fut tué au faubourg Saint-Antoine à Paris, en 1652. Samuel, son frère, abjura l'hérésie en 1648. Son fils, Henri de la Chapelle, s'unit à Marguerite de la Lande, dite de Machecoul, et fut seigneur de la Roche, etc. Il mena une vie fort scandaleuse avec Mme de la Hamelinière, comme le témoigne dans ses lettres Mme de Sévigné. Imitant ses ancêtres, il fit beaucoup de mal aux catholiques du pays de Fougeray. Ayant refusé d'abjurer ses erreurs, il fut forcé, en 1685 ; de s'exiler en Hollande ; sa fortune fut dispersée ; à peine ses deux soeurs, Marguerite et Henriette de la Chapelle, purent-elles conserver quelques débris de la châtellenie de Sion. Catherine de Rougé,. femme du maréchal de Créquy, acheta les terres de la Roche-Giffart et de Fougeray. Comme il a été déjà dit, le marquis de Coëtanfao posséda ensuite ces seigneuries du chef de sa femme, Innocente de Rougé ; mais elles furent vendues et séparées après sa mort, vers 1748. Le nouveau seigneur de Fougeray, Jean-Charles Loquet de Granville, avait bien acheté Fougeray et la Roche-Giffart ; mais le prince de Condé, seigneur de Châteaubriant, retira féodalement cette dernière seigneurie de la Roche, et la céda à Guy de Lavau et à Marie-Anne Baugin, sa femme. La famille de Lavau conserva la Roche jusqu'au XIXème siècle ; mais M. Joseph Guérin ayant épousé Mlle Sophie de Lavau, ce château est passé entre les mains de la famille Guérin, qui le possède encore à la fin du XIXème siècle.
Le château de la Roche-Giffart, construit au moyen âge par la famille dont il porte le nom, dut très probablement être un château fortifié ; toutefois il n'en reste plus de vestiges ; une sorte de bastion ruiné, pouvant remonter tout au plus au XVème ou XVIème siècle, est le seul débris de l'antique demeure des seigneurs de la Roche. Depuis bien des siècles, la seigneurie de la Roche-Giffart avait droit de bois mort, pacage et pâturage, non seulement pour les animaux domestiques, mais encore « pour les porcs et gourins », dans la forêt de Teillay avoisinant le château, et appartenant aux barons de Châteaubriant. Les seigneurs de la Roche-Giffart relevaient directement du roi ; ils possédaient une juridiction haute, moyenne et basse qui ressortissait à Châteaubriant ; ils étaient seigneurs fondateurs des églises paroissiales de Saint-Sulpice-des-Landes et d'Ercé-en-la-Mée ; toutefois les barons de Châteaubriant leur disputaient les droits honorifiques dans cette dernière paroisse. En 1747, la terre de la Roche-Giffart avait un revenu de 3 149 livres, et M. de Lavau l'acheta 72 000 livres. Les seigneurs de la Roche-Giffart, des maisons de la Chapelle, de Créquy et de Coëtanfao, menaient très grande'vie au château de la Roche, qu'ils habitaient de préférence à celui de Fougeray ; malheureusement, leur souvenir est resté peu honoré dans le pays. Le château de la Roche-Giffart a été reconstruit, depuis quelques années, par M. Auguste Guérin de la Roche-Giffart ; c'est une belle habitation moderne à laquelle conduisent des avenues séculaires (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Guille Durant et Jean Caorcin, plusieurs nobles sont mentionnés à Saint-Sulpice-des-Landes :
![]() Jean
de la Chapelle, sr. de la Roche-Giffart ;
Jean
de la Chapelle, sr. de la Roche-Giffart ;
![]() Alain
de Merzac, frère juveigneur de Jean Merzac sgr. de Pomenial ( ?).
Alain
de Merzac, frère juveigneur de Jean Merzac sgr. de Pomenial ( ?).
La
montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à
Sainct Supplice des Landes les nobles suivants :
" Jehan de La Chappelle se présente monté et armé en estat d'homme
d'armes pour Michel / de La Chappelle Roche Chiffart (sic, lire : Roche
Giffart) [Note : Pour les seigneurs de la Roche-Giffart, en
Saint-Sulpice-des-Landes, voir : B.M.S.A.I.V., t. V, 1867, p. 320-324] son frère aisné acompaigné d'un coustilleux et ung paige. Et
vériffie ou nom de son dict frère la déclaracion de luy cy devant baillée estre
véritable. Et a faict le serment. Et aparu avoir fourny Damoyselle Katherine
Tierry sa déclaracion par cy devant à monseigneur le séneschal de Rennes
montante en sommaire cinq cens trante livres monnoye. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.