|
Bienvenue chez les Taulésiens |
TAULE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Taulé
La commune de Taulé ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TAULE
Taulé vient de Taulé, un saint breton.
Taulé (d'origine gallo-romaine, semble-t-il) outre ses trèves Henvic, Carantec, Notre-Dame de Callot (aujourd'hui en Carantec) et Penzé (aujourd'hui enTaulé), englobait également autrefois le territoire de Locquénolé (enclave de Dol). Le centre primitif de la paroisse se trouvait jadis à Henvic "le vieux-bourg".

Avec sa chapelle Notre-Dame, Penzé (ou Pensez) alors village de Taulé (noté Pensai en 1158 et Pansei en 1185) dépendait au XIIème siècle de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Penzé, ancienne seigneurie qui dès le XIIIème siècle était une châtellenie ayant appartenu aux vicomtes de Léon, puis aux seigneurs de Rohan, est devenu le 14 juillet 1947 le centre d'une nouvelle paroisse.
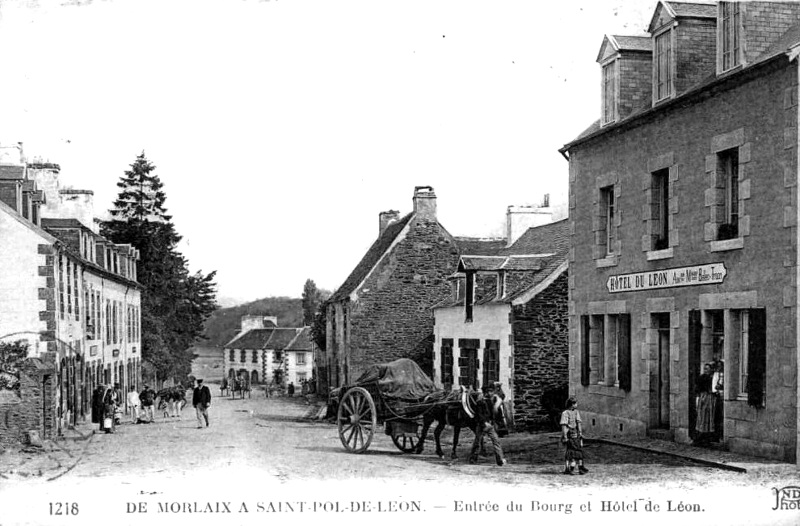
On trouve l'appellation Taule dès 1353. Taulé dépendait autrefois de l'ancien diocèse de Léon.
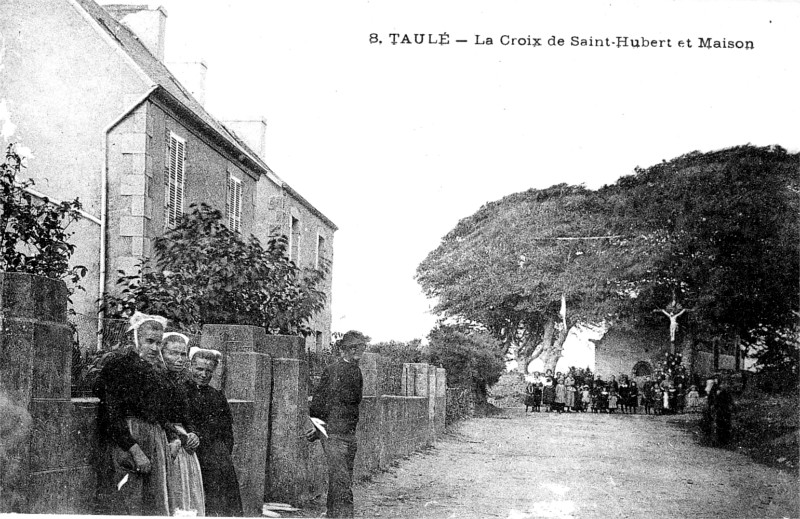
On rencontre les appellations suivantes : Taulai (en 1128), Taule (en 1353), Guictaule (en 1398) et Taulé (en 1426).
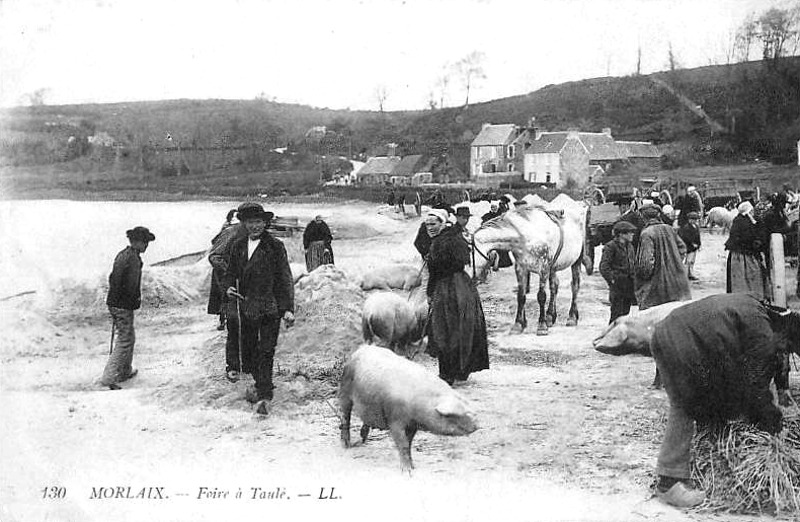
Note : Les maires de la commune de Taulé : François CALVEZ de 1790 à 1800 ; Pierre PINCHON de 1800 à 1808 ; Noël BROUSSAIL de 1808 à 1809 ; Jean-Baptiste LANNIGOU de 1809 à 1820 ; Nicolas Antoine GOUSSELIN de 1820 à 1838 ; Hervé GUIADER de 1838 à 1846 ; Jean-Marie HAMON du 3 novembre 1846 au 9 juillet 1855 ; Michel MEGE du 9 juillet 1855 au 11 avril 1872 ; François GUIADER du 11 avril 1872 à 23 février 1881 ; Gabriel HERRY du 23 février 1881 au 7 mai 1882 ; Ferdinand CAZIN D'HONINCTHUN du 7 mai 1882 au 19 janvier 1908 ; Georges de LANSALUT du 19 janvier 1908 au 19 avril 1943 ; Adolphe BORGNIS-DESBORDES du 19 avril 1943 au 17 octobre 1944 ; Georges de LANSALUT du 17 octobre 1944 au 10 mai 1945 ; Jean-François GUEGUEN du 10 mai 1945 au 9 mai 1953 ; Jean CORRE du 9 mai 1953 au 23 août 1968 ; Jean PENN du 11 octobre 1968 au 27 mars 1977 ; Claude BERNARD du 27 mars 1977 au 13 mai 1982 ; François MOAL à partir du 13 mai 1982, etc .....
![]()
PATRIMOINE de TAULE
![]() l'église Notre-Dame
(1789), érigée en paroisse le 14 juillet 1947. Cette église a remplacé l'ancienne chapelle Notre-Dame qui dépendait en
1185 de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Il s'agit d'un édifice
rectangulaire reconstruit en 1789 et agrandi sur les plans de M. Heuzé au
XXème siècle. Le vieux clocher date du
XVIème siècle : l'une des cloches date de 1794 et l'autre, plus ancienne,
du XVème siècle (semble-t-il). Le retable à tourelles, avec tableau de l'Assomption, date du
XVIIème siècle. L'église abrite la statue de Notre-Dame de Penzé. On y voit une dalle armoriée des armes de la famille
Boutouiller de Keromnès ;
l'église Notre-Dame
(1789), érigée en paroisse le 14 juillet 1947. Cette église a remplacé l'ancienne chapelle Notre-Dame qui dépendait en
1185 de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Il s'agit d'un édifice
rectangulaire reconstruit en 1789 et agrandi sur les plans de M. Heuzé au
XXème siècle. Le vieux clocher date du
XVIème siècle : l'une des cloches date de 1794 et l'autre, plus ancienne,
du XVème siècle (semble-t-il). Le retable à tourelles, avec tableau de l'Assomption, date du
XVIIème siècle. L'église abrite la statue de Notre-Dame de Penzé. On y voit une dalle armoriée des armes de la famille
Boutouiller de Keromnès ;
![]() l'église Saint-Pierre
(1901-1904) de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice en forme de
croix qui comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et, au droit de
la dernière travée, deux chapelles en ailes formant faux transept : elle
est terminée par une abside en hémicycle et chaque travée du bas-côté
est subdivisée en deux travées plus petites. Les fonts baptismaux datent de 1657.
L'église abrite les statues de sainte Anne et la Vierge, saint Eloi, saint
Sébastien et la Vierge-Mère. Gonfanon aux armes de France et de Pologne,
offert à la paroisse de Taulé par Haut et Puissant messire Thomas Charles
de Morant comte de Penzé, mestre de camp des dragons de la reine. " Novembre 1898 :
Donation par la famille de PENGUERN, d'un terrain à la commune, pour la
construction de l'église. — 4 septembre 1901 : Adjudication des travaux de reconstruction de l'église
paroissiale. Les travaux ont été adjugés à Mr Canévet de Coray.
— 15 mai 1902 : Bénédiction de la première pierre en présence du Curé de
Morlaix, du Curé de Landivisiau et de vingt-quatre prêtres, de l'Abbé Quéinnec,
Curé de Taulé. — Octobre 1904 : Consécration solennelle de l'église, dédiée à St-Pierre.
— Août 1913 : Bénédiction des quatre nouvelles cloches.
— Quant au cimetière qui entourait l'église, le seul vestige est le mur situé à
gauche du clocher. La place actuelle a donc remplacé le cimetière dans lequel
avaient été enterrés, le 7 mars 1917, Françcois III de Kergroadès et en 1730,
Catherine Denys dont le mari René de Coetlogon était propriétaire de Coatudual " ;
l'église Saint-Pierre
(1901-1904) de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice en forme de
croix qui comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et, au droit de
la dernière travée, deux chapelles en ailes formant faux transept : elle
est terminée par une abside en hémicycle et chaque travée du bas-côté
est subdivisée en deux travées plus petites. Les fonts baptismaux datent de 1657.
L'église abrite les statues de sainte Anne et la Vierge, saint Eloi, saint
Sébastien et la Vierge-Mère. Gonfanon aux armes de France et de Pologne,
offert à la paroisse de Taulé par Haut et Puissant messire Thomas Charles
de Morant comte de Penzé, mestre de camp des dragons de la reine. " Novembre 1898 :
Donation par la famille de PENGUERN, d'un terrain à la commune, pour la
construction de l'église. — 4 septembre 1901 : Adjudication des travaux de reconstruction de l'église
paroissiale. Les travaux ont été adjugés à Mr Canévet de Coray.
— 15 mai 1902 : Bénédiction de la première pierre en présence du Curé de
Morlaix, du Curé de Landivisiau et de vingt-quatre prêtres, de l'Abbé Quéinnec,
Curé de Taulé. — Octobre 1904 : Consécration solennelle de l'église, dédiée à St-Pierre.
— Août 1913 : Bénédiction des quatre nouvelles cloches.
— Quant au cimetière qui entourait l'église, le seul vestige est le mur situé à
gauche du clocher. La place actuelle a donc remplacé le cimetière dans lequel
avaient été enterrés, le 7 mars 1917, Françcois III de Kergroadès et en 1730,
Catherine Denys dont le mari René de Coetlogon était propriétaire de Coatudual " ;
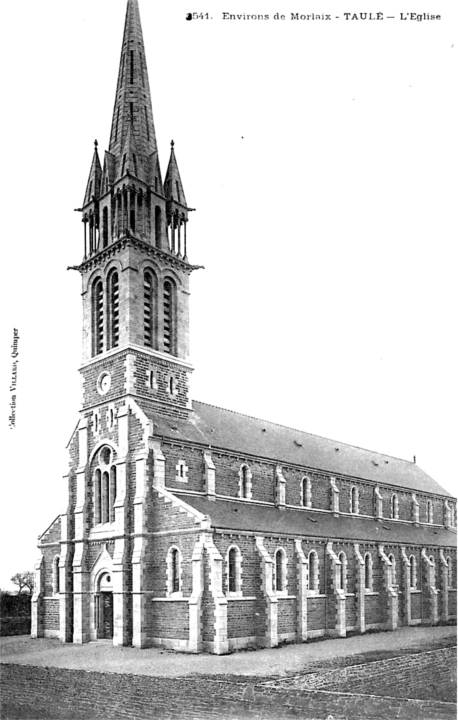 |
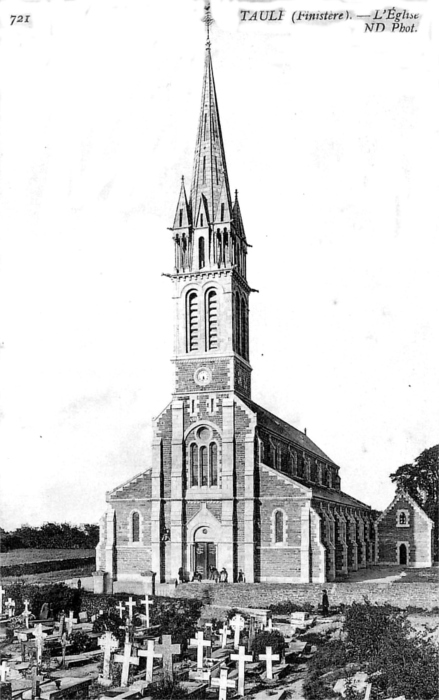 |
![]() l'ancienne église Saint-Pierre
de la paroisse de Taulé et son clocher (XVIème siècle) dû à l'atelier Beaumanoir ;
l'ancienne église Saint-Pierre
de la paroisse de Taulé et son clocher (XVIème siècle) dû à l'atelier Beaumanoir ;
![]() l'ossuaire (XVIème siècle) ;
l'ossuaire (XVIème siècle) ;
![]() la chapelle Saint-Herbot (XVI-XVIIème siècle)
de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice rectangulaire sans clocher
datant de 1556 (date gravée dans la pierre à droite de la porte) et restauré
en 1987, date à laquelle son placître a retrouvé sa croix traditionnelle
(oeuvre, semble-t-il, du marbrier Marcel Ruz). L'édifice aurait servi de chapelle
pour les pestiférés. La chapelle abrite les statues de saint Herbot, saint
Avertin et un Crucifix. " C'est un édifice rectangulaire datant du
milieu du XVIIème siècle qui fut donné à la paroisse par Dame Guillemette de
Quélen, propriétaire du manoir de Guernisac, par acte prônal, le 16 septembre
1629, pour servir de cimetière pour les pestiférés, à charge pour les
paroissiens d'aller processionnellement de l'église paroissiale à la dite
chapelle à chaque premier dimanche du mois et à charge de pourvoir à son
entretien. Saint-Herbot est prié pour la protection des bêtes à cornes et aussi
pour obtenir abondance de lait et de beurre. SANT HERBOT,
AMAN LEIZ AR RIBOT - SAINT-HERBOT, DU BEURRE PLEIN LA BARATTE " ;
la chapelle Saint-Herbot (XVI-XVIIème siècle)
de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice rectangulaire sans clocher
datant de 1556 (date gravée dans la pierre à droite de la porte) et restauré
en 1987, date à laquelle son placître a retrouvé sa croix traditionnelle
(oeuvre, semble-t-il, du marbrier Marcel Ruz). L'édifice aurait servi de chapelle
pour les pestiférés. La chapelle abrite les statues de saint Herbot, saint
Avertin et un Crucifix. " C'est un édifice rectangulaire datant du
milieu du XVIIème siècle qui fut donné à la paroisse par Dame Guillemette de
Quélen, propriétaire du manoir de Guernisac, par acte prônal, le 16 septembre
1629, pour servir de cimetière pour les pestiférés, à charge pour les
paroissiens d'aller processionnellement de l'église paroissiale à la dite
chapelle à chaque premier dimanche du mois et à charge de pourvoir à son
entretien. Saint-Herbot est prié pour la protection des bêtes à cornes et aussi
pour obtenir abondance de lait et de beurre. SANT HERBOT,
AMAN LEIZ AR RIBOT - SAINT-HERBOT, DU BEURRE PLEIN LA BARATTE " ;

![]() l'ancien oratoire dédiée à Sainte-Anne, situé près du hameau de Trevengant ou
Trévengat. Cette chapelle, en ruines depuis 1945 et démolie en 1956,
était un petit édifice rectangulaire sans caractère ;
l'ancien oratoire dédiée à Sainte-Anne, situé près du hameau de Trevengant ou
Trévengat. Cette chapelle, en ruines depuis 1945 et démolie en 1956,
était un petit édifice rectangulaire sans caractère ;
![]() la
chapelle Saint-Michel, située au Vieux-Chastel. Il s'agit d'un édifice
rectangulaire avec chevet à trois pans reconstruit vers 1870. La chapelle
abrite les statues de saint Michel, sainte Barbe et saint Yves ;
la
chapelle Saint-Michel, située au Vieux-Chastel. Il s'agit d'un édifice
rectangulaire avec chevet à trois pans reconstruit vers 1870. La chapelle
abrite les statues de saint Michel, sainte Barbe et saint Yves ;
![]() l'ancienne
chapelle de la Madeleine (de la paroisse de Taulé),
aujourd'hui disparue et mentionnée dans une charte de 1128. Elle était
également dédiée jadis à saint Maudet et dite parfois chapelle de
Brénigant. L'ancienne croix aurait été transportée au manoir de Lan
Penhoat et porte sur son socle "Mathurin Pledran fit faire
1645". L'emplacement est encore signalé par une fontaine ;
l'ancienne
chapelle de la Madeleine (de la paroisse de Taulé),
aujourd'hui disparue et mentionnée dans une charte de 1128. Elle était
également dédiée jadis à saint Maudet et dite parfois chapelle de
Brénigant. L'ancienne croix aurait été transportée au manoir de Lan
Penhoat et porte sur son socle "Mathurin Pledran fit faire
1645". L'emplacement est encore signalé par une fontaine ;
![]() les
anciennes chapelles de la paroisse de Taulé, aujourd'hui détruites ou
disparues : la chapelle Saint-Laurent (située jadis au manoir de Kercadoret),
la chapelle de Guic-Taulé (disparue depuis le XVIIIème siècle). La
chapelle de Guic-Taulé était sans doute la première église paroissiale de Taulé ;
les
anciennes chapelles de la paroisse de Taulé, aujourd'hui détruites ou
disparues : la chapelle Saint-Laurent (située jadis au manoir de Kercadoret),
la chapelle de Guic-Taulé (disparue depuis le XVIIIème siècle). La
chapelle de Guic-Taulé était sans doute la première église paroissiale de Taulé ;
![]() la croix de Porslan (1554) ;
la croix de Porslan (1554) ;
![]() la croix du placitre de l'église Saint-Pierre (XVème siècle) ;
la croix du placitre de l'église Saint-Pierre (XVème siècle) ;
![]() d'autres
croix ou vestiges de croix : Briac (1889), Ty-Croaz à Kerangomar (XVème
siècle), Lanc'hoat (XVème siècle), Penzé (1959), cimetière (1908),
Bel-Air (1954), Croix-de-Mézarun (1903) ;
d'autres
croix ou vestiges de croix : Briac (1889), Ty-Croaz à Kerangomar (XVème
siècle), Lanc'hoat (XVème siècle), Penzé (1959), cimetière (1908),
Bel-Air (1954), Croix-de-Mézarun (1903) ;
![]() le château de Coatilès
(XVIIème siècle). Son colombier date de 1670 et ses terrasses datent du
XVIIème siècle. La porte cintrée avec
des sculptures, est datée de 1673. Propriété successive des familles
Coatilés, Kernavan, Kergroadez, Musnier de Quatremarres, Le Gac de Lansalut
et Mazurié de Pennanec'h ;
le château de Coatilès
(XVIIème siècle). Son colombier date de 1670 et ses terrasses datent du
XVIIème siècle. La porte cintrée avec
des sculptures, est datée de 1673. Propriété successive des familles
Coatilés, Kernavan, Kergroadez, Musnier de Quatremarres, Le Gac de Lansalut
et Mazurié de Pennanec'h ;
![]() le manoir de Kerassel
ou Keraffel (XVI-XVIIIème siècle). Propriété, en 1636, d'Alain de Kerléan, sieur du Tymen.
" L'origine du manoir remonte à plusieurs siècles. La légende rapporte que
des moines s'y seraient établis avant qu'une noble dame n'y fixa sa résidence en
1545. — En 1636, c'était la demeure d'Alain de Kerléan dont le descendant, Yan
de Kerléan, décédé en 1703, fut enterré en l'église de Taulé. — En 1763, Jean de
Kerléan, officier en retraite, hérite de Kerassel. — En 1789, Jean-Marie de
Kerléan et son fils Charles sont condamnés à la déportation par le tribunal
révolutionnaire le 5 germinal de l'An II pour avoir possédé quelques armes. — En
1838, Jean-Joseph de Penguern épouse Joséphine de Kerléan. Décédée en 1892, elle
laisse deux filles : l'une d'elle épouse Eugène Jégou du Laz en 1870. — En 1858,
était aussi décédée à Kerassel, Angèle de Kerléan épouse d'Ambroise de
Parcevaux. A la suite du décès de la dernière enfant de Parcevaux en 1914, un
nouveau partage eut lieu. — Après être passé entre les mains de plusieurs
propriétaires successifs, le manoir et son jardin ont été cédés en juillet 1965
à M. Jacques Mignot, marié à Colette Rident, originaire de Sainte-Sève,
descendante de la famille du Penhoat " ;
le manoir de Kerassel
ou Keraffel (XVI-XVIIIème siècle). Propriété, en 1636, d'Alain de Kerléan, sieur du Tymen.
" L'origine du manoir remonte à plusieurs siècles. La légende rapporte que
des moines s'y seraient établis avant qu'une noble dame n'y fixa sa résidence en
1545. — En 1636, c'était la demeure d'Alain de Kerléan dont le descendant, Yan
de Kerléan, décédé en 1703, fut enterré en l'église de Taulé. — En 1763, Jean de
Kerléan, officier en retraite, hérite de Kerassel. — En 1789, Jean-Marie de
Kerléan et son fils Charles sont condamnés à la déportation par le tribunal
révolutionnaire le 5 germinal de l'An II pour avoir possédé quelques armes. — En
1838, Jean-Joseph de Penguern épouse Joséphine de Kerléan. Décédée en 1892, elle
laisse deux filles : l'une d'elle épouse Eugène Jégou du Laz en 1870. — En 1858,
était aussi décédée à Kerassel, Angèle de Kerléan épouse d'Ambroise de
Parcevaux. A la suite du décès de la dernière enfant de Parcevaux en 1914, un
nouveau partage eut lieu. — Après être passé entre les mains de plusieurs
propriétaires successifs, le manoir et son jardin ont été cédés en juillet 1965
à M. Jacques Mignot, marié à Colette Rident, originaire de Sainte-Sève,
descendante de la famille du Penhoat " ;
![]() le manoir de Vieux-Chastel (XIXème siècle).
L'ancienne terre noble est, en 1434, la propriété de Jehan du Faou,
époux de Constance Penhoadic. On mentionne Jean du Faou (ou Fou) en 1467.
Ollivier Quellen est mentionné en 1481 : ce dernier est marié avec Marie de Berien.
" La propriété du vieux Chastel a été donnée à Monsieur de Lansalut par son oncle Michel Mège, en 1901.
Michel Mège l'avait achetée en 1830 à la famille du Buisson du vieux Chastel
dont on a aucune trace. La Chapelle a été construite vers 1870 et dédiée à Saint
Michel. Autrefois on y venait pour les Rogations. Jehan du Faou, époux de
Constance Penhoadic possédait le vieux Chastel en 1434 ;
le manoir de Vieux-Chastel (XIXème siècle).
L'ancienne terre noble est, en 1434, la propriété de Jehan du Faou,
époux de Constance Penhoadic. On mentionne Jean du Faou (ou Fou) en 1467.
Ollivier Quellen est mentionné en 1481 : ce dernier est marié avec Marie de Berien.
" La propriété du vieux Chastel a été donnée à Monsieur de Lansalut par son oncle Michel Mège, en 1901.
Michel Mège l'avait achetée en 1830 à la famille du Buisson du vieux Chastel
dont on a aucune trace. La Chapelle a été construite vers 1870 et dédiée à Saint
Michel. Autrefois on y venait pour les Rogations. Jehan du Faou, époux de
Constance Penhoadic possédait le vieux Chastel en 1434 ;
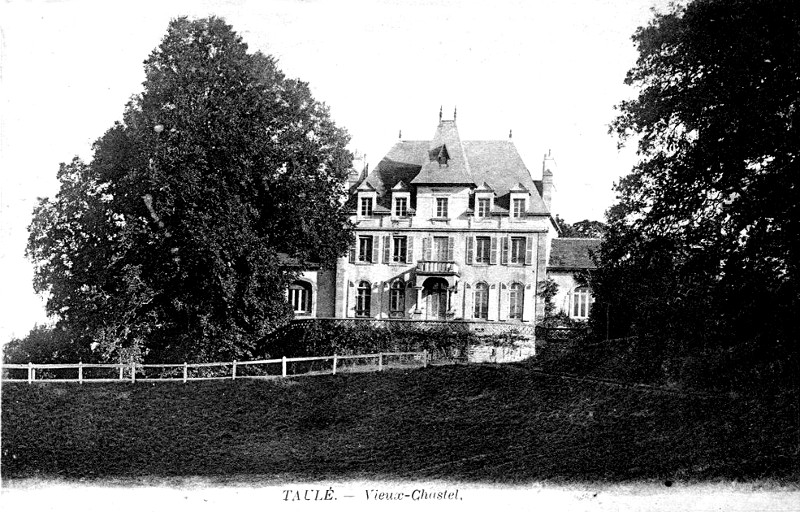
![]() le manoir
de Castelmen (XVIIème siècle) est construit en 1625 par Léon Jean
de Pensornou, sénéchal de Penzé, sur l'emplacement d'un édifice du
XIVème siècle détruit en 1615 et ayant appartenu à Jean de Châteaumen
(ou Castelmen). La famille de Châteaumen est mentionnée lors des montres
de 1426 et 1481. Le manoir du XVIIème siècle comportait une chapelle
privée dédiée à Saint Sébastien et aujourd'hui disparue. En 1306, le
manoir était la propriété d'Alain de Châteaumen. Il passe ensuite, en
1446, entre les mains de la famille Kergoulouarn, puis, au XVIème siècle,
entre les mains de la famille Kergroadez. Il devient ensuite la propriété
de la famille de Jean de Pensornou (au début du XVIIème siècle), puis de
Suzanne de Kergadiou, de la famille Kersaintgilly (en 1731), de Jean Louis
de Kermerc'hou de Kerauterm (en 1792). A noter que ce dernier descend de
Louis de Kermerc'hou (1699-1773), né à Plougasnou, et époux de Jeanne de
Kerautem (mariés en 1726). L'édifice actuel de 1625 comporte sur la
façade arrière une tour quadrangulaire. Le colombier de Castelmen
ou Châteaumen date de 1550 (il comportait 600 boulins en 1656). " Construit vers 1550,
le colombier de Castelmen est désigné comme "vieux colombier" dans un acte
datant de 1650. Il était cerné de fossés et situé à 200 m. du manoir de
Châteaumen devenu Castelmen. En 1731, la terre, le manoir avec ses dépendances
et les moulins furent achetés par Kersaint Gilles puis transmis par héritage.
Le colombier avait un rôle économique. Avec ses
600 niches et ses 2 à 3000 pigeons, il était le moyen le plus pratique de
disposer, d'une réserve de viande fraîche. Avant 1580, pour avoir le droit de
construire un colombier, il fallait posséder 150 hectares de terres en un seul
tenant. La terre devait être noble ... ainsi que le propriétaire. Apanage de la
noblesse, cet édifice fut détesté quand aux dégâts commis par les pigeons aux
cultures. A la révolution de 1789, la suppression de ce privilège fut exigée
avec force car il était ressenti comme une injustice. Aujourd'hui, beaucoup de
ces colombiers ont disparu, faute d'entretien " ;
le manoir
de Castelmen (XVIIème siècle) est construit en 1625 par Léon Jean
de Pensornou, sénéchal de Penzé, sur l'emplacement d'un édifice du
XIVème siècle détruit en 1615 et ayant appartenu à Jean de Châteaumen
(ou Castelmen). La famille de Châteaumen est mentionnée lors des montres
de 1426 et 1481. Le manoir du XVIIème siècle comportait une chapelle
privée dédiée à Saint Sébastien et aujourd'hui disparue. En 1306, le
manoir était la propriété d'Alain de Châteaumen. Il passe ensuite, en
1446, entre les mains de la famille Kergoulouarn, puis, au XVIème siècle,
entre les mains de la famille Kergroadez. Il devient ensuite la propriété
de la famille de Jean de Pensornou (au début du XVIIème siècle), puis de
Suzanne de Kergadiou, de la famille Kersaintgilly (en 1731), de Jean Louis
de Kermerc'hou de Kerauterm (en 1792). A noter que ce dernier descend de
Louis de Kermerc'hou (1699-1773), né à Plougasnou, et époux de Jeanne de
Kerautem (mariés en 1726). L'édifice actuel de 1625 comporte sur la
façade arrière une tour quadrangulaire. Le colombier de Castelmen
ou Châteaumen date de 1550 (il comportait 600 boulins en 1656). " Construit vers 1550,
le colombier de Castelmen est désigné comme "vieux colombier" dans un acte
datant de 1650. Il était cerné de fossés et situé à 200 m. du manoir de
Châteaumen devenu Castelmen. En 1731, la terre, le manoir avec ses dépendances
et les moulins furent achetés par Kersaint Gilles puis transmis par héritage.
Le colombier avait un rôle économique. Avec ses
600 niches et ses 2 à 3000 pigeons, il était le moyen le plus pratique de
disposer, d'une réserve de viande fraîche. Avant 1580, pour avoir le droit de
construire un colombier, il fallait posséder 150 hectares de terres en un seul
tenant. La terre devait être noble ... ainsi que le propriétaire. Apanage de la
noblesse, cet édifice fut détesté quand aux dégâts commis par les pigeons aux
cultures. A la révolution de 1789, la suppression de ce privilège fut exigée
avec force car il était ressenti comme une injustice. Aujourd'hui, beaucoup de
ces colombiers ont disparu, faute d'entretien " ;
![]() le manoir de Coatudual. " En 1503, Coatudual
était un fief noble tenu par l'un des quarante-neuf gentilshommes taulésiens
astreints à l'impôt du sang. Son toit abritait, vers 1700, Messire René de
Coetlogon et son épouse Catherine Denys, dame du Pontlo. Un de leurs fils quitta
la maison maternelle pour s'engager aux côtés de Duguay-Trouin, dans
l'expédition de Rio de Janeiro en 1711. Sa soeur, la dernière nièce du Maréchal
de Coetlogon, Amiral de France, mourut à Coatudual en 1789, à l'âge de 93 ans.
Le manoir, les jardins et les bois ont appartenu successivement à différents
propriétaires, notamment les familles de Rosily, de la Fressange, Jagoury,
etc... Beaucoup de Taulésiens ont encore en souvenir la longue avenue qui menait
droit à l'ancienne église " ;
le manoir de Coatudual. " En 1503, Coatudual
était un fief noble tenu par l'un des quarante-neuf gentilshommes taulésiens
astreints à l'impôt du sang. Son toit abritait, vers 1700, Messire René de
Coetlogon et son épouse Catherine Denys, dame du Pontlo. Un de leurs fils quitta
la maison maternelle pour s'engager aux côtés de Duguay-Trouin, dans
l'expédition de Rio de Janeiro en 1711. Sa soeur, la dernière nièce du Maréchal
de Coetlogon, Amiral de France, mourut à Coatudual en 1789, à l'âge de 93 ans.
Le manoir, les jardins et les bois ont appartenu successivement à différents
propriétaires, notamment les familles de Rosily, de la Fressange, Jagoury,
etc... Beaucoup de Taulésiens ont encore en souvenir la longue avenue qui menait
droit à l'ancienne église " ;
![]() l'ancienne
fontaine de Notre-Dame, située à Penzé ;
l'ancienne
fontaine de Notre-Dame, située à Penzé ;
![]() 15 moulins dont le moulin à eau de Bigodou, de
Vieux-Châtel, de Castellin ou Castelmen (XVIème siècle), de Kerangomar, Neuf, de
Kergus, de Guernisac, de Kerassel ou Keraffel, de Kermaven, de Penhoat, 3 moulins à papier, sur le
ruisseau de Lan-Penhoat et moulin principal de Pennarvern,...
15 moulins dont le moulin à eau de Bigodou, de
Vieux-Châtel, de Castellin ou Castelmen (XVIème siècle), de Kerangomar, Neuf, de
Kergus, de Guernisac, de Kerassel ou Keraffel, de Kermaven, de Penhoat, 3 moulins à papier, sur le
ruisseau de Lan-Penhoat et moulin principal de Pennarvern,...
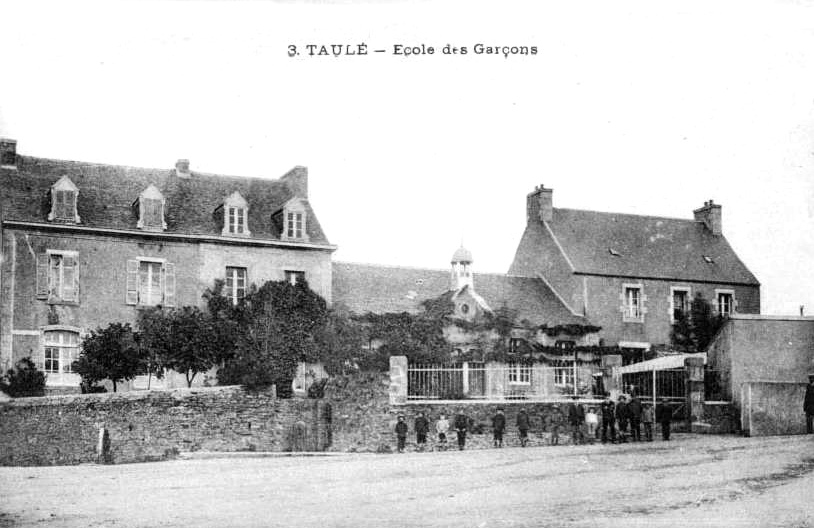
A signaler aussi :
![]() l'ancien
manoir de Guernisac (XVème siècle), berceau de la famille Guernisac,
branche cadette de la maison du Penhoat, dont elle portait les armes. La
maison de Guernisac s'est éteinte avec le décès du comte Ange de Guernisac ;
l'ancien
manoir de Guernisac (XVème siècle), berceau de la famille Guernisac,
branche cadette de la maison du Penhoat, dont elle portait les armes. La
maison de Guernisac s'est éteinte avec le décès du comte Ange de Guernisac ;
![]() l'ancien
manoir de Kergus, berceau d'une famille fondue au XVIIIème siècle dans
celle de Roquefeuil ;
l'ancien
manoir de Kergus, berceau d'une famille fondue au XVIIIème siècle dans
celle de Roquefeuil ;
![]() l'ancienne
forteresse "Castel-an-Trébez" (le château du Trépied),
construite par les vicomtes de Léon. Démolie en 1170 par le roi Henry II
d'Angleterre, puis reconstruite à nouveau et ruinée définitivement en
1374 par le duc Jean IV ;
l'ancienne
forteresse "Castel-an-Trébez" (le château du Trépied),
construite par les vicomtes de Léon. Démolie en 1170 par le roi Henry II
d'Angleterre, puis reconstruite à nouveau et ruinée définitivement en
1374 par le duc Jean IV ;
![]() l'ancien
château de Lannigou ou "Lannigou neuf" (1881), édifié en 1881
par Ferdinand Cazin d'Honinctum (ou Honinctun). Ce édifice remplace un
autre manoir, appelé aujourd'hui "ferme de Lannigou" et érigé
vers 1840 par Auguste Cazin d'Honinctum. Ces édifices ont été construits
sur des terres ayant appartenu à la famille Guicaznou au XVIème
siècle, puis à Guy Balavesne (en 1668). Propriété successive des familles Guicaznou (au
XVIème siècle), Guy Balavesne, maire de Morlaix (1668), François
Drillet, bailli de Morlaix en 1750 (sieur de Penamprat et époux de Anne
Laurence Guillotou), Sébastien-René Drillet, bailli de Morlaix
et de Lanmeur (fils des précédents et époux de Guillemette Bernard de
Basseville), Jean Baptiste Drillet (fils des précédents et promu capitaine
en 1789) et Cazin d'Honincthun (suite au mariage de Victoire
Drillet avec Auguste Cazin de la Trésorerie, dont le nom, devint en 1863,
Cazin d'Honincthun). A noter qu'Auguste Cazin d'Honincthun fit construire,
vers 1840, une autre demeure connue sous le nom de "vieux Lannigou".
Les deux Lannigou ("Lannigou neuf" et "vieux Lannigou) ont
été édifiés sur des terres qui appartenaient au XVIème siècle à la
famille Guicaznou Le château est surmonté d'une tour quadrangulaire qui
comporte une chapelle. " Au sommet d'un côteau boisé qui descend
jusqu'au bord de la rivière de Morlaix, est assis le Château moderne de
Lannigou. La terre de Lannigou a appartenu au XVIème siècle aux Guicasnou. En
1608 à Guy Balavesne, Maire de Morlaix, et en 1750 à Sébastien-René Drillet,
seigneur de Lannigou, bailli de Morlaix. Par alliance, Lannigou a passé à la
famille Cazin à M. le Baron Cazin d’Honincthun, Maire de Taulé de mai 1882 à janvier 1908 " ;
l'ancien
château de Lannigou ou "Lannigou neuf" (1881), édifié en 1881
par Ferdinand Cazin d'Honinctum (ou Honinctun). Ce édifice remplace un
autre manoir, appelé aujourd'hui "ferme de Lannigou" et érigé
vers 1840 par Auguste Cazin d'Honinctum. Ces édifices ont été construits
sur des terres ayant appartenu à la famille Guicaznou au XVIème
siècle, puis à Guy Balavesne (en 1668). Propriété successive des familles Guicaznou (au
XVIème siècle), Guy Balavesne, maire de Morlaix (1668), François
Drillet, bailli de Morlaix en 1750 (sieur de Penamprat et époux de Anne
Laurence Guillotou), Sébastien-René Drillet, bailli de Morlaix
et de Lanmeur (fils des précédents et époux de Guillemette Bernard de
Basseville), Jean Baptiste Drillet (fils des précédents et promu capitaine
en 1789) et Cazin d'Honincthun (suite au mariage de Victoire
Drillet avec Auguste Cazin de la Trésorerie, dont le nom, devint en 1863,
Cazin d'Honincthun). A noter qu'Auguste Cazin d'Honincthun fit construire,
vers 1840, une autre demeure connue sous le nom de "vieux Lannigou".
Les deux Lannigou ("Lannigou neuf" et "vieux Lannigou) ont
été édifiés sur des terres qui appartenaient au XVIème siècle à la
famille Guicaznou Le château est surmonté d'une tour quadrangulaire qui
comporte une chapelle. " Au sommet d'un côteau boisé qui descend
jusqu'au bord de la rivière de Morlaix, est assis le Château moderne de
Lannigou. La terre de Lannigou a appartenu au XVIème siècle aux Guicasnou. En
1608 à Guy Balavesne, Maire de Morlaix, et en 1750 à Sébastien-René Drillet,
seigneur de Lannigou, bailli de Morlaix. Par alliance, Lannigou a passé à la
famille Cazin à M. le Baron Cazin d’Honincthun, Maire de Taulé de mai 1882 à janvier 1908 " ;

![]() l'ancien
manoir de Kercadoret. La chapelle privée, aujourd'hui disparue, était
jadis dédiée à saint Laurent ;
l'ancien
manoir de Kercadoret. La chapelle privée, aujourd'hui disparue, était
jadis dédiée à saint Laurent ;
![]() l'ancien
manoir de Kerangomar ou Kerangoumar (XVIIème siècle). On y voyait jadis les écussons de
François de Kergroadez et de Kerangomar (entouré du collier de
Saint-Michel qui lui fut conféré en 1598). A noter que Kerangomar passa
dans la maison de Kergroadez suite au mariage de Hamon III, seigneur de
Kergroadez, le 29 mars 1431, avec Catherine de Kerouzéré, héritière de
Guillaume de Kerouzéré et de Jeanne Le Noir, seigneur et dame de
Kerangomar. Leur fils se nommait Robert de Kergroadez et leur petit-fils Hamon IV.
" A 2 kms, au Nord-Ouest de Lannigou, on découvre le manoir de Kerangomar
précédé d'une belle avenue de hêtres. C'est un édifice du XVIIème siècle flanqué
de 2 pavillons. Catherine de Kerouzeré, dame du lieu, épousa, en 1545, François
de Kersauson. On voit, à l'intériour du manoir, une cheminée de la Renaissance,
surmontée de l'écusson de François de Kergroadez, seigneur du dit lieu et de
Kerangomar. Ce François de Kergroadez mourut à Kerangomar en 1617 " ;
l'ancien
manoir de Kerangomar ou Kerangoumar (XVIIème siècle). On y voyait jadis les écussons de
François de Kergroadez et de Kerangomar (entouré du collier de
Saint-Michel qui lui fut conféré en 1598). A noter que Kerangomar passa
dans la maison de Kergroadez suite au mariage de Hamon III, seigneur de
Kergroadez, le 29 mars 1431, avec Catherine de Kerouzéré, héritière de
Guillaume de Kerouzéré et de Jeanne Le Noir, seigneur et dame de
Kerangomar. Leur fils se nommait Robert de Kergroadez et leur petit-fils Hamon IV.
" A 2 kms, au Nord-Ouest de Lannigou, on découvre le manoir de Kerangomar
précédé d'une belle avenue de hêtres. C'est un édifice du XVIIème siècle flanqué
de 2 pavillons. Catherine de Kerouzeré, dame du lieu, épousa, en 1545, François
de Kersauson. On voit, à l'intériour du manoir, une cheminée de la Renaissance,
surmontée de l'écusson de François de Kergroadez, seigneur du dit lieu et de
Kerangomar. Ce François de Kergroadez mourut à Kerangomar en 1617 " ;
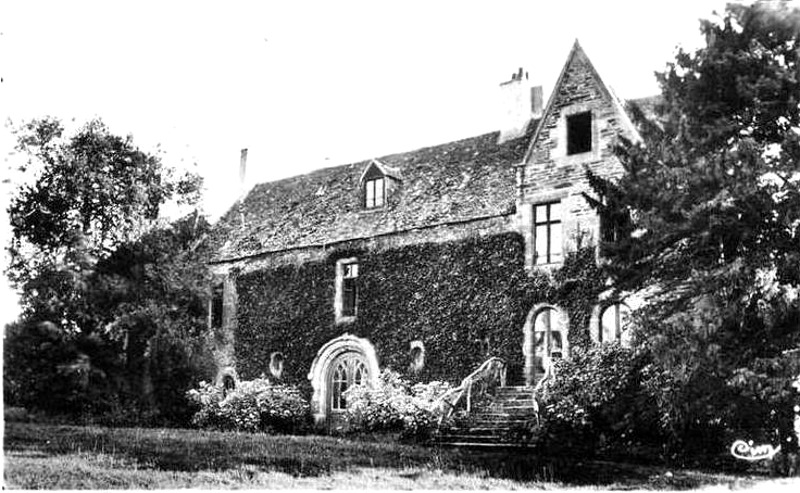
![]() l'ancien
manoir de Kérozal, édifié en plusieurs étapes par Jean Victor Lhuillier
(1827-1888). La partie gauche de l'édifice date de 1890. La partie Est du
château, édifiée par Blanche Lhuillier (épouse de Jean Victor), date de
1897. L'édifice devient ensuite la propriété de la fille de ces derniers,
Blanche (1859-1950) épouse de Lucien Blavoyer (1870-1927). Le domaine est
vendu vers 1937 à une communauté de soeurs Franciscaines. En 1972,
l'édifice est acheté par les "Genêts d'Or" pour accueillir des
enfants présentant des défiances intellectuelles ;
l'ancien
manoir de Kérozal, édifié en plusieurs étapes par Jean Victor Lhuillier
(1827-1888). La partie gauche de l'édifice date de 1890. La partie Est du
château, édifiée par Blanche Lhuillier (épouse de Jean Victor), date de
1897. L'édifice devient ensuite la propriété de la fille de ces derniers,
Blanche (1859-1950) épouse de Lucien Blavoyer (1870-1927). Le domaine est
vendu vers 1937 à une communauté de soeurs Franciscaines. En 1972,
l'édifice est acheté par les "Genêts d'Or" pour accueillir des
enfants présentant des défiances intellectuelles ;
![]() le
château de Kerozar, situé non loin d'une chapelle dédiée à
Sainte-Geneviève et édifié par Jacques Le Bris (1790-1866) qui fit
détruire l'ancien château. En effet, un édifice est mentionné dès le
XVIème siècle et appartient alors à Alain Quintin (époux de Périne de
Kermerc'hou). La demeure est vendue ensuite par Jeanne Quintin à Jean
Guillotou, puis il devient la propriété de François Joseph Guillotou,
seigneur de Kerever et secrétaire du roi en 1739. Le domaine est
vendu comme bien national, et devient ensuite la propriété de la famille
de Villiers, de la famille Le Loup Varennes, puis de la famille Le Bris
(dès 1843). Une des filles de Jacques Le Bris, Jeanne Zoé, héritière,
épouse le général Félix Le Bon (1845-1923). Le château de Kerozar est
vendu en 1965 à la société Unicopa. Les quatre angles formés par les
pignons du château ont la forme de tours carrées ;
le
château de Kerozar, situé non loin d'une chapelle dédiée à
Sainte-Geneviève et édifié par Jacques Le Bris (1790-1866) qui fit
détruire l'ancien château. En effet, un édifice est mentionné dès le
XVIème siècle et appartient alors à Alain Quintin (époux de Périne de
Kermerc'hou). La demeure est vendue ensuite par Jeanne Quintin à Jean
Guillotou, puis il devient la propriété de François Joseph Guillotou,
seigneur de Kerever et secrétaire du roi en 1739. Le domaine est
vendu comme bien national, et devient ensuite la propriété de la famille
de Villiers, de la famille Le Loup Varennes, puis de la famille Le Bris
(dès 1843). Une des filles de Jacques Le Bris, Jeanne Zoé, héritière,
épouse le général Félix Le Bon (1845-1923). Le château de Kerozar est
vendu en 1965 à la société Unicopa. Les quatre angles formés par les
pignons du château ont la forme de tours carrées ;
![]() le
château du Frout, encore surnommé "le nouveau Frout". On y
trouve une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et qui date de
1860. La porte de la chapelle est cintrée. La chapelle renferme trois
vitraux représentant saint Paul (daté de 1860), Hippolyte (daté de 1861),
Tugdual (daté de 1865), Paule (daté de 1866). Sur la gauche du château,
se trouve encore l'ancien château de Frout (ancienne ferme de Frout) auquel
on a rajouté une aile à angle droit en 1895 ;
le
château du Frout, encore surnommé "le nouveau Frout". On y
trouve une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et qui date de
1860. La porte de la chapelle est cintrée. La chapelle renferme trois
vitraux représentant saint Paul (daté de 1860), Hippolyte (daté de 1861),
Tugdual (daté de 1865), Paule (daté de 1866). Sur la gauche du château,
se trouve encore l'ancien château de Frout (ancienne ferme de Frout) auquel
on a rajouté une aile à angle droit en 1895 ;
![]() l'ancien
manoir du Frout, encore surnommé "le vieux Frout", édifié au
XVIème siècle. Le corps principal du logis date du XVIème siècle. La
porte cintrée est ornée d'un écu aux armes de la famille Bernard de
Basseville. Propriété de la famille Gourio (au XVIème siècle), associée
aux Crémeur et aux de Quelen, puis de la famille Leserec de Tredern (entre
1678 et 1692), de la famille Allain de la Brosse (de 1692 à 1707), de la
famille de Launay, de la famille Bernard de Basseville, époux de Jacquette
de La Chapelle (en 1734). La petite-fille, Cécile, de Bernard de Basseville
lègue son héritage à son neveu Jean-Baptiste Drillet de Lannigou, dont
une descendante, Paule de Parscau épouse Joseph de Kersauson Vieux Châtel
(1852-1913) ;
l'ancien
manoir du Frout, encore surnommé "le vieux Frout", édifié au
XVIème siècle. Le corps principal du logis date du XVIème siècle. La
porte cintrée est ornée d'un écu aux armes de la famille Bernard de
Basseville. Propriété de la famille Gourio (au XVIème siècle), associée
aux Crémeur et aux de Quelen, puis de la famille Leserec de Tredern (entre
1678 et 1692), de la famille Allain de la Brosse (de 1692 à 1707), de la
famille de Launay, de la famille Bernard de Basseville, époux de Jacquette
de La Chapelle (en 1734). La petite-fille, Cécile, de Bernard de Basseville
lègue son héritage à son neveu Jean-Baptiste Drillet de Lannigou, dont
une descendante, Paule de Parscau épouse Joseph de Kersauson Vieux Châtel
(1852-1913) ;
![]() l'ancien
château de Rozarcour ou Roz-ar-Scour (XIXème siècle), édifié vers 1880
par Gaston Lot, époux de Marguerite Lhuillier (fille de Jean Victor
Lhuillier). Le domaine devient ensuite, vers 1949, la propriété de la
Société Immobilière Brestoise, qui y installe le siège de l'Association
"Maison d'Accueil Saint-Joseph", puis la propriété de
l'Association "Roz ar Scour". L'édifice devient en
1976 la propriété de l'hôpital de Morlaix, afin d'y installer un service
psychiatrique, qui aujourd'hui à fermer ses portes ;
l'ancien
château de Rozarcour ou Roz-ar-Scour (XIXème siècle), édifié vers 1880
par Gaston Lot, époux de Marguerite Lhuillier (fille de Jean Victor
Lhuillier). Le domaine devient ensuite, vers 1949, la propriété de la
Société Immobilière Brestoise, qui y installe le siège de l'Association
"Maison d'Accueil Saint-Joseph", puis la propriété de
l'Association "Roz ar Scour". L'édifice devient en
1976 la propriété de l'hôpital de Morlaix, afin d'y installer un service
psychiatrique, qui aujourd'hui à fermer ses portes ;
![]() l'ancien
manoir de Saint-Yves ;
l'ancien
manoir de Saint-Yves ;
![]() l'ancienne
maison du Pors-Bras. " C'est l'une des plus
vieilles maisons de Taulé avec celle de Coatudual. Les documents conservés dans
la famille datent de 1685. Après avoir appartenu à plusieurs propriétaires,
manoir et jardin sont vendus à Mademoiselle de Kerléan en 1824. En 1853,
Joséphine Marie de Kerléan, épouse de Monsieur de Penguern, en devient
propriétaire. En 1856, son mari décède. Elle-même reste au manoir jusqu'à sa
mort en 1892. Elle laisse deux filles, l'aînée mariée à Monsieur du Laz et la
plus jeune, célibataire qui restera au Manoir jusqu'à sa mort en 1928. L'une de
ses nièces héritera de sa fortune. En 1898, Madame du Laz, née de Penguern, et
sa soeur, font don à la Commune d'un terrain pour construire l'église actuelle.
En 1946, la ferme du Pors-Bras est vendue. Le nouveau propriétaire en fait un
lotissement, appelé lotissement du Pors-Bras. Sur l'ancienne ferme se trouvent
également les deux terrains de football et le patronage ;
l'ancienne
maison du Pors-Bras. " C'est l'une des plus
vieilles maisons de Taulé avec celle de Coatudual. Les documents conservés dans
la famille datent de 1685. Après avoir appartenu à plusieurs propriétaires,
manoir et jardin sont vendus à Mademoiselle de Kerléan en 1824. En 1853,
Joséphine Marie de Kerléan, épouse de Monsieur de Penguern, en devient
propriétaire. En 1856, son mari décède. Elle-même reste au manoir jusqu'à sa
mort en 1892. Elle laisse deux filles, l'aînée mariée à Monsieur du Laz et la
plus jeune, célibataire qui restera au Manoir jusqu'à sa mort en 1928. L'une de
ses nièces héritera de sa fortune. En 1898, Madame du Laz, née de Penguern, et
sa soeur, font don à la Commune d'un terrain pour construire l'église actuelle.
En 1946, la ferme du Pors-Bras est vendue. Le nouveau propriétaire en fait un
lotissement, appelé lotissement du Pors-Bras. Sur l'ancienne ferme se trouvent
également les deux terrains de football et le patronage ;

![]()
ANCIENNE NOBLESSE de TAULE
SEIGNEURIE DE KERANGOMARD. — Paroisse de Taulé, ancien évêché de Léon. André de Kersauson, fils cadet de Jean, premier auteur de la branche de Guénan, en fut apanagé, mais il l'échangea en 1515, avec son neveu Hervé, contre la seigneurie de Guénan, dont il continua la filiation. La postérité d'Hervé conserva la terre de Kerangomard jusqu'à 1566, où elle passa dans la maison Rioualen (rameau de Rosmadec) par le mariage de François Rioualen avec Marie de Kersauson (J. de Kersauson).
SEIGNEURIE DE LAVALLOT. — Paroisse de Taulé, comme celle de Kerangomard, ancien évêché de Léon. Elle appartenait dans le principe à la maison de Cornouailles, dont une fille, Claude de Cornouaille, épousa, en 1547, Guillaume III de Kersauson, sr. de Penhoët. Elle fut durant plusieurs générations la qualification des cadets de la branche Penhoët-Pennendreff (J. de Kersauson). PRIÈRES NOMINALES AU PRONE. — « Prières pour le sieur de Coëthuel, de Kersauson, noble homme François de Kersauson, sr de Coëthuel, premier juveigneur de la maison de Pennendreff, mary et procureur des droicts de damoiselle Marguerite de Kercohent, héritière du Penhoët Feziou, en Ploudiry. Nous prierons Dieu pour les âmes de noble home Guillaume de Kersauson, et damoyselle Marie Kerengarz, héritiers de la maison de Pennendreff, seigneurs, en leur vivant, de Lavallot, Pennendreff, père et mère aud. sr de Coëthuel. Item, nous prierons pour noble hôme Guillaume de Kersauson et de date moyselle Claude de Cornouaille, héritiers de la maison de Lavallot, sr et dame, de leur vivant, de Penhoët, Lavallot, Coëtmeur, Kervizellou, ayeul et ayeulle aud. sr de Coëthuel. Item, nous prierons Dieu pour Laurent de Kersauson, Hervé de Kersauson, sr de Pennendreff, et Claude de Kersauson, sr de Lavallot, frère aud. sieur de Coëthuel. Plus nous prierons pour l'âme de haut et puissant messire Vincent de Kersauson, chevalier de l'ordre du Roy, en son vivant sr de Penhoët, Kervizellou, Guermeur Keromp, cousin germain audit sr de Coathuel » (Extrait des Archives de Pennendreff) [Note : Quoique rien n'indique dans cette pièce des registres de quelle paroisse elle est extraite, il est certain pour nous qu'elle provient de ceux de Taulé, dans laquelle était située la seigneurie de Lavallot, apportée aux Kersauson par Claude de Cornouaille, et qui devint, comme on l'a vu, l'apanage des cadets de Penhoët-Pennendreff].
Les Drillet, srs. de la Cassière et de Lanigou, en Taulé, évêché de Léon, portaient : Fascé d'argent et de sable de six pièces, au lion d'or couronné de gueules, brochant (Armorial de 1696). Cette famille a produit : un jurat de Morlaix en 1707. — Un contrôleur à la chancellerie en 1779.
Lors de la Réformation de l'évêché de Léon en 1443, plusieurs familles nobles sont mentionnées à Taulé :
![]() Chateaumen
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’azur au château
d’argent. Alain se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
Chateaumen
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’azur au château
d’argent. Alain se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Coskerguen
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce
d’azur surmontée d’une merlette de même. Guillaume se trouve
mentionné entre les nobles de Taulé.
Coskerguen
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce
d’azur surmontée d’une merlette de même. Guillaume se trouve
mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Guéguen,
seigneur du Henguer, paroisse de Taulé. Jean se trouve mentionné entre les
nobles de Taulé.
Guéguen,
seigneur du Henguer, paroisse de Taulé. Jean se trouve mentionné entre les
nobles de Taulé.
![]() Guernisac
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de
gueules, chargée de trois molettes d’azur. Marguerite se trouve
mentionné entre les nobles de Taulé.
Guernisac
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de
gueules, chargée de trois molettes d’azur. Marguerite se trouve
mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Guicaznou
(de), seigneur de Lezireur, paroisse de Taulé. D’argent fretté
d’azur. Jean se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
Guicaznou
(de), seigneur de Lezireur, paroisse de Taulé. D’argent fretté
d’azur. Jean se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Hamon,
seigneur de Lavallot, paroisse de Taulé. De sable fretté d’or, au
canton dextre d’argent, chargé d’une tour crénelée de gueules.
Pierre se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
Hamon,
seigneur de Lavallot, paroisse de Taulé. De sable fretté d’or, au
canton dextre d’argent, chargé d’une tour crénelée de gueules.
Pierre se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Keraminou
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce
d’azur surmontée d’une merlette de même. Hervé se trouve mentionné
entre les nobles de Taulé.
Keraminou
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce
d’azur surmontée d’une merlette de même. Hervé se trouve mentionné
entre les nobles de Taulé.
![]() Kerguz
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent au cor de
chasse d’azur lié de gueules en sautoir. Guillaume se trouve mentionné
entre les nobles de Taulé.
Kerguz
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent au cor de
chasse d’azur lié de gueules en sautoir. Guillaume se trouve mentionné
entre les nobles de Taulé.
![]() Kerlan
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Sibiril, et de Kerambellec, paroisse
de Taulé. Porte un houx accosté de deux étoiles (sceau de 1418).
Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
Kerlan
(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Sibiril, et de Kerambellec, paroisse
de Taulé. Porte un houx accosté de deux étoiles (sceau de 1418).
Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Noir
(Le) ou Duff (an), seigneur de Coëtbloc'hou, paroisse de Taulé. D’or
à une fasce de sable, chargée de trois arbres d’argent. Guillaume se
trouve mentionné entre les nobles d'Henvic.
Noir
(Le) ou Duff (an), seigneur de Coëtbloc'hou, paroisse de Taulé. D’or
à une fasce de sable, chargée de trois arbres d’argent. Guillaume se
trouve mentionné entre les nobles d'Henvic.
![]() Thomas,
seigneur de Kercadoret, paroisse de Taulé. De sable à la tour
d’argent. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
Thomas,
seigneur de Kercadoret, paroisse de Taulé. De sable à la tour
d’argent. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.
![]() Ynizan,
seigneur de Kermorvan, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de gueules
accompagnée de trois annelets de même. Guillaume se trouve mentionné
entre les nobles de Taulé.
Ynizan,
seigneur de Kermorvan, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de gueules
accompagnée de trois annelets de même. Guillaume se trouve mentionné
entre les nobles de Taulé.
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de 27 nobles de Taulé :
![]() Allain
du CHASTEAUMEN (30 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Allain
du CHASTEAUMEN (30 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Hervé
DANIEL (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en
archer ;
Hervé
DANIEL (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en
archer ;
![]() Yvon
DU BOYS (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en
archer ;
Yvon
DU BOYS (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en
archer ;
![]() Jehan
DU FOU, mineur (70 livres de revenu), remplacé par Yvon Lanmeur : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Jehan
DU FOU, mineur (70 livres de revenu), remplacé par Yvon Lanmeur : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Morice
GUEGUEN (10 livres de revenu), malade, remplacé par Jehan Gueguen : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Morice
GUEGUEN (10 livres de revenu), malade, remplacé par Jehan Gueguen : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Jehan
GUEGUEN (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en
archer ;
Jehan
GUEGUEN (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en
archer ;
![]() Mériadec
GUICAZNOU (1 100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge. Il est accompagné d'Hervé Le Jeune porteur d'une brigandine et en
archer ;
Mériadec
GUICAZNOU (1 100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge. Il est accompagné d'Hervé Le Jeune porteur d'une brigandine et en
archer ;
![]() Yvon
GUILLOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Yvon
GUILLOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Guillaume
HAMON (25 livres de revenu), remplacé par Yvon Mazeas : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Guillaume
HAMON (25 livres de revenu), remplacé par Yvon Mazeas : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Hervé
HULYAS (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Hervé
HULYAS (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Yvon
KERANFLAC (100 sols de revenu), remplacé par Jehan Moign : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Yvon
KERANFLAC (100 sols de revenu), remplacé par Jehan Moign : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Hervé
KERAUNNOU (15 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Guillaume : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
Hervé
KERAUNNOU (15 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Guillaume : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
![]() Yvon
KERAUNNOU (6 livres de revenu), remplacé par Yvon Canesen : porteur d'une
jaque, comparaît armé d'une vouge ;
Yvon
KERAUNNOU (6 livres de revenu), remplacé par Yvon Canesen : porteur d'une
jaque, comparaît armé d'une vouge ;
![]() Jehan
Thomas KERCADORET (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Jehan
Thomas KERCADORET (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Guillaume
KERCUZ (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Guillaume
KERCUZ (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Hervé
KERGALLIC (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Hervé
KERGALLIC (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Jehanne
KERLAN, mineure (30 livres de revenu), remplacée par Jehan Hamon : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Jehanne
KERLAN, mineure (30 livres de revenu), remplacée par Jehan Hamon : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Guillaume
KERRAUMMOU (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Guillaume
KERRAUMMOU (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Hervé
KERRET (100 sols de revenu), remplacé par Hervé Henry : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Hervé
KERRET (100 sols de revenu), remplacé par Hervé Henry : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Jehanne
LANNORGANT (10 livres de revenu), remplacé par Henry Madouzgrech : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
Jehanne
LANNORGANT (10 livres de revenu), remplacé par Henry Madouzgrech : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
![]() Guillaume
LE DU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer
;
Guillaume
LE DU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer
;
![]() Jehan
LE GALL (14 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Jehan
LE GALL (14 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Guillaume
PENSORNOU (35 livres de revenu), remplacé par son fils Laurens : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Guillaume
PENSORNOU (35 livres de revenu), remplacé par son fils Laurens : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Ollivier
QUELLEN (100 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
Ollivier
QUELLEN (100 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
![]() Jehan
QUELEN (30 livres de revenu), remplacé par Perrin Sulyer : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
Jehan
QUELEN (30 livres de revenu), remplacé par Perrin Sulyer : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
![]() Derien
TRENENGAN (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
Derien
TRENENGAN (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une
vouge ;
![]() Guillaume
YNISAN (20 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
Guillaume
YNISAN (20 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît
en archer ;
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Taulé sont mentionnés :
![]() Jehan
du Fou, sieur du vieux Chastel, malade, pour lequel maistre François
Kerourfil, qui est maryé à sa principale héritière, a promis fournir
homme à servir pour luy en habillement de guerre ;
Jehan
du Fou, sieur du vieux Chastel, malade, pour lequel maistre François
Kerourfil, qui est maryé à sa principale héritière, a promis fournir
homme à servir pour luy en habillement de guerre ;
![]() Maryadec
Guicaznou, sieur de Losneur, représenté par Jehan Guicaznou son fils, en
brigandine, bien armé et monté à deux chevaulx ;
Maryadec
Guicaznou, sieur de Losneur, représenté par Jehan Guicaznou son fils, en
brigandine, bien armé et monté à deux chevaulx ;
![]() Jehan
Quélen, représenté par Tanguy Quélen, en brigandine. Injonction à
deux chevaulx ;
Jehan
Quélen, représenté par Tanguy Quélen, en brigandine. Injonction à
deux chevaulx ;
![]() Guillaume
le Du, en brigandine et injonction de hocqueton ;
Guillaume
le Du, en brigandine et injonction de hocqueton ;
![]() Jehan
de Launay, en brigandine et bien en poinct ;
Jehan
de Launay, en brigandine et bien en poinct ;
![]() Guillaume
Guehoux, en brigandine, bien en poinct ;
Guillaume
Guehoux, en brigandine, bien en poinct ;
![]() Yvon
du Bois. Injonction de s'armer ;
Yvon
du Bois. Injonction de s'armer ;
![]() Laurens
Pensornou. Injonction de s'armer ;
Laurens
Pensornou. Injonction de s'armer ;
![]() Christophle
Kermellec, en brigandine et injonction de gorgelettes ;
Christophle
Kermellec, en brigandine et injonction de gorgelettes ;
![]() Guillaume
Cozquerven, représenté par Jehan son fils, en brigandine ;
Guillaume
Cozquerven, représenté par Jehan son fils, en brigandine ;
![]() Guillaume
Le Jeune ;
Guillaume
Le Jeune ;
![]() Pierre
Saint Denis ;
Pierre
Saint Denis ;
![]() François
Le Vayer, représenté par Goulven son fils, en brigandine ;
François
Le Vayer, représenté par Goulven son fils, en brigandine ;
![]() Laurent
Kermellec ;
Laurent
Kermellec ;
![]() Autre
Guillaume Cozquerven ;
Autre
Guillaume Cozquerven ;
![]() Hervé
Guéguen, en brigandine. Injonction de gorgelette et hocquetton ;
Hervé
Guéguen, en brigandine. Injonction de gorgelette et hocquetton ;
![]() Guillaume
le Veyer, en brigandine ;
Guillaume
le Veyer, en brigandine ;
![]() Jehan
le Gall, en brigandine. Injonction de salade et gorgelette ;
Jehan
le Gall, en brigandine. Injonction de salade et gorgelette ;
![]() Hervé
le Jeune ;
Hervé
le Jeune ;
![]() Guillaume
le Goezou ;
Guillaume
le Goezou ;
![]() Hervé
Pencat ;
Hervé
Pencat ;
![]() Yvon
Elias ;
Yvon
Elias ;
![]() Jehan
Bos ;
Jehan
Bos ;
![]() Perrot
Foucquet, représenté par Yvon son fils, en brigandine ;
Perrot
Foucquet, représenté par Yvon son fils, en brigandine ;
![]() Symon
le Goff ;
Symon
le Goff ;
![]() Robert
le Ny ;
Robert
le Ny ;
![]() Thomas
du Hammeau, représenté par Pierre An-Dhu ;
Thomas
du Hammeau, représenté par Pierre An-Dhu ;
![]() Yvon
Thomas, en brigandine ;
Yvon
Thomas, en brigandine ;
![]() Jehan
Thomas ;
Jehan
Thomas ;
![]() Jehan
Pensornnou. Injonction de s'armer ;
Jehan
Pensornnou. Injonction de s'armer ;
![]() Jehan
Daniel le jeune, en brigandine ;
Jehan
Daniel le jeune, en brigandine ;
![]() Robert
Joson, en brigandine ;
Robert
Joson, en brigandine ;
![]() Hervé
Cliezou, représenté par Hervé Henry, en brigandine et injonction d'espée
et hocquetton ;
Hervé
Cliezou, représenté par Hervé Henry, en brigandine et injonction d'espée
et hocquetton ;
![]() Katherine
Cozquerven, représentée par Hervé Henry, en brigandine ;
Katherine
Cozquerven, représentée par Hervé Henry, en brigandine ;
![]() Robert
Joson, en brigandine ;
Robert
Joson, en brigandine ;
![]() Jehan
Nicolas, greffier de Lesneven, escripvant sur ladite monstre ;
Jehan
Nicolas, greffier de Lesneven, escripvant sur ladite monstre ;
![]() Yvon
Guillou, default ;
Yvon
Guillou, default ;
![]() Vincent
Marc'hec, default ;
Vincent
Marc'hec, default ;
![]() Guillaume
Bouteiller, sieur de Keromnès, malade en extrémité. Injonction
d'envoyer pour luy ;
Guillaume
Bouteiller, sieur de Keromnès, malade en extrémité. Injonction
d'envoyer pour luy ;
![]() Marye
Thepault, représentée par Jehan Nédélec, en brigandine. Injonction de
salade ;
Marye
Thepault, représentée par Jehan Nédélec, en brigandine. Injonction de
salade ;
![]() Loys
Gleveder, en brigandine. Injonction de salade ;
Loys
Gleveder, en brigandine. Injonction de salade ;
![]() Hervé
Kergallic, mineur, injonction d'envoyer chevaulx et hommes ;
Hervé
Kergallic, mineur, injonction d'envoyer chevaulx et hommes ;
![]() Hervé
Christoples ;
Hervé
Christoples ;
![]() Jehan
Inizan, injonction de s'armer ;
Jehan
Inizan, injonction de s'armer ;
![]() Jehan
Kermellec, en brigandine ;
Jehan
Kermellec, en brigandine ;
![]() Jehan
Daniel, sergent de Lesneven. Injonction de s'armer ;
Jehan
Daniel, sergent de Lesneven. Injonction de s'armer ;
![]() Anne
Kermellec, fille d'Yvon Kermellec ;
Anne
Kermellec, fille d'Yvon Kermellec ;
![]() L'héritier
Yvon de la Motte ;
L'héritier
Yvon de la Motte ;
![]() Jehan
le Goff, default.
Jehan
le Goff, default.
A la « montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’évêché de Léon reçue à Saint-Renan le 24 août 1557, plusieurs nobles de Taulé (Taulle) sont mentionnés :
![]() Le sr.
de la Motte de Taulle [Note : Famille fondue en 1569 dans le Borgne de
Lesquiffiou] ;
Le sr.
de la Motte de Taulle [Note : Famille fondue en 1569 dans le Borgne de
Lesquiffiou] ;
![]() Gilles
le Noyr ;
Gilles
le Noyr ;
![]() Guillaume
Guycaznou ;
Guillaume
Guycaznou ;
![]() Guillaume
Marec ;
Guillaume
Marec ;
![]() Yvon
an Helyas ;
Yvon
an Helyas ;
![]() Yves
de la Motte ;
Yves
de la Motte ;
![]() Fyacre
Gueguen ;
Fyacre
Gueguen ;
![]() Auffroy
Bygodou ;
Auffroy
Bygodou ;
![]() Olivier
Mahé ;
Olivier
Mahé ;
![]() Thomas
Plesournou ;
Thomas
Plesournou ;
![]() Yvon
Perrot ;
Yvon
Perrot ;
![]() L’héritier
de Yvon Keraudy ;
L’héritier
de Yvon Keraudy ;
![]() Phelippe
Perrot ;
Phelippe
Perrot ;
![]() Yvon
le Gouezou ;
Yvon
le Gouezou ;
![]() Jehan
Nycholas, sr. de Kerrault ;
Jehan
Nycholas, sr. de Kerrault ;
![]() Autre
Jehan Nycholas ;
Autre
Jehan Nycholas ;
![]() Loys
Collotin ;
Loys
Collotin ;
![]() Maistre
Jehan le Galleer ;
Maistre
Jehan le Galleer ;
![]() Charles
Coetquelven.
Charles
Coetquelven.
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.