|
Bienvenue chez les Villaméens |
VILLAMEE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Louvigné-du-Désert
La commune de
Villamée ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de VILLAMEE
Villamée dérive de "villa Armoy" (maison de campagne), francisé en Villamer, puis Villamée.
Villamée doit son origine à une villa gallo-romaine. Le nom de Villamée est dérivé de celui de Ville-Amois, dont la dernière partie désigne un fief donné à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, en 990, par le duc de Bretagne, Conan II (Conan le Tort, comte de Rennes). L'abbaye y élève alors une église et y construit un prieuré. C'est à l'abbaye du Mont-Saint-Michel qu'il faut attribuer vraisemblablement l'origine de la paroisse.
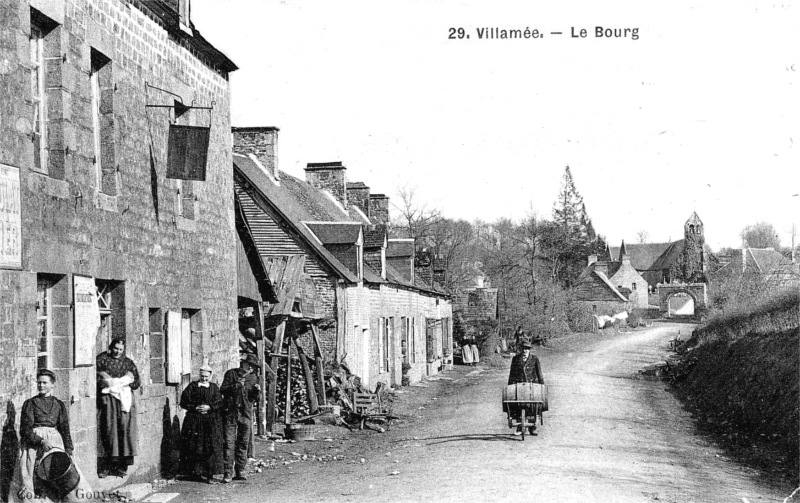
En 1050, l'évêque de Rennes, Méen ou Main, possède sur l'église de Villamée des droits qu'il cède aux moines du Mont-Saint-Michel. Ces deux dates, 990 et 1050 fixent l'intervalle dans lequel naît la paroisse. Celle-ci est conservée par l'abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Révolution
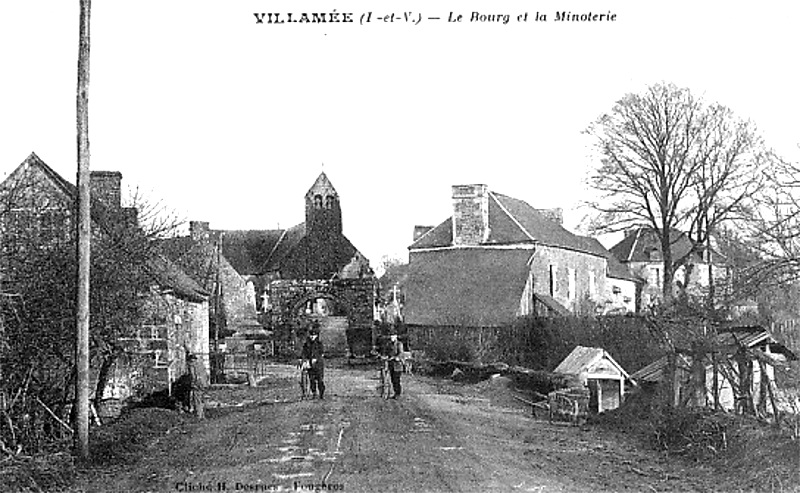
En 1574, un conseiller au Parlement de Bretagne, M. Harpin, achète le fief du Haut Pays, en Villamée, qui avait été aussi donné aux moines par Conan II.

En 1790, le recteur, M. Gasté, déclara qu'il jouissait du presbytère et de son pourpris, estimés 100 livres de rente ; — d'une portion des grosses dîmes, valant 1350 livres, — et des dîmes novales, ne rapportant que 25 livres. Il avait donc un revenu brut total de 1475 livres. A la même époque, la fabrique de Villamée avait 48 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).
On rencontre les appellations suivantes : Villa Amois (en 990), ecclesia de Villamois (en 1050), parochia Villamaris (au XIVème siècle), Villamers (en 1447).
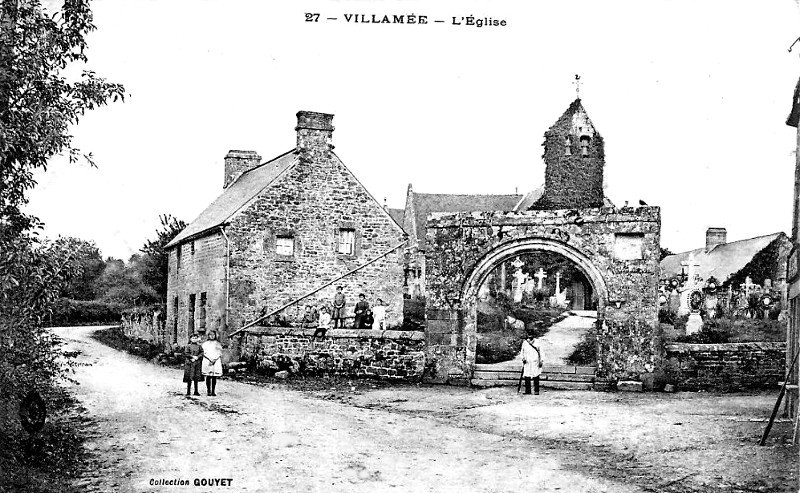
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Villamée : Guillaume Nouail (chapelain de Saint-Léonard de Fougères). Olivier Le Corvaisier (chanoine et chantre de Dol, en 1552). Nicolas Breillet (en 1595). Toussaint Levesque (il fut présenté en 1615 par les moines du Mont Saint-Michel). Julien Chauvin (en 1642, décédé en 1645). Michel Louvel (prêtre d'Avranches, il fut présenté le 13 décembre 1645). Jacques Bidault (il fit au roi, baron de Fougères, le 8 novembre 1676, la déclaration de son presbytère et de son pourpris, contenant 3 journaux de terre ; il gouvernait encore en 1681). Jean Dardaine (en 1697, décédé en 1701 et inhumé dans le choeur). Sébastien Malherbe (prêtre du diocèse, présenté le 20 avril 1701, il fut pourvu le 20 mai et résigna peu après en faveur du suivant). Jean Le Febure (prêtre du diocèse, il fut pourvu en 1701 ; décédé en 1723). Noël Richard (prêtre d'Avranches, il fut pourvu le 18 septembre 1723 ; décédé le 4 décembre 1742 et inhumé dans son église). Joseph Janvier (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 23 décembre 1742 ; décédé âgé de cinquante-huit ans, le 28 mai 1753, et inhumé dans son église). Jean Dauguet (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 16 juin 1753 ; décédé âgé de trente-deux ans, le 18 mars 1757). Jean-François Debaudre (prêtre de Bayeux, pourvu le 16 avril 1757, il résigna au suivant). Henry Durand (prêtre de Bayeux, il fut pourvu le 8 mars 1760 ; décédé âgé de cinquante-cinq ans, le 14 février 1773, et inhumé dans le cimetière). Julien Courtoux (il fut pourvu le 21 avril 1773 ; décédé âgé de cinquante-sept ans, en octobre 1775). Pierre Louail (chapelain de Bréquigny, pourvu le 15 octobre 1775, il devint en 1781 recteur de Saint-Aubin-du-Gormier). Joseph-Anne Durocher (recteur de Saint-Georges-de-Reintembault, pourvu sur la résignation du précédent le 12 mars 1782, il résigna à son tour en faveur du suivant). Nicolas-Julien Gasté (curé de Villamée, pourvu le 25 novembre 1789, il gouverna jusqu'à la Révolution). Jean Louvel (1803-1824). Jean-Pierre Marais (1824-1827). Jean-Julien Gablin (1827, décédé en 1829). François Duhoux (1829, décédé en 1865). Jean-Marie Garnier (1866-1872). Bonaventure Thébault (à partir de 1872), ......

Voir
![]() "
Origines
de la paroisse de Villamée
".
"
Origines
de la paroisse de Villamée
".
![]()
PATRIMOINE de VILLAMEE
![]() l'église
Saint-Martin (XV-XVI-XVIIème siècle). Elle est dédiée à saint Martin,
évêque de Tours. L'église primitive de Villamée est édifiée à
la fin du Xème siècle par des moines du Mont-Saint-Michel. L'église est
reconstruite au XVème siècle : elle se compose d'une nef du XV-XVIème
siècle avec une chapelle au nord. On voyait en 1680 dans la chapelle nord
l'enfeu des seigneurs des Coudrays. Les bénitiers datent du XVIème siècle. La
sacristie date de 1856. Le retable du maître-autel, oeuvre de Jean
Blanchard, date de 1809 et abrite la statue du Christ entouré de saint
Martin et de saint Laurent. Le porche, muni de bancs, date du XVIème siècle. On voit au sud-ouest un reste de litre qui portait
les armes des seigneurs de la Chesnaye en Parigné. Le
seigneur de la Chesnaye se disait fondateur de l'église de Villamée, où
il avait ses banc, enfeu et lisière. On a trouvé en 1910,
sur le mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème
siècle. L'église renferme plusieurs pierres tombales dont celle des
seigneurs de Coudray qui avaient jadis (au XVème siècle) droit de banc,
d'enfeu dans la chapelle Notre-Dame, située au nord de l'église de
Villamée. Le portail de l'entrée du cimetière date du XVIème siècle. On a trouvé en 1910 sur le
mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème siècle qui n'existent plus ;
l'église
Saint-Martin (XV-XVI-XVIIème siècle). Elle est dédiée à saint Martin,
évêque de Tours. L'église primitive de Villamée est édifiée à
la fin du Xème siècle par des moines du Mont-Saint-Michel. L'église est
reconstruite au XVème siècle : elle se compose d'une nef du XV-XVIème
siècle avec une chapelle au nord. On voyait en 1680 dans la chapelle nord
l'enfeu des seigneurs des Coudrays. Les bénitiers datent du XVIème siècle. La
sacristie date de 1856. Le retable du maître-autel, oeuvre de Jean
Blanchard, date de 1809 et abrite la statue du Christ entouré de saint
Martin et de saint Laurent. Le porche, muni de bancs, date du XVIème siècle. On voit au sud-ouest un reste de litre qui portait
les armes des seigneurs de la Chesnaye en Parigné. Le
seigneur de la Chesnaye se disait fondateur de l'église de Villamée, où
il avait ses banc, enfeu et lisière. On a trouvé en 1910,
sur le mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème
siècle. L'église renferme plusieurs pierres tombales dont celle des
seigneurs de Coudray qui avaient jadis (au XVème siècle) droit de banc,
d'enfeu dans la chapelle Notre-Dame, située au nord de l'église de
Villamée. Le portail de l'entrée du cimetière date du XVIème siècle. On a trouvé en 1910 sur le
mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème siècle qui n'existent plus ;

![]() le
prieuré Saint-Martin (XVIIème siècle), situé à proximité de l'église
Saint-Martin et jadis membre de l'abbaye du Mont Saint-Michel. «
D'or à une croix ancrée de gueules » (Armorial général ms. de
1698). En 990, Conan, comte de Rennes, donna à l'abbaye du Mont Saint-Michel
quatre villages nommés Ville-Amois, Passillé, Lislèle et Ville-Perdue,
avec toutes les terres qui en dépendaient, « Villam Amois et villam
Passilei et villam lssel et Villam Perdutit » (Dom Morice, Preuves de
l'Histoire de Bretagne, I, 350). Conan, en faisant don de ces terres à
l'abbaye, lui concéda en même temps tous les droits de juridiction sur
leurs habitants, à raison des crimes ou délits qu'ils pourraient commettre
eux-mêmes dans leur circonscription ; mais il réserva à sa justice
ordinaire la connaissance des crimes et délits qui pourraient y être
commis par des étrangers, comme aussi celle des crimes et délits commis
par les hommes des moines en dehors des limites de leur domaine (nota : En
1301, le prieur de Villamée fit reconnaître par le seigneur de Fougères
son droit « de pouvoir congnoistre des crimes dans l'estendue de la
seigneurie du susdit prioré » - D. Le Roy, Recherches sur le Mont
Saint-Michel). « Les religieux, en prenant possession des terres qu'ils devaient à
la libéralité de Conan, y construisirent, pour les biens spirituels de
leurs tenanciers, une église au lieu de Ville-Amois, dont elle emprunta le
nom, devenu plus tard Villamée. Cette église, ils la possédèrent pendant
un demi-siècle dans toutes les conditions des autres églises, c'est-à-dire
dans une complète dépendance de l'Ordinaire, tant sous le rapport de la
juridiction que sous celui des redevances et autres devoirs. Mais en 1050
Main, pour lors évêque de Rennes, renonça en son nom et au nom de ses
successeurs à tous les droits qu'il pouvait prétendre sur elle, ainsi que
sur l'église de Poilley, et en fit l'abandon complet à l'abbaye du Mont
Saint-Michel » (M. Maupillé, Notices historiques sur le canton de
Louvigné-du-Désert). Ce don du patronage des deux églises de Villamée et
de Poilley fut confirmé en 1164 par Etienne, évêque de Rennes, et en 1184
par Philippe, son successeur. Etienne fit cette confirmation
très-solennellement, le 30 septembre, dans le monastère de Sainte-Croix de
Vitré ; il abandonna aux religieux du Mont Saint-Michel les deux églises
en question, avec toutes leurs dépendances, « ecclesiam Ville Amois cum
pertinenciis suis, et ecclesiam de Polleio cum pertinenciis suis », et
autorisa les moines à posséder toute espèce de bénéfices dans son
diocèse, « beneficia tam mundana quam ecclesiastica ». Raoul,
archidiacre de Rennes, approuva cet acte, fait en présence du chantre Elie,
d'Even, chapelain de l'évêque, de Jean, doyen de Vitré, de Philippe de
Poilley, etc. En 1179 le pape Alexandre III confirma, de son côté, le Mont
Saint-Michel en possession de ces églises, « ecclesiam de Poleio et
ecclesiam de Villamers, cum villa ipsa et aliis earum pertinenciis »
(Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont Saint-Michel, II, 272 et
317). Les donations qui précèdent donnèrent naissance au prieuré de
Villamée, dont l'église de Poilley devint une annexe. Les barons de
Fougères approuvèrent volontiers toutes ces libéralités faites dans leur
territoire à l'abbaye du Mont Saint-Michel ; mais ils se réservèrent un
droit de « mangier ô tous ses nécessaires pour eux et tous leurs gens,
une fois l'an, pour un jour et pour une nuit, au prieuré de Villamer ».
Lorsque les rois de France devinrent seigneurs de Fougères, les religieux
demandèrent à Philippe de Valois de renoncer à ce droit, et ce prince
voulut bien y consentir en 1324 (Bibliothèque Nationale ms. lat., n°
22357). Vers la fin du XIVème siècle, le prieur de Villamée refusa
d'admettre d'autres moines près de lui, ce qui irrita tellement le seigneur
de Fougères qu'il fit saisir en 1397 le revenu de ce prieuré « tant
pour la nourriture et entretien de deux religieux en iceluy prieuré, devant
demeurer avec le prieur, que pour les reparations qui estoient necessitées
d'y estre faictes. Par là on peut juger, dit dom Le Roy, quels estoient les
moines qui habitoient seuls ès prieurés », et combien fut sage
l'abbé Pierre Le Roy, qui à cette époque éteignit un grand nombre de ces
« prieurés champêtres » pour obliger ses religieux à vivre
régulièrement en communauté. En 1652, le domaine proche du prieuré de
Villamée se composait de : la maison priorale, avec cellier, étable, cour
devant et jardin derrière, le tout situé près l'église et le cimetière
; — la métairie du Prieuré, contenant environ 40 journaux de terre, avec
ses maisons, granges, jardins, vivier, etc. ; — l'étang et le moulin de
Villamée, auquel les vassaux étaient tenus porter leurs grains ; — un
petit bois de chênes, etc. Les moines possédaient, en outre, d'assez
nombreux fiefs : en Villamée, les fiefs de la Touche, de la Bouvrie, de la
Touraille, des Isabelles, de Lislèle, de la Charrière, de la Tréhonnais,
des Coudrais, de Ville-Perdue, et le Fief-aux-Moines ;
— en Poilley, le fief du Bourg ; — en Parigné,
le fief du Haut-Pays, de Dohin et des Bayettes (nota : une partie de ces
fiefs avaient été aliénées au XVIème siècle, mais les prieurs en
firent rentrer un bon nombre au siècle suivant). Le prieur de Villamée
avait droit de haute, moyenne et basse justice dans toute l'étendue de ces
fiefs ; — droit de cep et collier au bourg de Villamée ; — droit de
mettre les délinquants aux prisons de Fougères, à raison de quel droit il
devait à la cour de cette baronnie une rente de 7 livres appelée garde. Il
avait, de plus, droit de terrage dans toutes les terres dépendant du
prieuré, sauf dans le fief du bourg de Poilley, droit qui consistait dans
la levée de la douzième gerbe de tous les grains recueillis chaque année
; — droit de corvée pour faucher et faner ses foins, et en outre celui
d'exiger 2 deniers par chaque tête de porc et de tout bétail nourri dans
les fiefs de la Bouvrie, de la Touraille et de la Tréhonnais. Il avait
enfin droit d'enfeu, banc, armoiries, prééminences, et tous autres droits
de seigneur fondateur dans l'église de Villamée. L'une des charges du
prieur consistait en une rente de 40 livres qu'il devait à l'abbaye du Mont
Saint-Michel (Déclaration du prieuré en 1652 et 1680). Quand arriva la
Révolution, le prieuré de Villamée était depuis longtemps tombé en
commende ; ses revenus furent estimés en 1790 comme il suit : métairie,
800 livres ; — moulin, 600 livres ; — rentes seigneuriales, 30 livres ,
— et grosses dîmes, 2000 livres ; le tout donnait au prieur un revenut
brut de 3430 livres , dont il fallait déduire les charges (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Liste des prieurs : — Dom
Pierre Toustain offrit en 1559 à l'abbaye du Mont Saint-Michel un beau
reliquaire portant cette inscription : « Anno dni 1559 frater Petrus
Toustain prior prioratus de Villa Maris fecit hoc fieri ». — René de
la Haye Saint-Hilaire, prieur de Saint-Brice, rendit aveu au roi le 29 août
1553 ; il jouissait encore en commende de Villamée en 1565. — Dom
Guillaume du Chesnay rendit aveu au roi en 1606 ; il devint prieur claustral
du Mont Saint-Michel tout en conservant son prieuré de Villamée ;
décédé le 30 novembre 1617 et inhumé au Mont, dans la chapelle Saint-Aubert).
— Dom Louis de Vion, religieux de l'abbaye de Saint-Denis, rendit aveu au
roi le 5 septembre 1624. — Dom Albert Barbet résigna en 1641. — Dom
Gabriel-Nicolas Ruault, Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit
possession le 23 mai 1641 et rendit aveu au roi le 3 juin suivant, puis le 6
décembre 1652 ; il résigna en 1658. — Dom Claude-Fulgence de Chabannes,
Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit possession le 9 janvier
1659. — Dom Jean-Baptiste-Guillaume de Bellegarde, prieur de Saint-Gildas
de Rhuys (1669). — Dom Fulgence de Chabannes possédait en 1676 le prieuré,
pour lequel il rendit aveu le 30 janvier 1681. — Dom Joseph Rosset, prieur
dès 1701 ; décédé en 1722. — Dom François Torquat, Bénédictin de
Saint-Melaine, nommé en 1722, résigna en 1746. — Dom Thomas-Julien
Lamandé, également religieux de Saint-Melaine, pourvu par l'abbé du Mont
Saint-Michel, prit possession le 9 février 1747. Ce prieur eut à repousser
les prétentions de Jean-Claude Marion, prêtre de Genève, et de Louis
Verchère, qui se firent pourvoir à Rome l'un en 1748, l'autre en 1750. Dom
Lamandé habita successivement les monastères de Saint-Melaine, Solesmes,
Landévennec, Quimperlé et le Pirmil, et résigna en 1780 en faveur du
suivant. — Jean-François du Breuilh, acolyte de Paris, fut pourvu en décembre
1780 et fut le dernier prieur de Villamée ; il fit lui-même la déclaration
des biens de son bénéfice en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;
le
prieuré Saint-Martin (XVIIème siècle), situé à proximité de l'église
Saint-Martin et jadis membre de l'abbaye du Mont Saint-Michel. «
D'or à une croix ancrée de gueules » (Armorial général ms. de
1698). En 990, Conan, comte de Rennes, donna à l'abbaye du Mont Saint-Michel
quatre villages nommés Ville-Amois, Passillé, Lislèle et Ville-Perdue,
avec toutes les terres qui en dépendaient, « Villam Amois et villam
Passilei et villam lssel et Villam Perdutit » (Dom Morice, Preuves de
l'Histoire de Bretagne, I, 350). Conan, en faisant don de ces terres à
l'abbaye, lui concéda en même temps tous les droits de juridiction sur
leurs habitants, à raison des crimes ou délits qu'ils pourraient commettre
eux-mêmes dans leur circonscription ; mais il réserva à sa justice
ordinaire la connaissance des crimes et délits qui pourraient y être
commis par des étrangers, comme aussi celle des crimes et délits commis
par les hommes des moines en dehors des limites de leur domaine (nota : En
1301, le prieur de Villamée fit reconnaître par le seigneur de Fougères
son droit « de pouvoir congnoistre des crimes dans l'estendue de la
seigneurie du susdit prioré » - D. Le Roy, Recherches sur le Mont
Saint-Michel). « Les religieux, en prenant possession des terres qu'ils devaient à
la libéralité de Conan, y construisirent, pour les biens spirituels de
leurs tenanciers, une église au lieu de Ville-Amois, dont elle emprunta le
nom, devenu plus tard Villamée. Cette église, ils la possédèrent pendant
un demi-siècle dans toutes les conditions des autres églises, c'est-à-dire
dans une complète dépendance de l'Ordinaire, tant sous le rapport de la
juridiction que sous celui des redevances et autres devoirs. Mais en 1050
Main, pour lors évêque de Rennes, renonça en son nom et au nom de ses
successeurs à tous les droits qu'il pouvait prétendre sur elle, ainsi que
sur l'église de Poilley, et en fit l'abandon complet à l'abbaye du Mont
Saint-Michel » (M. Maupillé, Notices historiques sur le canton de
Louvigné-du-Désert). Ce don du patronage des deux églises de Villamée et
de Poilley fut confirmé en 1164 par Etienne, évêque de Rennes, et en 1184
par Philippe, son successeur. Etienne fit cette confirmation
très-solennellement, le 30 septembre, dans le monastère de Sainte-Croix de
Vitré ; il abandonna aux religieux du Mont Saint-Michel les deux églises
en question, avec toutes leurs dépendances, « ecclesiam Ville Amois cum
pertinenciis suis, et ecclesiam de Polleio cum pertinenciis suis », et
autorisa les moines à posséder toute espèce de bénéfices dans son
diocèse, « beneficia tam mundana quam ecclesiastica ». Raoul,
archidiacre de Rennes, approuva cet acte, fait en présence du chantre Elie,
d'Even, chapelain de l'évêque, de Jean, doyen de Vitré, de Philippe de
Poilley, etc. En 1179 le pape Alexandre III confirma, de son côté, le Mont
Saint-Michel en possession de ces églises, « ecclesiam de Poleio et
ecclesiam de Villamers, cum villa ipsa et aliis earum pertinenciis »
(Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont Saint-Michel, II, 272 et
317). Les donations qui précèdent donnèrent naissance au prieuré de
Villamée, dont l'église de Poilley devint une annexe. Les barons de
Fougères approuvèrent volontiers toutes ces libéralités faites dans leur
territoire à l'abbaye du Mont Saint-Michel ; mais ils se réservèrent un
droit de « mangier ô tous ses nécessaires pour eux et tous leurs gens,
une fois l'an, pour un jour et pour une nuit, au prieuré de Villamer ».
Lorsque les rois de France devinrent seigneurs de Fougères, les religieux
demandèrent à Philippe de Valois de renoncer à ce droit, et ce prince
voulut bien y consentir en 1324 (Bibliothèque Nationale ms. lat., n°
22357). Vers la fin du XIVème siècle, le prieur de Villamée refusa
d'admettre d'autres moines près de lui, ce qui irrita tellement le seigneur
de Fougères qu'il fit saisir en 1397 le revenu de ce prieuré « tant
pour la nourriture et entretien de deux religieux en iceluy prieuré, devant
demeurer avec le prieur, que pour les reparations qui estoient necessitées
d'y estre faictes. Par là on peut juger, dit dom Le Roy, quels estoient les
moines qui habitoient seuls ès prieurés », et combien fut sage
l'abbé Pierre Le Roy, qui à cette époque éteignit un grand nombre de ces
« prieurés champêtres » pour obliger ses religieux à vivre
régulièrement en communauté. En 1652, le domaine proche du prieuré de
Villamée se composait de : la maison priorale, avec cellier, étable, cour
devant et jardin derrière, le tout situé près l'église et le cimetière
; — la métairie du Prieuré, contenant environ 40 journaux de terre, avec
ses maisons, granges, jardins, vivier, etc. ; — l'étang et le moulin de
Villamée, auquel les vassaux étaient tenus porter leurs grains ; — un
petit bois de chênes, etc. Les moines possédaient, en outre, d'assez
nombreux fiefs : en Villamée, les fiefs de la Touche, de la Bouvrie, de la
Touraille, des Isabelles, de Lislèle, de la Charrière, de la Tréhonnais,
des Coudrais, de Ville-Perdue, et le Fief-aux-Moines ;
— en Poilley, le fief du Bourg ; — en Parigné,
le fief du Haut-Pays, de Dohin et des Bayettes (nota : une partie de ces
fiefs avaient été aliénées au XVIème siècle, mais les prieurs en
firent rentrer un bon nombre au siècle suivant). Le prieur de Villamée
avait droit de haute, moyenne et basse justice dans toute l'étendue de ces
fiefs ; — droit de cep et collier au bourg de Villamée ; — droit de
mettre les délinquants aux prisons de Fougères, à raison de quel droit il
devait à la cour de cette baronnie une rente de 7 livres appelée garde. Il
avait, de plus, droit de terrage dans toutes les terres dépendant du
prieuré, sauf dans le fief du bourg de Poilley, droit qui consistait dans
la levée de la douzième gerbe de tous les grains recueillis chaque année
; — droit de corvée pour faucher et faner ses foins, et en outre celui
d'exiger 2 deniers par chaque tête de porc et de tout bétail nourri dans
les fiefs de la Bouvrie, de la Touraille et de la Tréhonnais. Il avait
enfin droit d'enfeu, banc, armoiries, prééminences, et tous autres droits
de seigneur fondateur dans l'église de Villamée. L'une des charges du
prieur consistait en une rente de 40 livres qu'il devait à l'abbaye du Mont
Saint-Michel (Déclaration du prieuré en 1652 et 1680). Quand arriva la
Révolution, le prieuré de Villamée était depuis longtemps tombé en
commende ; ses revenus furent estimés en 1790 comme il suit : métairie,
800 livres ; — moulin, 600 livres ; — rentes seigneuriales, 30 livres ,
— et grosses dîmes, 2000 livres ; le tout donnait au prieur un revenut
brut de 3430 livres , dont il fallait déduire les charges (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Liste des prieurs : — Dom
Pierre Toustain offrit en 1559 à l'abbaye du Mont Saint-Michel un beau
reliquaire portant cette inscription : « Anno dni 1559 frater Petrus
Toustain prior prioratus de Villa Maris fecit hoc fieri ». — René de
la Haye Saint-Hilaire, prieur de Saint-Brice, rendit aveu au roi le 29 août
1553 ; il jouissait encore en commende de Villamée en 1565. — Dom
Guillaume du Chesnay rendit aveu au roi en 1606 ; il devint prieur claustral
du Mont Saint-Michel tout en conservant son prieuré de Villamée ;
décédé le 30 novembre 1617 et inhumé au Mont, dans la chapelle Saint-Aubert).
— Dom Louis de Vion, religieux de l'abbaye de Saint-Denis, rendit aveu au
roi le 5 septembre 1624. — Dom Albert Barbet résigna en 1641. — Dom
Gabriel-Nicolas Ruault, Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit
possession le 23 mai 1641 et rendit aveu au roi le 3 juin suivant, puis le 6
décembre 1652 ; il résigna en 1658. — Dom Claude-Fulgence de Chabannes,
Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit possession le 9 janvier
1659. — Dom Jean-Baptiste-Guillaume de Bellegarde, prieur de Saint-Gildas
de Rhuys (1669). — Dom Fulgence de Chabannes possédait en 1676 le prieuré,
pour lequel il rendit aveu le 30 janvier 1681. — Dom Joseph Rosset, prieur
dès 1701 ; décédé en 1722. — Dom François Torquat, Bénédictin de
Saint-Melaine, nommé en 1722, résigna en 1746. — Dom Thomas-Julien
Lamandé, également religieux de Saint-Melaine, pourvu par l'abbé du Mont
Saint-Michel, prit possession le 9 février 1747. Ce prieur eut à repousser
les prétentions de Jean-Claude Marion, prêtre de Genève, et de Louis
Verchère, qui se firent pourvoir à Rome l'un en 1748, l'autre en 1750. Dom
Lamandé habita successivement les monastères de Saint-Melaine, Solesmes,
Landévennec, Quimperlé et le Pirmil, et résigna en 1780 en faveur du
suivant. — Jean-François du Breuilh, acolyte de Paris, fut pourvu en décembre
1780 et fut le dernier prieur de Villamée ; il fit lui-même la déclaration
des biens de son bénéfice en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;
![]() la
croix de l'enclos paroissial (XVIIème siècle) ;
la
croix de l'enclos paroissial (XVIIème siècle) ;
![]() la
croix (1710), située au lieu-dit Noë-Gérard ;
la
croix (1710), située au lieu-dit Noë-Gérard ;
![]() la
croix de mission (1931) ;
la
croix de mission (1931) ;
![]() l'ancien
presbytère (XVIIIème siècle) ;
l'ancien
presbytère (XVIIIème siècle) ;
![]() le
manoir du Haut-Coudray (XVIIème siècle), situé route du Chatellier. Il
possédait autrefois un colombier. Le domaine du Haut-Coudray est la
propriété des seigneurs Coudrais jusqu'en 1416. Les seigneurs du
Bas-Coudray étaient la famille de Crochenne seigneurs de Vauhoudin en 1513.
Il appartient ensuite aux familles Harpin seigneurs de la Chesnaye (en 1532
et en 1579), de Malenoë seigneurs de la Chesnaye (en 1623), Gaucher
seigneurs du Verger (en 1652), Cochard sieurs des Châteaux (en 1705),
Larcher (en 1705), Fournier (en 1754), le Cordier (en 1774). Il est uni à
la châtellenie de la Chesnaye en 1572, puis distrait en 1652 ;
le
manoir du Haut-Coudray (XVIIème siècle), situé route du Chatellier. Il
possédait autrefois un colombier. Le domaine du Haut-Coudray est la
propriété des seigneurs Coudrais jusqu'en 1416. Les seigneurs du
Bas-Coudray étaient la famille de Crochenne seigneurs de Vauhoudin en 1513.
Il appartient ensuite aux familles Harpin seigneurs de la Chesnaye (en 1532
et en 1579), de Malenoë seigneurs de la Chesnaye (en 1623), Gaucher
seigneurs du Verger (en 1652), Cochard sieurs des Châteaux (en 1705),
Larcher (en 1705), Fournier (en 1754), le Cordier (en 1774). Il est uni à
la châtellenie de la Chesnaye en 1572, puis distrait en 1652 ;
![]() le
puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Porte ;
le
puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Porte ;
![]() le
puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Touche ;
le
puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Touche ;
![]() le
puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Petite-Bouvie ;
le
puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Petite-Bouvie ;
![]() la
maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Haute-Meslerais. Il s'agit
de l'ancien manoir de Mellerayes. Propriété de la famille
Berthault sieurs de Pontpierre en 1673, puis de la famille de la Marzelle
sieurs de Beaumesnil en 1748 ;
la
maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Haute-Meslerais. Il s'agit
de l'ancien manoir de Mellerayes. Propriété de la famille
Berthault sieurs de Pontpierre en 1673, puis de la famille de la Marzelle
sieurs de Beaumesnil en 1748 ;
![]() la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Lillèle. Cette maison est
aussi appelée "Villa Issel" et fait partie de la donation à
l'abbaye du Mont-Saint-Michel ;
la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Lillèle. Cette maison est
aussi appelée "Villa Issel" et fait partie de la donation à
l'abbaye du Mont-Saint-Michel ;
![]() la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Violette ;
la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Violette ;
![]() la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Sétayère ;
la
maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Sétayère ;
![]() la
maison (XVII-XVIIIème siècle), située au lieu-dit Monberrouault ;
la
maison (XVII-XVIIIème siècle), située au lieu-dit Monberrouault ;
![]() les moulins
à eau de Villamé et du Coudray ;
les moulins
à eau de Villamé et du Coudray ;

A signaler aussi :
![]() l'ancien
manoir du Bas-Coudray, situé route du Chatellier ;
l'ancien
manoir du Bas-Coudray, situé route du Chatellier ;
![]() l'ancien
manoir de Mesguérin. Propriété successive des familles Pichart (en 1412),
le Pelletier (en 1430), Frétay (en 1670). Il est ensuite partagé en 1680.
Le Petit-Mesguérin devient la propriété de la famille le Mercier sieurs
de la Pichardaye, puis passe ensuite entre les mains des Hospitalières de
Saint-Nicolas de Fougères en 1731. Le Grand-Mesguérin devient la
propriété de la famille de Brégel, puis des Hospitalières et des
familles Doudart sieurs des Hayes en 1748, et Saint-Germain seigneurs du Haume en 1789 ;
l'ancien
manoir de Mesguérin. Propriété successive des familles Pichart (en 1412),
le Pelletier (en 1430), Frétay (en 1670). Il est ensuite partagé en 1680.
Le Petit-Mesguérin devient la propriété de la famille le Mercier sieurs
de la Pichardaye, puis passe ensuite entre les mains des Hospitalières de
Saint-Nicolas de Fougères en 1731. Le Grand-Mesguérin devient la
propriété de la famille de Brégel, puis des Hospitalières et des
familles Doudart sieurs des Hayes en 1748, et Saint-Germain seigneurs du Haume en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Pichardaye. Propriété successive des familles Bateur ou
Batteur seigneurs du Haut-Chastellier (en 1415), de Romilley seigneurs de la
Chevalaye (en 1456), de Jeanne de Servaude épouse de Pierre de la Valette
seigneur du Bois-Mellet (au début du XVIIème siècle), Hardy seigneurs du
Plessis-Hardy, le Mercier (en 1622 et en 1695), puis des Hospitalières de
Saint-Nicolas de Fougères en 1731 et en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Pichardaye. Propriété successive des familles Bateur ou
Batteur seigneurs du Haut-Chastellier (en 1415), de Romilley seigneurs de la
Chevalaye (en 1456), de Jeanne de Servaude épouse de Pierre de la Valette
seigneur du Bois-Mellet (au début du XVIIème siècle), Hardy seigneurs du
Plessis-Hardy, le Mercier (en 1622 et en 1695), puis des Hospitalières de
Saint-Nicolas de Fougères en 1731 et en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Chevalaye. Propriété successive des familles de Romilley (en
1456), Pigeon (en 1653), de la Vieuxville (en 1680) ;
l'ancien
manoir de la Chevalaye. Propriété successive des familles de Romilley (en
1456), Pigeon (en 1653), de la Vieuxville (en 1680) ;
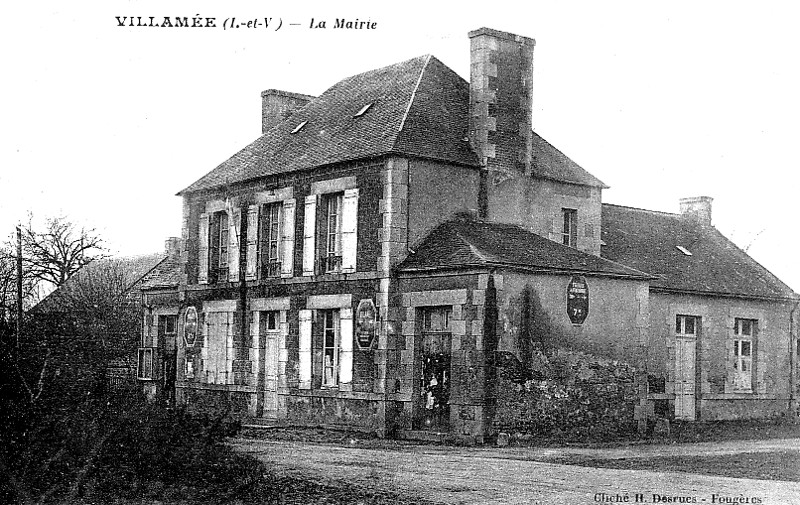
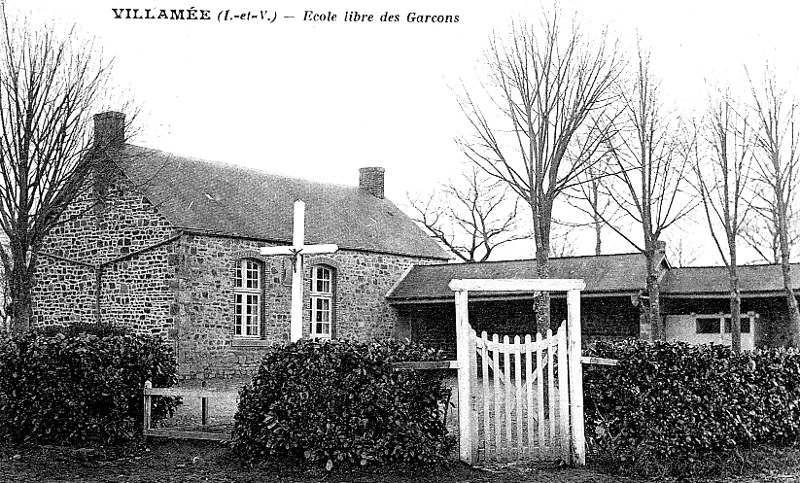
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de VILLAMEE
Les principales justices seigneuriales s'exerçant jadis en Villamée, sous l'appel du sénéchal de Fougères, étaient celles : du Prieuré ; de Saint-Brice par les Acres ; du Châtellier ; de Marigny ; de Bonteville ; du Bois-Guy, etc...
Voir
![]() "
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de Villamée
".
"
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de Villamée
".
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Villameix".
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.