|
Bienvenue ! |
Les ruines de Lexobie au Yaudet |
Retour page d'accueil Retour page Yaudet
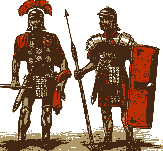 Depuis
César jusqu’au XVIIIe siècle, nos écoles historiques ne se sont guère
préoccupées de tracer les délimitations des territoires occupés sous la domination
Romaine par les divers peuples de l’Armorique. Il n’est donc pas surprenant
qu’après un si long temps et à une époque si rapprochée de nous, on ait éprouvé
tant de difficultés pour trouver tout d’abord les traces sûres de la vérité, sur
cette matière, et l’on comprend surtout que nombre de systèmes et d’opinions
contradictoires aient surgi de la discussion. Pour, nous, avons-nous besoin de le dire,
nous ne voulons pas avoir ici la prétention de remanier les diverses cartes
géographiques tracées par ces auteurs, pour fixer les positions respectives de toutes
les antiques peuplades Armoricaines, car, nous le savons, une semblable entreprise excède
nos forces et ne serait pas de notre part peu audacieuse. Sans nous occuper donc de cet
immense et difficile travail qui, s’il est jamais bien réalisé, réformerait
assurément plus d’une théorie aujourd’hui en crédit, nous allons hasarder
seulement quelques conjectures sur l’ancienne position de la Lexovie de César.
Certes , nous ne saurions le dissimuler, notre manière d’envisager cette question
nous met dans une sorte de péril, en nous mettant en contradiction avec la plupart des
auteurs qui l’ont discutée avant nous. Mais, nous devons le dire, l’étude des
lieux et celle de quelques passages de César, qui à coup sûr est l’auteur qui
mérite, dans cette discussion, la plus grande somme de créance, ne nous permettent pas
d’adopter, à cet égard, une autre opinion.
Depuis
César jusqu’au XVIIIe siècle, nos écoles historiques ne se sont guère
préoccupées de tracer les délimitations des territoires occupés sous la domination
Romaine par les divers peuples de l’Armorique. Il n’est donc pas surprenant
qu’après un si long temps et à une époque si rapprochée de nous, on ait éprouvé
tant de difficultés pour trouver tout d’abord les traces sûres de la vérité, sur
cette matière, et l’on comprend surtout que nombre de systèmes et d’opinions
contradictoires aient surgi de la discussion. Pour, nous, avons-nous besoin de le dire,
nous ne voulons pas avoir ici la prétention de remanier les diverses cartes
géographiques tracées par ces auteurs, pour fixer les positions respectives de toutes
les antiques peuplades Armoricaines, car, nous le savons, une semblable entreprise excède
nos forces et ne serait pas de notre part peu audacieuse. Sans nous occuper donc de cet
immense et difficile travail qui, s’il est jamais bien réalisé, réformerait
assurément plus d’une théorie aujourd’hui en crédit, nous allons hasarder
seulement quelques conjectures sur l’ancienne position de la Lexovie de César.
Certes , nous ne saurions le dissimuler, notre manière d’envisager cette question
nous met dans une sorte de péril, en nous mettant en contradiction avec la plupart des
auteurs qui l’ont discutée avant nous. Mais, nous devons le dire, l’étude des
lieux et celle de quelques passages de César, qui à coup sûr est l’auteur qui
mérite, dans cette discussion, la plus grande somme de créance, ne nous permettent pas
d’adopter, à cet égard, une autre opinion.
Nous rattachant donc uniquement aux textes de César, qui, lui, avait visité tous les lieux et qui par suite a pu les décrire avec une plus rigoureuse exactitude, nous allons revendiquer pour le Yaudet l’illustre cité de Lexovie et rectifier, s’il est possible, l’erreur historique, qui, depuis un siècle surtout, s’est plue constamment à nous montrer les ruines de cette antique ville dans les parages de Lisieux.
Certes, s’il est une vérité qui ressorte avec évidence du texte de César, dans l’histoire de l’insurrection Armoricaine, c’est que Lexovie ou la principale ville des Lexoviens était une ville maritime. En effet, la description que cet historien nous a laissée et qui est si curieuse de détails, ne saurait laisser subsister à ce sujet aucun doute. Cette ville, nous dit l’illustre historien Romain, était assise à l’extrémité d’une langue de terre, sur le haut d’un promontoire, comme une sorte de forteresse, dont les soubassements étaient deux fois par jour baignés par la mer. Enfin, à en croire cet auteur, les vaisseaux qui abordaient ces rivages et qui y jetaient l’ancre, couraient le risque à la marée basse, de s’abîmer dans le sable. A coup sûr celui qui aujourd’hui voudrait décrire le havre et le promontoire du Yaudet ne saurait mieux faire, pour être fidèle, que copier littéralement cette description qu'en a faite Jules César, il y a déjà environ 1800 ans. Il n’est pas jusqu’au sable mouvant de ce havre qui ne soit signalé par l’historien romain. Mais cette description que les siècles n’ont pu faire vieillir, quand on l’applique au Yaudet, qu’on le rapproche aussi donc maintenant du site de l’ancienne ville de Lisieux, pour voir si l’application aura le même caractère de justesse. Qu’on nous dise d’abord où étaient les sables mouvants, le port si dangereux de cette antique cité dans les ruines sont à 56 ou 64 kilomètres de la mer. Louis XIV fit jadis venir l’Eure et la Seine à Versailles, au grand étonnement du monde, mais nous doutons un peu que jamais nos adversaires nous démontrent que jadis la mer allait deux fois en douze heures baigner le pied des murs et des tours de l'ancienne ville de Lisieux.
Quoiqu’il en soit, pour justifier notre argumentation un peu peut-être étrange par sa nouveauté, arrivons aux citations. Après avoir raconté qu’il envoya Quintus Titarius Sabinus, pour barrer le passage aux Unelles, aux Curiosolites et aux Lexoviens, afin d’empêcher ces peuples de venir au secours des Venètes, ce grand capitaine décrit ainsi la position des villes principales de ces trois peuples : « Erant ejus modi ferè situs oppidorum, ut, posita in extremis lingulis promontoriis que, neque pedibus aditum haberent, quam ex alto se oestes incitavisset, quod bis accidit semper horarum XII spatio, neque navibus, quod rursus minuente oestu, naves in vadis afflictarentur. »
Et que nous importent, maintenant, les déductions que nos adversaires pourraient tirer contre nous de la table de Peutinger qu’on nous oppose, comme une autorité si grave, quand aujourd’hui il est bien prouvé que cette pièce est l’œuvre d’un soldat Romain étranger à la géographie et même à toutes les sciences et quand surtout les études les plus récentes démontrent tous les jours de plus en plus que cette table est pleine de fausses et chimériques indications, sur les positions respectives que l’auteur a voulu décrire.
Que nous importent encore les textes si vagues de Strabon qu’on met aussi parfois à la torture pour s’en prévaloir contre nous ? En vérité, nous l’avouerons sans détour, nous n’avons guère de confiance dans les descriptions que cet auteur nous a laissées de notre territoire et la raison est fort simple, c’est que ce savant Capadocien a constamment exploré l’Orient et jamais nos régions occidentales qu’il s’est permis de décrire. A coup sûr, si cet auteur avait jamais eu de nos contrées les notions géographiques les plus élémentaires, il n’aurait pas placé en Belgique les Venètes, l’un des plus illustres et des plus puissants peuples de l'Armorique.
Enfin, une dernière et briève considération, sur l’origine de l’évêché de Tréguier, va encore confirmer toutes nos présomptions.
En dépit de toutes les explications diverses que les auteurs ont données jusqu’ici aux mots : Evêque régionnaire, il est certain que dès les premiers siècles de l’église la juridiction des évêques était restreinte par des délimitations territoriales aussi bien qu’il est constant que les divisions et l’étendue des évêchés se formaient suivant le local que chaque peuple occupait ; or, s’il en est ainsi, quel était donc, sous la domination romaine, le peuple qui occupait le territoire compris plus tard dans les délimitations de l’évêché de Tréguier, si ce ne sont pas les Lexoviens et quel nom portait la capitale de ce peuple, si ce n’était pas celui de Lexovie ?
Mais pour nous résumer, tirons une dernière conclusion : deux villes modernes et rivales se disputent la gloire d’avoir eu pour berceau la capitale des Lexoviens : ce sont Lannion et Lisieux ; or, d’après César, l’unique historien de l’antiquité qui nous ait laissé des indications précises et certaines sur ce problème historique, Lisieux n’a rien de commun avec la Lexovie tributaire des Venètes. Au Yaudet donc, d’abord, puis à Lannion, de revendiquer avec quelque titre cet honneur. Nous le demandons maintenant, est-il donc vrai que notre conjecture ressemble un peu à la vérité et n’aurions-nous pas pu, sans témérité, être plus affirmatifs que nous ne l’avons été ?
© Copyright - Tous droits réservés.