|
Bienvenue ! |
Les monuments druidiques du Yaudet |
Retour page d'accueil Retour page Yaudet
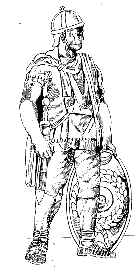 Comme nous
l’avons fait remarquer ailleurs, le Yaudet est une localité plus Romaine que
Gauloise. A part, en effet, le concours que les indigènes ont dû jadis prêter aux
Romains, pour la construction des murailles et forteresses de cette vieille cité, tout
nous y a paru accuser une origine évidemment et uniquement Romaine. Cette opinion, nous
le savons, nous met en contradiction avec quelques antiquaires qui, ayant avant nous
exploré les ruines de ce village ont cru y rencontrer des monuments druidiques et
d’autres débris de l’élément Gaulois.
Comme nous
l’avons fait remarquer ailleurs, le Yaudet est une localité plus Romaine que
Gauloise. A part, en effet, le concours que les indigènes ont dû jadis prêter aux
Romains, pour la construction des murailles et forteresses de cette vieille cité, tout
nous y a paru accuser une origine évidemment et uniquement Romaine. Cette opinion, nous
le savons, nous met en contradiction avec quelques antiquaires qui, ayant avant nous
exploré les ruines de ce village ont cru y rencontrer des monuments druidiques et
d’autres débris de l’élément Gaulois.
Il importe donc que nous justifions notre conviction par des faits incontestables.
L’erreur historique qui a cru voir au Yaudet des vestiges du culte druidique à sa source dans la facilité où l’on est de se méprendre sur les origines et l’ancienne destination de tous ces amas de rochers qui hérissent la lisière de nos côtes et surtout dans la célérité et le sans-façon que l’on a d’ordinaire mis à explorer les débris de notre ancienne cité. Jusqu’ici ce village n’avait guère été étudié que par fragments et jamais dans son ensemble. Et ce qui surtout devrait étonner davantage, c’est que entre tous les éléments qui se rattachent aux origines de cette localité, ceux qui par leur importance dominent tous les autres avaient aussi été le plus négligé. Ces éléments, avons-nous besoin de le dire, c’étaient l’élément Romain et l’élément religieux.
Mais aujourd’hui que les décombres de l’ancienne cité Romaine sont mis à découvert et se présentent tous à nous avec le plus harmonieux accord, pour accuser une origine identique, nous le demandons à tout homme de bonne foi, pourrions-nous encore accorder quelques créance à l’erreur que nous signalons ici en admettant que le polythéisme païen qui partout ailleurs persécutait à outrance tous les cultes dissidents, ait pu respecter jadis, au pied même du prétoire Romain du Yaudet, des monuments druidiques ? D’ailleurs les légendes de nos bréviaires, les actes de nos Saints et les historiens les plus graves de Bretagne se trouvant aussi d’accord pour placer au Yaudet, dès le VIe siècle, le premier siège épiscopal de l’ancien évêché de Tréguier, comment encore admettre que des dolmens ou des cromlechs aient toujours trouvé grâce auprès des premiers pontifes de ce siège au point de jouir, durant des siècles, de l’insigne faveur de subsister à l’ombre même de l’église épiscopale ? Non, disons-le sans détour, de semblables suppositions nous paraissent pour le moins bien étranges.
Mais pour conduire cette notice sur le Yaudet au point où nous avions hâte de la voir arriver, il nous reste maintenant à parler de la colonisation de la nouvelle cité de la vallée du Guer, après la ruine et la destruction de Lexobie. Le continuateur d’Ogée ne trouvant aucun monument écrit pour lui révéler cette colonisation, la devine et en donne une explication aussi naturelle que judicieuse.
Nous allons laisser parler cet auteur : «On peut présumer que la ville de Lannion doit son origine à la ruine de Lexobie par les Normands ou Danois, sous leur chef Hasting au IXe siècle. Les Lexobiens dont parlent César, Strabon et Pline remontèrent la rivière, à l’embouchure de laquelle était leur vieille cité (Coz-Yeodet) et s’établirent dans un lieu nommé Lan-Huon. Là ils durent se fortifier contre une nouvelle invasion des pirates » .
En effet, dès 1345, Northampton, général anglais, trouva Lannion si bien défendu qu’il n’osa en entreprendre le siège. Le château était établi sur une éminence occupée aujourd’hui par le jardin de M. de Laboëssière. Comme la plupart des forteresses du temps, il était bâti à l’extrémité d’une langue de terre, formée par la réunion de deux vallons. Une enceinte murale longeait l’Allée-Verte, le Pavé-Neuf traversait le marché ou Marhallach et le haut de la rue aux Fils descendait vers la rivière en enserrant dans la ville l’hôtel du Porsmeur, la fontaine Caradec et le couvent des Augustins, et enfin côtoyait la rivière pour venir de là flanquer l’un des angles du château. Au pied de ces murailles, des douves profondes ou des marécages (NDLR : les deux quais tiennent aujourd’hui l’emplacement de ces marécages) n’étaient pas sans utilité pour la défense de la place. Quelques portes s’ouvraient dans les murs pour accéder à la ville. La principale c’était celle de Porsmeur ou grande porte qui s’ouvrait sur la rue des Jongleurs ou des Capucins. Une autre s’ouvrait sur le port pour donner passage aux navires qui devaient pénétrer dans l’intérieur de la ville. Enfin une troisième, nommée la porte au Gruau, se trouvait au haut de la rue qui jadis portait ce nom, et qui aujourd’hui est connue sous celui de rue aux Chapeliers. Outre ces portes principales il existait encore une autre plus petite, mais secrète et dérobée : c’était celle qui se trouvait sur la rue aux Boyaux, au haut de la rue Poterne.
Quant à l’étang, il recouvrait tout le terrain des Buttes (de l’arc et de l’arbalète), depuis la rampe de Brélévenez jusqu’au quai. Il existe encore un vestige de la chaussée longeant jadis le terrain occupé aujourd’hui par les maisons qui bordent la rue conduisant de l’Allée-Verte au manoir de Penarstang. La plus ancienne trace manuscrite que nous connaissions du château est du 24 janvier 1489. C’est une délibération du grand conseil de la duchesse Anne, par laquelle celle-ci concède à Rolland de Clisson (NDLR : nous avons entre les mains une charte qui explique la filiation de la parenté qui existait jadis entre cette maison et celle des Cresolles), seigneur de Kerallio, l’emplacement du grand étang de Lannion avec la chaussée et le moulin y adjacents.
© Copyright - Tous droits réservés.