|
Bienvenue chez les Argentréens |
ARGENTRE-DU-PLESSIS |
Retour page d'accueil Retour Canton d'Argentré-du-Plessis
La
commune d'Argentré-du-Plessis ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE d'ARGENTRE-DU-PLESSIS
Argentré-du-Plessis vient, semble-t-il, du gaulois « Argantius », dérivé de « argant » et du suffixe « rate » (forteresse).
Les commencements d'Argentré sont complètement inconnus. On ne trouve les plus anciennes preuves de son existence que dans l'histoire des seigneurs qui ont pris pour surnom le nom de cette paroisse. Or, les premiers seigneurs d'Argentré connus d'une manière certaine sont Poisson d'Argentré, « Piscis de Argentreio », vivant vers 1100-1116, et Raoul d'Argentré, témoin en 1160 d'une donation faite à l'abbaye de Savigné (M. de la Borderie, Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 196).
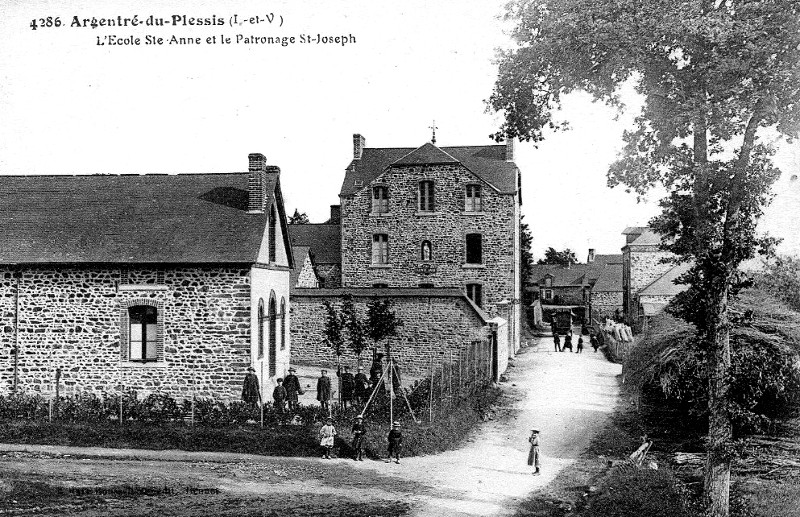
Le jeudi après Noël de l'an 1402 fut établi à Argentré une confrérie ou association de plusieurs seigneurs du pays. Il s'agit de Guillaume de Sévigné et Robert d'Espinay, chevaliers, Jehan de la Frète, seigneur dudit lieu, Guillaume Artur, seigneur de l'Arturaye, Louis de Sévigné, Jehan de Dommaigné et Jehan Brunel. Ils convinrent ensemble de former « une confrairie en l'honneur de la bénoiste Vierge Marie, en l'église d'Argentré, en laquelle église se rendront et seront tenus se rendre chacun des frères de ladite confrairie au jour de l'Assomption de Nostre-Dame, pour s'entrecompagner à disner ensemble au lieu qui sera désigné par les prévots qui ordonnés y seront, aux mises et despentz des frères, et pour savoir les affaires que les uns des frères auront à besoingner des autres ...... et seront dites en icelle église d'Argentré messes pour les frères d'icelle confrairie par l'ordonnance des prévots, aux mises et depentz des frères. Laquelle confrairie sera de telle ordonnance que chacun des frères promettront les uns aux autres, un chacun à autres, les autres à chacun, garder et soutenir l'estat, bien et honneur l'un de l'autre, et être alliés ensemble contre tous autres, sauf contre leur prince, etc. » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II, 726).
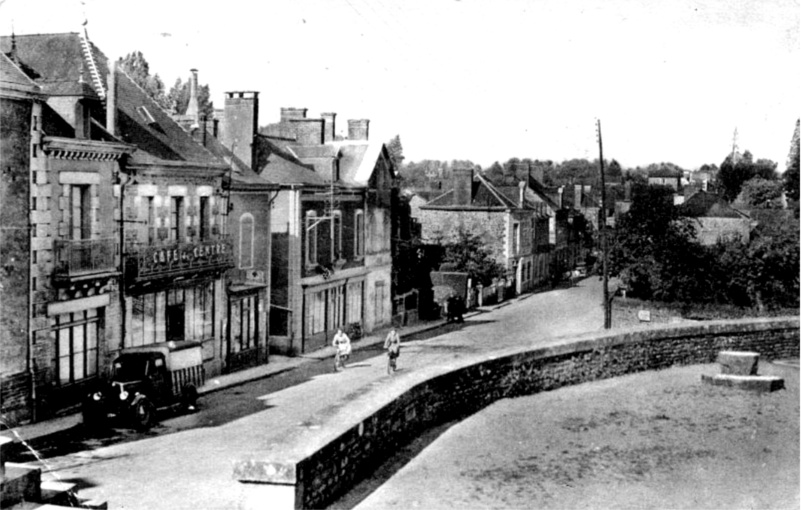
La présentation de la cure d'Argentré semble avoir toujours appartenu à l'alternative. En 1790, ce bénéfice valait environ 3 000 livres de rente ; la municipalité d'Argentré déclara, en effet, que le recteur jouissait d'un pourpris estimé 150 livres de revenu, consistant en presbytère, jardin, six champs et trois prés ; — de la moitié des dîmes anciennes, estimées 2 350 livres, — et des dîmes novales, estimées 500 livres. Total : 3 000 livres (Pouillé de Rennes).
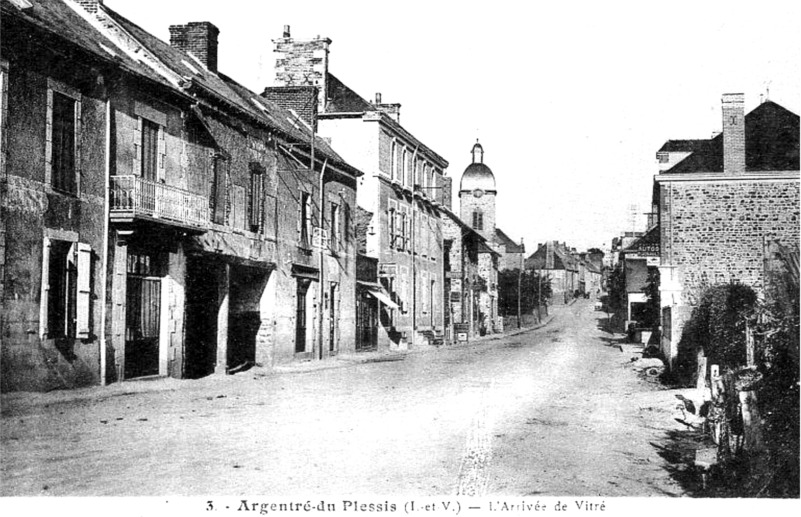
Le recteur, Julien Bouessée, prisant même un peu plus haut ses dîmes, déclara son revenu valoir 3 150 livres ; sur cette somme il devait donner la pension à deux vicaires, payer 203 livres 16 sols de décimes, 80 livres pour l'entretien du chanceau et du presbytère, etc., etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28).
On prétend que la Chapelle Saint-Pierre était son église primitive. La paroisse d’Argentré-du-Plessis dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes.
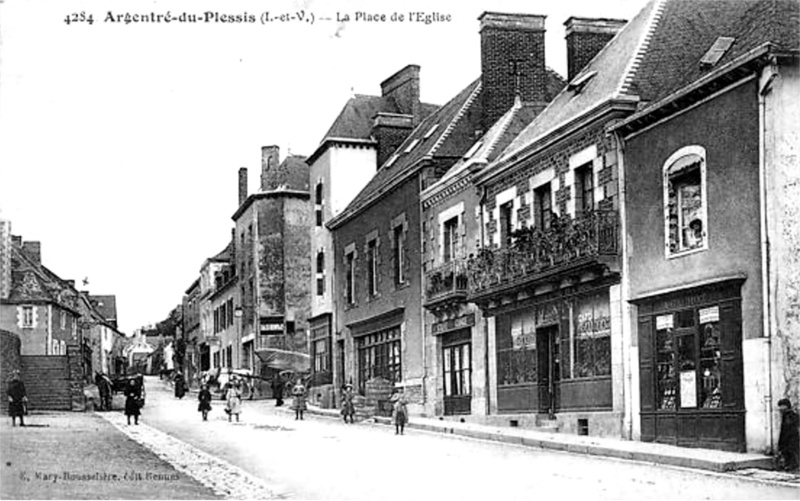
Des troupes royalistes battent des détachements républicains les 4 août et 27 septembre 1799. La seigneurie d’Argentré semble avoir été unie promptement à celle de Launay, puis à celle du Plessis.
On rencontre les appellation suivantes : Argentreium (au XIIème siècle), ecclesia de Argentreyo (en 1516).
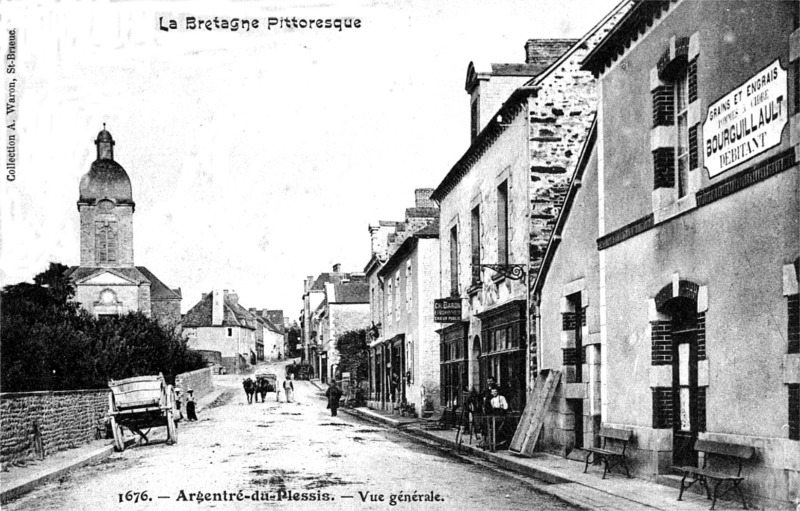
Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Argentré-du-Plessis : Pierre Thierry (décédé en 1530), Pierre d'Argentré (en 1580), Pierre Ogier (1589-1617), Georges Perronnerye (1611-1627), Vincent Bernier (en 1627), Etienne Monnerye (1628-1633), André Goupil (en 1633), J... Mergey (1652-1677), Roch Fournier de Trélo (1678-1684), François Duboys (1684-1690), René Kermasson (en 1690), Paul-Charles de la Saugère (en 1691), Honoré Tendon (1698-1716), Jean-Baptiste Pouynet (1716-1736), Joseph Nouail (1736-1774), Julien-Olivier Bouessée (1774-1792), Gilbert-Michel Gontier (1803-1820), François-Pierre Thébault (1820-1822), Jean-Marie Villais (1822-1867), Fortuné Hanry (1867-1868), Jean-Marie Crépin (à partir de 1868), ... .
Note 2 : Argentré-du-Plessis est la patrie de Charles, de Jean-Baptiste et de Louis Charles du Plessis d'Argentré, nés en 1673, 1720 et 1723, évêques de Tulle, de Séez et de Limoges.
Note 3 : liste non exhaustive des maires d'Argentré-du-Plessis : .... Alain du Plessis d'Argentré (1919-1954), Geneviève du Plessis d'Argentré, épouse d'Alain du Plessis d'Argentré (1954-1971), Victor Pasquet (1971-1983), Jean Bourdais (1983-1995), Emile Blandeau (1995-2013), Pierre Fadier (2013-2014), Daniel Bausson (2014-2015), Jean-Noël Bévière (2015-....), etc ....
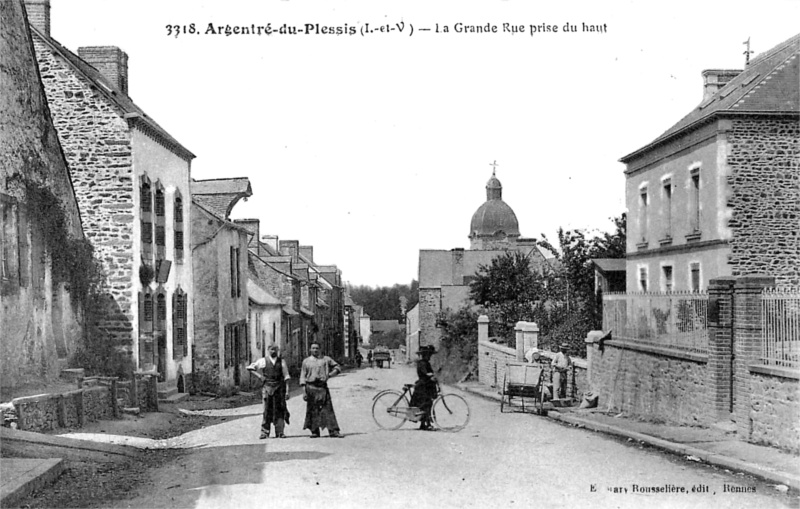
Voir
![]() "
Le
cahier de doléances d'Argentré (aujourd'hui Argentré-du-Plessis) en 1789
".
"
Le
cahier de doléances d'Argentré (aujourd'hui Argentré-du-Plessis) en 1789
".
![]()
PATRIMOINE d'ARGENTRE-DU-PLESSIS
![]() l'église
Notre-Dame (1775-1779), édifiée par l'architecte Brousseau. Dédiée à
Notre-Dame, l'église d'Argentré-du-Plessis fut incendiée par le feu du
ciel le 2l octobre 1772, pendant la célébration de la grand'messe. L'année
suivante, l'on fit de cet édifice ruiné un procès-verbal assez intéressant
dont nous extrayons ce qui suit (Archives du château du Plessix) : L'église
d'Argentré se composait d'une seule nef accostée au Nord d'une chapelle dédiée
à sainte Anne et terminée par un chanceau communiquant avec une autre
chapelle placée au Midi et consacrée au Saint-Rosaire. Le choeur avait un
chevet droit, et dans la principale verrière, placée au-dessus du maître-autel,
l'on voyait plusieurs écussons : d'abord, en supériorité, le blason des
barons de Vitré : de gueules au lion d'argent, armé, couronné et
lampassé d'or ; puis, au-dessous, les armoiries des seigneurs de
Marcille : d'argent à la bande de gueules chargée de trois channes d'or.
Cette famille posséda longtemps la seigneurie d'Argentré par suite du
mariage de Guillaume de Marcille, vers 1390, avec Orphaise d'Argentré, dame
dudit lieu. Dans une autre verrière du chanceau, vers le Nord, se
trouvaient les écussons de la famille de Montbourcher : d'or à trois
channes de gueules ; elle possédait, en effet, la seigneurie du Pinel,
en Argentré. La table du maître-autel était supportée par un « pilastre
» central, orné d'un écusson fruste ; au-dessus de cet autel apparaissait
la statue de la Sainte Vierge, armoriée du blason des seigneurs de Marcille.
Dans la chapelle du Rosaire, deux fenêtres étaient ornées de l'écusson
suivant, assez compliqué : écartelé : au 1er d'argent à la bande de
gueules chargée de trois channes d'or, qui est de Marcille ; au 2ème
d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent et cantonnée
de seize alérions d'azur, qui est de Montmorency-Laval ; au 3ème de
gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or, qui est de
Vitré ; au 4ème d'azur à trois chevrons, qui est ; sur le tout : d'argent
à la croix pattée d'azur, qui est d'Argentré. Au pied de l'autel du
Rosaire se trouvaient deux pierres tombales prétendues par le propriétaire
de la terre de la Porte (Guillaume de la Marraye possédait la Porte en
1513). Dans la chapelle Sainte-Anne se trouvaient un écusson : d'azur à
trois chevrons d'or renversés, et le blason des Marcille, écartelé
de Romilley, semble-t-il ; ces dernières armoiries, entourées du
cordon de l'Epi, étaient celles de Jean de Marcille, seigneur d'Argentré,
chevalier de l'Ordre de l'Epi, en 1441, époux de Marie de Romilley. Dans «
deux petits vitraux placés entre les arcades soutenant le clocher »,
en haut de la nef, on voyait des écussons portant : de gueules à dix
billettes d'or, posées 4, 3, 2 et 1. Ces armoiries appartenaient à la
famille du Plessix, qui avait succédé aux sires d'Argentré et de Marcille
dans la possession de la seigneurie d'Argentré. Aussi retrouvait-on les
mêmes armes, jointes à celles des familles alliées, peintes sur « une
ceinture noire » entourant intérieurement l'église, et sculptées sur
plusieurs bancs seigneuriaux appartenant à Alexis du Plessix, «
seigneur d'Argentré et fondateur de cette église ». Mentionnons enfin
« au côté vers l'évangile et immédiatement au pied de la table de
communion », deux tombes armoriées, présentant chacune d'elles «
une croix dans toute la longueur, et au-dessous des bras de la croix quatre
écussons paraissant porter une croix pleine ». Ces tombeaux étaient
probablement les anciennes sépultures des premiers sires d'Argentré, dont
le blason était d'argent à la croix pattée d'azur. Après avoir
dressé ce procès-verbal de l'état ancien de l'église incendiée, on
s'occupa de reconstruire cet édifice. La première pierre du nouveau temple
fut posée, le 20 juin 1775, par le même Alexis du Plessix d'Argentré,
seigneur du Plessix, Launay et autres lieux, seigneur fondateur de la
paroisse ; elle fut bénite par Nicolas de Gennes, ancien vicaire alternatif
de Notre-Dame et de Saint-Martin de Vitré. D'après la tradition, la
famille du Plessix contribua généreusement à l'édification de cette
église, dont deux frères, Louis et Jean-Baptiste du Plessix d'Argentré,
évêques de Limoges et de Séez, voulurent être les bienfaiteurs.
L'édifice étant achevé, fut solennellement bénit le 12 février 1779 par
le recteur d'Etrelles. La nouvelle église d'Argentré, existant encore, est
en forme de croix, vaste et d'aspect assez grandiose, mais dans le style si
froid de tous les monuments religieux du dernier siècle. On y voit
extérieurement plusieurs écussons destinés sans doute à porter les armes
du Plessix : de gueules à dix billettes d'or, 4, 3, 2, 1, mais qui
ne semblent pas avoir jamais été gravés (Pouillé de Rennes). Le retable du maître-autel
date de 1776 : les statues (saint Pierre, saint Joseph) sont l'oeuvre de
Charles Bridan et le tableau représentant "L'Assomption de la
Vierge", oeuvre de Nicolas-Guy Brenet, date de 1776. Le retable du bras
sud du transept est dédié à Saint-Jean-Baptiste et date de 1776. Le
retable du bras nord du transept est dédié à Saint-Louis. Le tableau du Triomphe de la Trinité (XVIIème
siècle) est l'oeuvre de Jacob Jordaens (il s'agit d'un don de la famille Du
Plessis-d'Argentré). L’ancienne église possédait les armes
des de Marcille, seigneurs d'Argentré du XVème au XVIIème siècle, dans
la chapelle nord. La maîtresse-vitre portait les armes des barons de Vitré
et des Marcille. La chapelle du sud portait les armes des Montbourcher, seigneurs du Pinel du XIVème au XVIème siècle. Les armes
des seigneurs du Plessis se voyaient au haut de la nef. La chapelle sud
renfermait aussi deux pierres tombales des seigneurs la Porte ;
l'église
Notre-Dame (1775-1779), édifiée par l'architecte Brousseau. Dédiée à
Notre-Dame, l'église d'Argentré-du-Plessis fut incendiée par le feu du
ciel le 2l octobre 1772, pendant la célébration de la grand'messe. L'année
suivante, l'on fit de cet édifice ruiné un procès-verbal assez intéressant
dont nous extrayons ce qui suit (Archives du château du Plessix) : L'église
d'Argentré se composait d'une seule nef accostée au Nord d'une chapelle dédiée
à sainte Anne et terminée par un chanceau communiquant avec une autre
chapelle placée au Midi et consacrée au Saint-Rosaire. Le choeur avait un
chevet droit, et dans la principale verrière, placée au-dessus du maître-autel,
l'on voyait plusieurs écussons : d'abord, en supériorité, le blason des
barons de Vitré : de gueules au lion d'argent, armé, couronné et
lampassé d'or ; puis, au-dessous, les armoiries des seigneurs de
Marcille : d'argent à la bande de gueules chargée de trois channes d'or.
Cette famille posséda longtemps la seigneurie d'Argentré par suite du
mariage de Guillaume de Marcille, vers 1390, avec Orphaise d'Argentré, dame
dudit lieu. Dans une autre verrière du chanceau, vers le Nord, se
trouvaient les écussons de la famille de Montbourcher : d'or à trois
channes de gueules ; elle possédait, en effet, la seigneurie du Pinel,
en Argentré. La table du maître-autel était supportée par un « pilastre
» central, orné d'un écusson fruste ; au-dessus de cet autel apparaissait
la statue de la Sainte Vierge, armoriée du blason des seigneurs de Marcille.
Dans la chapelle du Rosaire, deux fenêtres étaient ornées de l'écusson
suivant, assez compliqué : écartelé : au 1er d'argent à la bande de
gueules chargée de trois channes d'or, qui est de Marcille ; au 2ème
d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent et cantonnée
de seize alérions d'azur, qui est de Montmorency-Laval ; au 3ème de
gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or, qui est de
Vitré ; au 4ème d'azur à trois chevrons, qui est ; sur le tout : d'argent
à la croix pattée d'azur, qui est d'Argentré. Au pied de l'autel du
Rosaire se trouvaient deux pierres tombales prétendues par le propriétaire
de la terre de la Porte (Guillaume de la Marraye possédait la Porte en
1513). Dans la chapelle Sainte-Anne se trouvaient un écusson : d'azur à
trois chevrons d'or renversés, et le blason des Marcille, écartelé
de Romilley, semble-t-il ; ces dernières armoiries, entourées du
cordon de l'Epi, étaient celles de Jean de Marcille, seigneur d'Argentré,
chevalier de l'Ordre de l'Epi, en 1441, époux de Marie de Romilley. Dans «
deux petits vitraux placés entre les arcades soutenant le clocher »,
en haut de la nef, on voyait des écussons portant : de gueules à dix
billettes d'or, posées 4, 3, 2 et 1. Ces armoiries appartenaient à la
famille du Plessix, qui avait succédé aux sires d'Argentré et de Marcille
dans la possession de la seigneurie d'Argentré. Aussi retrouvait-on les
mêmes armes, jointes à celles des familles alliées, peintes sur « une
ceinture noire » entourant intérieurement l'église, et sculptées sur
plusieurs bancs seigneuriaux appartenant à Alexis du Plessix, «
seigneur d'Argentré et fondateur de cette église ». Mentionnons enfin
« au côté vers l'évangile et immédiatement au pied de la table de
communion », deux tombes armoriées, présentant chacune d'elles «
une croix dans toute la longueur, et au-dessous des bras de la croix quatre
écussons paraissant porter une croix pleine ». Ces tombeaux étaient
probablement les anciennes sépultures des premiers sires d'Argentré, dont
le blason était d'argent à la croix pattée d'azur. Après avoir
dressé ce procès-verbal de l'état ancien de l'église incendiée, on
s'occupa de reconstruire cet édifice. La première pierre du nouveau temple
fut posée, le 20 juin 1775, par le même Alexis du Plessix d'Argentré,
seigneur du Plessix, Launay et autres lieux, seigneur fondateur de la
paroisse ; elle fut bénite par Nicolas de Gennes, ancien vicaire alternatif
de Notre-Dame et de Saint-Martin de Vitré. D'après la tradition, la
famille du Plessix contribua généreusement à l'édification de cette
église, dont deux frères, Louis et Jean-Baptiste du Plessix d'Argentré,
évêques de Limoges et de Séez, voulurent être les bienfaiteurs.
L'édifice étant achevé, fut solennellement bénit le 12 février 1779 par
le recteur d'Etrelles. La nouvelle église d'Argentré, existant encore, est
en forme de croix, vaste et d'aspect assez grandiose, mais dans le style si
froid de tous les monuments religieux du dernier siècle. On y voit
extérieurement plusieurs écussons destinés sans doute à porter les armes
du Plessix : de gueules à dix billettes d'or, 4, 3, 2, 1, mais qui
ne semblent pas avoir jamais été gravés (Pouillé de Rennes). Le retable du maître-autel
date de 1776 : les statues (saint Pierre, saint Joseph) sont l'oeuvre de
Charles Bridan et le tableau représentant "L'Assomption de la
Vierge", oeuvre de Nicolas-Guy Brenet, date de 1776. Le retable du bras
sud du transept est dédié à Saint-Jean-Baptiste et date de 1776. Le
retable du bras nord du transept est dédié à Saint-Louis. Le tableau du Triomphe de la Trinité (XVIIème
siècle) est l'oeuvre de Jacob Jordaens (il s'agit d'un don de la famille Du
Plessis-d'Argentré). L’ancienne église possédait les armes
des de Marcille, seigneurs d'Argentré du XVème au XVIIème siècle, dans
la chapelle nord. La maîtresse-vitre portait les armes des barons de Vitré
et des Marcille. La chapelle du sud portait les armes des Montbourcher, seigneurs du Pinel du XIVème au XVIème siècle. Les armes
des seigneurs du Plessis se voyaient au haut de la nef. La chapelle sud
renfermait aussi deux pierres tombales des seigneurs la Porte ;
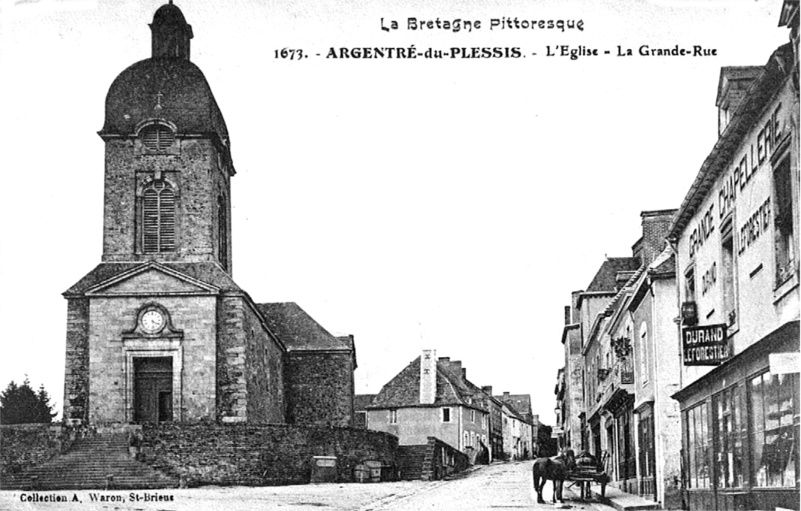
![]() la
chapelle Saint-Pierre (XI-XVème siècle), située rue Ambroise-Paré. Cette
chapelle passe pour avoir été, à l'origine, l'église paroissiale
d'Argentré. Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Elle
est, du reste, fort ancienne, et se compose d'une nef terminée par une
arcade triomphale et une abside romanes du XIème ou du XIIème siècle ;
mais la majeure partie de la nef date d'une époque beaucoup plus récente.
On a trouvé à diverses époques, près de cette chapelle, plusieurs
cercueils en calcaire coquillier. Non loin de là passe une vieille route,
appelée chemin, des Saulniers, que l'on a quelque raison de regarder comme
une voie gallo-romaine. Cette chapelle se trouvait jadis dans le fief
Saint-Pierre, dépendant de la seigneurie du Plessix, et il s'y tenait une
foire importante le jour Saint-Pierre. Dans cet édifice religieux, sécularisé
depuis la Révolution, était desservie en 1790 une fondation, dite de
Saint-Pierre, valant 30 livres de rente, et consistant en une messe le
vendredi, fondée le 19 septembre 1649 par René Farouge et Françoise
Bouetel, sa femme (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77 -
Pouillé de Rennes). Le chœur date du XI-XIIème siècle. Les fenêtres gothiques datent du XVème
siècle. Des cercueils en calcaire coquillier ont été trouvés près d’elle ;
la
chapelle Saint-Pierre (XI-XVème siècle), située rue Ambroise-Paré. Cette
chapelle passe pour avoir été, à l'origine, l'église paroissiale
d'Argentré. Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Elle
est, du reste, fort ancienne, et se compose d'une nef terminée par une
arcade triomphale et une abside romanes du XIème ou du XIIème siècle ;
mais la majeure partie de la nef date d'une époque beaucoup plus récente.
On a trouvé à diverses époques, près de cette chapelle, plusieurs
cercueils en calcaire coquillier. Non loin de là passe une vieille route,
appelée chemin, des Saulniers, que l'on a quelque raison de regarder comme
une voie gallo-romaine. Cette chapelle se trouvait jadis dans le fief
Saint-Pierre, dépendant de la seigneurie du Plessix, et il s'y tenait une
foire importante le jour Saint-Pierre. Dans cet édifice religieux, sécularisé
depuis la Révolution, était desservie en 1790 une fondation, dite de
Saint-Pierre, valant 30 livres de rente, et consistant en une messe le
vendredi, fondée le 19 septembre 1649 par René Farouge et Françoise
Bouetel, sa femme (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77 -
Pouillé de Rennes). Le chœur date du XI-XIIème siècle. Les fenêtres gothiques datent du XVème
siècle. Des cercueils en calcaire coquillier ont été trouvés près d’elle ;
![]() la
chapelle Saint-Louis (XIXème siècle), édifiée par la famille Bouin dans
le but de remplacer une chapelle primitive ;
la
chapelle Saint-Louis (XIXème siècle), édifiée par la famille Bouin dans
le but de remplacer une chapelle primitive ;
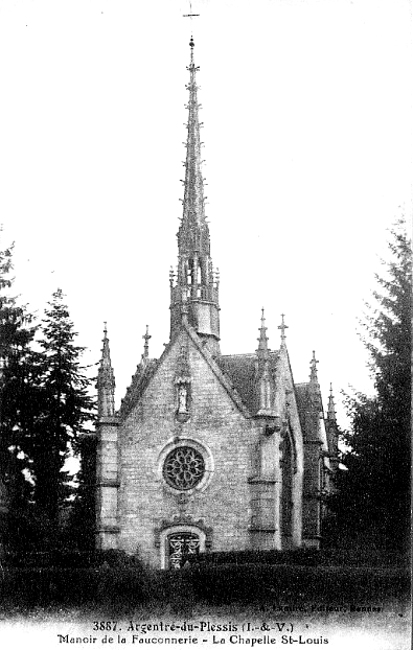
![]() l'ancien
prieuré du Breil-Benoît. Les religieux cisterciens de Clermont
possédaient dans la paroisse d'Argentré, évêché de Rennes, une grange
appelée le Breil-Benoît. Nous savons que cette terre se composait, dans
les siècles derniers de : la chapelle du Breil-Benoît, la métairie de
même nom, un moulin à eau appelé le Moulin-aux-Moines, enfin, un bois
nommé le bois de la Branchette. Ces biens furent vendus nationalement à
l'époque de la Révolution, mais dès cette époque la chapelle n'existait plus (Pouillé de Rennes) ;
l'ancien
prieuré du Breil-Benoît. Les religieux cisterciens de Clermont
possédaient dans la paroisse d'Argentré, évêché de Rennes, une grange
appelée le Breil-Benoît. Nous savons que cette terre se composait, dans
les siècles derniers de : la chapelle du Breil-Benoît, la métairie de
même nom, un moulin à eau appelé le Moulin-aux-Moines, enfin, un bois
nommé le bois de la Branchette. Ces biens furent vendus nationalement à
l'époque de la Révolution, mais dès cette époque la chapelle n'existait plus (Pouillé de Rennes) ;
![]() le
château de la Fauconnerie (XVII-XIXème siècle). Le puits date du XVIIème
siècle. Il conserve une chapelle construite en 1628. Cette chapelle
dédiée à Saint-Louis et Saint-Julien de la Fauconnerie et située dans le
pâtis de la Fauconnerie, fut fondée de trois messes par semaine, le 4
octobre 1627, par Julien Toullier, religieux augustin, et par autre Julien
Toullier, sieur de la Fauconnerie, habitant ce manoir avec sa femme, Jeanne
Primault. En 1678, Jean Grimaudet, seigneur de Gazon, demeurant aussi à la
Fauconnerie, y fonda également une messe chaque dimanche (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Les premiers chapelains de la
Fauconnerie semblent avoir été Gorges Tricot (décédé en 1631), et
Nicolas Belon (décédé en 1636), inhumés l'un et l'autre dans cette
chapelle. Leur dernier successeur, M. Legge, prêtre, déclara en 1790 jouir
de la chapelle, d'une maison, de deux jardins et de cinq champs, le tout
estimé environ 100 livres de rente (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). Saint-Louis de la Fauconnerie fut, à
l'origine, présentée par la famille des fondateurs ; mais en 1771 ce fut
le général de la paroisse qui la présenta à Joseph Morlier. Conservée
en 1803, à la demande des habitants, la chapelle de la Fauconnerie avoisine
maintenant le manoir du même nom, et l'on y dessert une nouvelle fondation
de messes faite par M. Foucault des Bigotières (Pouillé de Rennes). Propriété successive
des familles Ferrand (en 1513), Godart (en 1542), Ravenel (en 1556 et 1583),
Toullier (en 1627), Grimaudet, seigneurs de la Lande (avant 1653), Farcy (en
1653), Grimaudet (avant 1726), Foucault, seigneurs de la Bigotière (en 1726) ;
le
château de la Fauconnerie (XVII-XIXème siècle). Le puits date du XVIIème
siècle. Il conserve une chapelle construite en 1628. Cette chapelle
dédiée à Saint-Louis et Saint-Julien de la Fauconnerie et située dans le
pâtis de la Fauconnerie, fut fondée de trois messes par semaine, le 4
octobre 1627, par Julien Toullier, religieux augustin, et par autre Julien
Toullier, sieur de la Fauconnerie, habitant ce manoir avec sa femme, Jeanne
Primault. En 1678, Jean Grimaudet, seigneur de Gazon, demeurant aussi à la
Fauconnerie, y fonda également une messe chaque dimanche (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Les premiers chapelains de la
Fauconnerie semblent avoir été Gorges Tricot (décédé en 1631), et
Nicolas Belon (décédé en 1636), inhumés l'un et l'autre dans cette
chapelle. Leur dernier successeur, M. Legge, prêtre, déclara en 1790 jouir
de la chapelle, d'une maison, de deux jardins et de cinq champs, le tout
estimé environ 100 livres de rente (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). Saint-Louis de la Fauconnerie fut, à
l'origine, présentée par la famille des fondateurs ; mais en 1771 ce fut
le général de la paroisse qui la présenta à Joseph Morlier. Conservée
en 1803, à la demande des habitants, la chapelle de la Fauconnerie avoisine
maintenant le manoir du même nom, et l'on y dessert une nouvelle fondation
de messes faite par M. Foucault des Bigotières (Pouillé de Rennes). Propriété successive
des familles Ferrand (en 1513), Godart (en 1542), Ravenel (en 1556 et 1583),
Toullier (en 1627), Grimaudet, seigneurs de la Lande (avant 1653), Farcy (en
1653), Grimaudet (avant 1726), Foucault, seigneurs de la Bigotière (en 1726) ;
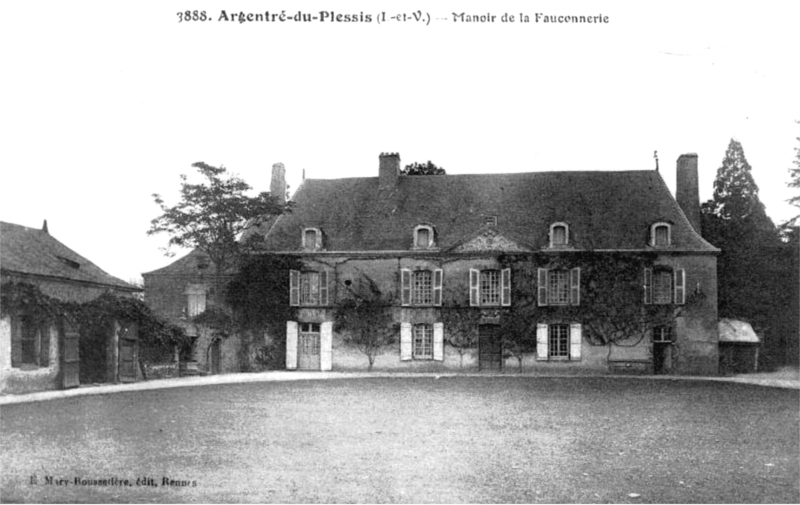
![]() le
château du Plessis (XIXème siècle). On y trouve une chapelle privative
qui date de 1879. L'ancienne chapelle du Plessix (ou Plessis) d'Argentré était
dédiée à la Sainte Famille et se trouvait isolée du château, mais elle
n'existe plus. Alexis du Plessix, seigneur du Plessix d'Argentré, y avait
fondé une messe tous les dimanches par acte du 8 avril 1674 (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Dans le château même,
construction assez remarquable du XVIème siècle, en forme d'équerre, avec
une belle tour crénelée à l'angle extérieur, est une chapelle dédiée
à saint Louis. Enfin, M. le marquis d'Argentré a fait construire une
chapelle monumentale dédiée au Sacré-Coeur de Jésus. Ce bel édifice,
de style ogival, occupe l'un des pavillons du château : richement sculptée,
éclairée par une très jolie rose et par de splendides verrières, ornée
d'un tableau de grand maître, accostée d'une délicieuse tourelle d'angle
servant de sacristie et précédée d'une vaste et belle galerie, cette
chapelle reproduit, sur la pierre et dans les vitraux, les armoiries du
Plessix et de Robien, qui sont celles des pieux propriétaires qui l'ont
fait élever (Du Plessix d'Argentré : de gueules à dix billettes d'or,
4, 3, 2, 1 ; et de Robien : d'azur à dix billettes d'argent, 4, 3,
2, 1). Elle a été bénite en 1879 par Mgr Place, archevêque de Rennes
(Pouillé de Rennes). Le Plessis (ou Plessix) est érigé en marquisat en 1819. L’ancien
château date du XVI-XVIIème siècle. Le Plessis possédait un droit de haute
justice. Propriété successive des familles du Plessis (en 1198 et
1789) et de Bertrand d’Argentré. Il est pillé pendant la Révolution ;
le
château du Plessis (XIXème siècle). On y trouve une chapelle privative
qui date de 1879. L'ancienne chapelle du Plessix (ou Plessis) d'Argentré était
dédiée à la Sainte Famille et se trouvait isolée du château, mais elle
n'existe plus. Alexis du Plessix, seigneur du Plessix d'Argentré, y avait
fondé une messe tous les dimanches par acte du 8 avril 1674 (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Dans le château même,
construction assez remarquable du XVIème siècle, en forme d'équerre, avec
une belle tour crénelée à l'angle extérieur, est une chapelle dédiée
à saint Louis. Enfin, M. le marquis d'Argentré a fait construire une
chapelle monumentale dédiée au Sacré-Coeur de Jésus. Ce bel édifice,
de style ogival, occupe l'un des pavillons du château : richement sculptée,
éclairée par une très jolie rose et par de splendides verrières, ornée
d'un tableau de grand maître, accostée d'une délicieuse tourelle d'angle
servant de sacristie et précédée d'une vaste et belle galerie, cette
chapelle reproduit, sur la pierre et dans les vitraux, les armoiries du
Plessix et de Robien, qui sont celles des pieux propriétaires qui l'ont
fait élever (Du Plessix d'Argentré : de gueules à dix billettes d'or,
4, 3, 2, 1 ; et de Robien : d'azur à dix billettes d'argent, 4, 3,
2, 1). Elle a été bénite en 1879 par Mgr Place, archevêque de Rennes
(Pouillé de Rennes). Le Plessis (ou Plessix) est érigé en marquisat en 1819. L’ancien
château date du XVI-XVIIème siècle. Le Plessis possédait un droit de haute
justice. Propriété successive des familles du Plessis (en 1198 et
1789) et de Bertrand d’Argentré. Il est pillé pendant la Révolution ;

![]() la
maison de la Basse-Fauconnière (XVIème siècle) ;
la
maison de la Basse-Fauconnière (XVIème siècle) ;
![]() le
manoir de Pinel (XV-XVIème siècle). Il possédait une chapelle dédiée à
sainte Eudoxie. Cette chapelle, aujourd'hui disparue, avoisinait le manoir
du Pinel ; c'était un édifice de style flamboyant, offrant encore à la
fin du XIXème siècle à son chevet une très belle fenêtre à meneaux et
une porte de même style. En 1580, M. de Montbourcher, seigneur du Pinel, y
fonda des messes et y affecta une rente de 36 livres d'argent et de 18
boisseaux de blé (Archives du château du Plessis). En 1790, cette
chapelle, desservie par M. Droyaux, vicaire à Argentré, lui rapportait 62
livres de rente. Le domaine avait une
motte et un droit de haute justice. Propriété successive des familles
Pinel (en 1197), Montbourcher (vers 1296), Champelais, seigneurs de
Courcelles (vers 1602), Laubereau et Morel (en 1678 et 1789) ;
le
manoir de Pinel (XV-XVIème siècle). Il possédait une chapelle dédiée à
sainte Eudoxie. Cette chapelle, aujourd'hui disparue, avoisinait le manoir
du Pinel ; c'était un édifice de style flamboyant, offrant encore à la
fin du XIXème siècle à son chevet une très belle fenêtre à meneaux et
une porte de même style. En 1580, M. de Montbourcher, seigneur du Pinel, y
fonda des messes et y affecta une rente de 36 livres d'argent et de 18
boisseaux de blé (Archives du château du Plessis). En 1790, cette
chapelle, desservie par M. Droyaux, vicaire à Argentré, lui rapportait 62
livres de rente. Le domaine avait une
motte et un droit de haute justice. Propriété successive des familles
Pinel (en 1197), Montbourcher (vers 1296), Champelais, seigneurs de
Courcelles (vers 1602), Laubereau et Morel (en 1678 et 1789) ;
![]() le
presbytère (XIXème siècle) ;
le
presbytère (XIXème siècle) ;
![]() 5 moulins
à eau : du Hil, aux Moines, Neuf, à Guérin, de Salè ;
5 moulins
à eau : du Hil, aux Moines, Neuf, à Guérin, de Salè ;
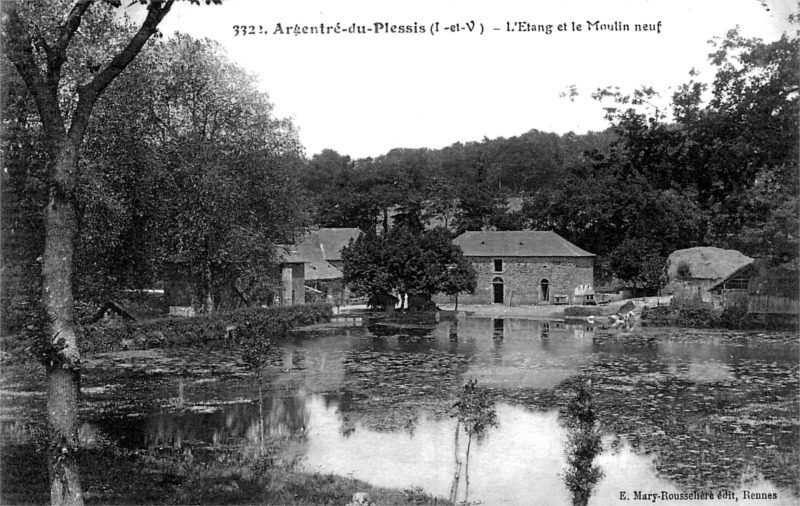
A signaler aussi :
![]() la
motte située dans le bois de Pinel (Moyen Age) ;
la
motte située dans le bois de Pinel (Moyen Age) ;
![]() l'ancienne
ferme du Plessis remplace l'ancienne maladrerie de Saint-Etienne qui possédait deux chapelles ;
l'ancienne
ferme du Plessis remplace l'ancienne maladrerie de Saint-Etienne qui possédait deux chapelles ;
![]() l'ancien
manoir de Launay. Sa chapelle a disparu. Propriété successive des familles
d'Argentré (en 1095), Marcille, seigneurs de la Motte-Marcille, Valory,
seigneurs de la Motte (vers 1678), des seigneurs du Plessis d'Argentré (en 1717 et 1789) ;
l'ancien
manoir de Launay. Sa chapelle a disparu. Propriété successive des familles
d'Argentré (en 1095), Marcille, seigneurs de la Motte-Marcille, Valory,
seigneurs de la Motte (vers 1678), des seigneurs du Plessis d'Argentré (en 1717 et 1789) ;
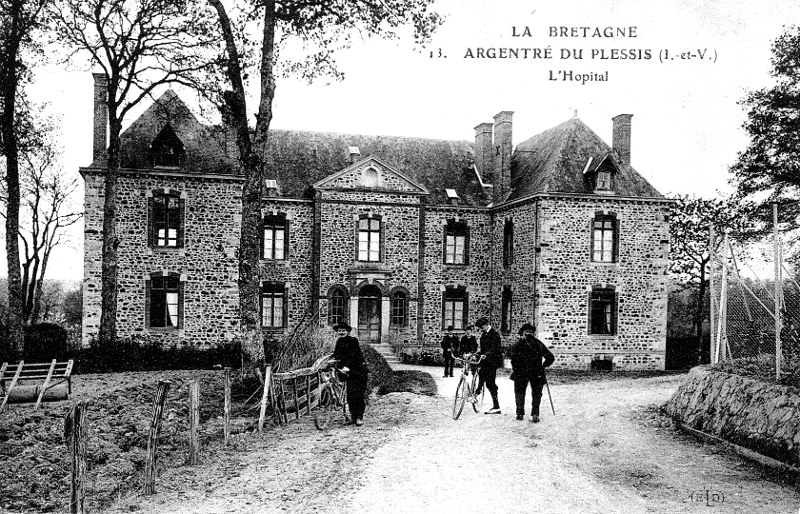
![]() l'ancien
manoir de l'Homelet (1533) ;
l'ancien
manoir de l'Homelet (1533) ;
![]() l'ancien
manoir de Crespel. Propriété successive des familles d'Argentré,
seigneurs de Launay (en 1300), Denée, seigneurs de la Motte de Gennes (vers
1470), Haugoumaz, seigneurs de la Guischardière (vers 1492), Argentré
(vers 1523). Les seigneurs du Plessis d'Argentré l’avaient encore en 1789 ;
l'ancien
manoir de Crespel. Propriété successive des familles d'Argentré,
seigneurs de Launay (en 1300), Denée, seigneurs de la Motte de Gennes (vers
1470), Haugoumaz, seigneurs de la Guischardière (vers 1492), Argentré
(vers 1523). Les seigneurs du Plessis d'Argentré l’avaient encore en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir des Orgères. Propriété de la famille Marcille, seigneurs de Launay
(en 1513) ;
l'ancien
manoir des Orgères. Propriété de la famille Marcille, seigneurs de Launay
(en 1513) ;

![]() l’ancienne
chapelle Saint-Gilles, aujourd'hui détruite, était située
près du bourg d'Argentré, dans une prairie qui porte encore
son nom. Elle était, au XVIIIème siècle, à la présentation du seigneur du Plessis ;
l’ancienne
chapelle Saint-Gilles, aujourd'hui détruite, était située
près du bourg d'Argentré, dans une prairie qui porte encore
son nom. Elle était, au XVIIIème siècle, à la présentation du seigneur du Plessis ;
![]() l'ancien
manoir du Breil-Manfany. Il possédait autrefois une chapelle et un droit de
haute justice. Propriété successive des familles de Manfany (en 1413),
Couaisnon (en 1432), Vauborel, seigneurs de Sainte-Marie (vers 1568), Hay,
barons des Nétumières (vers 1687 et en 1789) ;
l'ancien
manoir du Breil-Manfany. Il possédait autrefois une chapelle et un droit de
haute justice. Propriété successive des familles de Manfany (en 1413),
Couaisnon (en 1432), Vauborel, seigneurs de Sainte-Marie (vers 1568), Hay,
barons des Nétumières (vers 1687 et en 1789) ;
![]() l'ancien
manoir de la Bondie. Il était à la famille d'Argentré à la fin du XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Bondie. Il était à la famille d'Argentré à la fin du XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de la Rouveraye ou Rouvraye. On voyait près du manoir une chapelle et une motte
féodale à triple enceinte. Propriété de Marguerite d'Ancennis, femme
de Guy de Gué, seigneurs du Gué de Servon (en 1380), Jean du Gué (en 1513),
Marcille, seigneurs de Launay (en 1596 et 1663), des seigneurs de Launay jusqu’en 1789 ;
l'ancien
manoir de la Rouveraye ou Rouvraye. On voyait près du manoir une chapelle et une motte
féodale à triple enceinte. Propriété de Marguerite d'Ancennis, femme
de Guy de Gué, seigneurs du Gué de Servon (en 1380), Jean du Gué (en 1513),
Marcille, seigneurs de Launay (en 1596 et 1663), des seigneurs de Launay jusqu’en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de la Chalmière ou de la Charmière. Propriété de la famille
Chalmy en 1402, puis des chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Vitré de 1406 jusqu’en 1791 ;
l'ancien
manoir de la Chalmière ou de la Charmière. Propriété de la famille
Chalmy en 1402, puis des chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Vitré de 1406 jusqu’en 1791 ;
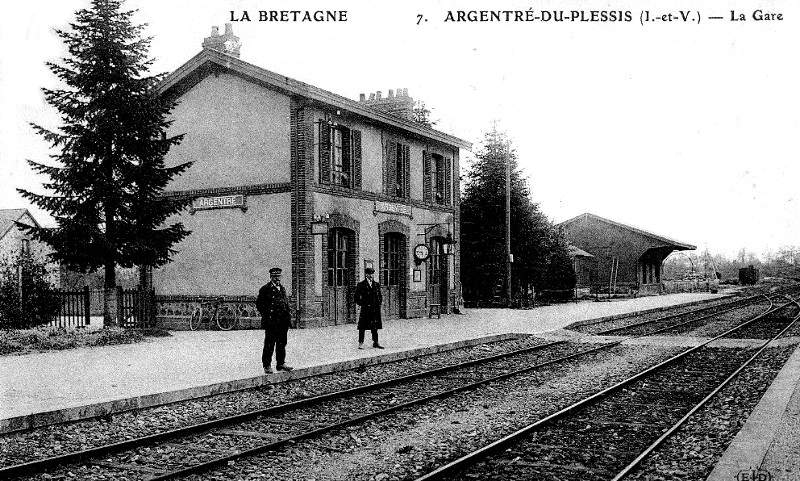
![]()
ANCIENNE NOBLESSE d'ARGENTRE-DU-PLESSIS
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Argentré" :
- Jacques de La Massaye : "Jacques de La Massaye en Argentré par Me Guillaume Meneust faict remonstrer qu'il tient en fyé noble environ dix livres de rente. Et supplye ung adjoinct. De quoy a esté ordonné luy estre dépesché acte de sadicte remonstrance. Et a offert ledict Meneust pour ledict de La Massaye faire le service qui luy sera ordonné par messeigneurs les commissaires".
- Marin Marcillé : "Marin Marcillé seigneur de Launaye se présente monté et armé en estat d'archer. Et déclare par serment sa richesse valloir environ deux cens livres de rente. Et a faict le serment".
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.