|
Bienvenue ! |
BRANDIVY ET LA RÉVOLUTION |
Retour page d'accueil Retour Ville de Brandivy
L’INSURRECTION dont Brandivy a été le théâtre, bien qu'elle soit une dans son
principe, se rapporte néanmoins à trois époques différentes : la grande
Révolution, l'Empire et la Monarchie de Juillet.
BRANDIVY ET LA GRANDE RÉVOLUTION.
Le pays de Grand-Champ, si célebre par sa résistance à l'oppression révolutionnaire, comptait pour ainsi dire autant de récalcitrants qu'il renfermait d'habitants. D'où provenait cette horreur unanime pour les idées nouvelles ? C'est ce qu'il convient d'indiquer d'une manière précise avant d'aborder les faits qui sont, dans la grande lutte, spéciaux à cette localité.
I.
CAUSES DE L'INSURRECTION EN GRAND-CHAMP.
Note : Le canton de Grand-Champ comprenait à cette époque ; Grand-Champ, avec ses deux tréves de Brandivy et de Locmaria, Plescop et Meucon.
Aucun pays ne se jette de gaieté de cœur dans la voie insurrectionnelle. Pour provoquer une prise d'armes générale, il faut des griefs considérables. Or de semblables raisons ne manquaient pas aux gens de Grand-Champ, le nouveau régime n'ayant négligé aucun moyen de pousser à bout leur patience : ce qui les exaspéra particulièrement, ce fut le déchaînement de la persécution religieuse.
Le premier acte capital en ce genre fat la clôtare de l'abbaye de Lanvaux. De pauvres religieux, n'ayant sur la terre d'autres aspirations que le salut de leurs âmes, ont fait vœu de vivre et de mourir dans un domaine qui leur appartient. Et voilà que, le 21 mars 1791, on leur signfile brutalement de vider la place avant le 1er avril, et de chercher un gîte ailleurs. Quel mal ont-ils fait ? Inutile de le demander. A cette époque de sinistre mémoire, tout le crime consistait à aimer la vertu, et toute la vertu à pratiquer le crime.
Ce premier acte fut à bref délai suivi d'un second : la profanation de l'église paroissiale de Grand-Champ. Le 19 juin, l'assemblée primaire du canton est convoquée à l'effet d'élire les cinq électeurs qui doivent nommer les députés à l'Assemblée législative. On décide qu'elle se tiendra dans l'église, transformée de la sorte en champ de foire électorale. Ne pouvait-elle pas se tenir au dehors ou dans un autre local ? Le temple de Dieu était-il fait pour abriter une pareille cohue [Note : Directoire du district de Vannes] ?
Du mépris du temple de Dieu à l'incarcération de ses prêtres, il n'y a qu'un pas. Ce pas fut franchi au mois de septembre 1792 lorsque le vénérable M. Raoul, recteur de Grand-Champ depuis 1783, fut conduit à Vannes et enfermé dans la maison de la Retraite des femmes. Avec l'approbation du Directoire, en date du dix du même mois, le Conseil général de la commune de Vannes avait assigné ce logement aux prêtres sexagénaires et infirmes, exemptés de la formalité du serment [Note : Directoire de Vannes]. M. Raoul se trouvait dans ce cas, étant octogénaire. La tradition rapporte que le peuple, muni d'armes de toutes sortes : crocs, fourches, fusils, alla en masse réclamer son pasteur, et qu’il ne se retira que devant le canon.
La douleur du peuple dut s'accroître en apprenant le peu d'égards qu'on témoignait aux vénérables prisonniers. Ils auraient désiré se servir du linge de la Retraite, transporter leurs malades à l'infirmerie et choisir eux-mêmes leurs gardiens, célébrer enfin la messe dans la chapelle de la maison : comme rien ne leur paraissait plus naturel, ils firent cette triple demande au Directoire. Celui-ci ne l'entendait pas de la sorte : « Non, répondit-il à vous de fournir votre linge ou il vous sera fourni d'ailleurs, mais vous ne toucherez pas au linge de la Retraite ; non, vous ne choisirez pas vos gardes-malades, les municipaux les désigneront ; non, vous ne serez pas autorisés à dire la messe dans la chapelle » [Note : Directoire de Vannes]. Ce dernier refus devait particulièrement peser à leur cœur. Mais aussi quelle insolence, en pleine République et dans une prison républicaine, de parler de messe et de s'occuper de Dieu !
Lors de l'incarcération de M. Raoul, le juge de paix de Grand-Champ se nommait Guillaume Pérono, et son greffier, Paul-Marie Le Noche. C'étaient deux exaltés dont les idées ennuyaient la municipalité. Comme celle-ci ne se présente pas en nombre pour recevoir leur serment, ils sont obligés, pour le prêter, de se rendre au Directoire de Vannes. Là, en présence des administrateurs, « ils ont juré séparément, la main levée, d'être fidèles à la nation et de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant » [Note : Directoire de Vannes]. (10 octobre 1792).
Cet excès de zèle trahit Pérono. Aux élections qui eurent lieu le 2 décembre suivant, le notaire Cohéléach lui enleva sa place. Le vaincu n'a garde, sans mot dire, d'accepter son échec. Il accuse son vainqueur « d'avoir dit que, s’il avait été juge de paix, il eût empêché le recteur d'aller à Vannes, que si on le nommait juge de paix, il le ferait revenir reprendre ses fonctions ; d'avoir payé à boire pour enlever les suffrages du peuple, de ne plus fréquenter son frère [Note : Cohéléach, curé constitutionnel de Kervignac, massacré par les chouans en 1794] qui avait prêté serment qu'il regardait comme contraire à la religion… ». Le Directoire répond ce sujet qu’il n'est pas d'avis de prendre au sérieux tous les propos reprochés à Cohéléach qui a d'ailleurs lui-même prêté serment. Il cassa toutefois les élections cantonales du 2 décembre où il a été nommé juge de paix et ordonne de procéder à de nouvelles élections. Les élections eurent lieu effectivement ; Pérono fut déçu dans ses espérances et son concurrent obtint de nouveau la majorité [Note : Direct du district de Vannes].
Mais Cohéléach tenta-t-il en réalité quelque démarche pour la délivrance de son recteur ? Il est permis d'en douter, d'autant plus que lui-même, par la prestation du serment, a clairement témoigné qu’il nageait dans les eaux révolutionnaires. Il ne resta que deux ans en place. Mis en demeure d'opter entre les fonctions de juge de paix et celles de notaire, il déclara, le 3 mars 1794, qu'il choisissait ces dernières.
Pour M. Raoul, il fut dispensé, en raison de son grand âge, du voyage de Josselin et gardé à la Retraite jusqu'au 15 mars 1795, date à laquelle tous les prêtres détenus dans cette maison comme réfractaires furent rendus à la liberté.
Les mêmes odieux décrets [Note : Tout prêtre qui refusait le serment était condamné, dans les 15 jours, à sortir de France sous peine de déportation. — Deux ans plus tard le représentant du peuple Carpentier déclarait suspect tout prêtre qui ne livrait pas ses lettres de prêtrise], qui avaient causé la détention du recteur, amenèrent la dispersion de son clergé. J'ai déjà dit avec quelle intrépidité l'abbé Udoux, curé de Brandivy, traversa ces temps malheureux. MM. Cadoret [Note : Pierre-Francois Cadoret, né à Grand-Champ, d’un père cordonnier] et Caudal [Note : René Caudal, fils d’un marchand de Plouhinec] l'imitèrent dans son dévouement, mais ne purent, comme lui, échapper à la mort : tombés entre les mains de leurs ennemis, ils périrent vers le mois de mars 1796.
Plus de prêtres et, partant, plus de messe ni de sacrement. A quoi sert dès lors l'argenterie des églises ? Une loi du 10 septembre 1792 ordonnait aux communes de dresser un état de l'argenterie qu'elles possédaient pour le culte, à l'exception des vases sacrés. La commune de Grand-Champ, au lieu de se conformer à cette loi injuste, s'empresse de recéler chez un particulier différents objets sacrés qu'elle allègue ensuite lui avoir été volés. Une visite domiciliaire, faite par la force armée dans la commune, arrive malheureusement à les découvrir. Des la première nouvelle, l'agent national près du district prend feu. « Il requiert que, faute à la municipalité d'avoir remis l'argenterie qui se trouve tant au bourg que dans les chapelles frairiennes de son ressort, elle soit condamnée à verser à la caisse du district une somme de 3000 livres, si mieux elle n'aime représenter l'argenterie qu'elle prétend lui avoir été volée ». Le directoire, sans sourcilier, l'adjuge ainsi, et accorde à la municipalité de Grand-Champ, pour faire son choix, un délai de huit jours (12 germinal an II, 1er avril 1794) [Note : District de Vannes]. Voilà des mesures assurément pacificatrices !
Conjointement avec la proscription du culte, la conscription des enfants. Encore un bon moyen de rendre la République populaire ! Chaque commune est taxée à un certain nombre de recrues, et le tirage au sort, à moins d'engagements volontaires, porte sur les jeunes gens, célibataires ou veufs, de 18 a 40 ans. Cependant le nombre à fournir est d'une modération rotative. Ainsi dans la levée de 100000 hommes, ordonnée par la loi du 25 juillet 1791, le Morbihan est compris pour 450 soldats, et le district de Vannes, avec ses 26 communes, pour 60 ; soit cinq au six pour Grand-Champ.
Pour la levée de 300000 hommes (loi du 24 février 1793), la commune de Grand-Champ avec sa populatian de 4288 âmes (y compris ses deux trêves) est taxée le 6 mars par directoire à 33 recrues, Meucon à 2, Plescob à 7, Plaudren avec Locqueltas et Monterblanc à 19 [Note : District de Vannes].
Lors de la levée de 30 000 cavaliers (loi du 22 juillet) sur les 33 que fournit le district, le directoire en impose trois à Grand-Champ, deux à Plaudren, deux à Plescob, Plœren et Meucon réunis [Note : District de Vannes]. Cette levée, il est vrai, entraînait des charges spéciales : la commune devait équiper les chevaux, faire l’achat du sabre et du pistolet, confectionner les bottes des cavaliers..... Ces charges toutefois n'avaient rien d'accablant.
Mais si modéré que fut le chiffre des recrues, l'opinion publique n'en repoussait pas moins toute espèce de tirage. Lors de la levée de 300 000 hommes, Grand-Champ, Meucon, Saint-Avé se soulèvent en criant : « Rac'h, rac'h, tous, tous ! ». Pour échapper aux vexations populaires, plusieurs officiers municipaux refusent de publier la loi ; d'autres, d'informer le commissaire cantonal du résultat du tirage. Le directoire s'irrite de tant de résistances, et les rebelles sont avertis, par une circulaire du 13 mars 1793, que, « faute à eux de remplir leurs devoirs, ils recevront garnisaires » [Note : District de Vannes].
Alors même que le tirage se fait régulièrement, à quoi cela avance-t-il, puisque les conscrits ne partent pas ? Le canton de Grand-Champ se distingue parmi les plus récalcitrants. Pour le réduire, l'administration arrête de « nommer le citoyen Bizaud, commissaire, pour mettre les scellés dans le canton de Grand-Champ chez les déserteurs, condamnés et autres dont les bien doivent être sous séquestre, arrête en outre que ledit commissaire s'adressera au juge de paix pour avoir les noms de toutes les personnes qui sont sous le coup de la loi ». (1er mai 1794) [Note : Direct. du district de Vannes]. Mais a-t-on jamais réussi à réduire un peuple révolté à coups d’exploits d’huissier ?
Aussi nos gars, non contents d’être déserteurs, s'unirent-ils ouvertement à ceux qui travaillaient, les armes à la main, au renversement de la République. Un grand rassemblement se fit dans la commune vers la fin de la même année et surprit le bourg occupé par les républicains. Furieux de leur échec, ceux-ci ne cherchent qu'à se venger. Leur vengeance tombe sur les fonctionnaires, coupables d'avoir gardé le silence sur les menées royalistes. Greffier, notaire, municipaux, tous sont arrêtés, conduits à Vannes, enfermes au Petit-Couvent. Au bout d'un certain temps, nos paysans n'y tiennent plus. Dans la nuit du 14 au 15 novembre, dix d'entre eux brisent les barreaux de leur cage et regagnent le pays natal. Qui n'est pas content ? Louis Mansart, concierge. Vers deux heures du matin, il reçoit avis de leur évasion, et cet avis lui est donné par les camarades mêmes des fugitifs. Il constate tristement que les lits sont vides et qu'une échelle appliquée au mur du fond de l'enclos a dû servir à l'escalader [Note : Arch. du Petit-Couvent]. Le concierge redouble de vigilance, ce qui n'empêche pas quatre autres municipaux, dans la nuit du 20 au 21 décembre, de prendre le même chemin. La colère du directoire est au comble et le châtiment ne se fait pas attendre. Les huissiers Boucher et Anézo partent pour Grand-Champ, sous la protection de la force armée, avec ordre d'apposer sans retard les scellés sur tous les meubles et effets des fugitifs [Note : Arch. du Petit-Couvent].
Restaient en prisent Cohéléach, ci-devant juge et notaire, Michel Georgelin, le fameux apostat de Lanvaux ; quelques autres encore, c'est-à-dire les amis du gouvernement. Cette situation comique ne pouvait se prolonger. Cinq jours après, Guezno et Guermeur, représentants du peuple près les armées des côtes de Brest, présents, en ce moment à Vannes, décidèrent d'y mettre fin. Après avoir protesté que « les détenus à Vannes, remplissant les fonctions publiques à Grand-Champ lors de la prise de ce bourg par les rebelles, ont manqué à leur devoir en refusant d'instruire l'administrateur du rassemblement fait dans leur commune », ils joutent :
« Vu les explications de Cohéléach.
Vu le témoignage du comité révolutionnaire de Vannes qui demande leur mise en liberté, que les détenus ont constamment joui d'une bonne réputation de probité et de civisme, qu'ils se sont montrés les amis de la Révolution et des lois ; que c'est à la terreur, non à la malveillance qu'on doit attribuer les fautes qu'ils ont commises lors de l'entrée des rebelles,
Arrêtent que les citoyens Jean Guhur, Pierre Le Meut, Jean Bernard, Jean Eveno, Jean Drean, Mélanie Audic, Pierre Mahé, Joseph Kersuzan, Michel Le Ray, Bernard Corlay [Note : Ces dix s’étaient évadés dès le 15 novembre], Jean Le Port, Gilles Le Gleuher, Paul Seveur, François Corfmat, François Le Gal, Joseph Caradeuo, Jean Le Viguelloux, Jean Le Boulaire, Jacques Le Boulaire, Mathurin Le Cheviller, tous ci-devant membres de la municipalité de Grand-Champ ; Pierre-François Caris, secrétaire greffier, Joachim-Adrien Cohéléach, ci-devant juge de paix et notaire, et Michel Georgelin, fermier du pourpris national de Lanvaux tous en fuite ou détenus à Vannes, sont dès ce moment libres et tenus de se retirer dans leurs foyers » [Note : C’est peut-être pendant cette détention que doit se placer cette curieuse anecdote. Des détenus républicains aimaient pendant la nuit à hurler la Marseillaise. Troublé dans son sommeil, Kerviler fait appel aux gars de Grand-Champ. Ceux-ci arrivent de bon matin dans les corridors et, pendant qu'ils y conduisent des brouettes avec fracas, chantent le De Profundis et le Miserere. On conçoit l’ahurissement des républicains. « Vous pouvez recommencer, » leur dit Kerviler (Récit de M. Kerviler)].
Cette mesure de clémence ne changea rien à l'état des choses : nos campagnes persistèrent dans une hostilité déclarée.
C’est qu’à ces deux griefs capitaux s’en joignait un troisième non moins capital, je veux dire la réquisition des denrées, combinée avec le cours forcé des assignats et la fixation du maximum.
J'admettrais volontiers, dans les cas extrêmes, le recours aux réquisitions, parce que les vivres ne peuvent rester entassés dans une locatité, si dans la localité voisine on meurt de faim. Or telle était la situation de la ville de Vannes en 1793-1794, par suite du mauvais vouloir des campagnes que la force seule pouvait dompter [Note : Ceci n’est pas exagéré. Les campagnes, d’après une certaine tradition visaient à réduire les républicains par la famine]. Le 1er février 1793, 50 hommes d'armes se rendent à Grand-Champ, avec ordre d'y demeurer jusqu'à ce que la municipalité ait fait envoyer à Vannes ce qu'elle doit fournir en grains. Outre la réquisition du grain, c'est celle du beurre et du bois. Une lettre circulaire, en date du 1er avril 1794, enjoint aux cultivateurs de porter au marché la quantité de beurre et de fagots qui leur est imposée par la municipalité. Grand-Champ est taxé à trente livres de beurre et deux cents fagots ; Plescop, à vingt livres de beurre et un cent de fagots ; Meucon à quatre livres de beurre et un cent de fagots ; Plaudren, à douze livres de beurre et un cent de fagots [Note : Direct. — Ces réquisitions étaient fréquentes et, parfois, énorme. Un arrêté du direct. dép. en date du 18 octobre 1793 porte : « Il sera fourni par voie de réquisition, dans les districts de Vannes et d’Auray, 25.000 quintaux de froment. Il sera procédé au répartiment de la quantité entre les communes. Les grains seront payés comptant, lors de la livraison et sur le pied du maximum ». — Peu après, nouvelle réquisitions dans le district de Vannes : 5000 quintaux d'avoine, 1000 de foin, 4000 de paille].
Mais si l'on admet, pour la vente des denrées, le recours éventuel à la force, ce ne doit pas être aux dépens du vendeur qui a, de son côté, droit à une juste rémunération. Or le cultivateur a toujours eu un faible pour le métal sonnant, et il ne se croyait pas suffisamment rémunéré pat le paiement en assignats qui avaient cours forcé dans tout le royaume aux termes d'un décret du 16 avril 1790, et qui, dès l'année suivante, avaient envahi le Morbihan [Note : De février 1791 à novembre de la même année, plus de 600 000 livres en assignats furent envoyées au directoire du Morbihan. — Les ouvriers du port de Lorient se coalisèrent pour refuser le papiers-monnaie (Direct.)].
Ajoutez-y que, pour se conformer à la loi du 29 septembre 1793 [Note : La loi du Maximum général est une seconde loi française instituant le maximum décroissant du prix des grains à la suite des réticences des directoires de département à en appliquer une première. Elle est votée le 29 septembre 1793 par la Convention], le directoire de Vannes avait, le 7 octobre suivant, fixé pour tout le district le prix maximum des denrées : papier, vache, cidre, cochon, morue, fers, bois, chandelles, sabots ; tout est taxé, rien d’oublié. En voici quelques spécimens :
Viande fraiche :
Livre de bœuf seul : 9 sols
Livre de veau seul : 6 sols
Livre de mouton seul : 5 sols
Les trois ensemble : 8 sols la libre.
Livre de beurre frais : 15 sols
Bétail de la plus belle espèce:
Bœuf : 300 liv.
Vache : 127 liv.
Veau : 36 liv.
Mouton : 12 liv.
Cochon : 120 liv.
Corde de gros bois : 24 liv.
Corde
de billette : 18 liv.
Un cent de fagots : 14 liv.
Barrique de cidre : 24 liv.
Livre de sel : 2 sous.
Livre de chandelle de suif : 18 sous.
Sabots pour
hommes : 14 sous.
Sabots pour femmes : 11 sous [Note : Direct. du district].
Tous ces prix paraissent raisonnables : plusieurs même sont élevés. Il advint cependant que les administrateurs du district, avant de lancer leur arrêté, auraient dû tout d’abord prévoir. Le bourgeois, né malin, dépréciait naturellement les denrées, s’efforçant, par des critiques excessives, de les faire déchoir du premier rang. Le paysan qui n’est pas une bête non plus, vantait non moins naturellement sa marchandise qu’il estimait toujours, quelle qu’elle fût, la meilleure du monde et digne du plus haut prix. Des difficultés si grandes finirent par s’élever au sujet de ce intempestif réglement que le directoire départemental, sur les plaintes réitérées des acheteurs, bouchers et autres, ordonna d’en ajourner l’exécution. Le paysan dut certainement applaudir au succès de sa ruse, mais avant d’en arriver là, que de tiraillements ! Le dessein secret ou avoué des campagnes, que j'ai signalé plus haut, de réduire les républicains par la famine, n’est pas pour me surprendre : le cultivateur n’aimait pas le citadin ou le républicain, car c’était tout un. Il avait déjà tant souffert de la République ! Mais, abstraction faite de la forme gouvernementale, cette hostilité du cultivateur s’expliquait aisément par le froissement de ses intérêts matériels. Je crois que peu d’hommes sur la terre aimeraient à subir le cours forcé des denrées, combiné avec paiement en assignats et l’établissement du maximum. Tout cela ne justifiait-il pas suffisamment, en dehors de tout autre mobile, sa répugnance à entretenir le marché ?
Devant la force, pas de résistance. La force disparue, on rentrait dans la résistance passive qui attirait sur les pauvres officiers municipaux toute la colère administrative.
Ainsi donc, triple entreprise manifeste sur les droits les plus sacrés :
Sur les droits de la conscience, par la proscription du culte ;
Sur les droits des familles, par la conscription militaire ;
Sur les droits de la propriété, par la réquisition des denrées.
Comment le peuple, en proie à de semblables vexations, pouvait demeurer froid ou indifférent ?
Une autre spoliation, bien qu'elle ne visât le peuple qu'indirectement, contribua certainement, dans les circonstances présentes, à échauffer les têtes et à précipiter l'explosion : c'était la constitution de la régle des émigrés, autrement dit la mainmise du parti au pouvoir sur les biens ecclésiastiques et sur les biens des fugitifs.
Après la promulgation des décrets qui expropriaient les communautés religieuses et les ci-devant nobles, fugitifs où émigrés, le gouvernement entreprit l'administration de leurs domaines qu'il qualifia de nationaux, en attendant leur mise en vente. C'est ce qu'il appela la régie des emigrés ; elle consistait tout simplement dans la perception annuelle des fermages, au lieu et place des veritables propriétaires [Note : Voici ne reçu : Régie des émigrés. Je soussigné, receveur des domaines nationaux, reconnais avoir reçu de N., domanier d’une tenue, appartenant à la Nation… suivant l’apprécis de Saint-Gilles. Signé : Mocquaux], avec défense expresse de leur fournir aucun paiement, à peine de payer deux fois [Note : Décret du directoire du Morbihan relatif aux biens des émigrés, 1er mars 1792. Cinq fermiers de M. de la Bourdonnaye-Coëtcandec sont mandés à la barre du directoire pour lui avoir payé le prix de leurs fermages (1er octobre 1794)]. Les baux passés par les seigneurs et les abbayes suivaient leur cours. On en renouvelait d'autres à leur expiration [Note : Pourtant une loi de l’an V portait annulation des baux des domaines nationaux]. Les dîmes elles-mêmes, si l'on excepte celles qui avaient pour principe un fief, étaient maintenues. Ce n'est pas précisément ce que cherchait l'administration centrale du Morbihan, qui avait nommé, dès le 24 septembre 1790, des commissaires avec mission de poursuivre, devant le directoire de chaque district, la liquidation des biens nationaux. Mais où trouver tant d'acquéreurs ? Pas dans nos campagnes où le sens de la justice n'était pas assez perverti pour autoriser un pareil vol, ni la religión assez affaiblie pour étouffer tout remords, ni à défaut de ces nobles motifs, les acheteurs assez en sûreté pour braver l’ndignation publique. Les villes et gros bourgs regorgeaient sans doute de bourgeois voltairiens que d'ignobles opérations n’effrayaient guère. Mais s’il était facile d'acquérir, il était difficile de jouir, et ils avaient à craindre d’y perdre, non leur honneur, dont ils se souciaient médiocrement, mais leur argent, ce qui les touchait davantage. De là, le peu d’empressement, attesté par plusieurs procès-verbaux, qu’ils mettaient à s’approprier le bien d’autrui. La vente était annoncée qu’il ne s’y présentait souvent ni acquéreur, ni enchérisseur. Les administrateurs avaient eux-mêmes besoin d’être stimulés, comme le prouve un décret de septembre 1793, qui leur infligeait dix ans de détention s’ils refusaient d’ordonner à ce égard les publications exigées par la loi.
L’occasion de s’enrichir à peu de frais paraissait cependant si belle qu’on finit par succomber à la tentation. Environ 75 domaines seigneuriaux furent vendus en Grand-Champ. Ils appartenaient à M.M. Galisson, Gicquel du Nédo, de Guerry, Gibon de Kerisouët, de la Bourdonnaye, Lantivy du Rest, de Mirabeau, de Montmorency-Laval, Blévin de Penhouët, de Rougé, Goyon de Vaudurant [Note : Arch. départ.]. De tous ces domaines, trois seulement se trouvaient en Brandivy. Ils étaient situés aux villages du Runio, du Tromer et du Resto. Les deux premiers relevaient de M. de Montmorency-Laval, et le troisième du come de Rougé. La seigneurie de la Grandville fut pendant un certain temps déclarée bien national, et ses revenus soldés au receveur des domaines. Ayant enfin réussi à faire admettre les motifs qui le retenaient à l’étranger, M. Bidé obtint la levée du séquestre qui pesait sur sa propriété et rentra dans tous ses droits [Note : Arch. de la Grandville].
Ces diverses ventes ne frappaient néanmoins qu’une faible partie des biens seigneuriaux et les nobles eurent la chance de conserver tout ou une partie de leur patrimoine, les droits de l’Eglise furent beaucoup moins respectés et l'on fit sans scrupule main basse sur ses domaines. Environ quatre-vingt-dix lots furent aliénés dans le courant de la Révolution. Ils avaient pour propriétaires le couvent de Nazareth, la fabrique de Locmaria, le chapitre de Vannes, le séminaire de Vannes, la chapellenie de Bodéan, les Carmes du Bondon, la chapellenie de Penhouët, la chapellenie de Notre-Dame, l'abbaye de Lanvaux et la Chartreuse d'Auray [Note : Arch. départ.]. Tous les biens monastiques de Brandivy y passèrent.
Les aliénations commencèrent, dès 1790. C'est en 1798 qu'elles furent le plus nombreuses. Les acquéreurs, du moins à cette dernière époque offraient des prix excessifs [Note : Pour ne citer qu’un exemple, le fonds du Tromer appartenant à M. de Montmorency fut vendu le 28 germinal an 6 (17 avril 1798) 64 000 livres. On l’estime, vers 1892, 10.000 fr (Titres Bodic)]. Mais peu leur importait en somme. Ils soldaient sans doute en papier-monnaie, tombé à un du cent de sa valeur. Il va sans dire que la plupart de nos paysans [Note : Je n’ai vu qu’un seul fonds acheté par un paysan de Brandivy, C’était en 1798], se sont tenus en dehors de ces scandaleuses liquidations, bien que des fonds de tenues leur aient été souvent offerts à des prix dérisoires |Note : Par exemple, deux bouteilles de vin (tradition)]. « Comme une branche est détachée de l'arbre, leur disait-on, ainsi se détache du ciel quiconque se rendra acquéreur des biens, prétendus nationaux ». Cette maxime entra profondément dans l'esprit de nos braves gens, et l'horreur qu'ils avaient conçue pour l'opération passa naturellement aux opérateurs. M. Villemain de Lorient, dont le fils fut l'ennemi constant de la monarchie légitime, apprit à ses dépens qu'il est pour les voleurs certaines limites qu'ils ne doivent pas dépasser, sous peine de déchaîner sur leur tête un orage vengeur.
Après avoir acquis l’abbaye de Lanvaux, heureux et fier de sa conquête, il y vint fixer sa résidence. La chasse était son principal amusement, et il s’y livrait avec ardeur, au sein de ses vastes domaines, suivi d’une meute superbe « Un jour, racontent nos vieillards, sa trompette retentissait plus sonore, ses chiens aboyient avec plus de vigueur, et l’acquéreur, sans songer à mal, s’en donnait à cœur joie. Il avait oublié qu’il était voleur, qu’il avait acquis illégitimement des biens sacrés, que le pays où il vivait avec une extrême répugnance toutes ces sacrilèges expropriations, enfin que bien mal acquis ne profite jamais. Il entre chez lui, se couche sans défiance ; or, cette nuit même, des hommes s’introduisent dans sa chambre et le tuent à coups de sabre ou de couteau. Pas un chien n’avait bougé » [Note : Tradition. Ce meutre a dû avoir lieu vers la fin de 93 ou au commencement de 1794].
Que l'on déclame à satiété contre ce meurtre et contre les meutriers : je les condamne moi-même de toutes mes forces. On s'explique néanmoins que les choses aient été poussées à ce degré de violence contre les détenteurs des biens ecclésiastiques, lorsqu'on met en regard l'expropriation brutale du clergé séculier et régulier et la sanglante persécution dont tous étaient victimes. Il y a lieu seulement d'être surpris qu'une révolte générale n'ait pas éclaté dès l'origine d'un bouleversement qui avait le don d'inspirer au prêtre, au seigneur et au cultivateur, une horreur commune. Il est clair que le paysan avait accueilli avec plaisir la suppression des dîmes et des autres droits féodaux, mais il vit de bonne heure que d'autres charges aussi rigoureuses venaient remplacer celles-là, et surtout que c'était acheter cette supression trop cher, que de l'acheter aux dépens de sa foi.
Pour contenir la fureur populaire, il ne suffisait pas « d'indemniser les citoyens qui ont souffert des incursions des ennemis de la République » [Note : Direct.] « d'accorder une récompense aux cultivateurs qui ont le plus ensemencé de pommes de terre » [Note : Direct.], de s’attendrir en hypocrites « sur l’abjuration faite par un chouan de l’erreur dans laquelle il a été jusquà présent » [Note : Direct.] « de distribuer entre les communes des millions pour travaux utiles et secours gratuits » [Note : Le district de Vannes disposait (mai 1795) de 42.960 fr. dont Grand-Champ recoit 3035 livres ; Meucon 203 ; Plaudren, 1843 ; Plescop 744] , de créer des jurys spéciaux pour le fait d’avoir crié : « Vive le roi », ou même d’apprendre à nos gens à invoquer « l’Etre suprême qui tranche chaque jour le fil de notre vie, chacun à son tour » [Note : Titres Jolif]. Il eût fallu un franc retour en arrière ; et c’est ce qu’on ne voulait pas. De là, l’explosion, sa violence et sa durée.
II.
L'INSURRECTION EN BRANDIVY.
Les conséquences intimes de cette explosion dans le canton de Grand-Champ, voilà maintenant ce qu'il importerait de connaître. Pour en saisir au vif tous les détails, il n'y a qu'un moyen : c'est de préciser, pour chaque commune, les faits insurrectionnels qui s'y rapportent, de rechercher sur le drame révolutionnaire les traditions encore inaltérées, de signaler enfin quelques-uns de ces vaillants obscurs qui ont pris à la résistance une part active. Ce travail, je l'ai tenté pour Brandivy.
En mai 1795, le général de Silz fut surpris à Grand-Champ et tué par le général Josuet. « Le même jour, dit Rohu, nous nous trouvions au nombre de cinq cents, sous les ordres de la Vendée, à une lieue et demie de Grand-Champ. Nous avions passée la nuit à l’abbaye de Lanvaux, et au jour, nous nous dirigeâmes vers le champ de bataille ; mais nous ne vîmes que ceux des nôtres qui se sauvaient en déroute vers les taillis de Kerret. On nous fit prendre la même route et nous ne nous arrêtâmes qu’à Bignan. Chose extraordinaire ! étant couchés la nuit sur la plancher en tuille d’une chambre de l’abbaye, la veille du combat dont je viens de parler, nous avions allumé du feu au milieu de l'appartement et nous étions étendus autour. Quelques-uns commençaient déjà à sommeiller, quand tout à coup trois fusils, placés contre la longère, furent jetés au feu sans que personne eût bougé, et un cri « aux armes » fut entendu dans toute la cour, sans que nous ayons pu savoir alors ni depuis, comment ces fusils avaient été jetés au feu, et qui avait poussé le cri d'alarmes qui nous fit descendre à la hâte dans la cour où nous restâmes jusqu'au jour ».
Un des chefs de cette troupe, nommé La Vendée, de son vrai nom Pierre Le Mercier, né au Lion-d'Angers, et qu'il ne faut pas confondre avec le traître Le Mercier, de Grand-Champ, avait suivi Georges Cadoudal en Bretagne, après l'extermination des Vendéens. Le 25 juin 1795, jour de foire à Auray, il surprend dans la lande de Plœren seize soldats qui escortent une voiture et ordonne de les fusiller. L'un d'eux parvient à s'échapper et à fuir jusqu'à Brandivy. Il est saisi de nouveau, ramené à Coët-Sal et mis à mort [Note : Papiers de M. Le Bihan, ancien recteur de Pluneret]. C'était entre les deux partis une guerre d’extermination, les bleus ne faisant pas quartier aux chouans et les chouans n'ayant nulle envie d'épargner les bleus, encore moins les traîtres.
Un parti royaliste se présente au Troguern où une vieille mendiante étrangère à la localité a passé la nuit. La présence de la mendiante en ce rendez-vous des royalistes étonne au premier abord. De l'étonnement nos gens passent à la fureur : ils ont reconnu une de leurs espionnes, pour dérober la famille hospitalière à la vengeance républicaine, la vieille est à l'instant conduite vers la montagne de Brenedan, mise à mort et inhumée [Note : Tradition].
Cette mesure ne manquait pas de rigueur, mais elle était commandée par les circonstances. Une dénonciation était inévitable et à, en croire l’expérience, elle devait entraîner après soi des suites sanglantes. C'est que les républicains avaient à leur actif plusieurs exploits de ce genre et l'on savait qu'ils ne reculaient pas, à l'occasion, devant le massacre des personnes les plus inoffensives. Que leur a fait, par exemple, ce cultivateur à demi-lettré du Favision, que la passion de l'étude attire de temps à autre, parmi les broussailles, dans l'enceinte solitaire du Castel-Guen ? La gendarmerie l'y surprend, penché sur ses livres. Il a l'air d'un prêtre, c'est assez, il faut qu'il périsse [Note : Tradition]. Persuadés à leur tour que dans les temps de guerre civile, la modération ne sert de rien, les royalistes firent souvent trêve à leurs sentiments généreux, et malheur aux républicains comme aux traîtres qui leur tombaient sous la main [Note : On ne tuait pas tous les espions. On se contentait souvent de leur raser la barbe et les cheveux]. Mais pourquoi insister sur ce douloureux sujet ? Brandivy n'a été, à ma connaissance, souillé que par trois ou quatre meurtres isolés, et je n'en dirai pas davantage.
Je préfère attirer l'attention du lecteur sur le manoir de la Grandville, où siégeait, au commencement de septembre 1795, le conseil militaire du Morbihan, préoccupé de relever les courages après le désastre de Quiberon. Etaient présents le chanoine de Boutouillic, l'abbé Guillo, de la Bourdonnaye, du Quérizec, Mercier La Vendée, Cadoudal... Les circonstances étaient si graves que le comte de Puisaye, général en chef, prit la résolution de se rendre de sa personne à ce conseil pour en présider les délibérations. A cet effet, il quitte Houat où il s’est réfugié depuis la défaite de son parti ; et, non sans de grands dangers, parvient jusqu’à la Grand-ville. On décide d’informer au plus vite de la situation le comte d’Artois, récemment débarqué à l’île d’Yeu. Le comte de Vauban, maréchal des logis et second chef des armées catholiques et royalistes, est chargé de la commission. Le conseil se sépare ensuite. Résolu à une prochaine revanche [Note : Hist. de Cadoudal].
En l’attendant, les municipalités travaillent avec ardeur à la délivrance des prisonniers faits à Quiberon. Ils étaient nombreux [Note : Nostang avait 96 détenus ; Branderion, 22 ; Languidic, 87 ; Plouhinec, 261 ; Merlevenez, 94 (Distr. d’Hennebont, arch. départ. N. 946)], car la plupart des hommes valides qui ne suivaient pas Cadoudal s’étaient lancés à corps perdu dans cette expédition. Les administrateurs du département n’étaient pas, à leur égard, sans embarras. Si durs qu’ils fussent, ils ne pouvaient sérieusement songer à les faire passer par les armes ; d'un autre côté, prolonger leur détention, c'était épuiser, en pure perte, les magasins de l'Etat. Dans ces conditions, mieux valait négocier leur mise en liberté. Les municipaux de Grand-Champ ne sont pas des derniers à réclamer la délivrance de leurs concitoyens. Pour faciliter le succès de leurs démarches, ils prennent la précaution de livrer au directoire 23 mauvais fusils. Ce témoignage de bonne volonté ne suffit pas. La porte du cachot ne s'ouvre devant les détenus que moyennant le paiement d'une rançon en nature. L'un est obligé de verser 300 livres de froment, tous les autres 550 livres de seigle dans les magasins militaires [Note : Plouhinec donna pour les détenus de sa commune 813 quintaux de froment ; Riantec, 677… (Distr. d'Hennebont N. 948)]. C'est sur le vu des quittances délivrées par les officiers de ces magasins que le directoire arrête, le 4 octobre, « que les nommés Julien Briendo, François Le Ninan, Jacques Le Douarin, Joachim Jacob, François Le Doublique, Pierre Le Boucher, Vincent Guillais, Joseph Lamour, Jean Thomas, Mathurin Le Déo, Guillaume Ribouchon. Joseph Gillet, Vincent Mainguy, détenus à Vannes ; que Jean-Marie Tual, Yves Le Beot, Pierre Berto, Yves Ribouchon, Joachim Alix, Joseph Le Bries, Joseph Morice et François Le Gal, détenus au Port-Liberté (Port-Louis), at ayant justifié n'être pas dans la réquisition, seront mis en liberté provisoire… laquelle délivrance se fera en présence de Joseph Botherel de Grand-Champ qui garantira l'identité des personnes réclamées » [Note : Arch. départ. (district d'Hennebont. N. 945)].
Quelques-uns n'obtinrent leur libération que dans la suite. D'autres n'attendirent pas l'arrêté du directoire pour aller respirer le grand air. Ils durent leur prompte délivrance au dévouement de certaines femmes qui jouèrent dans ces douloureuses circonstances, un rôle assez chevaleresque. A en croire la tradition, la consigne autorisait la libre entrée pour celles qui manifestaient le désir d'entretenir les prisonniers. Profitant de l'occasion, elles se munissent d'habits de leur sexe. Les détenus s'en revêtent et, à l'aide de ce déguisement, trompent la surveillance du poste. Certains gardes d'ailleurs, par ordre ou par pure bienveillance, fermaient les yeux sur cette ruse féminine ; et, lorsqu'un fugitif, novice en ce costume, avait le pantalon trop bas, ils l'avertissaient charitablement de le relever.
Parmi les hommes de Brandivy qui échappèrent à la captivité, on cite Joseph Le Mentec, de Plunian. Après divers efforts infructueux, il s'amarre solidement à une corde et monte sur un vaisseau anglais qui le débarque aux environs de Concarneau. A peine ses pieds touchent-ils la terre qu'il reprend, à travers champs, le chemin de son village où il arrive enfin, Dieu sait au prix de quelles misères, les habits en lambeaux, les traits méconnaissables.
Un autre paysan qui eut le même bonheur déclarait plus tard marcher à Quiberon sur l’or et sur l'argent. Comme on le plaisantait de s'être oublié jusqu'à n'avoir pas empoché un seul Louis d'or : « Saperdienne, répondait-il, j'y songeais à ma vie et pas à autre chose ! ».
Deux chouans de Brandivy méritent entre tous une mention spéciale : François Le Boulair, dont nous ne dirons mot maintenant parce que nous le retrouverons sous l’Empire avec le grade de capitaine, et Joseph Botherel, ci-dessus désigné.
Joseph Botherel faisait ses études au collège de Vannes au moment de la Révolution. Né le 24 septembre 1769 au village de Kermeliard en Brandivy, il avait 25 ans révolus lorsque comment, sous l'impulsion de son condisciple Georges Cadoudal, la grande chouannerie dont il fut un des plus ardents auxiliaires. Une grave maladie le retenait dans son village natal lors des événements de Quiberon, mais dès les premiers jours de sa convalescence il rejoignait à Keramené, en Moustoir-ac, le corps de Rohu. C'était une des fortes têtes du parti, et nul, mieux que lui, ne s'entendait à refaire une caisse, comme on le verra tout à l'heure.
La caisse était fréquemment à sec, et l'argent étant le nerf de la guerre, cette pénurie causait de grands soucis aux royalistes. Mais leur embarras était de courte durée, grâce à la bonne volonté vraiment inépuisable des campagnes. En même temps, en effet, qu'il donnait ses fils à l'insurrection, le peuple la soutenait encore vigoureusement de sa bourse. On sait que c'est au système des bons, payables quand il y aurait de l'argent, que recouraient, dans leur détresse, les chefs de l'armée catholique. Comme ceux-ci étaient d'une prohité reconnue, les paysans consentaient volontiers, sur une simple reconnaissance, à se dessaisir de leurs économies en faveur de la cause commune [Note : Les chefs ont toujours fait honneur à leurs signatures, sauf dans les dernières années de la grande Révolution : certains billets souscrits à cette époque attendent encore d’être remboursés (Note de M. Le Bihan, recteur de Pluneret)].
Nos paysans prêtaient de l'argent aux royalistes et refusaient tout argent à la République, sans se laisser abattre par aucune vexation.
Ils refusaient. d'abord les contributions. Peut-on les en blâmer ? Une bande de pillards et d'égorgeurs s'était abattue sur la France comme sur un pays conquis. Que devaient les bons citoyens à ces gens-là ? Rien. On ne doit rien aux bêtes féroces. Il est vrai que les bêtes féroces se vengeaient de ces résistances par des exploits affreux dont la tradition a conservé le souvenir. Le seul cri Enn Nation [Note : C’est-à-dire les nationaux] disperse le village. Les maisons restées vides deviennent la proie d'agents qu'aucun scrupule n'arrête. Bestiaux, charrette, mobilier, provisions.... tout prend le chemin de Vannes ; et, pour rentrer en possession de ce qu'on lui a dérobé, le propriétaire doit d'abord verser ses denrées réquisitionnées, payer ses contributions et, par-dessus le marché, subir mille tracasseries indignes, heureux encore d'en être quitte à ce prix.
Si récalcitrants au sujet des contributions, ils ne l'étaient pas moins en tout ce qui touchait à la régie des domaines nationaux. Les religieux et les nobles en effet, pour être proscrits, cessaient-ils d'être propriétaires ? Les décrets qui avaient mis leurs biens en vente étaient manifestement frappés de nullité, et les redevances des domaines prétendus nationaux appartenaient aux propriétaires au même titre que par le passé. Comment supposer dès lors que ces paysans qui refusaient les impôts à la République lui auraient de bon gré soldé les rentes de leurs tenues ? Jusqu'en l'an VII, je trouve un cultivateur contraint, par voie d'huissier, de se soumettre. Comme d'un autre coté, les tenanciers se trouvaient dans l'impossibilité de faire tenir à qui de droit ces redevances, les chefs de l’armée royale tranchèrent la question en décidant de les employer à la défense du parti.
C'est Joseph Botherel qui en inspira l'idée ou du moins qui s'occupa, dans une bonne mesure, de la mettre à exécution.
Il s'avise donc, avec Isan Baudet, de Pluneret, de soliiciter des tenanciers les rentes échues qui ne peuvent parvenir aux légitimes propriétaires. Tous deux vont de paroisse en paroisse, de village en village, ne reculant, pour remplir la mission qu’ils se sont imposée, devant aucun danger. Ils osent même s’aventurer jusqu’aux portes de Lorient, sans aucun souci des patriotes qui administrent la cité. Surpris dans la sommune de Quéven, ils se réfugient dans une maison que les républicans cernent aussitôt. Après de minutieuses recherches, on les découvre cachés à l’entrée d’une cheminée. Ils sont descendus, dirigés sur Lorient et guillotinés [Note : Note de M. Le Bihan, ancien recteur de Pluneret. Il les dit guillotinés. Je les croirais plutôt fusillés sur le chemin. La tradition toutefois n’admet pas ce tragique dénouement, du moins en ce qui concerne Joseph Botherel. On le disait échappé au malheureux sort des chefs de la chouanneris, parti pour l’Angleterre où il avait réalisé une fortune immense, avec une succession toujours ouverte, faute d’héritiers. La nouvelle nous arriva de Reims en 1875. Une lettre écrite en anglais l’annonca à un brave homme de Brandivy, petit-neveu par sa mère de Joseph Botherel, L’auteur de la lettre qui gardait l’anonyme promettait, généreusement son appui, moyennant le déboursé préalable d’une somme assez ronde nécessaire pour couvrir les premiers frais, Malgré cette condition, il y avait, on en conviendra, de quoi griser les gens. Les têtes montèrent en effet et sans compter un vicomte Botherel, trente famille se réclamèrent en peu de jours de la parenté du millionnaire. Cette perspective dorée a poussé les héritiers à toutes les démarches imaginables. Aujourd’hui le calme paraît s’être fait dans les esprits et l’on a eu raison de renoncer à ces belles espérances, puisque le prétendu fugitif et millionnaire a tout simplemente été tué par les bleus, vers la fin de 1795 ou dans les premiers mois de 1796].
En offrant à la résistance des hommes et des subsides, le peuple lui fournissait encore des munitions. C’est une grave affaire que celle des munitions et il suffit qu’un parti en manque pour courir à une ruine certaine. Afin déviter ce malheur, les royalistes en faisaient fabriquer sur différents point. Nul manoir n’avait peut-être, pour ce genre de travaux, une situation plus favorable que celui de la Grandville. Aussi Cadoudal y mit-il de bonne heure une fabrique de cartouches, en même temps qu’il en faisait le quartier général de ses opérations [Note : Arch. de la Grandville].
Les républicains finirent par avoir connaissance des complots qui se tramaient à l’ombre du vieux castel. Ils le prennent un jour, en livrent les archives aux flammes [Note : Archiv. de la Grandville], et y installent une garnison. Cette dernière assertion peut se prouver par un passage des mémoires de Rohu, qui signale, en 1796, une colonne mobile dite de la Grandville. chargée d'opérer aux alentours, cette colonne surprit Cadoudal dans cette vaste lande qui s'étend au nord du village de Ménétavid, sur le chemin de Brandivy à Plumergat. Cadoudal, le chapeau orné d'une cocarde et d'un panache blancs, revenait de Plœren où il avait dispersé trois cents marins, et se rendait à Pluvigner pour y chercher des cartouches. A la vue de l'ennemi, il lance en avant son manteau et commande l'attaque. Ce n'est pas l'ardeur qui manque à ses hommes, ce sont les munitions : il faut reculer. Moins heureux que Condé qui reconquit sa canne, Cadoudal perd son manteau. Les bleus l'emportent à Auray, tout glorieux du trophée qu'ils ont réussi à enlever [Note : Mémoires de Rohu. — Hist. de Cadoudal].
III.
PROCLAMATION DU GÉNÉRAL LEMOINE.
L'exécution de Joseph Botherel et les exploits de Cadoudal font voir en pleine insurrection, dès les premiers mois de 1796, le département du Morbihan. Les républicains l'avaient cru terrassé, tout au moins découragé par le désastre de Quiberon. Ce qui les confirmait dans cette manière de voir, c'est que nos gens leur avaient, sans trop de difficultés, livré une certaine quantité d'armes. A ce sujet, il faut convenir qu'ils avaient le contentement facile. Pour quelques mauvais fusils déposées aux ateliers nationaux, en septembre et octobre 1795, par les municipaux, voilà le directoire de Vannes, pris d’émotion, qui se hâte de leur distribuer des certificats de bonne conduite : aux municipaux de Plescob qui ont déposé sept mauvais fusils ; à ceux de Meucon qui n’en ont déposé aucun, parce qu’ils n’ont rien trouvé ; à ceux de Grand-Champ qui ont déposé treize mauvais fusils ; à ceux de Sarzeau qui ont déposé once mauvais fusills ; à ceux de Plaudren qui ont déposé cinq mauvais fusils ; à ceux de Surzur qui ont déposé cinq mauvais fusil ; à ceux d’Ambon, pour trois mauvais fusil ; à ceux de la Trinité, pour une carabine, la seule arme qu’ils aient pu se procurer..... Notez que c'est le directoire lui-même qui donne à ces fusils la qualification de mauvais.
Le réveil fut terrible. Pour avoir une idée des sentiments féroces qu'inspirait aux républicains la nouvelle prise d'armes, il faut lire la proclamation du général Lemoine adressée en breton et en français aux habitants du Morbihan [Note : Trouvée dans les titres de Brandivy]. L'entête porte : Liberté, Egalité ; fraternité n'y est pas pour une bonne raison. La date est du 7 pluviose (27 janvier 1796), quatrième année républicaine :
« Il est enfin arrivé l'instant où la guerre qui désole ces contrées doit finir : des mesures sévères sont prises pour la terminer.
Je ne vous parlerai point de pacification ni de capitulation. Le gouvernement veut la destruction totale des chouans et la paix. Chargé dans ce département de l’exécution dernière de ses volontés, je crois devoir vous prévenir des maux affreux qui vous menacent si vous ne vous hâtez de répondre à ses vues.
Que ceux d'entre vous qui ne sont qu'égarés soient sans inquiétude. Ils trouveront dans les républicains des amis et des protecteurs. Malheureux habitants des campagnes, rentrez dans vos chamniéres : livrez-vous à vos travaux champêtres, restez au millieu de vos familles pour les consoler ; obéissez aux sommations qui vont vous être faites ; vos personnes et vos propriétés seront respectées.
Depuis la Révolution, vous vous êtes montrés rebelles à la voix de la patrie ; vous vous êtes armés pour l'assassiner lorsqu'elle vous tendait les bras ; vous avez répondu aux voies douces et paternelles qui ont êté employées par des massacres ou des pillages. Aujourd'hui, pour mettre le comble votre rébellion, vous empêchez l’approvisionnement des villes, vous couper les ponts et refusez de payer vos contributions. Tant de forfaits vont enfin recevoir leur prix. Il est un Dieu vengeur qui poursuit les coupables et les atteint jusque dans leurs repaires les plus cachés.
Vous ne trouverez plus d'appui dans les villes, elles sont toutes déclarées en état de siège ; vous serez gouvernés militairement jusqu'à ce que vous soyez soumis aux lois de la République. Songez donc que de vous-mêmes dépend votre bonheur et que votre conduite réglera la mienne.
Cette mesure ne doit point effrayer les bons citoyens : elle doit au contraire remonter leur énergie et les faire réunir à l'armée pour coopérer au rétablissement de l'ordre.
Et vous, administrateurs du département qui m'êtes particulièrement connus, je ne cesserai de me concerter avec vous. Vos principes et votre amour pour la chose publique sont de sûrs garants du succès de mes opérations. L. LEMOINE ».
La pièce
originale porte en regard la traduction bretonne : je la place
à la suite, pour plus de commodité :
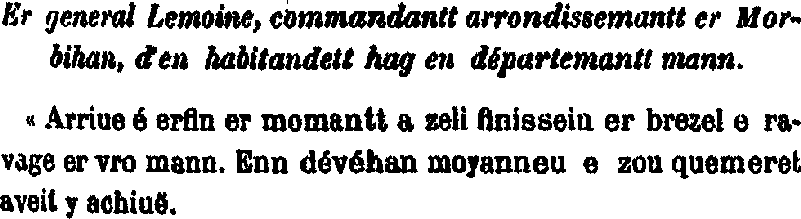
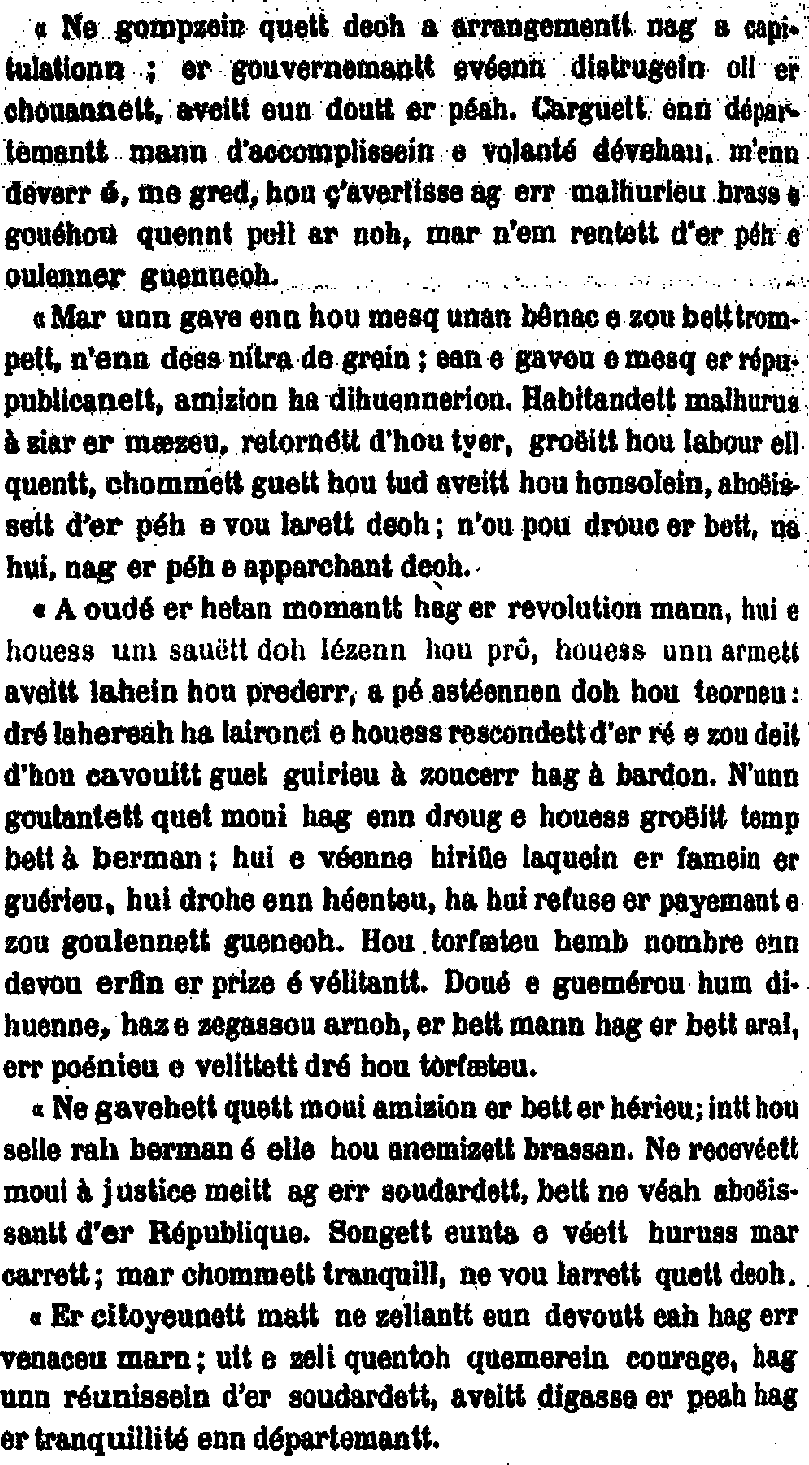
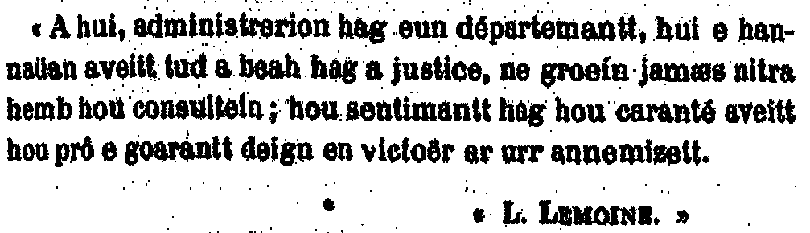
Mon brave général, si vous aviez eu la hardiesse de libeller un manifeste ainsi concu : « Paix aux catholiques, guerre aux terroristes » vous eussiez plus contribué par ces deux mots à la pacification du département que par toutes ces phrases creuses qui ne touchaient point l'âme. Comment pouviez-vous espérer de ramener le calme au sein du peuple, alors que vous ne preniez aucune mesure efficace pour dissiper ses craintes et assurer ses droits ? Aussi le manifeste demeura sans résultat et la guerre ne cessa de désoler le Morbihan jusqu'au mois de juin, où Cadoudal et Hoche, lassés de tant de carnages, jetèrent enfin les bases d'un traité de paix.
(Abbé Guilloux).
© Copyright - Tous droits réservés.