|
Bienvenue chez les Pocéens |
POCE-LES-BOIS |
Retour page d'accueil Retour Canton de Vitré
La commune
de Pocé-les-Bois ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de POCE-LES-BOIS
Pocé-les-Bois vient, semble-t-il, du gallo-romain « Cé ».
La paroisse de Pocé existait certainement au XIIème siècle et remonte vraisemblablement au XIème siècle ; dès 1152 les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-Melaine de Rennes en étaient les maîtres et ils y avaient fondé un prieuré réuni en 1411 à leur mense abbatiale.

Le recteur de Pocé (Pocé-les-Bois), présenté jusqu'en 1770 par l'abbé de Saint-Melaine, jouissait de la moitié de toutes les dîmes de sa paroisse. Il avait, en outre, le presbytère et son pourpris, composé d'un jardin, d'un champ et de deux prés. M. Rouxel déclara en 1790 que sa cure valait 1 800 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine - Pouillé de Rennes). La paroisse de Pocé-les-Bois dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes.
On rencontre les appellations suivantes : ecclesia de Poceio (en 1158), Poceyum (en 1516).
Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Pocé-les-Bois : Sylvestre Chohan (vers 1530), Jean de la Motte (en 1538), Jacques Mazure (avant 1588), Guillaume Moreau (avant 1592), Joachim Perrot (en 1595), Julien Jeulland (1609-1638), Jean Couaiscault (en 1638), François Morel (vers 1644 et jusqu'en 1672), Jean-Baptiste Méhaignerye (en 1672), Julien Fournier (1679-1697), Jean-François Fournier (en 1697), Alexandre Le Goffry (1697-1725), Jacques Le Coq (1725-1739), François Morin (1739-1748), Pierre-Marie Chauvière (1748-1762), Georges Saudrais (1762-1783), Julien Rouxel (1783-1789 puis 1803-1820), Pierre-Maurice du Rocher (1820-1824), Toussaint-Pierre Guyard (1824-1835), Charles Hardy (1835-1863), Pierre Julliot (à partir de 1863), ....
Voir
![]() "
Cahier
de doléances de Pocé (aujourd'hui Pocé-les-Bois) en 1789
".
"
Cahier
de doléances de Pocé (aujourd'hui Pocé-les-Bois) en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de POCE-LES-BOIS
![]() l'église
Notre-Dame (1890-1903), construite par Arthur Regnault. La Nativité de
Notre-Dame est la fête patronale de Pocé-les-Bois. L'ancienne église, en
partie fort ancienne, se composait d'une nef et d'un choeur à chevet droit,
séparés l'un de l'autre par un arc triomphal en ogive. La nef n'avait
point de style et semblait des XVIème et XVIIème siècles, mais le choeur
était roman et mérite d'être signalé : il était éclairé à l'origine
par d'étroites meurtrières, dont une subsistait encore au Nord ; son
chevet, soutenu extérieurement par trois contreforts plats, devait aussi
avoir deux meurtrières qui ne paraissaient plus. Ce choeur pouvait remonter
au XIème siècle, et par suite aux origines mêmes de la paroisse. Au haut
de la nef, et de chaque côté de l'arc triomphal, étaient deux petits
autels dédiés à la Sainte Vierge et à saint Etienne. On voit que c'est
encore le plan complet d'une église du moyen-âge. A l'extérieur apparaissaient
les vestiges d'une litre, probablement celle des seigneurs de Gazon. Ces
derniers, en effet, se disaient fondateurs de l'église de Pocé-les-Bois et
y prétendaient « aux droits d'enfeu prohibitif, bancs à accoudoir,
ceintures et écussons tant par dehors que par dedans, et armoiries en
toutes les vitres » (E. Frain, Une Terre, 115). La confrérie du
Rosaire, fondée de quelques rentes, fut érigée en cette église en 1702
par Julien Huet, prieur des Dominicains de Vitré. On y voyait aussi la
fondation de la Cour-Béniste, consistant en une messe matinale tous les dimanches,
fondée en 1629 par André Mazure et valant en 1790 environ 100 livres ; —
et la fondation du pain bénit, faite en 1596 par Julienne Le Cocq, dame de
la Gaulairie (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur de l'église actuelle
datent de 1890-1903. Cette nouvelle église est construite grâce à l’influence
de la famille du Pontavice, propriétaire du château du Bois-Bide. Le
maître-autel en bois, oeuvre de l'atelier Piette, date de 1922. L’autel
en pierre blanche, oeuvre du sculpteur Cottard, date de 1899. La
statue du "Christ en croix" date du XIVème siècle ;
l'église
Notre-Dame (1890-1903), construite par Arthur Regnault. La Nativité de
Notre-Dame est la fête patronale de Pocé-les-Bois. L'ancienne église, en
partie fort ancienne, se composait d'une nef et d'un choeur à chevet droit,
séparés l'un de l'autre par un arc triomphal en ogive. La nef n'avait
point de style et semblait des XVIème et XVIIème siècles, mais le choeur
était roman et mérite d'être signalé : il était éclairé à l'origine
par d'étroites meurtrières, dont une subsistait encore au Nord ; son
chevet, soutenu extérieurement par trois contreforts plats, devait aussi
avoir deux meurtrières qui ne paraissaient plus. Ce choeur pouvait remonter
au XIème siècle, et par suite aux origines mêmes de la paroisse. Au haut
de la nef, et de chaque côté de l'arc triomphal, étaient deux petits
autels dédiés à la Sainte Vierge et à saint Etienne. On voit que c'est
encore le plan complet d'une église du moyen-âge. A l'extérieur apparaissaient
les vestiges d'une litre, probablement celle des seigneurs de Gazon. Ces
derniers, en effet, se disaient fondateurs de l'église de Pocé-les-Bois et
y prétendaient « aux droits d'enfeu prohibitif, bancs à accoudoir,
ceintures et écussons tant par dehors que par dedans, et armoiries en
toutes les vitres » (E. Frain, Une Terre, 115). La confrérie du
Rosaire, fondée de quelques rentes, fut érigée en cette église en 1702
par Julien Huet, prieur des Dominicains de Vitré. On y voyait aussi la
fondation de la Cour-Béniste, consistant en une messe matinale tous les dimanches,
fondée en 1629 par André Mazure et valant en 1790 environ 100 livres ; —
et la fondation du pain bénit, faite en 1596 par Julienne Le Cocq, dame de
la Gaulairie (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur de l'église actuelle
datent de 1890-1903. Cette nouvelle église est construite grâce à l’influence
de la famille du Pontavice, propriétaire du château du Bois-Bide. Le
maître-autel en bois, oeuvre de l'atelier Piette, date de 1922. L’autel
en pierre blanche, oeuvre du sculpteur Cottard, date de 1899. La
statue du "Christ en croix" date du XIVème siècle ;

![]() l'ancien
prieuré de Pocé, aujourd'hui disparu. Alain et Etienne, évêques de
Rennes, en 1152 et 1170, Josse, archevêque de Tours, en 1158, et le pape
Luce III en 1185, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes dans la
possession de l'église de Pocé-les-Bois, « ecclesiam de Poceio »,
ce que fit également le Chapitre de Rennes en 1213. Dès 1157, les moines
de ce monastère jouissaient, en effet, d'une partie de Pocé-les-Bois,
comme le prouve l'acte de fondation du prieuré de Notre-Dame de Vitré,
auquel fut uni tout ce qu'ils avaient en Pocé-les-Bois. En 1300, un nommé
Regnauld donna encore des dîmes en Pocé-les-Bois à l'abbé de
Saint-Melaine, parce que son petit-fils s'était fait religieux dans son
monastère. En 1679, la présentation de la cure de Pocé-les-Bois
appartenait toujours à l'abbaye de Saint-Melaine, qui se disait aussi en
droit d'y lever les dîmes grosses et menues, à la douzième gerbe. Vers le
même temps, Gilles Pichon signait « chapelain du prieuré de Pocé »,
probablement parce qu'il desservait les messes dues par les religieux en
cette paroisse. On voyait encore à la fin du XIXème siècle, dans le
bourg, un petit sanctuaire qui avait remplacé l'ancienne chapelle priorale
de Pocé (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 129 - Dom Morice, Preuves de
l'Histoire de Bretagne, I, 630 - Pouillé de Rennes) ;
l'ancien
prieuré de Pocé, aujourd'hui disparu. Alain et Etienne, évêques de
Rennes, en 1152 et 1170, Josse, archevêque de Tours, en 1158, et le pape
Luce III en 1185, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes dans la
possession de l'église de Pocé-les-Bois, « ecclesiam de Poceio »,
ce que fit également le Chapitre de Rennes en 1213. Dès 1157, les moines
de ce monastère jouissaient, en effet, d'une partie de Pocé-les-Bois,
comme le prouve l'acte de fondation du prieuré de Notre-Dame de Vitré,
auquel fut uni tout ce qu'ils avaient en Pocé-les-Bois. En 1300, un nommé
Regnauld donna encore des dîmes en Pocé-les-Bois à l'abbé de
Saint-Melaine, parce que son petit-fils s'était fait religieux dans son
monastère. En 1679, la présentation de la cure de Pocé-les-Bois
appartenait toujours à l'abbaye de Saint-Melaine, qui se disait aussi en
droit d'y lever les dîmes grosses et menues, à la douzième gerbe. Vers le
même temps, Gilles Pichon signait « chapelain du prieuré de Pocé »,
probablement parce qu'il desservait les messes dues par les religieux en
cette paroisse. On voyait encore à la fin du XIXème siècle, dans le
bourg, un petit sanctuaire qui avait remplacé l'ancienne chapelle priorale
de Pocé (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 129 - Dom Morice, Preuves de
l'Histoire de Bretagne, I, 630 - Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancienne
église Notre-Dame-de-la-Nativité (XI-XIIème siècle). Le chœur et la nef
dataient du XVI-XVIIème siècle. Les seigneurs de Gazon et ceux de la
Rouxière avaient un droit d’enfeu dans l’église ;
l'ancienne
église Notre-Dame-de-la-Nativité (XI-XIIème siècle). Le chœur et la nef
dataient du XVI-XVIIème siècle. Les seigneurs de Gazon et ceux de la
Rouxière avaient un droit d’enfeu dans l’église ;
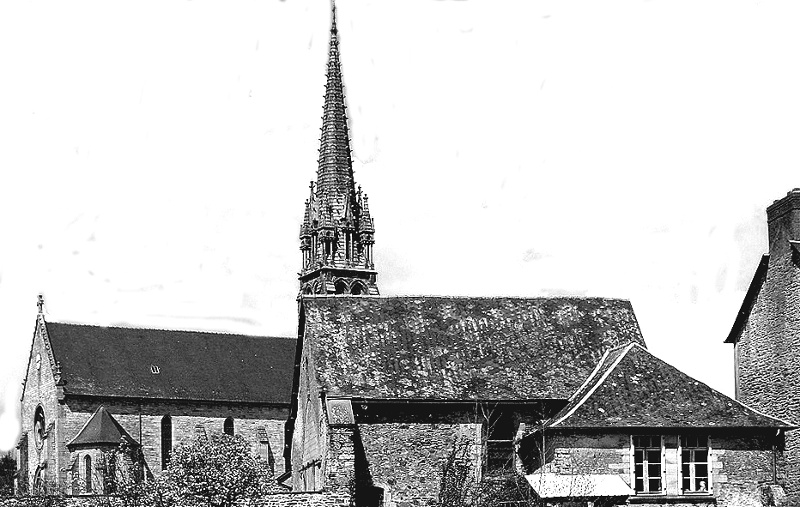
![]() la
chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1843). Cette chapelle, sise à l'entrée du
bourg, sur une éminence, a remplacé la précédente.
Elle a été bâtie en 1843 par la famille du Bourg et continue d'être
entretenue. Elle a été édifiée pour remplacer une
ancienne chapelle dédiée à Saint-Michel et dépendant du prieuré de la
Cour-Bénite. La Cour-Bénite était habitée par quelques chanoines
détachés de la Collégiale de Champeaux. L’autel et le retable, oeuvre
des sculpteurs Jean et Michel Langlois, datent de 1659 ;
la
chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1843). Cette chapelle, sise à l'entrée du
bourg, sur une éminence, a remplacé la précédente.
Elle a été bâtie en 1843 par la famille du Bourg et continue d'être
entretenue. Elle a été édifiée pour remplacer une
ancienne chapelle dédiée à Saint-Michel et dépendant du prieuré de la
Cour-Bénite. La Cour-Bénite était habitée par quelques chanoines
détachés de la Collégiale de Champeaux. L’autel et le retable, oeuvre
des sculpteurs Jean et Michel Langlois, datent de 1659 ;
![]() le
calvaire de la chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1904). Il s'agit d'une
oeuvre du sculpteur Donnard de Landerneau ;
le
calvaire de la chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1904). Il s'agit d'une
oeuvre du sculpteur Donnard de Landerneau ;
![]() le
château du Bois-Bide (1883-1930), reconstruit par la famille du Pontavice.
On y trouvait autrefois une chapelle privative qui datait du XVIIème
siècle, un cadran solaire, et un colombier du XVIIème siècle. La chapelle
Notre-Dame du Bois-Bide fut construite au XVIIème siècle. La cloche en fut
bénite le 6 septembre 1684. Par testament du 7 janvier 1739, Charles
Picquet, seigneur de Montreuil et greffier en chef au Parlement de Bretagne,
fonda une messe en cette chapelle, lui appartenant, pour tous les dimanches
et fêtes chômées, et aux fêtes de sainte Anne, sainte Barbe, sainte
Appolline, saint Lunaire, saint François d'Assise et saint Charles. Après
la mort de ce seigneur, Françoise Onfroy, sa veuve, régularisa cette
fondation et la dota de 100 livres de rente le 28 octobre 1742. L'année
suivante, René Jarnouen, sieur de Villartay, fut pourvu de cette
chapellenie (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43 - Pouillé
de Rennes). L’orangerie date de 1744. On y trouve aussi une ancienne croix : la croix Noblet.
Le château est restauré en 1998-1999. Propriété successive des familles
l'Espinay, seigneurs de la Rivière (en 1458), Lambaré, seigneurs de la
Pageotière (au début du XVIIème siècle), Bigot, seigneurs de
Montlevrier, le Clavier (en 1645), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1711),
le Moyne (en 1756), du Bourg (vers 1782), du Pontavice (au XIXème siècle) ;
le
château du Bois-Bide (1883-1930), reconstruit par la famille du Pontavice.
On y trouvait autrefois une chapelle privative qui datait du XVIIème
siècle, un cadran solaire, et un colombier du XVIIème siècle. La chapelle
Notre-Dame du Bois-Bide fut construite au XVIIème siècle. La cloche en fut
bénite le 6 septembre 1684. Par testament du 7 janvier 1739, Charles
Picquet, seigneur de Montreuil et greffier en chef au Parlement de Bretagne,
fonda une messe en cette chapelle, lui appartenant, pour tous les dimanches
et fêtes chômées, et aux fêtes de sainte Anne, sainte Barbe, sainte
Appolline, saint Lunaire, saint François d'Assise et saint Charles. Après
la mort de ce seigneur, Françoise Onfroy, sa veuve, régularisa cette
fondation et la dota de 100 livres de rente le 28 octobre 1742. L'année
suivante, René Jarnouen, sieur de Villartay, fut pourvu de cette
chapellenie (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43 - Pouillé
de Rennes). L’orangerie date de 1744. On y trouve aussi une ancienne croix : la croix Noblet.
Le château est restauré en 1998-1999. Propriété successive des familles
l'Espinay, seigneurs de la Rivière (en 1458), Lambaré, seigneurs de la
Pageotière (au début du XVIIème siècle), Bigot, seigneurs de
Montlevrier, le Clavier (en 1645), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1711),
le Moyne (en 1756), du Bourg (vers 1782), du Pontavice (au XIXème siècle) ;

![]() 6 moulins
à eau dont celui de la Courbe, de la Rouxière, des Piles, de Malipasse, de Bressac ;
6 moulins
à eau dont celui de la Courbe, de la Rouxière, des Piles, de Malipasse, de Bressac ;
A signaler aussi :
![]() le
menhir de Le Gué-de-Prunelle (époque néolithique) ;
le
menhir de Le Gué-de-Prunelle (époque néolithique) ;
![]() la
découverte vers 1880 à l'Angelerie de quelques hachettes en bronze ;
la
découverte vers 1880 à l'Angelerie de quelques hachettes en bronze ;
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Gorgon est une ancienne chapelle frairienne. Elle est
mentionnée en 1702, à propos de huit messes qui y furent alors fondées.
l'ancienne
chapelle Saint-Gorgon est une ancienne chapelle frairienne. Elle est
mentionnée en 1702, à propos de huit messes qui y furent alors fondées.
![]() l'ancien
manoir du Plantis. Propriété successive des familles Busson (en 1427 et
1513), Onfroy et Picquet (en 1747) ;
l'ancien
manoir du Plantis. Propriété successive des familles Busson (en 1427 et
1513), Onfroy et Picquet (en 1747) ;
![]() l'ancien
manoir du Châlet. Propriété successive des familles Rabaut (en 1427),
Julienne (avant 1553), Faruel (en 1553), le Clavier (à la fin du XVIème
siècle), Mazurais (en 1616), le Fort (en 1650), Gardin, seigneurs de Méniboeuf (en 1789) ;
l'ancien
manoir du Châlet. Propriété successive des familles Rabaut (en 1427),
Julienne (avant 1553), Faruel (en 1553), le Clavier (à la fin du XVIème
siècle), Mazurais (en 1616), le Fort (en 1650), Gardin, seigneurs de Méniboeuf (en 1789) ;
![]() l'ancien
manoir du Mesnil. Propriété successive des familles Coësmes (en 1513), le
Roy, seigneurs du Plessis-Raffray (en 1527), Billeu (en 1688), Seré (en 1695) ;
l'ancien
manoir du Mesnil. Propriété successive des familles Coësmes (en 1513), le
Roy, seigneurs du Plessis-Raffray (en 1527), Billeu (en 1688), Seré (en 1695) ;
![]() l'ancien
manoir de Champ-Rousse ou du Champ-Raoul. Propriété de la famille Busson,
seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513. Il est uni à la seigneurie de Gazon ;
l'ancien
manoir de Champ-Rousse ou du Champ-Raoul. Propriété de la famille Busson,
seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513. Il est uni à la seigneurie de Gazon ;
![]() l'ancien
manoir du Teilleul. Propriété successive des familles Acigné, seigneurs
de Forges (en 1432), Busson, seigneurs de Gazon (en 1475 et 1513). Il est
uni à la seigneurie de Gazon ;
l'ancien
manoir du Teilleul. Propriété successive des familles Acigné, seigneurs
de Forges (en 1432), Busson, seigneurs de Gazon (en 1475 et 1513). Il est
uni à la seigneurie de Gazon ;
![]() l'ancien
manoir de Gazon. Il possédait jadis une chapelle privative et un droit de haute
justice. La chapelle Notre-Dame de Gazon, voisine de ce manoir, possédé
pendant des siècles par la famille Busson, existait au XVIIème siècle ;
mais elle fut restaurée et bénite de nouveau le 10 octobre 1753.
Reconstruite entièrement plus tard, elle reçut une nouvelle bénédiction
le 26 avril 1786 et fut alors dédiée à la Sainte Vierge. Propriété successive des familles Busson (en 1380), Beaumanoir
(vers 1527), Matz, seigneurs de Terchampt (vers 1610), Grimaudet, seigneurs
de la Lande (en 1650), Huchet, seigneurs de Cintré (en 1763), Provost ;
l'ancien
manoir de Gazon. Il possédait jadis une chapelle privative et un droit de haute
justice. La chapelle Notre-Dame de Gazon, voisine de ce manoir, possédé
pendant des siècles par la famille Busson, existait au XVIIème siècle ;
mais elle fut restaurée et bénite de nouveau le 10 octobre 1753.
Reconstruite entièrement plus tard, elle reçut une nouvelle bénédiction
le 26 avril 1786 et fut alors dédiée à la Sainte Vierge. Propriété successive des familles Busson (en 1380), Beaumanoir
(vers 1527), Matz, seigneurs de Terchampt (vers 1610), Grimaudet, seigneurs
de la Lande (en 1650), Huchet, seigneurs de Cintré (en 1763), Provost ;
![]() le
manoir de la Gaulairie. Il possédait une chapelle privative. La chapelle de
la Gaulairie, également ancienne et dépendant du manoir de ce nom, avait
été restaurée en 1880. Propriété
successive des familles Tirel (en 1512), Gennes (vers 1569), Frain,
seigneurs de la Motte (en 1742) ;
le
manoir de la Gaulairie. Il possédait une chapelle privative. La chapelle de
la Gaulairie, également ancienne et dépendant du manoir de ce nom, avait
été restaurée en 1880. Propriété
successive des familles Tirel (en 1512), Gennes (vers 1569), Frain,
seigneurs de la Motte (en 1742) ;
![]() l'ancien
manoir du Bois-Jean. Propriété successive des familles Doguet (en 1513),
Ravenel (en 1610), le Moyne, sieurs de la Rebourcière (en 1628) ;
l'ancien
manoir du Bois-Jean. Propriété successive des familles Doguet (en 1513),
Ravenel (en 1610), le Moyne, sieurs de la Rebourcière (en 1628) ;
![]() l'ancien
manoir de la Troussanaye. Propriété successive des familles Lignières (en
1513), Quengo (en 1553), Ringues (en 1595), Laval, sieurs de la Touche (en
1657), Ravenel (vers 1665 et 1740) ;
l'ancien
manoir de la Troussanaye. Propriété successive des familles Lignières (en
1513), Quengo (en 1553), Ringues (en 1595), Laval, sieurs de la Touche (en
1657), Ravenel (vers 1665 et 1740) ;
![]() l'ancien
manoir de la Touche. Propriété de la famille Busson, seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Touche. Propriété de la famille Busson, seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Rouxière. Il possédait une chapelle privative surnommée la
chapelle de la Rouxière ou des Mauviettes, restaurée vers 1840. Saint-Jean
de la Rouxière, appelé vulgairement Saint-Jean des Mauviettes et parfois
aussi Saint-Michel, était un ancien sanctuaire. En 1534, le roi François
Ier fit appeler devant son conseil l'alloué et les officiers de la cour de
Vitré, qui avaient arrêté dans cette chapelle Guillaume Samson, dom
Julien Villange, dom Geffroy Ernaud et dom Louis Bourges, ces trois derniers
prêtres, et les en avaient « arrachés de force, traisnés et conduits
en prison, sans égard aux immunités, franchise, sauvegarde et asile des
lieux saints » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 G, 2)
— Cette chapelle avait été restaurée vers 1840 et l'on s'y rendait en pèlerinage. Le domaine avait un
droit de haute justice. Il était uni au Bois-Bide. Propriété successive
des familles Domaigné (en 1427 et 1513), la Charonnière (en 1541),
Bégassoux (vers 1616), Lefebvre, seigneurs de Laubrière (vers 1680),
Picquet, seigneurs de la Motte (en 1710 et 1739), le Moyne, sieurs du Bois-Bide (en 1764) ;
l'ancien
manoir de la Rouxière. Il possédait une chapelle privative surnommée la
chapelle de la Rouxière ou des Mauviettes, restaurée vers 1840. Saint-Jean
de la Rouxière, appelé vulgairement Saint-Jean des Mauviettes et parfois
aussi Saint-Michel, était un ancien sanctuaire. En 1534, le roi François
Ier fit appeler devant son conseil l'alloué et les officiers de la cour de
Vitré, qui avaient arrêté dans cette chapelle Guillaume Samson, dom
Julien Villange, dom Geffroy Ernaud et dom Louis Bourges, ces trois derniers
prêtres, et les en avaient « arrachés de force, traisnés et conduits
en prison, sans égard aux immunités, franchise, sauvegarde et asile des
lieux saints » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 G, 2)
— Cette chapelle avait été restaurée vers 1840 et l'on s'y rendait en pèlerinage. Le domaine avait un
droit de haute justice. Il était uni au Bois-Bide. Propriété successive
des familles Domaigné (en 1427 et 1513), la Charonnière (en 1541),
Bégassoux (vers 1616), Lefebvre, seigneurs de Laubrière (vers 1680),
Picquet, seigneurs de la Motte (en 1710 et 1739), le Moyne, sieurs du Bois-Bide (en 1764) ;
![]() l'ancien
manoir de la Courbe. Propriété successive des familles l'Espinay,
seigneurs de la Rivière (en 1513), Lambaré, seigneurs de la Pageotière
(en 1611), le Bigot, seigneurs de Montlevrier (vers 1627), le Clavier,
seigneurs du Bois-Bide (vers 1657), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1747) ;
l'ancien
manoir de la Courbe. Propriété successive des familles l'Espinay,
seigneurs de la Rivière (en 1513), Lambaré, seigneurs de la Pageotière
(en 1611), le Bigot, seigneurs de Montlevrier (vers 1627), le Clavier,
seigneurs du Bois-Bide (vers 1657), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1747) ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de POCE-LES-BOIS
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Pocé" :
- Henry Doguet : "Henry Doguet seigneur du Boays Jehan se présente en [robe] pour il et damoyselle Julienne de Byno en / son nom et tutrixe des enffens et du feu seigneur de La Guischardière en Cornillé. Et dit son revenu noble valloir environ quarante livres, et cil de ladicte damoyselle tutrixe valloir cent livres par an. Disant jaczoit que [Note : Jaczoit que, pour : ja soit que... quoique] la richesse d'il et de ladicte damoyselle soit par trop feible pour froyez ung homme armé en estat d'archer se voulloir présentement armez et monter à cheval pour le service qu'il désire faire au Roy et à Monseigneur le duc. A quoy par mondict seigneur d'Espinay capitayne a esté dit celuy Daguet estre de sa famille et domesticque, et qu'il se tenait asseuré que celuy Doguet se trouveroit prest et en armes lors qu'il sera commandé et ordonné audict Dogue!, quel d'Espinay respondroit de la personne et service que debvoit faire celuy Doguet. Ce que ledict Doguect a ainsi juré, et a esté ordonné ce estre rédigé par escript.".
(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.