|
Bienvenue chez les Grehaignois |
SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Pleine-Fougères
La commune de
Saint-Georges-de-Gréhaigne ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
Saint-Georges-de-Gréhaigne vient, semble-t-il, du breton "créen" (colline).
Il semble que Saint-Georges-de-Gréhaigne (du moins le territoire au sud du marais) soit un démembrement de la paroisse de Pleine-Fougères. La paroisse de Saint-Georges, fondée au début du XIème siècle par les bénédictins de l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes, se nomme d'abord Saint-Georges-de-Villers, puis Saint-Georges-de-Hiragne, pour enfin s'appeller Saint-Georges-de-Gréhaigne au XIIIème siècle. La paroisse de Saint-Georges-de-Gréhaigne dépendait autrefois de l'ancien évêché de Dol.
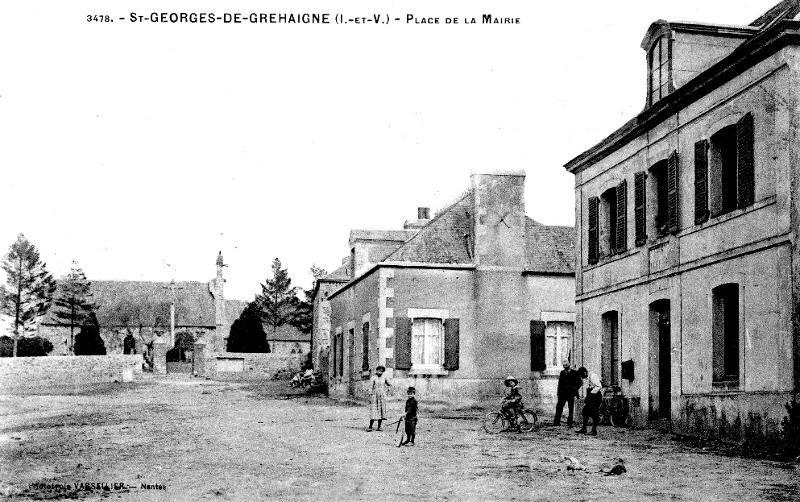
Le Village de Vilers et son église sont donnés vers 1040 par leur possesseur laïque à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes et celle-ci achète dix ans plus tard le Monastère de Saint-Georges au Village d'Hyrhane : telle est l'origine du prieuré, qui est d'abord appelé Saint-Georges de Vilers, puis Saint-Georges d'Hyrhane. Une abbesse de Saint-Georges, en 1274, transige avec les chanoines de Dol, au sujet des dîmes de cette paroisse, qui n'était qu'un prieuré, relevant de la célèbre abbaye. En 1491, Françoise d'Epinay reconstruit le prieuré ruiné au XVème siècle, lors de la guerre de succession de Bretagne. Le Prieuré avait autrefois un droit de haute justice et des fourches patibulaires à quatre pots. Il avait aussi un cep, un collier et un auditoire dans le bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Voici l'aveu de l'abbaye Saint-Georges rendu au Roi en 1665 par Magdelaine de la Fayette, abbesse de Saint-Georges : " SAINCT GEORGE DE GREHAIGNE. ... Item confessent et advouent tenir du dict seigneur Roy la terre et seigneurie de Sainct George de Grehaigne, en l’évesché de Dol, avec ses apartenances et dépendances s’estendant en la parroisse de Sainct George de Grehaigne, Ros sur Couesnon, Plaine Fougère et Mouesdré en Normandie … FIEFZ DE SAINCT GEORGE DE GREHAIGNE. Un fief et bailliage apellé le grand fief du bourg de Sainct George de Grehaigne, en laquelle parroisse les dictes dames abbesse et couvent ont de grands communs, gallois, et particulièrement ceux qu’ils appellent vulgairement « les francs fiefs » dans les marais qu’elles advouent aussy tenir du dict seigneur Roy, avecq droit de pesche en la rivière de Couesnon prohibitif à tous autres, en l’endroit et estendue du dict fief et autres fiefz cy après, en la parroisse de Ros sur Couesnon, avecq le debvoir de lots et ventes. Et en la dicte parroisse de Plaine Fougère, les dictes dames ont et advouent tenir deux fiefs et bailliages, l’un nommé le fief de Higourdière, l’autre fief apellé le fief du Pain (Pin). Item un fief et bailliage apellé le bailliage du Van Sainct Reverd. Item advouent tenir un autre fief nommé le fief des Moudrins, duquel les hommes et vassaux doibvent chacun an aus dictes dames vingt rusches de sel menu blanc, avecq droit de grèves sablonneuses pour faire le dict sel et autres communs et gallois. Item apartient aus dictes dames, dans les dictes parroisses de Ros sur Couesnon et Sainct George, un droit apellé ancrage, qui est tel que quand chaque vaisseau mouille l’ancre, soubz la dicte jurisdiction de Sainct George, il doibt …. et outre pour le droit de débris. A cause desquels fiefs les dictes dames abbesse et couvent ont et leur apartient et advouent tenir du dict seigneur Roy, et avoir droit de jurisdiction haulte, basse et moienne justice, avecq droit de justice à quatre paux, sep, collier, et auditoire au dict bourg et parroisse de Sainct George de Grehaigne, en laquelle y a exercice de jurisdiction au jour de vendredy de chacune semaine, droit de tenir les plaids sans assignation, chacun an, le landemain et feste de Sainct George, vingt quatriesme jour d’avril, par les officiers que la dicte dame a et a droit de seneschal, alloué, lieutenant et procureur d’office et de greffier, qui font le dict exercice de jurisdiction et tout droit de jurisdiction et seigneurie comme est dict au commancement du presant minu. De plus, les dictes dames ont et advouent tenir et leur apartenir le droit de supérioritté, patrones et fondatrices de l’église et parroisse du dict Sainct George. Ont les dictes dames en la dicte parroisse de Sainct George un debvoir apellé le debvoir des mariez, qui est tel que la dernière des mariées de chacune année doit le jour de l'Epiphanie, à l’issüe de la grande messe, un esteuf, et icelui jetter par trois fois par dessus la dicte église à peine d’amande. Et d’autant que les dicts hommes et vassaux doibvent, scasoir : ceux du fief du dict bourg de Sainct George à la seigneurie de Combourg, le jour et feste de Sainct Samson, la somme de soixante sols monnoye de rente à portage jusques à la croix de Villecherel, parroisse de Plaine Fougère, les dicts hommes et vassaux et ceux des dicts fiefs du Pain et Val Sainct Reverd, ne doibvent aucune coutume ne trépas pour aller et venir vendre et distribuer leur marchandise par sur les terres de la dicte seigneurye de Combourg. Sur tous lesquels hommes et vassaux les dames abbesse et couvent ont droit de lods et ventes, mesme sur ceux qu’ils appellent et qui sont dans les communs apellez francs fiefs, et plusieurs autres droits et debvoirs seigneuriaux. Item confessent et advouent tenir un fief despendant de la jurisdiction du dict Sainct George de Grehaigne, en la paroisse (sic) [Note : Lisez « province »] de Normandie, parroisse de Mouesdré, apellé le fief de Mouesdré, dans lequel fief la dicte dame a plusieurs hommes et vassaux à debvoir de rentes et autres droits féodaux. Item ont et advouent tenir dans le dict bourg de Sainct George un four à banc auquel les hommes et vassaux doibvent aller faire cuire leur pain. Dans lequel bourg et parroisse de Sainct George de Grehaigne y a un prieuré apellé le prieuré de Sainct George de Grehaigne, membre dépendant de la dicte abbaye de Sainct George, lequel est possédé en tiltre par une des religieuses de la dicte abbaye, consistant en une maison prieuralle, jardins, pourpris, terres arables et non arables, le tout contenant environ quarante journaux de terres exemptes de touttes rentes et dixmes, avecq fiefs et jurisdiction ".

Le Pouillé de Rennes stipule que l'histoire fort intéressante des commencements de cette paroisse n'est autre que celle du prieuré de Gréhaigne, fondé dès le XIème siècle par les Bénédictines de l'abbaye de Saint-Georges. L'abbesse de Saint-Georges présenta le recteur de Saint-Georges-de-Gréhaigne jusqu'à la Révolution ; en 1790, cette dame levait les trois quarts des grosses dîmes de la paroisse et abandonnait au recteur, pour sa portion congrue, le dernier quart de ces dîmes et toutes les novales. En 1735, une bonne partie de la paroisse de Saint-Georges dépendait d'ecclésiastiques : les Bénédictins du Mont Saint-Michel y avaient un fief important, les religieux de l'Hôpital de Cendres 40 journaux de terre, le recteur de Saint-Georges 13 journaux 69 cordes, l'obiterie de Saint-Georges une vingtaine de journaux, l'abbesse de Saint-Georges le prieuré de Gréhaigne, et le chapelain du Val 100 livres de rente (Archives paroissiales). La fabrique possède un registre des Comptes des trésoriers de Saint-Georges du commencement du XVIIème siècle ; on y voit qu'en 1626 il fallait six pots de vin, payés 60 sols, pour la communion pascale, et qu'on allait alors en procession au Mont Saint-Michel, à Broualan, Sainte-Anne-de-la-Grève, Saints, Pleine-Fougères, Roz, Macey, etc.

L'une des terres nobles de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Poilley, est érigée en comté, avec haute, moyenne et basse justice.
On rencontre les appellations suivantes : Sanctus Georgius de Vilers (en 1040), Sanctus Georgius de Hyrhana (en 1050), Sanctus Georgius de Grihania (en 1140).

Note 1 : En 1728, la fabrique de Saint-Georges-de-Gréhaigne possédait un jardin appelé le courtil Saint-Lazare (Pouillé de Rennes).
Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Georges de Gréhaigne : Julien Forgeais (il fut reçu chanoine de Dol le 13 mai 1569 ; décédé vers 1593). Pierre Guéret (présenté par l'abbesse de Saint-Georges le 13 juin 1593, il fut pourvu en 1594 et gouvernait encore en 1603). Guillaume Gaultier (recteur en 1609 ; décédé vers 1631). Henri Thomas (pourvu le 13 mai 1631, il résigna l'année suivante). Jean Thomas (présenté par l'abbesse le 6 avril 1632, devint chanoine de Dol et résigna sa cure). Robert Husson (il fut présenté le 15 octobre 1635). François Jalleu (prêtre du Mans ; en 1636, il permuta avec le suivant en 1640). Jacques Frain (prêtre d'Avranches, précédemment recteur de Saint-Ideuc, il prit possession le 23 avril 1640 ; il gouvernait encore en 1676). François Cassin (décédé vers 1677). Martin Razé (il succéda au précédent en 1677). Gaspard Daucey (en 1678, il devint en 1681 recteur du Crucifix de Dol). Jacques du Couldray (décédé le 22 février 1685). Guillaume Durand (originaire de Sourdeval, il fut pourvu en 1685 ; décédé âgé de trente-six ans, le 29 décembre 1688). François Beaudouart (présenté le 24 décembre 1688, il résigna le 26 janvier 1692). Noël Guénard (1692-1693). François Benoist (1693, décédé le 24 juillet 1712). Joseph-Charles de Quétrambat ou de Quatrambart (prêtre de Rennes, présenté le 29 juillet 1712, il fut pourvu le 2 août et prit possession le 4 ; décédé le 18 septembre 1717). Ignace Hindré (prêtre de Rennes, présenté le 19 septembre 1717, il fut pourvu le 29 et prit possession le 30 ; décédé en 1718). René du Pan de Kerguenech (prêtre de Saint-Brieuc, présenté le 20 juin 1718, il fut pourvu le 28 et prit possession le même jour ; il se démit en 1727 et devint recteur de Pleubihan). Jean Planchois (prêtre de Rennes, présenté le 26 mai 1727, pourvu le 15 juillet, il prit possession le 16 et se démit presque aussitôt). Augustin Robert (prêtre de Saint-Malo, présenté le 16 novembre 1727, pourvu le 20, il prit possession le 25 et permuta le 3 décembre avec le suivant). Jean-Malo 0llivier (sieur du Beffroy, précédemment recteur de Saint-Tual, il prit possession le 5 décembre 1727 ; il résigna en faveur du suivant le 8 juin 1733 ; décédé à Villecunan, en Pleine-Fougères, âgé de soixante-quatorze ans, et inhumé le 26 mars 1749 dans l'église de Pleine-Fougères). Julien-Thomas Dhuisne (originaire de Roz-sur-Couesnon, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 24 août 1733 ; décédé âgé de cinquante-sept ans, le 6 février 1762). Michel-Jean-Yves Millet (né à Fougères de Jean Millet et d'Anne Goupil, présenté le 14 février 1762 et pourvu le 19, il prit possession le 20 ; décédé le 13 avril 1772). François Penault (prêtre de Saint-Brieuc et curé de Saint-Cast, présenté le 13 avril 1772, pourvu le 15, prit possession le 18 et gouverna jusqu'à la Révolution). Joseph Toullier de la Villemarie (chanoine honoraire ; 1803-1830). François Bugaux (1830-1877). François Lainé (1877-1879). Amédée Ollivier (à partir de 1879), ...

Voir aussi
![]() "
Cahier
de doléances de Saint-Georges-de-Gréhaigne en 1789
".
"
Cahier
de doléances de Saint-Georges-de-Gréhaigne en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
![]() l'église
Saint-Georges (XIII-XIVème siècle), reconstruite entre la fin du XIIIème
siècle et le début du XIVème siècle sur l'emplacement d'un édifice du
XIème siècle qui était jadis un prieuré de l'abbaye Saint-Georges de
Rennes. Saint Georges, martyr, est le patron de cette église,
pittoresquement posée au sommet d'une colline rocheuse dont la base est
baignée par les flots de la mer. C'est un édifice du XIVème et XVème siècles,
composé d'une nef et d'un choeur à chevet droit moins large que la nef.
Au-dessus de l'arc triomphal s'élève le clocher, en forme de campanile. Le
tout n'a pas grand style, mais se présente bien au milieu d'un cimetière
qu'orne un vieux portail monumental. L'abbesse de Saint-Georges était jadis
dame supérieure et fondatrice de l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne,
dans laquelle elle jouissait de toutes les prééminences. Il s'y trouvait
une confrérie de Saint-Sébastien très-anciennement érigée (Pouillé de
Rennes). Le clocher en forme de campanile a deux baies et se dresse
entre le choeur et la nef. La verrière, figurant saint Georges (prince de
Cappadoce, martyrisé au IIIème siècle sous Dioclétien), date du XVIème siècle. On
y trouve la pierre tombale de Thomas Simon (1595 ou 1598) ;
l'église
Saint-Georges (XIII-XIVème siècle), reconstruite entre la fin du XIIIème
siècle et le début du XIVème siècle sur l'emplacement d'un édifice du
XIème siècle qui était jadis un prieuré de l'abbaye Saint-Georges de
Rennes. Saint Georges, martyr, est le patron de cette église,
pittoresquement posée au sommet d'une colline rocheuse dont la base est
baignée par les flots de la mer. C'est un édifice du XIVème et XVème siècles,
composé d'une nef et d'un choeur à chevet droit moins large que la nef.
Au-dessus de l'arc triomphal s'élève le clocher, en forme de campanile. Le
tout n'a pas grand style, mais se présente bien au milieu d'un cimetière
qu'orne un vieux portail monumental. L'abbesse de Saint-Georges était jadis
dame supérieure et fondatrice de l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne,
dans laquelle elle jouissait de toutes les prééminences. Il s'y trouvait
une confrérie de Saint-Sébastien très-anciennement érigée (Pouillé de
Rennes). Le clocher en forme de campanile a deux baies et se dresse
entre le choeur et la nef. La verrière, figurant saint Georges (prince de
Cappadoce, martyrisé au IIIème siècle sous Dioclétien), date du XVIème siècle. On
y trouve la pierre tombale de Thomas Simon (1595 ou 1598) ;
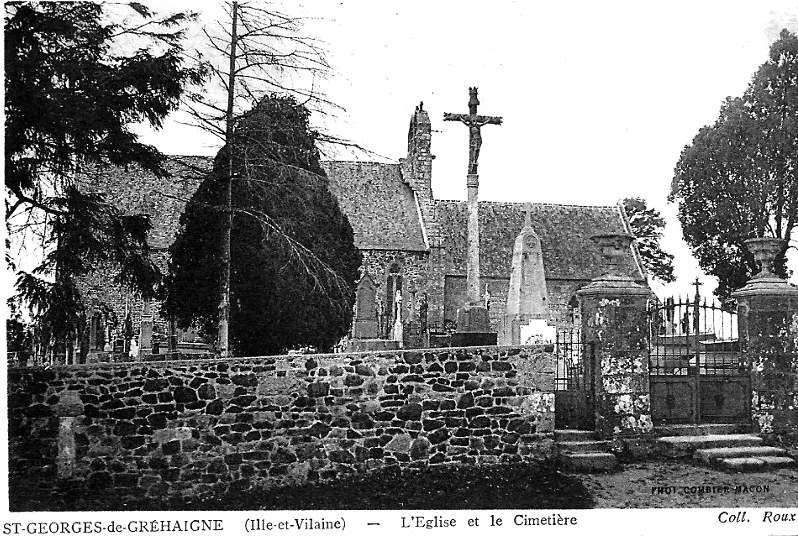
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Mauron, située jadis au bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne.
Elle était fondée de messes et son chapelain habitait, dit-on, sur la
lande de Montomblet, en Saints ;
l'ancienne
chapelle Saint-Mauron, située jadis au bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne.
Elle était fondée de messes et son chapelain habitait, dit-on, sur la
lande de Montomblet, en Saints ;
![]() l'ancien
prieuré Saint-Georges, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye
Saint-Georges. « De sinople à un bâton prioral d'or accosté des lettres
S. G. de même » (Armorial général ms. de 1698). Dès l'époque de la fondation de l'abbaye de
Saint-Georges, avant l'an 1034, Havoise, duchesse de Bretagne, donna à ce monastère
un moulin près de Pontorson et une portion de terre
voisine du village de Saint-Georges-de-Vilers, « quamdem portionem terrœ vicinam villœ Sancti Georgii quœ vocatur
Vilers » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 106). Vers l'an 1040, un seigneur dont le nom demeure inconnu
donna aux mêmes religieuses de Saint-Georges le village même de Vilers
avec son église, dédiée à saint Georges, et la moitié du marais
voisin, le tout exempt d'impôts, « villam quœ dicitur
Vilers, cum ecclesia in eadem villa sita quœ nomine Sancti Georgii
dedicata est » (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Dix ans plus tard, Roger, fils d'Ascelin,
vendit à Adèle, abbesse de Saint-Georges, le monastère de
Saint-Georges situé dans le village d'Hyrhane,
qui était alors en sa possession, « vendidit Rogerius Ascelini filius monasterium Sancti Georgii in Hyrhana villa
» (Cartulaire de Saint-Georges, 131). Enfin, environ l'an 1085, Robert de Maédré et Leiarde, sa
femme, à l'occasion de l'entrée de leur fille Agnès dans le cloître
de Saint-Georges, donnèrent à ce couvent la sixième partie des dîmes
de Maédré, aujourd'hui Moidrey, bourg très-voisin de Saint-Georges-de-Gréhaigne
(Cartulaire de Saint-Georges, 153). Tels furent les commencements du
prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne, appelé primitivement
Saint-Georges-de-Vilers, puis Saint-Georges-d'Hyrhane, dont l'on a fait le nom actuel
de Gréhaigne (Saint-Georges-de-Gréhaigne) ;
cela ressort clairement de la concordance des chartes
du Cartulaire de Saint-Georges dont nous venons
de faire l'énumération. Il est à croire que le seigneur inconnu
qui donna l'église de Saint-Georges-de-Vilers
appartenait à la famille des seigneurs de Montrouault, car, vers
l'an 1140, Gaultier de Montrouault persécuta longtemps les religieuses de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, « diu inquietavit et inquietaverat moniales Sancti Georgii
de Grihania », au sujet de cette église, dont il revendiquait la possession.
Revenus enfin à de meilleurs sentiments et pleins de
repentance, ce seigneur et son fils aîné Raoul jurèrent devant
Geoffroy, archevêque de Dol (dans le diocèse duquel se trouvait
Gréhaigne, aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne), qu'ils renonçaient à leurs droits héréditaires sur l'église
de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; ce que voyant les religieuses,
elles voulurent témoigner leur reconnaissance
à Raoul et lui concédèrent, à sa vie durant, le quart des
revenus de cette église (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Deux actes du
XIIème siècle nous apprennent que Conan II, duc de Bretagne, avait lui-même donné la
juridiction seigneuriale de Gréhaigne aux religieuses de Saint-Georges : l'un
est une bulle du pape Alexandre III confirmant, en 1164, ces
religieuses dans la possession de l'église, du cimetière et des
hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne : « Ecclesiam Sancti Georgii de Grihannia...
homines in cimeterio Sancti Georgii commorantes, ad ejusdem monasterii
proprietatem pertinentes, ex dono bonœ memoriœ
comitis Conani quidquid juris habebat in predicta villa de Grihannia, tam in hominibus
quam aliis possessionibus » (Cartulaire de Saint-Georges, 173). L'autre
acte est une sentence rendue par Guillaume, sénéchal de Rennes, entre les
religieuses de Saint-Georges et un seigneur, probablement de Combourg, nommé Jean de Dol. Les
Bénédictines se plaignaient de ce que ce seigneur levait 9 livres de rente sur les
hommes de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) ; il fut prouvé que ces
hommes étaient « subjects auxdites dames par don leur fait par
le comte de Bretagne », et, par suite, qu'ils ne devaient rien à Jean de Dol. Cependant comme il parut, en même
temps, que les habitants de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) s'étaient engagés, sans
l'aveu des religieuses de Saint-Georges, à payer ces 9 livres à Jean
de Dol pour jouir d'une garde ou sauvegarde qu'il leur promettait, le sénéchal autorisa ce seigneur à prendre cette
rente de 9 livres, à condition qu'il ferait garder les hommes de
Saint-Georges-de-Gréhaigne « par ses vassaux à lui », et seulement tant que
l'abbesse de Saint-Georges le tolèrerait (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 197 —
Archives départementales, 26 H, 276. — Au XVIIème siècle, les hommes du fief
du bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne, vassaux de l'abbesse, payaient encore
au seigneur de Combourg, le jour Saint-Samson, 69 sols de rente à portage
jusqu'à la croix de la Villecherel, en Pleine-Fougères ; en revanche, ces hommes, ainsi que
ceux des fiefs du Pin et du Val-Saint-Revert, également vassaux de Saint-Georges,
ne payaient ni coutume ni trépas sur les terres de la seigneurie de Combourg - Cartulaire
de l'abbaye Saint-Georges, 371). Les papes Innocent III en 1208, et Eugène IV en 1442,
confirmèrent l'abbaye de Saint-Georges dans la possession de l'église, du cimetière et
des hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne demeurant dans ce cimetière, comme
l'avait fait leur prédécesseur Alexandre III. Nous croyons qu'il faut entendre par ce cimetière
habité, « homines commorantes in cimeterio Sancti Georgii », un lieu d'asile qui
entourait l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne, formant peut-être le bourg lui-même,
ou du moins une partie de ce bourg. En 1233, le prieuré de Gréhaigne
se trouvait entre les mains d'un nommé Ascelin Pasdebof, qui composa
avec l'abbesse de Saint-Georges pour les redevances des fiefs de Gréhaigne.
Clément, évêque de Dol, ratifia cet accord, par suite duquel le prieuré
resta à Ascelin Pasdebof à sa vie durant, à condition
qu'à sa mort il le laisserait en parfait état aux religieuses (Cartulaire
de l'abbaye Saint-Georges, 222). En 1272, Rolland, fils de Guy,
chevalier, renonça en faveur de l'abbesse de Saint-Georges aux prétentions
qu'il avait manifestées d'être sénéchal féodé de la paroisse de
Saint-Georges-de-Gréhaigne ; il fit, de plus, serment de défendre, même contre les siens, les droits de
l'abbaye à Gréhaigne (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 242). Pendant les guerres de Bretagne,
à la fin du XVème siècle, le manoir prioral de Gréhaigne
fut ruiné ; l'abbesse Françoise d'Espinay, qui le trouva en ce triste état en 1491, s'empressa de
le faire reconstruire. A la fin du XIXème siècle, il n'en reste plus qu'une maison
insignifiante dans le bourg et près de l'église. Voyons maintenant en quoi consistaient
le prieuré et la seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne au XVIIème siècle. Il faut remarquer
tout d'abord que la seigneurie n'appartenait pas à la prieure, mais bien à
l'abbesse ; voici donc premièrement ce qu'avait la prieure : « Au bourg et paroisse de
Saint-Georges-de-Gréhaigne y a un prieuré appelé le prieuré de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, membre dépendant de l'abbaye de Saint-Georges, lequel est possédé
en titre par une religieuse de ladite abbaye, consistant
: en une maison priorale, jardins, pourpris, terres arrables et non arrables, le tout contenant environ 40 journaux
de terres exemptes de toutes rentes et dixmes, avec fiefs et juridiction ; — quelques rentes tant par froment que deniers
; — 96 boisseaux de froment dus par l'abbesse de Saint-Georges
; les trois quarts des oblations de l'église, sauf le jour
Saint-Georges ; — les trois quarts des menues dîmes comme
chanvres, lins, laines, cochons, oisons, etc. ». La déclaration de la seigneurie, appartenant à l'abbesse
et au couvent, est beaucoup plus étendue : «
Confessent (lesdites religieuses de Saint-Georges) tenir du
seigneur Roy la terre et seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne, en l'évesché
de Dol, avec ses appartenances et dépendances s'estendant en les
paroisses de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Roz-sur-Couesnon, Pleine-Fougères et Mouesdré en Normandie ;
consistant scavoir en ce qui est en ladite paroisse de Saint-Georges : les
mazières de la Grange avec l'emplacement d'un colombier et ses cours et déports
; — une vieille masse de moulin à vent
et plusieurs pièces de terre ; — les trois quartes parties des
dixmes de blasteries de ladite paroisse
de Saint-Georges, sur lesquelles l'abbesse doit à la prieure de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, chaque année, quatre-vingt-seize boisseaux
de froment, mesure d'Antrain ; — des grèves,
communs et gallois, avec droit de pesche en la rivière de
Couasnon prohibitif à tous autres en l'estendue des fiefs de l'abbaye ; — un moulin à vent en la paroisse de Roz-sur-Couesnon
; — dans le bourg de Saint-Georges, joignant le cimetière, un four à ban auquel les hommes et vassaux doivent
aller faire cuire leur pain ; — le tiers des dixmes de toutes
sortes en la paroisse de Mouesdré ». Les
religieuses possédaient plusieurs fiefs constituant leur seigneurie
de Gréhaigne ; en voici la nomenclature : le Grand fief du bourg
de Saint-Georges, — le fief de Higourdière, — le fief du
Pin (nota : en 1323, l'abbesse de Saint-Georges et les seigneurs de la Châtaigneraye
et de la Roche se partagèrent les bailliages situés au territoire du Pin -
Voir Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 259.)
, — le fief du Vau-Saint-Reverd, — le fief des Moudrins, — le fief de
Mouesdré. « A cause desquels fiefs lesdites dames abbesse et couvent
ont droit de juridiction haulte, basse et moyenne justice, avecq droit de
justice à quatre paux, cep, collier et auditoire audit bourg de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, en laquelle y a exercice de juridiction au jour
de vendredy de chacune semaine, droit de tenir les plaids sans assignation,
chacun an, le lendemain et feste de Saint-Georges, 24e jour d'avril, par les
officiers nommés par lesdites dames ». Les religieuses de
Saint-Georges étaient naturellement patronnes et fondatrices de l'église
de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; elles y avaient tous les droits de supériorité
et présentaient à la cure. Elles jouissaient aussi de droits particuliers,
l'un appelé droit d'ancrage, les autres, devoirs des mariés : «
Apartient auxdites dames, dans lesdites paroisses de Roz-sur-Couesnon et
Saint-Georges, un droit apellé ancrage, qui est tel que quand chaque
vaisseau mouille l'ancre soubs ladite juridiction de Saint-Georges il doit 5
sols et oultre pour le droit de bris. Plus ont lesdites dames en ladite
paroisse de Saint-Georges un debvoir, appelé le debvoir des mariez, qui est
tel que la dernière des mariées de chaque année doit le jour de l'Epiphanie,
à l'issue de la grande messe, un esteuf (balle de jeu de paume) et iceluy
jeter par trois fois par dessus ladite église, à peine d'amende. Plus est
deub à la dame prieure de Saint-Georges-de-Gréhaigne, par chacune nouvelle
mariée qui a épousé en ladite paroisse, une chanson en dansant, le
premier dimanche après les épousailles, hors et près le cimetière dudit
Saint-Georges, à l'issue de la grande messe » (Déclarations de
l'abbaye de Saint-Georges en 1633 et 1665 et du prieuré en 1640). Comme
l'on voit, l'abbesse de Saint-Georges était bien plus puissante à Gréhaigne
(aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) que la prieure du lieu, aussi
celle-ci n'affermait-elle son prieuré que 47 livres 10 sols en 1510 ; il
est vrai qu'il était estimé 300 livres en 1618. Le prieuré de
Saint-Georges-de-Gréhaigne fut uni en 1727, par arrêt du Conseil d'Etat,
à la mense abbatiale ; les religieuses réunirent alors tout ce qu'elles
possédaient en ce pays ; le 26 juin 1752, elles affermèrent le tout 1.200
livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 275). Liste des
prieures : — Soeur Renée Lambin afferma le prieuré en 1510, à Guillaume
du Bord, 47 livres 10 sols. — Soeur Marguerite Piédevache, prieure en
1526, fit accord en 1537 avec Raoul de Saint-Main, fermier de l'abbesse,
pour les 96 boisseaux de froment que lui devait cette dernière. Elle résigna
en 1562 en faveur de la suivante. — Soeur Jehanne de la Verrie prit
possession le 24 janvier 1563 ; Jeanne de Fescal lui disputant le prieuré,
elle lui abandonna ce bénéfice moyennant une pension de 20 livres. —
Soeur Jeanne de Fescal prit possession le 27 mars 1563 et le 2 mai 1565 ;
elle conserva le prieuré pendant quarante ans et le résigna en 1605. —
Soeur Ambroisie de Beaudreuil, pourvue le 5 décembre 1605, rendit aveu au
roi en 1648 et 1640 et résigna en 1645. — Soeur Gilette Botrel, pourvue
le 29 mai 1645, résigna en 1667. — Soeur Bertranne Becdelièvre du
Chastellier prit possession le 17 avril 1667 et résigna en 1688. — Soeur
Marie-Anne Becdelièvre du Bouexic prit possession le 22 avril 1688, et résigna
en 1696 en faveur de la suivante. — Soeur Marguerite Butault de la
Chasteigneraye prit possession le 2 janvier 1697 et résigna en 1712. —
Soeur Renée de La Haye de Silz, pourvue le 16 septembre 1712, prit
possession le 19 septembre de l'église paroissiale et du manoir prioral de
Saint-Georges-de-Gréhaigne. Sur le désir manifesté, en 1725, par les
religieuses de l'abbaye de réunir le prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne
à la mense abbatiale et conventuelle, Mme de La Haye de Silz résigna son bénéfice,
mais en conserva les revenus sa vie durant ; elle fut la dernière prieure
(abbé Guillotin de Corson) ;
l'ancien
prieuré Saint-Georges, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye
Saint-Georges. « De sinople à un bâton prioral d'or accosté des lettres
S. G. de même » (Armorial général ms. de 1698). Dès l'époque de la fondation de l'abbaye de
Saint-Georges, avant l'an 1034, Havoise, duchesse de Bretagne, donna à ce monastère
un moulin près de Pontorson et une portion de terre
voisine du village de Saint-Georges-de-Vilers, « quamdem portionem terrœ vicinam villœ Sancti Georgii quœ vocatur
Vilers » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 106). Vers l'an 1040, un seigneur dont le nom demeure inconnu
donna aux mêmes religieuses de Saint-Georges le village même de Vilers
avec son église, dédiée à saint Georges, et la moitié du marais
voisin, le tout exempt d'impôts, « villam quœ dicitur
Vilers, cum ecclesia in eadem villa sita quœ nomine Sancti Georgii
dedicata est » (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Dix ans plus tard, Roger, fils d'Ascelin,
vendit à Adèle, abbesse de Saint-Georges, le monastère de
Saint-Georges situé dans le village d'Hyrhane,
qui était alors en sa possession, « vendidit Rogerius Ascelini filius monasterium Sancti Georgii in Hyrhana villa
» (Cartulaire de Saint-Georges, 131). Enfin, environ l'an 1085, Robert de Maédré et Leiarde, sa
femme, à l'occasion de l'entrée de leur fille Agnès dans le cloître
de Saint-Georges, donnèrent à ce couvent la sixième partie des dîmes
de Maédré, aujourd'hui Moidrey, bourg très-voisin de Saint-Georges-de-Gréhaigne
(Cartulaire de Saint-Georges, 153). Tels furent les commencements du
prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne, appelé primitivement
Saint-Georges-de-Vilers, puis Saint-Georges-d'Hyrhane, dont l'on a fait le nom actuel
de Gréhaigne (Saint-Georges-de-Gréhaigne) ;
cela ressort clairement de la concordance des chartes
du Cartulaire de Saint-Georges dont nous venons
de faire l'énumération. Il est à croire que le seigneur inconnu
qui donna l'église de Saint-Georges-de-Vilers
appartenait à la famille des seigneurs de Montrouault, car, vers
l'an 1140, Gaultier de Montrouault persécuta longtemps les religieuses de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, « diu inquietavit et inquietaverat moniales Sancti Georgii
de Grihania », au sujet de cette église, dont il revendiquait la possession.
Revenus enfin à de meilleurs sentiments et pleins de
repentance, ce seigneur et son fils aîné Raoul jurèrent devant
Geoffroy, archevêque de Dol (dans le diocèse duquel se trouvait
Gréhaigne, aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne), qu'ils renonçaient à leurs droits héréditaires sur l'église
de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; ce que voyant les religieuses,
elles voulurent témoigner leur reconnaissance
à Raoul et lui concédèrent, à sa vie durant, le quart des
revenus de cette église (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Deux actes du
XIIème siècle nous apprennent que Conan II, duc de Bretagne, avait lui-même donné la
juridiction seigneuriale de Gréhaigne aux religieuses de Saint-Georges : l'un
est une bulle du pape Alexandre III confirmant, en 1164, ces
religieuses dans la possession de l'église, du cimetière et des
hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne : « Ecclesiam Sancti Georgii de Grihannia...
homines in cimeterio Sancti Georgii commorantes, ad ejusdem monasterii
proprietatem pertinentes, ex dono bonœ memoriœ
comitis Conani quidquid juris habebat in predicta villa de Grihannia, tam in hominibus
quam aliis possessionibus » (Cartulaire de Saint-Georges, 173). L'autre
acte est une sentence rendue par Guillaume, sénéchal de Rennes, entre les
religieuses de Saint-Georges et un seigneur, probablement de Combourg, nommé Jean de Dol. Les
Bénédictines se plaignaient de ce que ce seigneur levait 9 livres de rente sur les
hommes de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) ; il fut prouvé que ces
hommes étaient « subjects auxdites dames par don leur fait par
le comte de Bretagne », et, par suite, qu'ils ne devaient rien à Jean de Dol. Cependant comme il parut, en même
temps, que les habitants de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) s'étaient engagés, sans
l'aveu des religieuses de Saint-Georges, à payer ces 9 livres à Jean
de Dol pour jouir d'une garde ou sauvegarde qu'il leur promettait, le sénéchal autorisa ce seigneur à prendre cette
rente de 9 livres, à condition qu'il ferait garder les hommes de
Saint-Georges-de-Gréhaigne « par ses vassaux à lui », et seulement tant que
l'abbesse de Saint-Georges le tolèrerait (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 197 —
Archives départementales, 26 H, 276. — Au XVIIème siècle, les hommes du fief
du bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne, vassaux de l'abbesse, payaient encore
au seigneur de Combourg, le jour Saint-Samson, 69 sols de rente à portage
jusqu'à la croix de la Villecherel, en Pleine-Fougères ; en revanche, ces hommes, ainsi que
ceux des fiefs du Pin et du Val-Saint-Revert, également vassaux de Saint-Georges,
ne payaient ni coutume ni trépas sur les terres de la seigneurie de Combourg - Cartulaire
de l'abbaye Saint-Georges, 371). Les papes Innocent III en 1208, et Eugène IV en 1442,
confirmèrent l'abbaye de Saint-Georges dans la possession de l'église, du cimetière et
des hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne demeurant dans ce cimetière, comme
l'avait fait leur prédécesseur Alexandre III. Nous croyons qu'il faut entendre par ce cimetière
habité, « homines commorantes in cimeterio Sancti Georgii », un lieu d'asile qui
entourait l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne, formant peut-être le bourg lui-même,
ou du moins une partie de ce bourg. En 1233, le prieuré de Gréhaigne
se trouvait entre les mains d'un nommé Ascelin Pasdebof, qui composa
avec l'abbesse de Saint-Georges pour les redevances des fiefs de Gréhaigne.
Clément, évêque de Dol, ratifia cet accord, par suite duquel le prieuré
resta à Ascelin Pasdebof à sa vie durant, à condition
qu'à sa mort il le laisserait en parfait état aux religieuses (Cartulaire
de l'abbaye Saint-Georges, 222). En 1272, Rolland, fils de Guy,
chevalier, renonça en faveur de l'abbesse de Saint-Georges aux prétentions
qu'il avait manifestées d'être sénéchal féodé de la paroisse de
Saint-Georges-de-Gréhaigne ; il fit, de plus, serment de défendre, même contre les siens, les droits de
l'abbaye à Gréhaigne (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 242). Pendant les guerres de Bretagne,
à la fin du XVème siècle, le manoir prioral de Gréhaigne
fut ruiné ; l'abbesse Françoise d'Espinay, qui le trouva en ce triste état en 1491, s'empressa de
le faire reconstruire. A la fin du XIXème siècle, il n'en reste plus qu'une maison
insignifiante dans le bourg et près de l'église. Voyons maintenant en quoi consistaient
le prieuré et la seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne au XVIIème siècle. Il faut remarquer
tout d'abord que la seigneurie n'appartenait pas à la prieure, mais bien à
l'abbesse ; voici donc premièrement ce qu'avait la prieure : « Au bourg et paroisse de
Saint-Georges-de-Gréhaigne y a un prieuré appelé le prieuré de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, membre dépendant de l'abbaye de Saint-Georges, lequel est possédé
en titre par une religieuse de ladite abbaye, consistant
: en une maison priorale, jardins, pourpris, terres arrables et non arrables, le tout contenant environ 40 journaux
de terres exemptes de toutes rentes et dixmes, avec fiefs et juridiction ; — quelques rentes tant par froment que deniers
; — 96 boisseaux de froment dus par l'abbesse de Saint-Georges
; les trois quarts des oblations de l'église, sauf le jour
Saint-Georges ; — les trois quarts des menues dîmes comme
chanvres, lins, laines, cochons, oisons, etc. ». La déclaration de la seigneurie, appartenant à l'abbesse
et au couvent, est beaucoup plus étendue : «
Confessent (lesdites religieuses de Saint-Georges) tenir du
seigneur Roy la terre et seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne, en l'évesché
de Dol, avec ses appartenances et dépendances s'estendant en les
paroisses de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Roz-sur-Couesnon, Pleine-Fougères et Mouesdré en Normandie ;
consistant scavoir en ce qui est en ladite paroisse de Saint-Georges : les
mazières de la Grange avec l'emplacement d'un colombier et ses cours et déports
; — une vieille masse de moulin à vent
et plusieurs pièces de terre ; — les trois quartes parties des
dixmes de blasteries de ladite paroisse
de Saint-Georges, sur lesquelles l'abbesse doit à la prieure de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, chaque année, quatre-vingt-seize boisseaux
de froment, mesure d'Antrain ; — des grèves,
communs et gallois, avec droit de pesche en la rivière de
Couasnon prohibitif à tous autres en l'estendue des fiefs de l'abbaye ; — un moulin à vent en la paroisse de Roz-sur-Couesnon
; — dans le bourg de Saint-Georges, joignant le cimetière, un four à ban auquel les hommes et vassaux doivent
aller faire cuire leur pain ; — le tiers des dixmes de toutes
sortes en la paroisse de Mouesdré ». Les
religieuses possédaient plusieurs fiefs constituant leur seigneurie
de Gréhaigne ; en voici la nomenclature : le Grand fief du bourg
de Saint-Georges, — le fief de Higourdière, — le fief du
Pin (nota : en 1323, l'abbesse de Saint-Georges et les seigneurs de la Châtaigneraye
et de la Roche se partagèrent les bailliages situés au territoire du Pin -
Voir Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 259.)
, — le fief du Vau-Saint-Reverd, — le fief des Moudrins, — le fief de
Mouesdré. « A cause desquels fiefs lesdites dames abbesse et couvent
ont droit de juridiction haulte, basse et moyenne justice, avecq droit de
justice à quatre paux, cep, collier et auditoire audit bourg de
Saint-Georges-de-Gréhaigne, en laquelle y a exercice de juridiction au jour
de vendredy de chacune semaine, droit de tenir les plaids sans assignation,
chacun an, le lendemain et feste de Saint-Georges, 24e jour d'avril, par les
officiers nommés par lesdites dames ». Les religieuses de
Saint-Georges étaient naturellement patronnes et fondatrices de l'église
de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; elles y avaient tous les droits de supériorité
et présentaient à la cure. Elles jouissaient aussi de droits particuliers,
l'un appelé droit d'ancrage, les autres, devoirs des mariés : «
Apartient auxdites dames, dans lesdites paroisses de Roz-sur-Couesnon et
Saint-Georges, un droit apellé ancrage, qui est tel que quand chaque
vaisseau mouille l'ancre soubs ladite juridiction de Saint-Georges il doit 5
sols et oultre pour le droit de bris. Plus ont lesdites dames en ladite
paroisse de Saint-Georges un debvoir, appelé le debvoir des mariez, qui est
tel que la dernière des mariées de chaque année doit le jour de l'Epiphanie,
à l'issue de la grande messe, un esteuf (balle de jeu de paume) et iceluy
jeter par trois fois par dessus ladite église, à peine d'amende. Plus est
deub à la dame prieure de Saint-Georges-de-Gréhaigne, par chacune nouvelle
mariée qui a épousé en ladite paroisse, une chanson en dansant, le
premier dimanche après les épousailles, hors et près le cimetière dudit
Saint-Georges, à l'issue de la grande messe » (Déclarations de
l'abbaye de Saint-Georges en 1633 et 1665 et du prieuré en 1640). Comme
l'on voit, l'abbesse de Saint-Georges était bien plus puissante à Gréhaigne
(aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) que la prieure du lieu, aussi
celle-ci n'affermait-elle son prieuré que 47 livres 10 sols en 1510 ; il
est vrai qu'il était estimé 300 livres en 1618. Le prieuré de
Saint-Georges-de-Gréhaigne fut uni en 1727, par arrêt du Conseil d'Etat,
à la mense abbatiale ; les religieuses réunirent alors tout ce qu'elles
possédaient en ce pays ; le 26 juin 1752, elles affermèrent le tout 1.200
livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 275). Liste des
prieures : — Soeur Renée Lambin afferma le prieuré en 1510, à Guillaume
du Bord, 47 livres 10 sols. — Soeur Marguerite Piédevache, prieure en
1526, fit accord en 1537 avec Raoul de Saint-Main, fermier de l'abbesse,
pour les 96 boisseaux de froment que lui devait cette dernière. Elle résigna
en 1562 en faveur de la suivante. — Soeur Jehanne de la Verrie prit
possession le 24 janvier 1563 ; Jeanne de Fescal lui disputant le prieuré,
elle lui abandonna ce bénéfice moyennant une pension de 20 livres. —
Soeur Jeanne de Fescal prit possession le 27 mars 1563 et le 2 mai 1565 ;
elle conserva le prieuré pendant quarante ans et le résigna en 1605. —
Soeur Ambroisie de Beaudreuil, pourvue le 5 décembre 1605, rendit aveu au
roi en 1648 et 1640 et résigna en 1645. — Soeur Gilette Botrel, pourvue
le 29 mai 1645, résigna en 1667. — Soeur Bertranne Becdelièvre du
Chastellier prit possession le 17 avril 1667 et résigna en 1688. — Soeur
Marie-Anne Becdelièvre du Bouexic prit possession le 22 avril 1688, et résigna
en 1696 en faveur de la suivante. — Soeur Marguerite Butault de la
Chasteigneraye prit possession le 2 janvier 1697 et résigna en 1712. —
Soeur Renée de La Haye de Silz, pourvue le 16 septembre 1712, prit
possession le 19 septembre de l'église paroissiale et du manoir prioral de
Saint-Georges-de-Gréhaigne. Sur le désir manifesté, en 1725, par les
religieuses de l'abbaye de réunir le prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne
à la mense abbatiale et conventuelle, Mme de La Haye de Silz résigna son bénéfice,
mais en conserva les revenus sa vie durant ; elle fut la dernière prieure
(abbé Guillotin de Corson) ;
![]() la
fontaine de Bélistre ;
la
fontaine de Bélistre ;
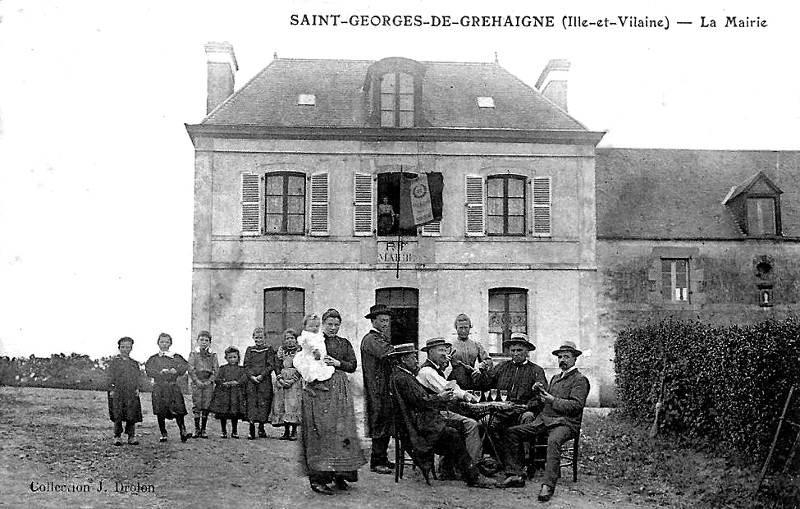
A signaler aussi :
![]() la
digue d'Anne de Bretagne (XI-XVIème siècle) ;
la
digue d'Anne de Bretagne (XI-XVIème siècle) ;
![]() l'ancien
manoir du Haut de la Grève, situé route de l'Etang de Moidrey ;
l'ancien
manoir du Haut de la Grève, situé route de l'Etang de Moidrey ;
![]() l'ancien
manoir des Verdières, situé route de Pontorson. Propriété de la famille de la Binolaye en 1513 ;
l'ancien
manoir des Verdières, situé route de Pontorson. Propriété de la famille de la Binolaye en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Chanel. Propriété de la famille le Sage en 1513, puis de la
famille de Beaumont l'Orgerest au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de Chanel. Propriété de la famille le Sage en 1513, puis de la
famille de Beaumont l'Orgerest au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir du Pont-de-la-Rufel ;
l'ancien
manoir du Pont-de-la-Rufel ;
![]() l'ancien
manoir de la Chapelle-Vauclerc, situé route de Pleine-Fougères.
Propriété de la famille de Vauclerc en 1513, puis de la famille de Crapado au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Chapelle-Vauclerc, situé route de Pleine-Fougères.
Propriété de la famille de Vauclerc en 1513, puis de la famille de Crapado au XVIIIème siècle ;
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Saint-Georges-de-Gréhaigne :
![]() Geoffroy
PRODHOMME : défaillant ;
Geoffroy
PRODHOMME : défaillant ;
![]() Macé
PRODHOMME : défaillant ;
Macé
PRODHOMME : défaillant ;
Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513 (rapport fait en partie par Macé Le Breton et Colas Guérin, élus), sont mentionnées à Saint-Georges-de-Gréhaigne les personnes et maisons nobles suivantes :
![]() Guillaume du
Vauclerc, écuier, sieur de la Chapelle-Vauclerc, exempt.
Guillaume du
Vauclerc, écuier, sieur de la Chapelle-Vauclerc, exempt.
![]() Guillaume Le Sage et Jeanne
Prodhomme, exempts.
Guillaume Le Sage et Jeanne
Prodhomme, exempts.
![]() Le domaine de la Motte...,
appartenant au susdit Guillaume du Vauclerc de mesme
que celuy de Malicorne.
Le domaine de la Motte...,
appartenant au susdit Guillaume du Vauclerc de mesme
que celuy de Malicorne.
![]() Jean de la
Binolaye, demeurant en Normandie, possède la métairie des Verdières.
Jean de la
Binolaye, demeurant en Normandie, possède la métairie des Verdières.
![]() Guillaume Le Sage
jouit de celle de Chanel.
Guillaume Le Sage
jouit de celle de Chanel.
![]() Pierre de la Marche
sieur de la Montorton.
Pierre de la Marche
sieur de la Montorton.
![]() Guillaume Bouchart
sieur de la Costardière.
Guillaume Bouchart
sieur de la Costardière.
© Copyright - Tous droits réservés.