|
Bienvenue chez les Méloriens |
SAINT-MELOIR-DES-ONDES |
Retour page d'accueil Retour Canton de Cancale
La commune de Saint-Méloir-des-Ondes ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MELOIR-DES-ONDES
Saint-Méloir-des-Ondes vient de Saint-Méloir, ermite et martyr breton du VIème siècle.
La paroisse est donnée en 993 par le duc Geoffroy 1er à l'Abbaye du Mont-Saint-Michel et les moines y fondent un prieuré. La paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes dépendait autrefois de l'ancien évêché de Saint-Malo.

L'intéressante histoire des commencements du prieuré de Saint-Méloir-des-Ondes nous prouve l'existence de cette paroisse dès les premières années du XIème siècle. C'est à cette époque reculée qu'elle fut donnée à l'abbaye du Mont Saint-Michel, qui y fonda le prieuré de Saint-Méloir. Le dimanche 30 janvier 1228, les habitants de Saint-Méloir (aujourd'hui Saint-Méloir-des-Ondes), réunis en assemblée de paroisse et agissant en commun, baillèrent à Roger, leur recteur, un champ donné à l'église de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) par Geoffroy Du Guesclin, et situé près du bourg, vis-à-vis la Haute-Rue. Il fut convenu que Roger pourrait faire de ce champ ce qui lui plairait, aussi bien que des bâtiments qu'il y construirait, mais qu'il devrait chaque année, à Noël, payer à l'église de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) une demi-mine de froment, sous peine d'amende, due à cette église. « Ainsi dès cette époque, conclut judicieusement M. de la Borderie, les habitants de nos paroisses rurales étaient constitués à l'état de personnes civiles, de corps de communauté, pouvant posséder, recevoir, contracter, ester en justice, etc. ; chaque paroisse, en un mot, avait dès lors son organisation municipale, imparfaite assurément, mais réelle et suffisante pour établir entre les habitants un lien de solidarité qui s'est perpétué jusqu'à nos jours » (Revue de Bretagne et Vendée, XXIX, 397). Au XVIIIème siècle, les religieux du Mont Saint-Michel étaient encore seigneurs et grands décimateurs de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) ; toutefois le Chapitre de Saint-Malo, le recteur et la fabrique de Saint-Méloir-des-Ondes levaient aussi quelques dîmes dans cette paroisse. La fabrique avait alors 125 livres de revenu fixe, sans comprendre les bancs, lui rapportant 180 livres, et l'ouverture de la terre pour les sépultures, valant 400 livres. Le 15 juillet 1728, le recteur René Dabin fit la déclaration suivante de son bénéfice : il jouissait d'un seul trait de dîme, celui du Bourg, valant 300 livres de rente, mais il avait en outre des dîmes de blé-noir lui rapportant 45 livres, d'avoine 15 livres, de pois, fèves et paumelle 16 livres, de lins et chanvres 40 livres, et une petite dîme novale de 14 livres ; — il avait, de plus, son presbytère avec cour et jardin, contenant ensemble 2 journaux de terre et estimés 70 livres ; — enfin, son casuel atteignait 250 livres. De la sorte il possédait un revenu brut de 750 livres ; mais comme il donnait 200 livres à ses vicaires et qu'il payait les décimes et l'entretien du presbytère, il ne déclara qu'un revenu net de 448 livres 12 sols (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Saint-Méloir-des-Ondes a été érigé en cure de deuxième classe par ordonnance royale datée du 24 janvier 1827 (Pouillé de Rennes).
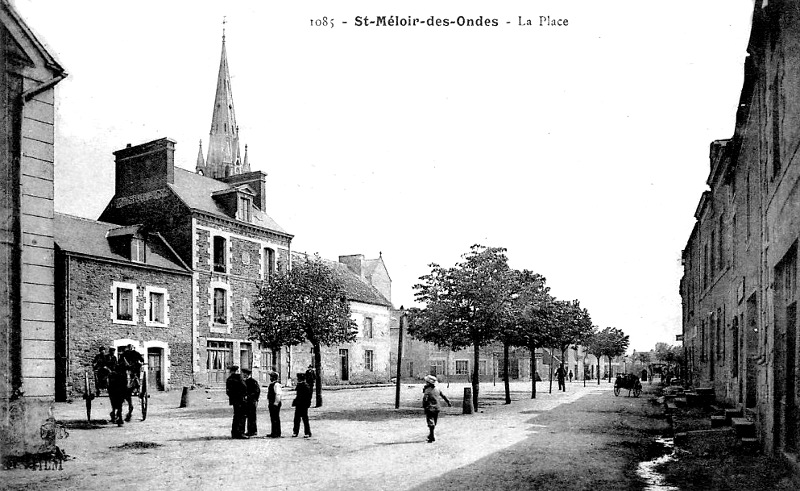
Le bourg de Saint-Méloir-des-Ondes renfermait jadis l'auditoire de la seigneurie des Landes. Le seigneur de Châteauneuf exerçait à Saint-Méloir-des-Ondes un droit de quintaine. On cultivait de la vigne à Saint-Méloir au XIIIème siècle.
L'armée anglaise du duc de Malborough qui débarque à Cancale le 5 juin 1758, s'empare de Saint-Méloir-des-Ondes le 7 juin 1758 en se dirigeant vers Saint-Malo. Saint-Méloir-des-Ondes prend le nom de Méloir-Richeux pendant la Révolution.
On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia Sancti Meler (au XIème siècle), ecclesia Sancti Melorii (en 1191), ecclesia de Sancto Mellorio de Undis (au XVIème siècle).
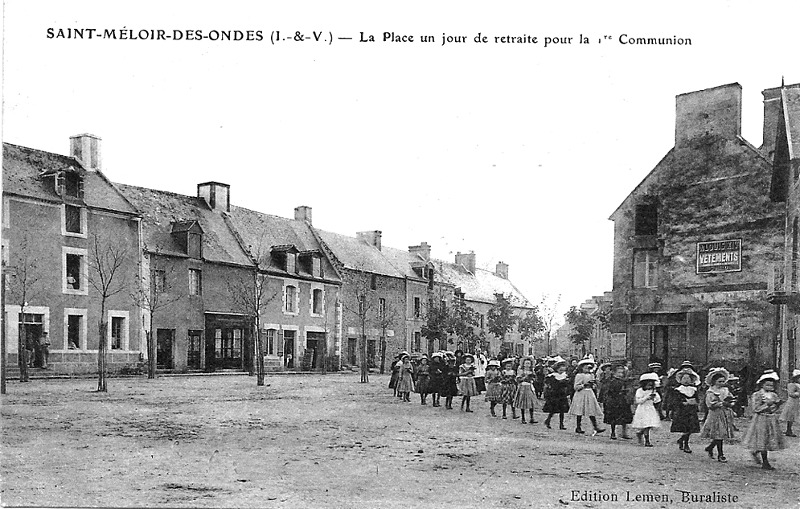
Note
1 : Il n'y avait pas d'écoles fondées en cette paroisse, mais le Pouillé
ms. de Saint-Malo (1739-1767) nous dit qu'à cette époque les prêtres et
quelques femmes pieuses y suppléaient en instruisant les uns les garçons, les
autres les filles. En 1790, M. Radou, prêtre, pourvu du bénéfice de la Magdeleine
(ou Madeleine), estimé plus de 300 livres de rente, déclara ne payer qu'une
minime subvention « à raison de l'école gratuite » qu'il faisait dans
la paroisse (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 20).
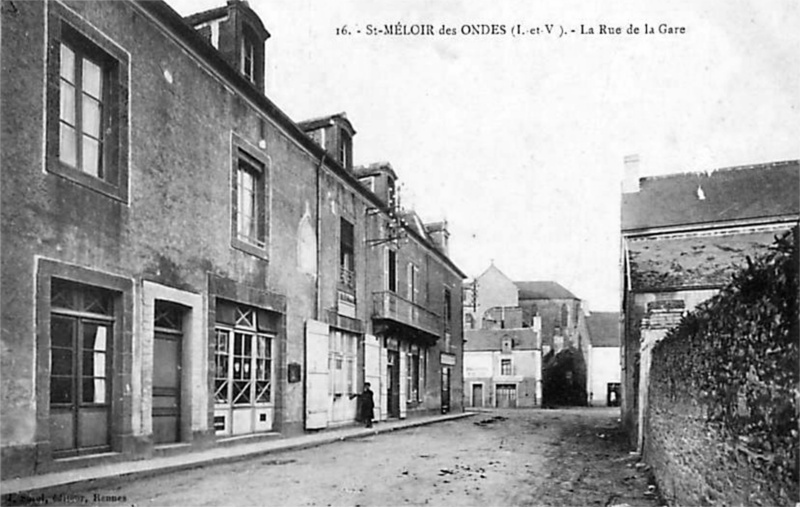
Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes : Anquetil (« Anschetillus ecclesie Sancti Melorii sacerdos », fut témoin vers 1098 d'un accord conclu entre les moines du Mont Saint-Michel et Guillaume Goyon). Even (« Evenus sacerdos », fut témoin vers 1160 de deux actes d'Adam d'Herefort et de Damète Goyon, sa femme, en faveur du prieuré de Saint-Méloir). Hugues ou Huon (« Hugo sacerdos », en 1165). Jean Pointel (« Johannes Pointellus », vers 1180-1190). Guillaume Richart (en 1207). Robert de Radeweie (« Robertus de Radeweie ecclesie Sancti Melorii personna », en 1215). Roger (« Rogerus Sancti Meloerii capellanus », en 1228). Roger Langlois (« Rogerus Anglicus, presbiter Sancti Melorii », donna en 1238 à l'abbaye du Mont Saint-Michel, pour une rente annuelle d'une demi-mine de froment, deux jardins à lui appartenant, contigus à son logis près Saint-Méloir, et qu'il tenait héréditairement d'un chevalier appelé Jean Quinart). Rolland Fabry (il permuta avec le suivant en 1334). Robert Samson (précédemment recteur de Taden, il fut pourvu en 1334). Laurent du Bouays (chanoine de Saint-Malo, décédé vers 1565). Jean Dupré (secrétaire de l'évêque de Saint-Malo, il fut pourvu le 10 juin 1565 ; il débouta Nicolas de la Planche, qui se fit pourvoir à Tours et résigna en 1566 ses prétendus droits à Henri Le Rasle. Jean Dupré, chanoine de Saint-Malo en 1578, résigna en faveur du suivant). Laurent du Guilly ou de Quilly (il prit possession le 20 mars 1585 et résigna en faveur du suivant). Mathieu Le Fer (pourvu le 11 janvier 1591, il prit possession le 10 février. Le Pape s'opposa à sa nomination, parce qu'il n'avait que vingt-deux ans, et pourvut Michel Eon. Mais Mathieu Le Fer résigna en faveur de Laurent du Guilly, qui, pourvu de nouveau, reprit possession le 31 janvier 1593). Pierre Gingatz (il résigna en faveur du suivant). Nicolas des Déserts (sieur des Préaux, il prit possession le 26 juillet 1627 et résigna au bout de dix ans). Etienne Le Breton (sieur de la Ville-Hervy, chanoine de Dol, il prit possession le 18 octobre 1637 et résigna en 1662). Jacques Le Poitevin (il fut pourvu le 16 novembre 1662). Olivier de la Haye (en 1687, il résigna au suivant). Julien Rouxel (pourvu le 13 septembre 1691, il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois ruches à miel de même ; décédé en avril 1705). René-Marie Dabin (pourvu par l'évêque le 25 avril 1705, il prit possession le 29 et débouta Tanguy Le Barzec, présenté par l'abbé du Mont Saint-Michel et pourvu par l'archevêque de Tours ; décédé en 1750). Michel-Jean Hugon du Canet (pourvu le 3 octobre 1750, il résigna presque aussitôt). Julien-Guillaume Chauvin (pourvu le 30 octobre 1750, il ne put se maintenir, mais resta dans la paroisse, où il prenait encore le titre de recteur en 1752). Jacques Potier de la Houssaye (il résigna au suivant). Nicolas Chapel (pourvu le 6 décembre 1751, il se maintint malgré l'opposition de M. Chauvin ; décédé en 1786). Joseph-Jean Penhouet, (pourvu le 1er novembre 1786, IL débouta Nicolas Lesplu, présenté par les religieux du Mont Saint-Michel, et reprit possession le 26 février 1787 ; il gouverna jusqu'à la Révolution). Olivier Guillory (1803, décédé en 1813). François Macé (1813, décédé en 1821). Servan-Pierre Lévêque (1821-1825). Pierre-Marie Lecorre (chanoine honoraire ; en 1825, décédé en 1870) Jean-Baptiste Turmel (chanoine honoraire ; 1870-1878). Julien Delanoë (à partir de 1879), ......

Voir
![]() " Quelques
anciens fait divers de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes
".
" Quelques
anciens fait divers de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes
".
Voir
![]() " Le
cahier de doléances de Saint-Méloir-des-Ondes en 1789
".
" Le
cahier de doléances de Saint-Méloir-des-Ondes en 1789
".
![]()
PATRIMOINE de SAINT-MELOIR-DES-ONDES
![]() l'église Saint-Méloir
(1860-1884) édifiée en remplacement d'une ancienne église délabrée. Saint Méloir, martyr
breton, est le patron de cette église. Le souvenir de l'ancienne église mérite
d'attirer l'attention. On y voyait au XVIIIème siècle trois chapelles
seigneuriales et de nombreuses verrières peintes. La première de ces
chapelles, dédiée à saint Michel, appartenait aux religieux du Mont
Saint-Michel, mais ceux-ci la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton,
seigneur de la Plussinais, qui y plaça son banc, son enfeu et ses
armoiries. La deuxième, située à droite du choeur, dépendait de la
seigneurie des Landes ; on y voyait des écussons sculptés en pierre, ornés
de casques et lambrequins, et portant : d'argent à la bande fuselée de
sable. C'étaient les armes des Le Bouteiller, seigneurs des Landes ; on
les retrouvait peintes dans la première fenêtre de la nef et sculptées
sur un banc posé devant l'autel du Rosaire. La troisième chapelle
appartenait au seigneur de la Bardoulais. On y trouvait sur la muraille un
écusson peint : d'azur à la croix d'argent. Le seigneur de la
Bardoulais y avait un enfeu et un banc. Au chevet de l'église était un
grand vitrail portant au sommet les armes de l'abbaye du Mont Saint-Michel :
de sable à dix coquilles d'argent posées 4, 3, 2, 1, au chef d'or à
trois fleurs de lys de gueules, surmontées d'une crosse et d'une mitre.
Aux deux côtés de la même fenêtre étaient sculptés sur pierre, à
droite les armes du duché de Bretagne : d'hermines plein, et à
gauche celles du seigneur de Béringhen, marquis de Châteauneuf : d'argent
à trois pals de gueules, au chef d'azur chargé de deux quintes-feuilles
d'argent. Sur la deuxième fenêtre de la nef était l'écusson de
Pierre Le Gobien, archidiacre de Porhoët, décédé en 1627, qui possédait
en Saint-Méloir-des-Ondes la maison noble des Douets : coupé au 1er
d'argent à trois têtes de loup arrachées de sable, lampassées de
gueules, au canton d'azur chargé d'un croissant d'or ; au 2ème
d'argent à trois fasces ondées d'azur ; l'écu surmonté d'un chapeau
à trois glands, avec bourdon posé derrière. La famille Le Gobien
prétendait, en effet, avoir droit à une chapelle avec enfeu et
prééminences dans l'église de Saint-Méloir-des-Ondes. Sur la sacristie
et dans un autre vitrail on voyait aussi l'écusson de gueules à une
sirène d'or, qui devait être celui de la famille de Seré,
propriétaire du manoir de la Ville-Maleterre (Terrier ms. de
Châteauneuf). Il paraît qu'à l'origine le seigneur du Val-Ernoul avait
également une chapelle prohibitive en l'église de Saint-Méloir-des-Ondes,
car en 1574 Jean Le Bret, sieur de la Tréhénais, céda à Pierre Le
Filleur, sieur de la Ville-Volant, les droits d'enfeu et prééminence lui
appartenant en cette chapelle. En 1755, l'abbé du Mont Saint-Michel
confirma François Porée, sieur de Razet et propriétaire du Val-Ernoul,
dans la possession de ces privilèges (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, B, 976). En 1687, le sire de Châteauneuf se disait
seigneur supérieur et prééminencier de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes),
mais les moines du Mont Saint-Michel prétendaient aux mêmes droits et
étaient, de plus, seigneurs fondateurs. Le même seigneur de Châteauneuf
avait un droit de quintaine sur les mariés de Saint-Méloir-des-Ondes ;
ceux-ci devaient courir, sous peine de 60 sols d'amende, le lundi de
Pâques, et ce jour-là les trésoriers de la fabrique devaient fournir aux
officiers de Châteauneuf qui présidaient la course « un chevreau
lardé, rosti, cuit et assaucé, avec quatre sols de pain et deux pots de
vin de Gascogne, et, de plus, un boisseau d'avoine pour leurs chevaux »
(Archives Nationales, P. 1721). Les confréries du Rosaire et du
Saint-Sacrement étaient au XVIIIème siècle érigées en l'église de
Saint-Méloir-des-Ondes. Il s'y trouvait aussi un bon nombre de fondations, «
formant alors une obiterie assez considérable ». Enfin, en 1708, une
mission y avait été fondée pour tous les six ans par Alain Le Breton et
Servanne Gaultier, seigneur et dame de la Plussinais (Pouillé ms. de
Saint-Malo, 1739-1767). Cette ancienne église de Saint-Méloir-des-Ondes a
fait place vers 1860 à une belle construction de style ogival, oeuvre de M.
l'architecte Frangeul. Elle se compose de trois nefs et d'un choeur en
hémicycle ; une tour en granit s'élève sur sa façade, et l'ensemble de
l'édifice a quelque chose de monumental (Pouillé de Rennes).
La flèche date de 1884. Le bénitier date du XVI-XVIIème siècle.
On y trouve un ex-voto du XXème siècle. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ancienne église possédait
trois chapelles seigneuriales. L'une des chapelle est cédée par le prieur
en 1723 à la famille le Breton seigneurs de la Plussinais en Saint-Jouan
des Guérets : elle contenait leur enfeu. Une autre chapelle (au nord du
chevet) dépendait de la seigneurie des Landes et portait les armes de la
famille le Bouteiller seigneurs des Landes de 1470 à 1620. La troisième
(au sud) appartenait au seigneurs de la Bardoulais qui y avaient un enfeu.
La maîtresse vitre portait les armes de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, de
Bretagne, de la famille de Béringhen, marquis de Châteauneuf de 1681 à
1740 et celles de la famille Le Bouteiller seigneurs des Landes, entourées
du collier de Saint-Michel. D'autres fenêtres portaient les armes des
familles Seré seigneurs de la Ville-Maleterre (au XVIIème siècle), Gobien
seigneurs des Douets (au XVI-XVIIème siècle) et Le Bouteiller ;
l'église Saint-Méloir
(1860-1884) édifiée en remplacement d'une ancienne église délabrée. Saint Méloir, martyr
breton, est le patron de cette église. Le souvenir de l'ancienne église mérite
d'attirer l'attention. On y voyait au XVIIIème siècle trois chapelles
seigneuriales et de nombreuses verrières peintes. La première de ces
chapelles, dédiée à saint Michel, appartenait aux religieux du Mont
Saint-Michel, mais ceux-ci la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton,
seigneur de la Plussinais, qui y plaça son banc, son enfeu et ses
armoiries. La deuxième, située à droite du choeur, dépendait de la
seigneurie des Landes ; on y voyait des écussons sculptés en pierre, ornés
de casques et lambrequins, et portant : d'argent à la bande fuselée de
sable. C'étaient les armes des Le Bouteiller, seigneurs des Landes ; on
les retrouvait peintes dans la première fenêtre de la nef et sculptées
sur un banc posé devant l'autel du Rosaire. La troisième chapelle
appartenait au seigneur de la Bardoulais. On y trouvait sur la muraille un
écusson peint : d'azur à la croix d'argent. Le seigneur de la
Bardoulais y avait un enfeu et un banc. Au chevet de l'église était un
grand vitrail portant au sommet les armes de l'abbaye du Mont Saint-Michel :
de sable à dix coquilles d'argent posées 4, 3, 2, 1, au chef d'or à
trois fleurs de lys de gueules, surmontées d'une crosse et d'une mitre.
Aux deux côtés de la même fenêtre étaient sculptés sur pierre, à
droite les armes du duché de Bretagne : d'hermines plein, et à
gauche celles du seigneur de Béringhen, marquis de Châteauneuf : d'argent
à trois pals de gueules, au chef d'azur chargé de deux quintes-feuilles
d'argent. Sur la deuxième fenêtre de la nef était l'écusson de
Pierre Le Gobien, archidiacre de Porhoët, décédé en 1627, qui possédait
en Saint-Méloir-des-Ondes la maison noble des Douets : coupé au 1er
d'argent à trois têtes de loup arrachées de sable, lampassées de
gueules, au canton d'azur chargé d'un croissant d'or ; au 2ème
d'argent à trois fasces ondées d'azur ; l'écu surmonté d'un chapeau
à trois glands, avec bourdon posé derrière. La famille Le Gobien
prétendait, en effet, avoir droit à une chapelle avec enfeu et
prééminences dans l'église de Saint-Méloir-des-Ondes. Sur la sacristie
et dans un autre vitrail on voyait aussi l'écusson de gueules à une
sirène d'or, qui devait être celui de la famille de Seré,
propriétaire du manoir de la Ville-Maleterre (Terrier ms. de
Châteauneuf). Il paraît qu'à l'origine le seigneur du Val-Ernoul avait
également une chapelle prohibitive en l'église de Saint-Méloir-des-Ondes,
car en 1574 Jean Le Bret, sieur de la Tréhénais, céda à Pierre Le
Filleur, sieur de la Ville-Volant, les droits d'enfeu et prééminence lui
appartenant en cette chapelle. En 1755, l'abbé du Mont Saint-Michel
confirma François Porée, sieur de Razet et propriétaire du Val-Ernoul,
dans la possession de ces privilèges (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine, B, 976). En 1687, le sire de Châteauneuf se disait
seigneur supérieur et prééminencier de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes),
mais les moines du Mont Saint-Michel prétendaient aux mêmes droits et
étaient, de plus, seigneurs fondateurs. Le même seigneur de Châteauneuf
avait un droit de quintaine sur les mariés de Saint-Méloir-des-Ondes ;
ceux-ci devaient courir, sous peine de 60 sols d'amende, le lundi de
Pâques, et ce jour-là les trésoriers de la fabrique devaient fournir aux
officiers de Châteauneuf qui présidaient la course « un chevreau
lardé, rosti, cuit et assaucé, avec quatre sols de pain et deux pots de
vin de Gascogne, et, de plus, un boisseau d'avoine pour leurs chevaux »
(Archives Nationales, P. 1721). Les confréries du Rosaire et du
Saint-Sacrement étaient au XVIIIème siècle érigées en l'église de
Saint-Méloir-des-Ondes. Il s'y trouvait aussi un bon nombre de fondations, «
formant alors une obiterie assez considérable ». Enfin, en 1708, une
mission y avait été fondée pour tous les six ans par Alain Le Breton et
Servanne Gaultier, seigneur et dame de la Plussinais (Pouillé ms. de
Saint-Malo, 1739-1767). Cette ancienne église de Saint-Méloir-des-Ondes a
fait place vers 1860 à une belle construction de style ogival, oeuvre de M.
l'architecte Frangeul. Elle se compose de trois nefs et d'un choeur en
hémicycle ; une tour en granit s'élève sur sa façade, et l'ensemble de
l'édifice a quelque chose de monumental (Pouillé de Rennes).
La flèche date de 1884. Le bénitier date du XVI-XVIIème siècle.
On y trouve un ex-voto du XXème siècle. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ancienne église possédait
trois chapelles seigneuriales. L'une des chapelle est cédée par le prieur
en 1723 à la famille le Breton seigneurs de la Plussinais en Saint-Jouan
des Guérets : elle contenait leur enfeu. Une autre chapelle (au nord du
chevet) dépendait de la seigneurie des Landes et portait les armes de la
famille le Bouteiller seigneurs des Landes de 1470 à 1620. La troisième
(au sud) appartenait au seigneurs de la Bardoulais qui y avaient un enfeu.
La maîtresse vitre portait les armes de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, de
Bretagne, de la famille de Béringhen, marquis de Châteauneuf de 1681 à
1740 et celles de la famille Le Bouteiller seigneurs des Landes, entourées
du collier de Saint-Michel. D'autres fenêtres portaient les armes des
familles Seré seigneurs de la Ville-Maleterre (au XVIIème siècle), Gobien
seigneurs des Douets (au XVI-XVIIème siècle) et Le Bouteiller ;
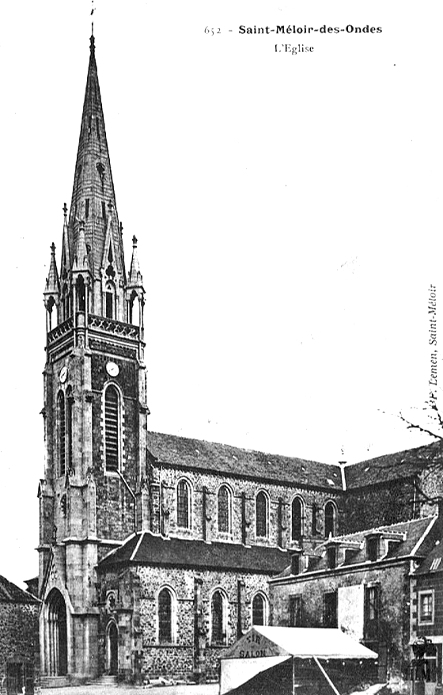
![]() la chapelle Saint-Charles (1786), ancienne
dépendance du manoir de Blessin ;
la chapelle Saint-Charles (1786), ancienne
dépendance du manoir de Blessin ;
![]() la chapelle Saint-Pierre (1720), située à la
Ville-Gilles ;
la chapelle Saint-Pierre (1720), située à la
Ville-Gilles ;
![]() la chapelle Saint-Pierre (1665), dépendance du
manoir de La Grande Coudre ;
la chapelle Saint-Pierre (1665), dépendance du
manoir de La Grande Coudre ;
![]() la chapelle Saint-Jean-Baptiste (1599),
restaurée en 1718 et 1801 ;
la chapelle Saint-Jean-Baptiste (1599),
restaurée en 1718 et 1801 ;
![]() l'ancienne
Chapelle de la Madeleine, située jadis route Paramé et aujourd'hui
disparue. On y a exhumé vers 1850 de nombreux ossements.
Elle occupait l'emplacement actuel de la Maison du Carrouge et
semble avoir dépendue à l'origine d'une léproserie. La
chapelle de la Madeleine ou Magdeleine, située en Saint-Méloir-des-Ondes,
dans les terres et à côté d'un ruisseau, était vraisemblablement une léproserie
au moyen-âge. Elle devint par la suite des temps un simple bénéfice que
possédaient au XVIème siècle Olivier du Pré, remplacé en 1557 par Jean
Régnaud, et en 1560 par autre Olivier du Pré. Le dernier chapelain, Joseph
Radon, déclara en 1790 que son bénéfice de la Magdeleine consistait en la
chapelle de ce nom, fondée d'une messe chaque samedi, — en 12 journaux de
terre, estimés 300 livres de revenu, — et en la moitié des oblations,
qui n'atteignait que 3 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,
9 G, 20). La chapelle de Sainte-Magdeleine n'existe plus, mais elle a laissé
son nom au village au milieu duquel elle se trouvait ; on voit encore la
fontaine qui avoisinait le petit sanctuaire, et jadis se tenait à côté,
à la fête de la Magdeleine, une foire qui rappelait l'antique dévotion
des habitants pour ce lieu ; cette foire a été transférée à la fin du
XIXème siècle au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes (Pouillé de Rennes) ;
l'ancienne
Chapelle de la Madeleine, située jadis route Paramé et aujourd'hui
disparue. On y a exhumé vers 1850 de nombreux ossements.
Elle occupait l'emplacement actuel de la Maison du Carrouge et
semble avoir dépendue à l'origine d'une léproserie. La
chapelle de la Madeleine ou Magdeleine, située en Saint-Méloir-des-Ondes,
dans les terres et à côté d'un ruisseau, était vraisemblablement une léproserie
au moyen-âge. Elle devint par la suite des temps un simple bénéfice que
possédaient au XVIème siècle Olivier du Pré, remplacé en 1557 par Jean
Régnaud, et en 1560 par autre Olivier du Pré. Le dernier chapelain, Joseph
Radon, déclara en 1790 que son bénéfice de la Magdeleine consistait en la
chapelle de ce nom, fondée d'une messe chaque samedi, — en 12 journaux de
terre, estimés 300 livres de revenu, — et en la moitié des oblations,
qui n'atteignait que 3 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,
9 G, 20). La chapelle de Sainte-Magdeleine n'existe plus, mais elle a laissé
son nom au village au milieu duquel elle se trouvait ; on voit encore la
fontaine qui avoisinait le petit sanctuaire, et jadis se tenait à côté,
à la fête de la Magdeleine, une foire qui rappelait l'antique dévotion
des habitants pour ce lieu ; cette foire a été transférée à la fin du
XIXème siècle au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes (Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancienne
chapelle (1644) située jadis au village des Villes-Bagues et aujourd'hui disparue ;
l'ancienne
chapelle (1644) située jadis au village des Villes-Bagues et aujourd'hui disparue ;
![]() l'ancien
prieuré de Saint-Méloir, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye
du Mont-Saint-Michel. Dès le commencement du XIème siècle, l'église de Saint-Méloir-des-Ondes
fut donnée, ainsi que celle de Cancale, à l'abbaye
du Mont Saint-Michel par Geoffroy Ier, duc de Bretagne, mort avant 1008.
Mais les moines ne demeurèrent pas d'abord paisibles possesseurs de
ces églises, qui leur furent complètement enlevées
; ce qu'apprenant le duc Alain III, vers l'an 1030, ce prince
fit rendre justice aux religieux, et confirmant les donations
faites par son père, il leur assura les églises de Saint-Méloir
et de Saint-Méen de Cancale, la terre de ce nom et le port de Portpican, «
ecclesias duas sitas in territorio quod vocatur
Pavalet scilicet Sancti Meler atque Sancti Mewen, ................ terram
quoque prope littus maris sitam que dicitur Chancavena
et portum qui nominatur Porpican ». A
partir de ce moment, Saint-Méloir ne sortit plus des mains des religieux du
Mont Saint-Michel, qui y fondèrent un prieuré (Dom Morice, Preuves
de l'Histoire de Bretagne, I, 372, 380). Vers l'an 1098, les moines se
virent disputer la possession d'une portion du cimetière de Saint-Méloir par trois personnages appelés
Guillaume Goyon, Guiguen, vicaire du pays d'Aleth,
et Drigon le Prêtre. Ils allèrent aussitôt demander justice
au tribunal du comte de Rennes, duc de Bretagne. Mais, avant que
celui-ci eût rendu sa sentence, Guillaume Goyon et ses compagnons renoncèrent à
leurs prétentions et abandonnèrent au Mont Saint-Michel, en toute propriété, la
portion du cimetière qu'ils réclamaient, et que l'acte appelle «
la première corde de ce cimetière », dénomination qui indique
à la fois et la contenance du terrain et sa situation sur le bord
extérieur de l'enclos. Ils stipulèrent toutefois que cette partie du
cimetière serait affectée exclusivement à la sépulture des
morts, sauf le droit réservé au moine et au prêtre desservant l'église
de Saint-Méloir d'y bâtir une maison à leur usage (Revue de Bretagne et
de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f° 70). On voit par là, dit M. de la
Borderie, qu'il y avait alors à Saint-Méloir tout à la fois un moine et
un prêtre séculier. Le moine était délégué par l'abbé du Mont
Saint-Michel pour régir les domaines, recevoir les revenus et exercer les
droits dont l'ensemble constituait ce qu'on appelait le prieuré de Saint-Méloir. Parmi ces droits se trouvait
à l'origine le gouvernement spirituel de la paroisse elle-même ; mais la discipline ecclésiastique ayant
interdit aux religieux l'exercice du ministère pastoral, force fut au prieur de se faire remplacer dans les
fonctions curiales par un prêtre séculier à l'entretien duquel
il dut pourvoir (Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du
Mont Saint-Michel, f° 70). C'est à propos de cette pension du
curé de Saint-Méloir qu'eut lieu la transaction suivante, datée du 30 décembre 1165,
et conclue entre ce prêtre et les religieux du Mont Saint-Michel : « Par cet arrangement,
auquel Albert, évêque de Saint-Malo, donna sa sanction, il
fut réglé que les offrandes faites par les fidèles dans l'église de Saint-Méloir seraient partagées
moitié par moitié entre le curé et les moines. Ceux-ci, toutefois,
devaient avoir les deux tiers des offrandes des jours de
Noël, de Pâques et de la Toussaint ; et, en revanche, le curé
percevait seul en totalité celles qui avaient spécialement pour
but de rémunérer quelqu'une des fonctions de son ministère
paroissial, à savoir : les offrandes des confréries, des baptêmes,
des épousailles, des confessions, et tout ce que l'église recevait dans les enterrements. Quant à la dîme des
blés, elle devait être tout entière serrée dans la grange des moines,
qui n'en donnaient au curé qu'un neuvième et gardaient le
reste pour eux. Pour faire accepter ces conditions au curé Huon, les moines lui promirent toutefois, à sa vie
durant, une rente de deux mines de seigle et deux mines d'orge » (Revue de
Bretagne et de Vendée, XXIX, 395 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f°
134). Un autre acte de 1191, par lequel l'évêque de Saint-Malo, Pierre
Giraud, confirme les biens du Mont Saint-Michel dans son diocèse,
nous apprend que si, dans les paroisses de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes)
et de Cancale, la dîme des blés appartenait aux moines pour huit neuvièmes et au curé pour
un neuvième seulement, toutes les autres dîmes, par exemple celle du croît des animaux, se partageaient
entre eux par moitié (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.
788). Un peu avant ce dernier acte, le pape Alexandre III confirma, le
27 janvier 1179, l'abbaye du Mont Saint-Michel dans la
possession des églises de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) et de Cancale, de
leurs chapelles et de leurs autres dépendances, « ecclesiam Sancti
Melorii et ecclesiam Sancti Mevenni , cum capellis et earum
pertinenciis » (Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont
Saint-Michel, II, 317). Les questions de dîme dont nous
venons de parler donnèrent lieu en 1215 à un différend assez curieux entre Geoffroy
de Thorigny, prieur de Saint-Méloir, et le curé du même lieu,
appelé Robert de Radeweie. « Il s'agissait de la dîme des vignes,
dont la culture prenait à cette époque en notre pays un
développement dont on ne se douterait guère aujourd'hui. La cause fut portée au tribunal de l'évêque de Saint-Malo,
qui fit accepter aux deux parties une transaction portant que dans
les terres changées de blé en vigne le curé aurait seulement le neuvième de la dîme et les moines le reste, mais que
dans toutes les anciennes vignes il partagerait par moitié avec les moines »
(Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 396). Peu de temps après, en 1221, Alain de Motey concéda aux
moines de Saint-Méloir l'emplacement d'une maison et certains
jardins qui avoisinaient leur manoir. En 1251, Hugues le
Champ leur donna le champ Saint-Méen, et Hamon l'Epine le fief de
l'Abbaye, le tout en Cancale. La famille Goyon, dont un membre avait d'abord
cherché chicane aux religieux, semble aussi
avoir favorisé plus tard l'établissement des religieux, comme nous
le prouvent les donations faites au prieuré de Saint-Méloir
par Olivier Goyon et Damète Goyon, femme d'Adam d'Herefort. Enfin, Richard Le Maréchal et Gervaise
de Dinan, sa femme, cédèrent aux moines les droits de juridiction
qu'ils avaient sur leurs hommes de Saint-Méloir, se réservant
seulement l'exécution des criminels condamnés à mort par le
tribunal des religieux (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.
779 - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 579, 643, 893). Le jour de la Purification 1259,
Nicolas, évêque de Saint-Malo, visita le prieuré de Saint-Méloir
et reconnut que cette maison ne lui devait
point de devoir de procuration. Cependant, vers la même époque,
les moines du Mont Saint-Michel voulurent bien accorder 6 livres par an à
l'archevêque de Tours pour son droit de
visite à Saint-Méloir, Saint-Broladre et Montdol, et 2 livres à l'évêque
de Saint-Malo pour sa visite à Saint-Méloir.
En 1682 ils payaient encore exactement ces 40 sols au prélat malouin
(Gallia christiana, XIV, 1005 - D. Le Roy, Cur. recherches sur le Mont
Saint-Michel). Le prieuré de Saint-Méloir acquit, comme l'on voit, une véritable importance. Ses
biens s'étendaient dans les paroisses de Saint-Méloir-des-Ondes, Cancale, Saint-Benoît-des-Ondes,
Saint-Coulomb et Pleurtuit. Les religieux étaient patrons et présentateurs
des cures de Saint-Méloir, Cancale et Saint-Benoît,
et prenaient dans les églises de Saint-Méloir et de Cancale
la moitié de toutes les oblations ordinaires et les deux tiers de
celles faites à Noël, à Pâques et à la Toussaint (Archives Nationales, P. 1720). Au
bourg même de Saint-Méloir se trouvait le manoir seigneurial et prioral de Saint-Méloir, avec ses grange, jardins,
cour et masures, le tout contenant 2 journaux clos de murailles ;
de cette maison dépendaient le Domaine, contenant 5 journaux de
terre, et le Pré-au-Prieur, en contenant trois. Les
moines dîmaient en 1682 comme au XIIIème siècle, c'est-à-dire
qu'ils levaient « toutes les dîmes dans les paroisses de Cancale et de
Saint-Méloir, excepté la neuvième partie, qui appartient aux recteurs
et vicaires perpétuels ; à l'égard des verdages,
lins, chanvres et prémices, le tout est partagé entre eux
et les vicaires perpétuels par moitié ; enfin, ils ont aussi les deux
tiers des dîmes dans toute la paroisse de Saint-Benoît
». Notons aussi que le port de Cancale appartenait aux-dits religieux ;
que ceux-ci jouissaient du droit de haute justice
et de plusieurs fiefs seigneuriaux, et qu'ils étaient exempts de payer
aucunes coutumes pour les vins et les provisions employés à leur usage. En
revanche, les Bénédictins devaient dire deux messes par semaine dans
l'église de Saint-Méloir, et ils étaient en outre
tenus de distribuer chaque année 4 mines de paumelle aux pauvres des
paroisses de Saint-Méloir et de Cancale. Au temps de Pierre Le Roy, abbé du Mont Saint-Michel, le
titre du prieuré de Saint-Méloir fut éteint en 1401 et ses revenus
furent unis à la mense abbatiale ; aussi en 1556 le cardinal
d'Annebault, abbé du Mont Saint-Michel, rendit-il
aveu au roi pour son prieuré de Saint-Méloir, et en 1644 Jacques de
Souvré, un de ses successeurs, afferma-t-il, entre autres dépendances de
son abbaye, « les prioré et seigneurie de Cancale et Saint-Méloir »
pour la somme de 4.000 livres, outre les charges. Notons en passant, parmi
ces redevances, « douze pots d'huile » dus aux religieux du Mont,
et 36 sols dus aux Innocents, c'est-à-dire probablement aux enfants faisant
jadis en l'abbaye la fête des Innocents (D. Le Roy, Cur. recherches sur le
Mont Saint-Michel, 735 et 772). Il n'est point fait mention dans ces actes
d'une chapelle priorale, mais nous savons que dans l'église paroissiale de
Saint-Méloir les moines avaient une chapelle prohibitive appelée chapelle
de Saint-Michel ; ils la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton, seigneur de
la Plassinais, qui y plaça son banc et son enfeu. Au sommet du principal
vitrail de cette église de Saint-Méloir on voyait encore en 1760 les
armoiries du Mont Saint-Michel : de sable à dix coquilles d'argent posées
4, 3, 2, 1, au chef d'or à trois fleurs de lys de gueules, surmontées
d'une crosse et d'une mitre. Les mêmes armoiries, accompagnées de celles
de Bretagne, se voyaient aussi sur le banc des officiers de la juridiction
seigneuriale du prieuré (Terrier ms. de la seigneurie de Châteauneuf). Les
Bénédictins du Mont Saint-Michel étaient alors considérés comme
fondateurs de l'église et seigneurs de la paroisse de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes).
En 1728, ils affermaient 3.800 livres ce qu'ils possédaient en cette
paroisse, c'est-à-dire « sept traits de dîmes, un logis prioral et
quelques fiefs et terres y annexés » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine). A la fin du XIXème siècle, on montrait encore dans le
bourg de Saint-Méloir-des-Ondes l'ancien logis prioral ; c'était une
maison insignifiante, placée au Nord et proche de l'église (abbé Guillotin de Corson).
l'ancien
prieuré de Saint-Méloir, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye
du Mont-Saint-Michel. Dès le commencement du XIème siècle, l'église de Saint-Méloir-des-Ondes
fut donnée, ainsi que celle de Cancale, à l'abbaye
du Mont Saint-Michel par Geoffroy Ier, duc de Bretagne, mort avant 1008.
Mais les moines ne demeurèrent pas d'abord paisibles possesseurs de
ces églises, qui leur furent complètement enlevées
; ce qu'apprenant le duc Alain III, vers l'an 1030, ce prince
fit rendre justice aux religieux, et confirmant les donations
faites par son père, il leur assura les églises de Saint-Méloir
et de Saint-Méen de Cancale, la terre de ce nom et le port de Portpican, «
ecclesias duas sitas in territorio quod vocatur
Pavalet scilicet Sancti Meler atque Sancti Mewen, ................ terram
quoque prope littus maris sitam que dicitur Chancavena
et portum qui nominatur Porpican ». A
partir de ce moment, Saint-Méloir ne sortit plus des mains des religieux du
Mont Saint-Michel, qui y fondèrent un prieuré (Dom Morice, Preuves
de l'Histoire de Bretagne, I, 372, 380). Vers l'an 1098, les moines se
virent disputer la possession d'une portion du cimetière de Saint-Méloir par trois personnages appelés
Guillaume Goyon, Guiguen, vicaire du pays d'Aleth,
et Drigon le Prêtre. Ils allèrent aussitôt demander justice
au tribunal du comte de Rennes, duc de Bretagne. Mais, avant que
celui-ci eût rendu sa sentence, Guillaume Goyon et ses compagnons renoncèrent à
leurs prétentions et abandonnèrent au Mont Saint-Michel, en toute propriété, la
portion du cimetière qu'ils réclamaient, et que l'acte appelle «
la première corde de ce cimetière », dénomination qui indique
à la fois et la contenance du terrain et sa situation sur le bord
extérieur de l'enclos. Ils stipulèrent toutefois que cette partie du
cimetière serait affectée exclusivement à la sépulture des
morts, sauf le droit réservé au moine et au prêtre desservant l'église
de Saint-Méloir d'y bâtir une maison à leur usage (Revue de Bretagne et
de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f° 70). On voit par là, dit M. de la
Borderie, qu'il y avait alors à Saint-Méloir tout à la fois un moine et
un prêtre séculier. Le moine était délégué par l'abbé du Mont
Saint-Michel pour régir les domaines, recevoir les revenus et exercer les
droits dont l'ensemble constituait ce qu'on appelait le prieuré de Saint-Méloir. Parmi ces droits se trouvait
à l'origine le gouvernement spirituel de la paroisse elle-même ; mais la discipline ecclésiastique ayant
interdit aux religieux l'exercice du ministère pastoral, force fut au prieur de se faire remplacer dans les
fonctions curiales par un prêtre séculier à l'entretien duquel
il dut pourvoir (Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du
Mont Saint-Michel, f° 70). C'est à propos de cette pension du
curé de Saint-Méloir qu'eut lieu la transaction suivante, datée du 30 décembre 1165,
et conclue entre ce prêtre et les religieux du Mont Saint-Michel : « Par cet arrangement,
auquel Albert, évêque de Saint-Malo, donna sa sanction, il
fut réglé que les offrandes faites par les fidèles dans l'église de Saint-Méloir seraient partagées
moitié par moitié entre le curé et les moines. Ceux-ci, toutefois,
devaient avoir les deux tiers des offrandes des jours de
Noël, de Pâques et de la Toussaint ; et, en revanche, le curé
percevait seul en totalité celles qui avaient spécialement pour
but de rémunérer quelqu'une des fonctions de son ministère
paroissial, à savoir : les offrandes des confréries, des baptêmes,
des épousailles, des confessions, et tout ce que l'église recevait dans les enterrements. Quant à la dîme des
blés, elle devait être tout entière serrée dans la grange des moines,
qui n'en donnaient au curé qu'un neuvième et gardaient le
reste pour eux. Pour faire accepter ces conditions au curé Huon, les moines lui promirent toutefois, à sa vie
durant, une rente de deux mines de seigle et deux mines d'orge » (Revue de
Bretagne et de Vendée, XXIX, 395 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f°
134). Un autre acte de 1191, par lequel l'évêque de Saint-Malo, Pierre
Giraud, confirme les biens du Mont Saint-Michel dans son diocèse,
nous apprend que si, dans les paroisses de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes)
et de Cancale, la dîme des blés appartenait aux moines pour huit neuvièmes et au curé pour
un neuvième seulement, toutes les autres dîmes, par exemple celle du croît des animaux, se partageaient
entre eux par moitié (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.
788). Un peu avant ce dernier acte, le pape Alexandre III confirma, le
27 janvier 1179, l'abbaye du Mont Saint-Michel dans la
possession des églises de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) et de Cancale, de
leurs chapelles et de leurs autres dépendances, « ecclesiam Sancti
Melorii et ecclesiam Sancti Mevenni , cum capellis et earum
pertinenciis » (Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont
Saint-Michel, II, 317). Les questions de dîme dont nous
venons de parler donnèrent lieu en 1215 à un différend assez curieux entre Geoffroy
de Thorigny, prieur de Saint-Méloir, et le curé du même lieu,
appelé Robert de Radeweie. « Il s'agissait de la dîme des vignes,
dont la culture prenait à cette époque en notre pays un
développement dont on ne se douterait guère aujourd'hui. La cause fut portée au tribunal de l'évêque de Saint-Malo,
qui fit accepter aux deux parties une transaction portant que dans
les terres changées de blé en vigne le curé aurait seulement le neuvième de la dîme et les moines le reste, mais que
dans toutes les anciennes vignes il partagerait par moitié avec les moines »
(Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 396). Peu de temps après, en 1221, Alain de Motey concéda aux
moines de Saint-Méloir l'emplacement d'une maison et certains
jardins qui avoisinaient leur manoir. En 1251, Hugues le
Champ leur donna le champ Saint-Méen, et Hamon l'Epine le fief de
l'Abbaye, le tout en Cancale. La famille Goyon, dont un membre avait d'abord
cherché chicane aux religieux, semble aussi
avoir favorisé plus tard l'établissement des religieux, comme nous
le prouvent les donations faites au prieuré de Saint-Méloir
par Olivier Goyon et Damète Goyon, femme d'Adam d'Herefort. Enfin, Richard Le Maréchal et Gervaise
de Dinan, sa femme, cédèrent aux moines les droits de juridiction
qu'ils avaient sur leurs hommes de Saint-Méloir, se réservant
seulement l'exécution des criminels condamnés à mort par le
tribunal des religieux (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.
779 - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 579, 643, 893). Le jour de la Purification 1259,
Nicolas, évêque de Saint-Malo, visita le prieuré de Saint-Méloir
et reconnut que cette maison ne lui devait
point de devoir de procuration. Cependant, vers la même époque,
les moines du Mont Saint-Michel voulurent bien accorder 6 livres par an à
l'archevêque de Tours pour son droit de
visite à Saint-Méloir, Saint-Broladre et Montdol, et 2 livres à l'évêque
de Saint-Malo pour sa visite à Saint-Méloir.
En 1682 ils payaient encore exactement ces 40 sols au prélat malouin
(Gallia christiana, XIV, 1005 - D. Le Roy, Cur. recherches sur le Mont
Saint-Michel). Le prieuré de Saint-Méloir acquit, comme l'on voit, une véritable importance. Ses
biens s'étendaient dans les paroisses de Saint-Méloir-des-Ondes, Cancale, Saint-Benoît-des-Ondes,
Saint-Coulomb et Pleurtuit. Les religieux étaient patrons et présentateurs
des cures de Saint-Méloir, Cancale et Saint-Benoît,
et prenaient dans les églises de Saint-Méloir et de Cancale
la moitié de toutes les oblations ordinaires et les deux tiers de
celles faites à Noël, à Pâques et à la Toussaint (Archives Nationales, P. 1720). Au
bourg même de Saint-Méloir se trouvait le manoir seigneurial et prioral de Saint-Méloir, avec ses grange, jardins,
cour et masures, le tout contenant 2 journaux clos de murailles ;
de cette maison dépendaient le Domaine, contenant 5 journaux de
terre, et le Pré-au-Prieur, en contenant trois. Les
moines dîmaient en 1682 comme au XIIIème siècle, c'est-à-dire
qu'ils levaient « toutes les dîmes dans les paroisses de Cancale et de
Saint-Méloir, excepté la neuvième partie, qui appartient aux recteurs
et vicaires perpétuels ; à l'égard des verdages,
lins, chanvres et prémices, le tout est partagé entre eux
et les vicaires perpétuels par moitié ; enfin, ils ont aussi les deux
tiers des dîmes dans toute la paroisse de Saint-Benoît
». Notons aussi que le port de Cancale appartenait aux-dits religieux ;
que ceux-ci jouissaient du droit de haute justice
et de plusieurs fiefs seigneuriaux, et qu'ils étaient exempts de payer
aucunes coutumes pour les vins et les provisions employés à leur usage. En
revanche, les Bénédictins devaient dire deux messes par semaine dans
l'église de Saint-Méloir, et ils étaient en outre
tenus de distribuer chaque année 4 mines de paumelle aux pauvres des
paroisses de Saint-Méloir et de Cancale. Au temps de Pierre Le Roy, abbé du Mont Saint-Michel, le
titre du prieuré de Saint-Méloir fut éteint en 1401 et ses revenus
furent unis à la mense abbatiale ; aussi en 1556 le cardinal
d'Annebault, abbé du Mont Saint-Michel, rendit-il
aveu au roi pour son prieuré de Saint-Méloir, et en 1644 Jacques de
Souvré, un de ses successeurs, afferma-t-il, entre autres dépendances de
son abbaye, « les prioré et seigneurie de Cancale et Saint-Méloir »
pour la somme de 4.000 livres, outre les charges. Notons en passant, parmi
ces redevances, « douze pots d'huile » dus aux religieux du Mont,
et 36 sols dus aux Innocents, c'est-à-dire probablement aux enfants faisant
jadis en l'abbaye la fête des Innocents (D. Le Roy, Cur. recherches sur le
Mont Saint-Michel, 735 et 772). Il n'est point fait mention dans ces actes
d'une chapelle priorale, mais nous savons que dans l'église paroissiale de
Saint-Méloir les moines avaient une chapelle prohibitive appelée chapelle
de Saint-Michel ; ils la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton, seigneur de
la Plassinais, qui y plaça son banc et son enfeu. Au sommet du principal
vitrail de cette église de Saint-Méloir on voyait encore en 1760 les
armoiries du Mont Saint-Michel : de sable à dix coquilles d'argent posées
4, 3, 2, 1, au chef d'or à trois fleurs de lys de gueules, surmontées
d'une crosse et d'une mitre. Les mêmes armoiries, accompagnées de celles
de Bretagne, se voyaient aussi sur le banc des officiers de la juridiction
seigneuriale du prieuré (Terrier ms. de la seigneurie de Châteauneuf). Les
Bénédictins du Mont Saint-Michel étaient alors considérés comme
fondateurs de l'église et seigneurs de la paroisse de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes).
En 1728, ils affermaient 3.800 livres ce qu'ils possédaient en cette
paroisse, c'est-à-dire « sept traits de dîmes, un logis prioral et
quelques fiefs et terres y annexés » (Archives départementales
d'Ille-et-Vilaine). A la fin du XIXème siècle, on montrait encore dans le
bourg de Saint-Méloir-des-Ondes l'ancien logis prioral ; c'était une
maison insignifiante, placée au Nord et proche de l'église (abbé Guillotin de Corson).
![]() la
croix de la Jeannais (1774), située près de l'ancien manoir de la Jeannais.
Elle mesure 1,35 mètre de haut et les bras fortement pattés mesurent 0,75
mètre de long. Cette croix est érigée à l'occasion d'une mission donnée
en 1774 (mai-juin) par les Missionnaires du Saint-Esprit, établis à
Saint-Laurent-sur-Sèvre : "La procession générale de clôture se
fit le Dimanche 12 juin, à laquelle M. Jacob, vicaire général de
Saint-Malo, porta le Saint Sacrement au reposoir construit dans le bois de
la Jannays. Ces Messieurs Missionnaires ont obtenu de Mgr l'Evêque de
Saint-Malo une indulgence de quarante jours pour toutes les personnes qui
auront fait une neuvaine au pied de la croix de la Mission, qu'elles
gagneront toutes les fois qu'elles y réciteront cinq pater et cinq ave,
pendant que la croix subsistera... Nicolas Chapel, recteur de
Saint-Méloir-des-Ondes, etc ...". La croix a été depuis mise au bord de la route ;
la
croix de la Jeannais (1774), située près de l'ancien manoir de la Jeannais.
Elle mesure 1,35 mètre de haut et les bras fortement pattés mesurent 0,75
mètre de long. Cette croix est érigée à l'occasion d'une mission donnée
en 1774 (mai-juin) par les Missionnaires du Saint-Esprit, établis à
Saint-Laurent-sur-Sèvre : "La procession générale de clôture se
fit le Dimanche 12 juin, à laquelle M. Jacob, vicaire général de
Saint-Malo, porta le Saint Sacrement au reposoir construit dans le bois de
la Jannays. Ces Messieurs Missionnaires ont obtenu de Mgr l'Evêque de
Saint-Malo une indulgence de quarante jours pour toutes les personnes qui
auront fait une neuvaine au pied de la croix de la Mission, qu'elles
gagneront toutes les fois qu'elles y réciteront cinq pater et cinq ave,
pendant que la croix subsistera... Nicolas Chapel, recteur de
Saint-Méloir-des-Ondes, etc ...". La croix a été depuis mise au bord de la route ;
![]() l'ancienne
croix brisée (XVIème siècle), située près du manoir des Douets. Non
loin de la Ville-ès-Gars, vers le Nord-Ouest, à 500 mètres de la route,
s'élevait jadis, près du manoir de ce nom, la chapelle
Saint-Pierre-des-Douets. Cette chapelle avait été bâtie au XVIIème
siècle par Jean Le Gobien et Simone Artur, seigneur et dame de
Launay-Quinart. La chapelle a disparu, mais près de là, on voit une
vieille croix du XVIème siècle ou du XVIIème siècle. Jadis, dans le
cimetière frairien, ses débris gisent aujourd'hui entre le clos et la
ferme. C'était une croix octogonale, semée sur ses pans coupés de
cabochons ronds, ornée à sa face d'un Christ en relief, et sans image au
revers. Seuls subsistaient au début du XXème siècle, posés sur le gazon,
la tête et les bras, hauts de 0,48 mètre ;
l'ancienne
croix brisée (XVIème siècle), située près du manoir des Douets. Non
loin de la Ville-ès-Gars, vers le Nord-Ouest, à 500 mètres de la route,
s'élevait jadis, près du manoir de ce nom, la chapelle
Saint-Pierre-des-Douets. Cette chapelle avait été bâtie au XVIIème
siècle par Jean Le Gobien et Simone Artur, seigneur et dame de
Launay-Quinart. La chapelle a disparu, mais près de là, on voit une
vieille croix du XVIème siècle ou du XVIIème siècle. Jadis, dans le
cimetière frairien, ses débris gisent aujourd'hui entre le clos et la
ferme. C'était une croix octogonale, semée sur ses pans coupés de
cabochons ronds, ornée à sa face d'un Christ en relief, et sans image au
revers. Seuls subsistaient au début du XXème siècle, posés sur le gazon,
la tête et les bras, hauts de 0,48 mètre ;
![]() les
deux petites croix jumelles en granit, situées route de
Saint-Benoit-des-Ondes à Paramé : "... sur un socle cubique
allongé, haut de 0,50 m, se dressent deux petites croix carrées : celle de
l'Est, haute de 0,45 m, celle de l'Ouest, de 0,38 m". On rapporte :
"qu'il y a une trentaine d'années, les gens qui, du Nord et de
l'Est de la paroisse, apportaient un mort à l'église, s'arrêtaient
toujours au pâtis des Portes. Ils ôtaient les deux croix et déposaient la
châsse sur la pierre ; après un instant de repos, ils se remettaient en
route et franchissaient la dernière étape" . Sur la même route,
toujours aux Portes, et au lieu dit la Croix de Lormel, se trouvaient jadis
aussi deux croix de pierre, la première ruinée aujourd'hui, la seconde disparue ;
les
deux petites croix jumelles en granit, situées route de
Saint-Benoit-des-Ondes à Paramé : "... sur un socle cubique
allongé, haut de 0,50 m, se dressent deux petites croix carrées : celle de
l'Est, haute de 0,45 m, celle de l'Ouest, de 0,38 m". On rapporte :
"qu'il y a une trentaine d'années, les gens qui, du Nord et de
l'Est de la paroisse, apportaient un mort à l'église, s'arrêtaient
toujours au pâtis des Portes. Ils ôtaient les deux croix et déposaient la
châsse sur la pierre ; après un instant de repos, ils se remettaient en
route et franchissaient la dernière étape" . Sur la même route,
toujours aux Portes, et au lieu dit la Croix de Lormel, se trouvaient jadis
aussi deux croix de pierre, la première ruinée aujourd'hui, la seconde disparue ;
![]() la
croix de Lessart, située près du village de la Beuglais. Carrée, très
fruste, elle mesure 1,65 mètre de haut, et ses bras sont longs de 1 mètre.
Des restes d'une croix se trouvait jadis également sur la route de
Saint-Méloir-des-Ondes au Mur Blanc (débris d'une "croix mutilée
d'un bras" mesurant 0,70 mètre) ;
la
croix de Lessart, située près du village de la Beuglais. Carrée, très
fruste, elle mesure 1,65 mètre de haut, et ses bras sont longs de 1 mètre.
Des restes d'une croix se trouvait jadis également sur la route de
Saint-Méloir-des-Ondes au Mur Blanc (débris d'une "croix mutilée
d'un bras" mesurant 0,70 mètre) ;
![]() la croix de Pont-Benoît (fin du Moyen Age
– XVIème siècle) ;
la croix de Pont-Benoît (fin du Moyen Age
– XVIème siècle) ;
![]() la
croix de la Grande Fontaine. Il s'agit d'un simple monolithe rond de 0,80
mètre, à la tête d'une hauteur disproportionnée, et aux bras longs
seulement de 0,40 mètre. Elle reposait directement, sans socle, sur la terre ;
la
croix de la Grande Fontaine. Il s'agit d'un simple monolithe rond de 0,80
mètre, à la tête d'une hauteur disproportionnée, et aux bras longs
seulement de 0,40 mètre. Elle reposait directement, sans socle, sur la terre ;
![]() l'ancien
calvaire du cimetière, aujourd'hui disparu et situé jadis en face de
l'entrée de l'ancienne église. Quant, vers 1856, on démolit celle-ci,
pour construire l'église actuelle, le calvaire est détruit avec elle et il
n'est point replacé ailleurs ;
l'ancien
calvaire du cimetière, aujourd'hui disparu et situé jadis en face de
l'entrée de l'ancienne église. Quant, vers 1856, on démolit celle-ci,
pour construire l'église actuelle, le calvaire est détruit avec elle et il
n'est point replacé ailleurs ;
![]() l'ancienne
croix de Radegonde. Ce calvaire se trouvait jadis à proximité de
l'ancienne chapelle du Grand Porcon. Ce calvaire a du disparaître en 1868.
On sait que les eaux de la fontaine Sainte-Radegonde guérissaient les
enfants de la lèpre appelé "Mal Saint-Aragon" ;
l'ancienne
croix de Radegonde. Ce calvaire se trouvait jadis à proximité de
l'ancienne chapelle du Grand Porcon. Ce calvaire a du disparaître en 1868.
On sait que les eaux de la fontaine Sainte-Radegonde guérissaient les
enfants de la lèpre appelé "Mal Saint-Aragon" ;
![]() les
anciennes croix Gibouin, situées jadis près de Paramé, à l'entrée de la
ferme de ce nom et en face de la Chipaudière. De formes cylindriques, elles
se dressaient sur une forte maçonnerie qui contenait, dit-on, les débris
de deux petites croix anciennes ;
les
anciennes croix Gibouin, situées jadis près de Paramé, à l'entrée de la
ferme de ce nom et en face de la Chipaudière. De formes cylindriques, elles
se dressaient sur une forte maçonnerie qui contenait, dit-on, les débris
de deux petites croix anciennes ;
![]() les
autres anciennes croix, aujourd'hui disparues : de Cloceis, la "Croix-de-Bois",
à Fougeray, et à La Ville-au-Gars. Concernant cette dernière (mutilée de
la tête et d'un bras), elle avait été réduite à une hauteur de 0,75
mètre et gisait un moment donné au bord d'un chemin ;
les
autres anciennes croix, aujourd'hui disparues : de Cloceis, la "Croix-de-Bois",
à Fougeray, et à La Ville-au-Gars. Concernant cette dernière (mutilée de
la tête et d'un bras), elle avait été réduite à une hauteur de 0,75
mètre et gisait un moment donné au bord d'un chemin ;
![]() le manoir le Vieux Vaulerault (1503).
Le château du Vaulerault, situé route de Cancale, est la propriété de la
famille Romelin en 1513, puis de la famille de Lorgeril et Dartige du Fournet ;
le manoir le Vieux Vaulerault (1503).
Le château du Vaulerault, situé route de Cancale, est la propriété de la
famille Romelin en 1513, puis de la famille de Lorgeril et Dartige du Fournet ;
![]() le manoir de Blessin (vers 1660).
Il possédait jadis une chapelle édifiée en 1619 et qui a été
reconstruite et bénite en 1786. La chapelle Saint-Charles du Blessin fut
rebâtie en 1619 (ou 1622) près de cette maison par François Nouail, sieur
du Blessin, qui y fonda trois messes hebdomadaires, les dimanche, lundi et
vendredi. Pierre Le Breton, chanoine de Dol, en était chapelain vers 1728 ;
il eut pour successeur en 1729 Guillaume Guimont, que présenta Alain Le
Breton, seigneur de la Plussinais et du Blessin ; mais en 1764 la chapelle
du Blessin n'était plus desservie (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Breton
seigneurs de la Plussinais au XVIIIème siècle ;
le manoir de Blessin (vers 1660).
Il possédait jadis une chapelle édifiée en 1619 et qui a été
reconstruite et bénite en 1786. La chapelle Saint-Charles du Blessin fut
rebâtie en 1619 (ou 1622) près de cette maison par François Nouail, sieur
du Blessin, qui y fonda trois messes hebdomadaires, les dimanche, lundi et
vendredi. Pierre Le Breton, chanoine de Dol, en était chapelain vers 1728 ;
il eut pour successeur en 1729 Guillaume Guimont, que présenta Alain Le
Breton, seigneur de la Plussinais et du Blessin ; mais en 1764 la chapelle
du Blessin n'était plus desservie (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Breton
seigneurs de la Plussinais au XVIIIème siècle ;
Nota : Sur la route de Saint-Benoît, le Blessin s'annonce par sa chapelle dédiée à Saint-Charles, à belle façade surmontée d'un campanile de granit flanqué à droite et à gauche et à hauteur de la corniche d'un vase dorique. Envahie de végétation, entourée d'arbuste, cette jolie chapelle, bénite en 1786, servait au public et devenait, chaque novembre, un lieu de pélerinage marin. Lorsque les terre-neuvas tardaient à rentrer des bancs, les Cancalaises venaient à la chapelle et là, chacune munie d'une bougie, mères, épouses, sœurs, fiancées faisaient le tour de la chapelle dans le sens où le vent devrait tourner pour favoriser le retour des absents. Entrant à l'intérieur pour y prier et mettre leur obole, elles sortaient ensuite et, avec leur tablier, dirigeaient le vent du côté désiré. Face à la chapelle se tient le nouveau Blessin, construction empire sans caractère. Plus bas, sur le côté droit de la route, s'élève encore le vrai Blessin, datant du XVIIème et fief des Le Breton, sieurs de la Plussinais. dont l'un des membres, arrêté sous la Révolution, fut emmené à Paris pour y être guillotiné. Mais, en route, la nouvelle de la mort de Robespierre le fit relâcher par ses geôliers. Un malouin célèbre fit ensuite sa demeure du Blessin en 1831, Pierre-Louis Boursaint, haut fonctionnaire du ministère de la marine, homme remarquable, philanthrope mais bizarre et dont la fin tragique couronna le destin étrange. Avant son suicide, en 1833, à Saint-Germain-en-Laye, il avait institué les marins et veuves de matelots de Saint-Malo ses légataires universels. (Daniel Derveaux).
![]() le manoir de la Grande-Coudre (XVI-XVIIème
siècle). Ce manoir est remanié en 1665. Il conserve un colombier du XVIIème siècle,
restauré au XXème siècle, ainsi qu'une
chapelle sécularisée dédiée à Saint-Pierre et construite en 1665.
Pierre Pépin et Guillemette Salmon, seigneur et dame de la Couldre, la
Vieuville et Villepépin, ayant fait bâtir une chapelle à leur manoir de
la Couldre, y fondèrent le 3 juillet 1655 quatre messes par semaine. Jean
Le Nepveu, Joseph Goret de Villepépin, doyen et chanoine de Saint-Malo,
puis Alexis Rouault, desservirent au XVIIIème siècle cette chapelle, dont
le revenu était de 285 livres en 1790 (Pouillé de Rennes). Propriété successive des
familles Rouxel (en 1513), Pepin ou Pépin seigneurs du Chênaie (en 1665), Baillon
(au XVIIIème siècle). Ancienne propriété de la famille Surcouf ;
le manoir de la Grande-Coudre (XVI-XVIIème
siècle). Ce manoir est remanié en 1665. Il conserve un colombier du XVIIème siècle,
restauré au XXème siècle, ainsi qu'une
chapelle sécularisée dédiée à Saint-Pierre et construite en 1665.
Pierre Pépin et Guillemette Salmon, seigneur et dame de la Couldre, la
Vieuville et Villepépin, ayant fait bâtir une chapelle à leur manoir de
la Couldre, y fondèrent le 3 juillet 1655 quatre messes par semaine. Jean
Le Nepveu, Joseph Goret de Villepépin, doyen et chanoine de Saint-Malo,
puis Alexis Rouault, desservirent au XVIIIème siècle cette chapelle, dont
le revenu était de 285 livres en 1790 (Pouillé de Rennes). Propriété successive des
familles Rouxel (en 1513), Pepin ou Pépin seigneurs du Chênaie (en 1665), Baillon
(au XVIIIème siècle). Ancienne propriété de la famille Surcouf ;
Nota : La Coudre, propriété en 1947 de Monsieur Le Masson, est un curieux et rare ensemble que celui formé par la chapelle, le colombier, l'ancien manoir, la ferme, un étang et un petit boqueteau, clos de murs interminables. La chapelle Saint-Pierre se présente la première. Datant de 1665, sa porte est en plein cintre, surmontée d'une niche cintrée flanquée de pilastres supportant une corniche moulurée. Les gargouilles de granit sont en forme de canon. Sous le toit court une corniche modillonnée. Tout proche et à cheval sur le mur d'enceinte comme la chapelle, le colombier joue les donjons, avec son toit aigu et ses étroites ouvertures. Une bande de carreaux de faience court sous sa corniche. Quant au manoir, considéré de l'étang. il affecte un peu l'allure d'un château fort en miniature. Sa façade ouest, donnant sur une courette close, a conservé beaucoup de caractère avec la tourelle d'angle, une lucarne à fronton demi-circulaire, la cheminée à couronnement mouluré, des fenêtres à appuis décorés et un crépi lépreux où lierre et vigne vierge dessinent leurs délicats réseaux. Paisible retraite que durent apprécier les Pépin, sieurs du Chesnaie, seigneurs des lieux au XVIIème, les Baillon au XVIIIème siècle et les Surcouf plus récemment. (Daniel Derveaux).
![]() la malouinière du Parc (XVI-XVIIème siècle),
édifiée en 1599 par Guillemette Salmon. Propriété de Magon de La Giclais en 1727.
L'ancien manoir du Parc, situé dans le village de la Beuglais, possédait une chapelle privée
datée du XVIème siècle et réparée en 1718 et 1801. Jean Nouail et
Rosalie Miniac, seigneur et dame du Parc, bâtirent cette chapelle, dédiée
à Saint-Jean-Baptiste, en 1718 dans la cour de leur manoir. Le recteur, M.
Dabin, n'y consentit toutefois qu'à la condition expresse qu'on y ferait le
catéchisme tous les dimanches et fêtes ; il fit la bénédiction du nouvel
édifice le 9 mai 1719. Dès le 18 avril précédent Jean Nouail avait fondé
en sa chapelle une messe pour tous les dimanches et fêtes ; il la dota de
100 livres de rente et présenta pour la desservir Joseph Porée du Parc,
chanoine et chantre de Saint-Malo ; ce dernier eut pour successeurs Pierre
Nouail, également chantre et chanoine de Saint-Malo, et Sébastien Le Maître
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Ce
dernier assista au mariage princier qui illustra ce petit sanctuaire du
Parc. Le 22 février 1781, en effet, le prince Eugène de Savoie-Carignan,
fils de S. A. S. Louis prince de Savoie-Carignan et de la princesse
Christine de Rheinsfeld, colonel propriétaire du régiment de Savoie, au
service de la France sous le nom de comte de Villefranche, épousa dans la
chapelle du Parc Elisabeth Magon de Boisgarin (ou Bois-Garin), fille de François
Magon, seigneur de Boisgarin, et de Louise de Karuel, demeurant au Parc.
Cette union fut bénite par Joseph Morin, chanoine de Saint-Malo, en présence
de M. Chapel, recteur de Saint-Méloir-des-Ondes, et d'un petit nombre
d'invités (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Boullain (en 1634), Porée (en 1648 et en 1674),
Nouail (en 1718), Magon seigneurs du Bois-Garin (au XVIIIème siècle) ;
la malouinière du Parc (XVI-XVIIème siècle),
édifiée en 1599 par Guillemette Salmon. Propriété de Magon de La Giclais en 1727.
L'ancien manoir du Parc, situé dans le village de la Beuglais, possédait une chapelle privée
datée du XVIème siècle et réparée en 1718 et 1801. Jean Nouail et
Rosalie Miniac, seigneur et dame du Parc, bâtirent cette chapelle, dédiée
à Saint-Jean-Baptiste, en 1718 dans la cour de leur manoir. Le recteur, M.
Dabin, n'y consentit toutefois qu'à la condition expresse qu'on y ferait le
catéchisme tous les dimanches et fêtes ; il fit la bénédiction du nouvel
édifice le 9 mai 1719. Dès le 18 avril précédent Jean Nouail avait fondé
en sa chapelle une messe pour tous les dimanches et fêtes ; il la dota de
100 livres de rente et présenta pour la desservir Joseph Porée du Parc,
chanoine et chantre de Saint-Malo ; ce dernier eut pour successeurs Pierre
Nouail, également chantre et chanoine de Saint-Malo, et Sébastien Le Maître
(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Ce
dernier assista au mariage princier qui illustra ce petit sanctuaire du
Parc. Le 22 février 1781, en effet, le prince Eugène de Savoie-Carignan,
fils de S. A. S. Louis prince de Savoie-Carignan et de la princesse
Christine de Rheinsfeld, colonel propriétaire du régiment de Savoie, au
service de la France sous le nom de comte de Villefranche, épousa dans la
chapelle du Parc Elisabeth Magon de Boisgarin (ou Bois-Garin), fille de François
Magon, seigneur de Boisgarin, et de Louise de Karuel, demeurant au Parc.
Cette union fut bénite par Joseph Morin, chanoine de Saint-Malo, en présence
de M. Chapel, recteur de Saint-Méloir-des-Ondes, et d'un petit nombre
d'invités (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Boullain (en 1634), Porée (en 1648 et en 1674),
Nouail (en 1718), Magon seigneurs du Bois-Garin (au XVIIIème siècle) ;
Nota : Grandeur et décadence des vieilles demeures ! Quelle autre que le Parc, le « Château de la Princesse » pourrait s'en plaindre avec autant de titres, lui qui connut les fastes d'un mariage princier dans sa chapelle, dénouement d'un joli roman entre la fille du châtelain. Elisabeth de Boisgarein, et le prince de Savoie-Carignan. Aujourd'hui, l'écurie se loge dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste et le fermier-propriétaire occupe l'ancien manoir. L'avenue de chênes menant de la route au Parc n'existe plus. On entre ainsi directement dans la cour d'honneur où, pourtant, la façade principale a gardé noble allure. La partie centrale, construite par Guillemette Salmon à la fin du XVIème siècle, possède de fort belles fenêtres à encadrements chanfreinés et appuis moulurés, le linteau de l'une d'elles porte le nom de la fondatrice et la date 1599. Les moulures d'encadrement de la porte d'entrée se terminent de chaque côté, au ras du sol, par un masque de grotesque. Sur le toit à pente aiguë, deux superbes lucarnes renaissance à fronton demi-circulaire sommé de pommes de pin et supporté par deux pilastres, se révèlent uniques dans le Clos Poulet. De chaque côté du corps central, un pavillon plus récent et moins élevé, flanqué de hautes cheminées, achève de donner au Parc une allure très malouinière, bien qu'il soit très antérieur à ce style. D'ailleurs, la façade nord, extrêmement curieuse par les constructions successives qui s'y sont soudées au cours des siècles, possède toujours, noyée au milieu de ces dernières, la tourelle carrée de l'escalier intérieur du manoir. Un étang, dallé et bordé de Saint-Cast, encadre encore de ses deux ailes en équerre le jardin transformé en potager et verger. En 1613, à la mort de Guillemette Salmon, veuve de Pierre Boullain, le Parc échut à noble homme Richard Boullain, sieur de la Bardoulais qui l'habita jusqu'à sa mort, en 1635. Michel Porée, sieur du Parc, l'acquit ensuite pour la léguer à son fils, procureur fiscal de Saint-Malo de 1611 à 1626. Celui-ci mourut en 1660, laissant deux fils : Thomas, chanoine de Saint-Malo. seigneur de La Gouesnière et Nicolas, seigneur du Parc et de la Bardoulais, conseiller du roi au Parlement. Le fils de Nicolas, René, chanoine de Saint-Malo, céda le Parc, en 1711, à Jean Nouail (qui construisit la chapelle en 1718). Le Parc passa ensuite à Marie Nouail, demoiselle du Parc, qui épousa à Saint-Malo, le 19 novembre 1727, Messire Jean-Baptiste Magon, seigneur de la Giclais, mestre de camp du Régiment de Berry-Infanterie, chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Leur fils, Jean-François Magon, seigneur du Parc, leur succéda. Marié en 1754 à Louise de Karuel, il prit le nom de la terre de sa femme, Boisgarein, située en Spézet dans les montagnes d'Arrée. C'est la fille de Jean de Boisgarein. Elisabeth, qui devait jeter l'émoi dans une cour d'Europe en épousant Eugène de Savoie-Carignan, fils cadet du prince régnant Louis-Victor de Savoie, frère de la princesse de Lamballe. Elle l'avait rencontré à Saint-Malo alors que, sous le nom de comte de Villafranca, le jeune prince commandait le régiment de Savoie-Carignan, en garnison dans la Cité corsaire. Le mariage fut béni par l'évêque de Saint-Malo qui accorda des dispenses pour la publication des bans à Turin. Un héritier naquit de cette union, qui devint colonel et baron d'Empire, reprit le titre de comte de Villefranche sous Louis XVIII et épousa la fille du duc de la Vauguyon. Le fils qu'il en eut redevint, par décret, prince de Savoie, titre qu'il porta le dernier. Un second décret, promulgué en 1834 par le roi de Sardaigne Charles-Albert, l'institua héritier présomptif du trône en cas d'extinction mâle de la branche régnante. Le petit-fils d'Elisabeth exerça effectivement la régence durant les guerres de l'indépendance italienne. Madame de Boisgarein, bisaïeule de ce personnage, résida au Parc jusqu'en 1809 où lui succéda la famille Le Fer. (Daniel Derveaux).
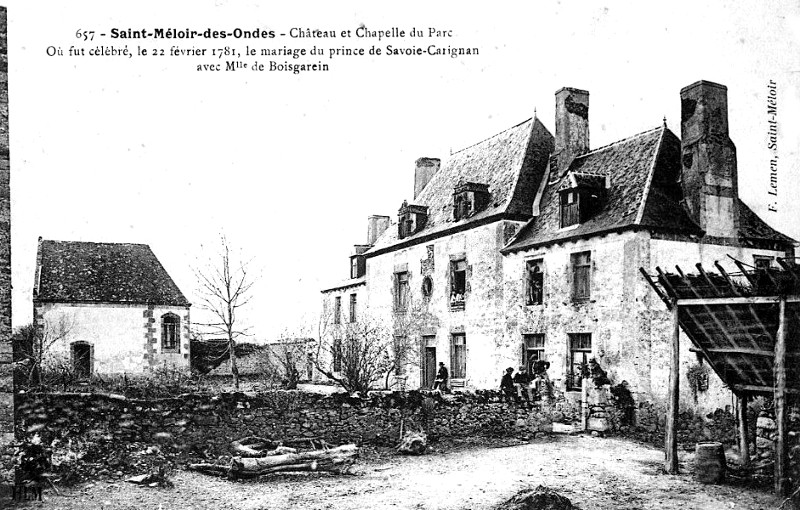
![]() la malouinière de Vaulerault (1710), édifiée
par Cheville du Vaulerault ;
la malouinière de Vaulerault (1710), édifiée
par Cheville du Vaulerault ;
Nota : La belle malouinière du Vaulérault, aspectée également est-ouest, se présente sous le signe de l'architecture de Versailles revue par Garangeau. Demeure, jardin, terrasse tout y procède du style Louis XIV. La mer, tout simplement, sert à la fois d'horizon et de miroir d'eau, et ceci dès la terrasse à la suite du jardin à la française. C'est une particularité à souligner, que les corsaires malouins ne s'établissaient que très rarement en bordure de mer. A Saint-Malo ou au long de leurs courses océanes, ils la voyaient tant, qu'ils aspiraient à en reposer leur vue par de la verdure. Le Vaulérault est le seul à regarder vraiment la pleine mer. Il est vrai que le spectacle n'est pas quelconque : toute la baie de Cancale, les côtes de Normandie et, en face, à sept lieues à peine, le Mont-Saint-Michel sur l'or des sables où l'émeraude des eaux. Seules ainsi conçues dans le Clos, les deux façades sont ornées d'un pavillon central, saillant à peine sur le reste et surmonté d'un fronton surbaissé. Les encadrements des fenêtres, les corniches, cordons d'angles et les lucarnes sont en granit. Les cheminées, toutefois, ne sont pas monumentales. Bâtie par Cheville, sieur du Vaulérault, la demeure passa successivement aux familles de la Buharais. Charril des Mazures, Gougeon, Langlois et de Lorgeril. Elle est passée en dernier lieu, par alliance, aux Dartige du Fournet qui l'habitent encore en 1947. Avant de quitter le Vaulérault, il faut aller jeter un coup d'œil à la vieille ferme qui en dépend, et qui doit être l'ancien manoir des Romelin, datant du début du XVIème, avec sa jolie porte cintrée à chanfreins et son bandeau extérieur mouluré. A l'intérieur, l'escalier à vis vous mènera dans une grande pièce ornée d'une cheminée monumentale en beau granit blanc. Le manteau s’orne d'un écusson chargé du monogramme IHS, tandis que les piliers de soutènement, sculptés, accusent l'époque Renaissance. (Daniel Derveaux).
![]() la malouinière (1719), érigée par Alain
Porée (armateur malouin). Propriété de Robert de Lamennais en 1759. L'ancien
manoir du Grand Val d'Ernon, situé non loin du village de Blessin,
est la propriété de la famille Porée seigneurs de Razet en 1755, puis de
la famille Robert de la Mennais ;
la malouinière (1719), érigée par Alain
Porée (armateur malouin). Propriété de Robert de Lamennais en 1759. L'ancien
manoir du Grand Val d'Ernon, situé non loin du village de Blessin,
est la propriété de la famille Porée seigneurs de Razet en 1755, puis de
la famille Robert de la Mennais ;
Nota : Un peu plus bas sur la route, s'amorce le chemin du Grand Val Ernoul, dont les terrasses étagées, soutenues par des rangées de contreforts massifs, contemplaient jadis la mer déferlant à leur pied. Cette superbe gentilhommière, datée 1719, fut sans doute construite par les Porée, seigneurs de Razet qui la vendirent vers 1759. Robert Mennais, père de La Mennais, l'acquit vers cette époque. La famille Caujole, qui en est la propriétaire en 1947, la possède depuis 1818. C'est à présent une ferme importante et les boiseries Louis XV, remisées au grenier, ont cédé la place à l'appareillage nécessaire à toute exploitation agricole. (Daniel Derveaux).
![]() la malouinière de la Ville-Gilles (1721),
édifiée par Quentin Nouail de la Villegilles. L'ancien
manoir de la Ville-Gilles ou de la Virgile, situé route de
Saint-Servan-sur-Mer, possède une chapelle privée dédiée jadis à
Saint-Pierre et qui date de 1721. Pierre-François Nouail, sieur du Fougeray,
construisit cette chapelle et la dota, le 19 août 1721, de deux messes par
semaine. Sa femme, Julienne de la Haye, voulant augmenter cette chapellenie,
fonda par testament deux autres messes hebdomadaires. Jean-Baptiste Nouail
fut pourvu en 1742 de ce bénéfice, qui valait en 1790 584 livres de revenu
net, parce qu'on y avait uni la fondation des Landes. La chapelle de la
Ville-Gilles, encore entretenue, est dédiée présentement à la Sainte
Vierge (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Tirecoq (en 1513), Nouail seigneurs du Fougeray (en
1721), Claparède et Santos-Cottin ;
la malouinière de la Ville-Gilles (1721),
édifiée par Quentin Nouail de la Villegilles. L'ancien
manoir de la Ville-Gilles ou de la Virgile, situé route de
Saint-Servan-sur-Mer, possède une chapelle privée dédiée jadis à
Saint-Pierre et qui date de 1721. Pierre-François Nouail, sieur du Fougeray,
construisit cette chapelle et la dota, le 19 août 1721, de deux messes par
semaine. Sa femme, Julienne de la Haye, voulant augmenter cette chapellenie,
fonda par testament deux autres messes hebdomadaires. Jean-Baptiste Nouail
fut pourvu en 1742 de ce bénéfice, qui valait en 1790 584 livres de revenu
net, parce qu'on y avait uni la fondation des Landes. La chapelle de la
Ville-Gilles, encore entretenue, est dédiée présentement à la Sainte
Vierge (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Tirecoq (en 1513), Nouail seigneurs du Fougeray (en
1721), Claparède et Santos-Cottin ;
Nota : La Ville-Gilles, est un beau spécimen de construction malouine du début du XVIIIème siècle, à large escalier s'ouvrant dès le vestibule d'entrée. La chapelle Saint-Pierre, qui date de 1721, donne sur la belle rabine menant à la grand'route. Les Nouail, seigneurs du Fougeray, en furent les premiers occupants et la conservèrent tout le XVIIIème. Cette famille possédait également la riche seigneurie des Landes, non loin de la Ville-Gilles. Les bâtiments fermiers subsistants et les anciennes douves donnent une idée de l'importance des Landes. En 1590, une garnison de ligueurs y tenait le parti de Mercœur. (Daniel Derveaux).
![]() la
fontaine située près de l'ancienne chapelle frairienne de la Madeleine ;
la
fontaine située près de l'ancienne chapelle frairienne de la Madeleine ;
![]() un fourneau "potager" (XVIème
siècle) ;
un fourneau "potager" (XVIème
siècle) ;
![]() 11 moulins dont les moulins à vent de la Bardoulais, de
Vaulerault, de la Coudre, deux de Nielles, deux du bourg, du Pont-Benoit, de la
Grande-Roche, des Landes, de Fringonet ;
11 moulins dont les moulins à vent de la Bardoulais, de
Vaulerault, de la Coudre, deux de Nielles, deux du bourg, du Pont-Benoit, de la
Grande-Roche, des Landes, de Fringonet ;
A signaler aussi :
![]() des sites gallo-romains ;
des sites gallo-romains ;
![]() des haches polies (époque néolithique) ;
des haches polies (époque néolithique) ;
![]() l'ancien
manoir prioral, situé au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes ;
l'ancien
manoir prioral, situé au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes ;
![]() l'ancien
manoir du Pavillon, situé route de Cancale. Propriété de la famille
Poulain seigneurs du Chênaie au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir du Pavillon, situé route de Cancale. Propriété de la famille
Poulain seigneurs du Chênaie au XVIIIème siècle ;
![]() la
maison du Tertre-Janson, située route de Cancale. Propriété de la famille Regnault en 1513 ;
la
maison du Tertre-Janson, située route de Cancale. Propriété de la famille Regnault en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Porcon, situé route de Cancale. La chapelle Saint-Gobrien de
Porcon dépendait de ce manoir, qui a donné son nom à une famille ancienne
et distinguée. Le 12 janvier 1668, Pierre Grout, seigneur de la Villejean,
fonda deux messes par semaine dans cette chapelle, qu'il dota de 60 livres
de rente. Cette fondation, augmentée de deux autres messes, fut réduite en
1734 à deux messes hebdomadaires. En 1752, la chapelle de Porcon
appartenait à M. Boulain, chanoine de Saint-Malo et abbé de Melleray, et
elle avait pour chapelain Jean-François Grout, chanoine de Dol (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Grout
seigneurs de la Villejan en 1668, puis de la famille Boulain en 1752 ;
l'ancien
manoir du Porcon, situé route de Cancale. La chapelle Saint-Gobrien de
Porcon dépendait de ce manoir, qui a donné son nom à une famille ancienne
et distinguée. Le 12 janvier 1668, Pierre Grout, seigneur de la Villejean,
fonda deux messes par semaine dans cette chapelle, qu'il dota de 60 livres
de rente. Cette fondation, augmentée de deux autres messes, fut réduite en
1734 à deux messes hebdomadaires. En 1752, la chapelle de Porcon
appartenait à M. Boulain, chanoine de Saint-Malo et abbé de Melleray, et
elle avait pour chapelain Jean-François Grout, chanoine de Dol (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Grout
seigneurs de la Villejan en 1668, puis de la famille Boulain en 1752 ;
![]() l'ancien
manoir de la Ville-Aufray, situé route de Saint-Coulomb. Propriété de la
famille Bonnier en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Ville-Aufray, situé route de Saint-Coulomb. Propriété de la
famille Bonnier en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Tion, situé route de Saint-Coulomb. Propriété de la famille
Maleterre en 1513 ;
l'ancien
manoir du Tion, situé route de Saint-Coulomb. Propriété de la famille
Maleterre en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir du Fléchet, situé route de Saint-Coulomb. Propriété de la famille
de Québriac en 1513, puis de la famille le Fer seigneurs de la Bargoulais
au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir du Fléchet, situé route de Saint-Coulomb. Propriété de la famille
de Québriac en 1513, puis de la famille le Fer seigneurs de la Bargoulais
au XVIIIème siècle ;
![]() le
château de Beauregard, situé route de Cancale. Il possède une chapelle
datée de 1785. Dédiée à Sainte-Radegonde, la chapelle est bénite le 13
août 1785, par M. J.J. Penhoët, curé de Saint-Méloir-des-Ondes. Le
procès verbal de bénédiction est signé par Ontroy, veuve Gouyon, les
trois dames de la Bouexière (ou Boissière), par M. de Rosnyvinen (marquis
de Piré) et Fr. Jean Macé, prêtre. Cette chapelle présente au-dessus de sa porte les écussons
des familles de la Boissière et de Lantivy. La chapelle était fondée
jadis de trois messes par semaine ; à côté, sur la falaise, coule la
fontaine de Sainte-Radegonde, but de pèlerinage pour les enfants
malades. Propriété de la famille de la
Boissière au XVIIIème siècle, puis de la famille Bailby ;
le
château de Beauregard, situé route de Cancale. Il possède une chapelle
datée de 1785. Dédiée à Sainte-Radegonde, la chapelle est bénite le 13
août 1785, par M. J.J. Penhoët, curé de Saint-Méloir-des-Ondes. Le
procès verbal de bénédiction est signé par Ontroy, veuve Gouyon, les
trois dames de la Bouexière (ou Boissière), par M. de Rosnyvinen (marquis
de Piré) et Fr. Jean Macé, prêtre. Cette chapelle présente au-dessus de sa porte les écussons
des familles de la Boissière et de Lantivy. La chapelle était fondée
jadis de trois messes par semaine ; à côté, sur la falaise, coule la
fontaine de Sainte-Radegonde, but de pèlerinage pour les enfants
malades. Propriété de la famille de la
Boissière au XVIIIème siècle, puis de la famille Bailby ;
Nota : Château et seigneurie en la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes, évêché de Saint-Malo. Le château de Beauregard, situé dans la baie de Cancale et dont les jardins descendent en terrasse jusqu'à la mer, appartient vers 1899 au comte Aristide de Lantivy-Gillot de Kervéno dont le père l'a eu en héritage de la famille de la Bouëxière. Au-dessus de la porte de la chapelle du château se trouvent encore les écussons accolés des familles de la Bouëxière et Fleuriot de Langle. Cette seigneurie appartenait avant la Révolution à la maison de Rosnyvinen (Théodore Courtaux, 1899).
Nota : Nous voici maintenant devant Beauregard, dont l'entrée ne présage certes aucunement du charme édenique qu'un ancien propriétaire audacieux, Monsieur Bailby, conféra à cet ancien fief des Lantivy (voilà quelque vingt ans seulement). A vrai dire, seule la chapelle est restée d'époque. Elle fut construite en 1785. Au-dessus de la porte principale, on voit encore les écussons accolés des familles de la Boissière et de Lantivy, surmontés d'une couronne de marquis. Pour ce qui est de la gentilhommière, tellement transformée, il est bien difficile de limiter l'ancien du pastiche. Les styles eux-mêmes s'enchevêtrent, se confondent et vont jusqu'à s'allier à l'art extrême-oriental. Si les de la Boissière qui y résidaient avant la Révolution devaient y revenir, sans doute, malgré leurs armoiries disséminées ici et là, ne s'y reconnaitraient-ils plus du tout, pas plus d'ailleurs dans les jardins. Pourtant, une incontestable beauté règne dans cette fantaisie échevelée, cette violence faite à la nature plutôt sévère et farouche de la côte. L'alliance des vieilles pierres, des toits pittoresques et de la verdure grimpante, des arbres taillés ou librement éployés de toutes les essences, donne une note d'intimité anglo-japonaise. La belle grille en fer forgé Louis XV ouvre sur une débauche de couleurs et de formes, harmonieusement mariées, où s'étagent des terrasses de parterres, d'arcades, d'allées couvertes, de boulingrins et de vasques. Sur cet ensemble règne un peuple de divinités de grès ou de marbre. Toutes les civilisations amies des jardins ont ici leur mot à dire : l'anglaise y côtoie la française, l'arabe la chinoise, dans un cadre grandiose naturel : l'immense baie de Cancale. Il y a une véritable gageure à entretenir d'aussi beaux jardins en bordure de mer dans une région aussi venteuse. Monsieur Zurstrassen, propriétaire de Beauregard en 1947, la tient avec succès et c'est un émerveillement constamment renouvellé que d'errer en ce paradis. (Daniel Derveaux).
![]() l'ancien
manoir du Clos, situé route de Paramé. Propriété de la famille de Châteaubriand
seigneurs de Beaufort en 1513 ;
l'ancien
manoir du Clos, situé route de Paramé. Propriété de la famille de Châteaubriand
seigneurs de Beaufort en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Longovain, situé route de Paramé. Propriété de la famille
Barlet en 1500 ;
l'ancien
manoir de Longovain, situé route de Paramé. Propriété de la famille
Barlet en 1500 ;
![]() l'ancien
Château-Richeux, situé route de Paramé. Il dépendait jadis de la
seigneurie du Plessis-Bertrand en Saint-Coulomb. Le château de Richer aurait
été édifié par un dénommé Richer vers 1030 et qui mourut vers l'an 1050 ;
l'ancien
Château-Richeux, situé route de Paramé. Il dépendait jadis de la
seigneurie du Plessis-Bertrand en Saint-Coulomb. Le château de Richer aurait
été édifié par un dénommé Richer vers 1030 et qui mourut vers l'an 1050 ;
Nota : La route nationale, qui longe l'immense digue de trente-six mille mètres construite, pour se défendre des eaux, par les riverains dès le XIème, nous mène auprès de la pointe du Château-Richeux, berceau féodal de la famille du Guesclin. (Daniel Derveaux).
![]() l'ancien
manoir de Terlé. Propriété de la famille de la Motte en 1513 ;
l'ancien
manoir de Terlé. Propriété de la famille de la Motte en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de Vautouraude. Il possédait jadis une chapelle privée, aujourd'hui
disparue. La chapelle Saint-Marcoulf du Vautouraude dépendait de ce manoir.
Le 16 septembre 1667, Françoise Ribertière, veuve d'Etienne Artur,
seigneur de la Motte, d'accord avec ses enfants, fonda une messe en cette
chapelle pour tous les dimanches et fêtes ; mais en 1752 ce sanctuaire n'était
plus desservi (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Garnier sieurs
du Fougeray, pair de France, en 1789 ;
l'ancien
manoir de Vautouraude. Il possédait jadis une chapelle privée, aujourd'hui
disparue. La chapelle Saint-Marcoulf du Vautouraude dépendait de ce manoir.
Le 16 septembre 1667, Françoise Ribertière, veuve d'Etienne Artur,
seigneur de la Motte, d'accord avec ses enfants, fonda une messe en cette
chapelle pour tous les dimanches et fêtes ; mais en 1752 ce sanctuaire n'était
plus desservi (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Garnier sieurs
du Fougeray, pair de France, en 1789 ;
![]() l'ancien
manoir de Limonay, situé route de la Gouesnière. Propriété de la famille
le Clerc et Levesque en 1513 ;
l'ancien
manoir de Limonay, situé route de la Gouesnière. Propriété de la famille
le Clerc et Levesque en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Jeannais, situé route de la Gouesnière. Propriété de la
famille Chatton en 1513, puis de la famille Joliff sieurs du Clos au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Jeannais, situé route de la Gouesnière. Propriété de la
famille Chatton en 1513, puis de la famille Joliff sieurs du Clos au XVIIIème siècle ;
Nota : A quelque cinq cents mètres du bourg de Saint-Méloir, sur la route de La Gouesnière, s'élève l'ancien manoir de la Janaie. Une date, au-dessus d'une porte, en situe l'époque : 1745. Il fut habité au XVIIIème siècle par les Le Joliff, sieurs du Clos, vers 1947 il l'est par Me Riaux. (Daniel Derveaux).
![]() l'ancien
manoir de la Barbotais. Propriété de la famille Picot en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Barbotais. Propriété de la famille Picot en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Trégueurie. Propriété de la famille Poilevé en 1513 ;
l'ancien
manoir de la Trégueurie. Propriété de la famille Poilevé en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Chênais ;
l'ancien
manoir de la Chênais ;
![]() l'ancien
manoir de la Ville-es-Volants. Propriété de la famille le Filleur au XVIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Ville-es-Volants. Propriété de la famille le Filleur au XVIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir des Douets. Il possédait jadis une chapelle du XVIIème siècle
dédiée à Saint-Pierre et aujourd'hui disparue. Jean Le Gobien et Simonne
Artur, seigneur et dame de Launay-Quinart, bâtirent cette chapelle proche
leur manoir des Douets. Simonne Artur, devenue veuve, y fonda par testament
en date du 15 mai 1618 deux messes par semaine, les dimanche et vendredi.
Leur fils, Pierre Le Gobien, archidiacre de Porhoët, y ajouta une troisième
messe pour le mercredi et donna à cet effet sa maison de la Tréhénais.
Les chapelains des Douets furent Guillaume Le Gobien, que remplaça en 1694
Charles Le Gobien, — N... Artur de la Gibonnais (1752), — René de Heursant
— et Guillaume Heurtault de la Villemorin (1765) (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Propriété de la famille le Gobien en 1572 et au XVIIème
siècle, puis de la famille de la Palier-Christi au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir des Douets. Il possédait jadis une chapelle du XVIIème siècle
dédiée à Saint-Pierre et aujourd'hui disparue. Jean Le Gobien et Simonne
Artur, seigneur et dame de Launay-Quinart, bâtirent cette chapelle proche
leur manoir des Douets. Simonne Artur, devenue veuve, y fonda par testament
en date du 15 mai 1618 deux messes par semaine, les dimanche et vendredi.
Leur fils, Pierre Le Gobien, archidiacre de Porhoët, y ajouta une troisième
messe pour le mercredi et donna à cet effet sa maison de la Tréhénais.
Les chapelains des Douets furent Guillaume Le Gobien, que remplaça en 1694
Charles Le Gobien, — N... Artur de la Gibonnais (1752), — René de Heursant
— et Guillaume Heurtault de la Villemorin (1765) (Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Propriété de la famille le Gobien en 1572 et au XVIIème
siècle, puis de la famille de la Palier-Christi au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir de la Tréhennais. Propriété de la famille Cohue en 1513, puis de
la famille le Bret en 1574 ;
l'ancien
manoir de la Tréhennais. Propriété de la famille Cohue en 1513, puis de
la famille le Bret en 1574 ;
![]() l'ancien
manoir du Bouillon, situé route de Saint-Servan-sur-Mer ;
l'ancien
manoir du Bouillon, situé route de Saint-Servan-sur-Mer ;
Nota : Retraversons Saint-Méloir pour aborder la route de Saint-Servan où, presqu'à son début, se dresse le Bouillon avec son entrée monumentale en pierres moulurées et son saut de loup comblé. Cette petite malouinière Louis XVI appartint aux Nouail de la Ville-Gilles. (Daniel Derveaux).
![]() l'ancien
manoir de la Rimbaudais, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Propriété
de la famille Herbert seigneurs de la Porte-Barré au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Rimbaudais, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Propriété
de la famille Herbert seigneurs de la Porte-Barré au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir des Landes-Seré, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Il possédait
jadis des tourelles, des douves et fossés, un colombier, une orangerie et
une chapelle datée du XVIIème siècle. La chapelle dédiée au
Saint-Nom-de-Jésus et Saint-Luc des Landes fut construite dans la cour de
ce manoir, et le 5 novembre 1664 Marie Pépin, veuve de Luc Seré, sieur de
la Ville-Maleterre, y fonda une messe tous les dimanches et vendredis. Cette
chapelle fut desservie par Jean Guichart (1702), — Julien Marié (1711)
— et François Guichart, précepteur de Saint-Malo (1752) ; mais elle fut
abandonnée avant la Révolution, car en 1790 sa fondation se desservait en
la chapelle de la Ville-Gilles (Pouillé de Rennes). Le manoir possédait jadis un droit
de haute justice. Son gibet à trois piliers se dressait au Clos de la
Justice ou des Vertes-Vies, près de Ville-Blot. Propriété successive des
familles Levesque seigneurs du Molant (en 1428), d'Ust (en 1454), le
Bouteiller seigneurs de Maupertuis (en 1470), Seré seigneurs de la
Pasquerie (vers 1620), Bourdas (en 1705), Nouail seigneurs de la
Ville-Gilles (en 1739 et en 1789) ;
l'ancien
manoir des Landes-Seré, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Il possédait
jadis des tourelles, des douves et fossés, un colombier, une orangerie et
une chapelle datée du XVIIème siècle. La chapelle dédiée au
Saint-Nom-de-Jésus et Saint-Luc des Landes fut construite dans la cour de
ce manoir, et le 5 novembre 1664 Marie Pépin, veuve de Luc Seré, sieur de
la Ville-Maleterre, y fonda une messe tous les dimanches et vendredis. Cette
chapelle fut desservie par Jean Guichart (1702), — Julien Marié (1711)
— et François Guichart, précepteur de Saint-Malo (1752) ; mais elle fut
abandonnée avant la Révolution, car en 1790 sa fondation se desservait en
la chapelle de la Ville-Gilles (Pouillé de Rennes). Le manoir possédait jadis un droit
de haute justice. Son gibet à trois piliers se dressait au Clos de la
Justice ou des Vertes-Vies, près de Ville-Blot. Propriété successive des
familles Levesque seigneurs du Molant (en 1428), d'Ust (en 1454), le
Bouteiller seigneurs de Maupertuis (en 1470), Seré seigneurs de la
Pasquerie (vers 1620), Bourdas (en 1705), Nouail seigneurs de la
Ville-Gilles (en 1739 et en 1789) ;
![]() l'ancien
manoir de Pont-Prins, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Propriété de
la famille Chevalier en 1513 ;
l'ancien
manoir de Pont-Prins, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Propriété de
la famille Chevalier en 1513 ;
![]() l'ancien
manoir de la Ville-Martère ou de la Ville-Maleterre (XVI-XVIIème siècle),
situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Il possédait jadis une chapelle
privée dédiée à Notre-Dame-la-Blanche,
reconstruite en 1707 et aujourd'hui disparue. Cette chapelle, fort ancienne,
s'appelait aussi Notre-Dame de Maleterre, « capella B. M. de Malaterra ».
En 1218, un différend s'éleva à son sujet entre les religieux du Mont
Saint-Michel, d'une part, et Guillaume Le Moine, chevalier, Geffroy Yvas,
son frère, et Haimon Maleterre, d'autre part. Gaultier, abbé de Rillé, délégué
par le Saint-Siège pour mettre d'accord les dissidents, y réussit et
adjugea à l'abbaye du Mont Saint-Michel les oblations faites en cette
chapelle (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, LXXXVI, 785). Elle fut
desservie en 1563 par Bertrand Le Maczon, successeur de Nicolas Hovel, et en
1632 par Pierre Langronne, remplaçant Julien Morin. Mais à cette dernière
époque le service en était fait à l'église paroissiale, parce que la
chapelle était ruinée (nota : cette première chapellenie de Notre-Dame de
Maleterre continua jusqu'à la Révolution d'être desservie en l'église
paroissiale ; elle valait 40 livres de rente en 1750 et le recteur en
présentait le chapelain). C'est pourquoi en 1707 Armand Danibielle, sieur
de Saint-Jean, marchand à Saint-Malo, fit bâtir près de sa maison de la
Chapelle-Maleterre un petit sanctuaire qui conserva le nom de Notre-Dame-la-Blanche
; il y fonda, par acte du 31 décembre 1707, deux messes par semaine pour
lui, Claude Boylet, sa belle-soeur, et ses autres parents. Olivier Busnel
fut pourvu de ce bénéfice le 13 mars 1708 ; il eut pour successeurs N.
Blondel (1752), — Pierre Gilbert, décédé vers 1774, — et Joseph
Radon. Le recteur, M. Chauvin, déclara en 1752 que Notre-Dame-la-Blanche
appartenait alors à Jean Grout, seigneur de Bellesme, et qu'elle était
desservie quatre jours par semaine, le dimanche compris, parce qu'on y avait
uni la fondation de la Ville-Maleterre (Pouillé de Rennes). La chapelle
Saint-Jean-Baptiste de la Ville-Maleterre fut bâtie par Pierre Seré et
Bernardine Gaillard, sieur et dame de la Pasquerie, dans la, cour de leur
manoir de la Ville-Maleterre, mais ils ne la fondèrent point de messes. Ce
fut leur fils Jean Seré, sieur de la Chapelle, qui, le 17 décembre 1633, dota ce sanctuaire en y
fondant quelques messes. En 1752 cette chapelle, appartenant à M. Grout de
Bellesme, était en ruine, et sa fondation était desservie en la chapelle
de Notre-Dame-la-Blanche (Pouillé de Rennes). On voit encore un colombier.
Propriété successive des familles Billart (en 1513), Seré (au XVIIème siècle),
Grout seigneurs de Bellesme (en 1752) ;
l'ancien
manoir de la Ville-Martère ou de la Ville-Maleterre (XVI-XVIIème siècle),
situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Il possédait jadis une chapelle
privée dédiée à Notre-Dame-la-Blanche,
reconstruite en 1707 et aujourd'hui disparue. Cette chapelle, fort ancienne,
s'appelait aussi Notre-Dame de Maleterre, « capella B. M. de Malaterra ».
En 1218, un différend s'éleva à son sujet entre les religieux du Mont
Saint-Michel, d'une part, et Guillaume Le Moine, chevalier, Geffroy Yvas,
son frère, et Haimon Maleterre, d'autre part. Gaultier, abbé de Rillé, délégué
par le Saint-Siège pour mettre d'accord les dissidents, y réussit et
adjugea à l'abbaye du Mont Saint-Michel les oblations faites en cette
chapelle (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, LXXXVI, 785). Elle fut
desservie en 1563 par Bertrand Le Maczon, successeur de Nicolas Hovel, et en
1632 par Pierre Langronne, remplaçant Julien Morin. Mais à cette dernière
époque le service en était fait à l'église paroissiale, parce que la
chapelle était ruinée (nota : cette première chapellenie de Notre-Dame de
Maleterre continua jusqu'à la Révolution d'être desservie en l'église
paroissiale ; elle valait 40 livres de rente en 1750 et le recteur en
présentait le chapelain). C'est pourquoi en 1707 Armand Danibielle, sieur
de Saint-Jean, marchand à Saint-Malo, fit bâtir près de sa maison de la
Chapelle-Maleterre un petit sanctuaire qui conserva le nom de Notre-Dame-la-Blanche
; il y fonda, par acte du 31 décembre 1707, deux messes par semaine pour
lui, Claude Boylet, sa belle-soeur, et ses autres parents. Olivier Busnel
fut pourvu de ce bénéfice le 13 mars 1708 ; il eut pour successeurs N.
Blondel (1752), — Pierre Gilbert, décédé vers 1774, — et Joseph
Radon. Le recteur, M. Chauvin, déclara en 1752 que Notre-Dame-la-Blanche
appartenait alors à Jean Grout, seigneur de Bellesme, et qu'elle était
desservie quatre jours par semaine, le dimanche compris, parce qu'on y avait
uni la fondation de la Ville-Maleterre (Pouillé de Rennes). La chapelle
Saint-Jean-Baptiste de la Ville-Maleterre fut bâtie par Pierre Seré et
Bernardine Gaillard, sieur et dame de la Pasquerie, dans la, cour de leur
manoir de la Ville-Maleterre, mais ils ne la fondèrent point de messes. Ce
fut leur fils Jean Seré, sieur de la Chapelle, qui, le 17 décembre 1633, dota ce sanctuaire en y
fondant quelques messes. En 1752 cette chapelle, appartenant à M. Grout de
Bellesme, était en ruine, et sa fondation était desservie en la chapelle
de Notre-Dame-la-Blanche (Pouillé de Rennes). On voit encore un colombier.
Propriété successive des familles Billart (en 1513), Seré (au XVIIème siècle),
Grout seigneurs de Bellesme (en 1752) ;
![]() l'ancien
manoir de la Blanch, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Il possédait
jadis une chapelle privée, aujourd'hui disparue. Propriété de la famille
Grout seigneurs de Bellesme au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir de la Blanch, situé route de Saint-Servan-sur-Mer. Il possédait
jadis une chapelle privée, aujourd'hui disparue. Propriété de la famille
Grout seigneurs de Bellesme au XVIIIème siècle ;
![]() l'ancien
manoir des Longs-Prés. Il possédait jadis une chapelle privée aujourd'hui
disparue et bénite en 1720. La chapelle du Longpré (ou Longs-Prés) fut bâtie
près de ce manoir par François Baillon, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel. Celui-ci demanda et obtint de l'ordinaire de transférer en ce
nouveau sanctuaire la chapellenie de Lesnen, desservie à l'hôpital de
Dinan et lui appartenant ; cette fondation consistait en quatre messes
hebdomadaires, avec catéchisme et prière tous les dimanches au soir. Mgr
des Maretz y donna son approbation le 7 mai 1720. En même temps, Laurent
Rouault, chanoine de Saint-Malo, fut pourvu du bénéfice (Pouillé de
Rennes). On y voyait aussi un colombier et une orangerie. Propriété de la famille
Baillon en 1720 ;
l'ancien
manoir des Longs-Prés. Il possédait jadis une chapelle privée aujourd'hui
disparue et bénite en 1720. La chapelle du Longpré (ou Longs-Prés) fut bâtie
près de ce manoir par François Baillon, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel. Celui-ci demanda et obtint de l'ordinaire de transférer en ce
nouveau sanctuaire la chapellenie de Lesnen, desservie à l'hôpital de
Dinan et lui appartenant ; cette fondation consistait en quatre messes
hebdomadaires, avec catéchisme et prière tous les dimanches au soir. Mgr
des Maretz y donna son approbation le 7 mai 1720. En même temps, Laurent
Rouault, chanoine de Saint-Malo, fut pourvu du bénéfice (Pouillé de
Rennes). On y voyait aussi un colombier et une orangerie. Propriété de la famille
Baillon en 1720 ;
Nota : Par le Long-Pré et la Massuère, cette dernière conservant un escalier inscrit dans une tourelle demi-circulaire, nous arrivons sur la route nationale où, au lieu-dit les Croix-Giboin, s'élève un curieux amalgame de constructions anciennes. Plusieurs manoirs forment une ferme et ses dépendances. La ferme conserve une porte de grange et des portillons d'entrée cintrés du XVIème siècle. Les dépendances à l'ouest se composent d'un pavillon pareil à celui de Beauregard en Saint-Servan et d'une tourelle carrée s'inscrivant dans l'angle formé par la construction soudée au pavillon en retour d'équerre. Toute la décoration extérieure est à noter, les fenêtres en arcs brisés et chanfreinés, à appuis moulurés, l'arête de pierre du pignon et la maçonnerie des murs et des épaisses cheminées, constituée de pierres plates. Sur le sol alentour, gisent ou s'élèvent les vestiges archéologiques intéressants : anciens portiques et portillons ruinés, pierres taillées, auges massives qu'habillent deux lèpres plaisantes, la rouille et la mousse. Le grand charme de vétusté et de pittoresque qui se dégage de cet ensemble, contraste fortement avec celui émanant du manoir du Domaine, de l'autre côté de la route. (Daniel Derveaux).
![]() l'ancien
manoir des Villes-Bagues. La chapelle Sainte-Anne et Saint-Joseph,
aujourd'hui disparue, fut bâtie par Gillette Roquet, dame de la Ville-Bague
et veuve de Gilles Denouges, et bénite le 18 avril 1644 par Charles Treton
du Ruau, vicaire général de Saint-Malo. Gillette Roquet avait fondé dès
le 2 juin 1643 deux messes par semaine pour être desservies en cette
chapelle le dimanche et le vendredi. Mais cette fondation fut augmentée
plus tard, car en 1752 le recteur de Saint-Méloir-des-Ondes déclara
qu'elle consistait en quatre messes hebdomadaires. Les chapelains de la
Ville-Bague furent Julien Le Houx (1698), — François Guichart (1738) —
et Jean Patard (1763). Ce dernier fut présenté par Charlotte de Combault
d'Anteuil, veuve de Bertrand Mahé de la Bourdonnais, gouerneur de l'île
Bourbon et propriétaire de la Ville-Bague (Pouillé de Rennes). Propriété de Gillette Roquet veuve de Gilles
Denouges en 1644, puis de Bertrand Mahé seigneur de la Bourdonnais au XVIIIème siècle ;
l'ancien
manoir des Villes-Bagues. La chapelle Sainte-Anne et Saint-Joseph,
aujourd'hui disparue, fut bâtie par Gillette Roquet, dame de la Ville-Bague
et veuve de Gilles Denouges, et bénite le 18 avril 1644 par Charles Treton
du Ruau, vicaire général de Saint-Malo. Gillette Roquet avait fondé dès
le 2 juin 1643 deux messes par semaine pour être desservies en cette
chapelle le dimanche et le vendredi. Mais cette fondation fut augmentée
plus tard, car en 1752 le recteur de Saint-Méloir-des-Ondes déclara
qu'elle consistait en quatre messes hebdomadaires. Les chapelains de la
Ville-Bague furent Julien Le Houx (1698), — François Guichart (1738) —
et Jean Patard (1763). Ce dernier fut présenté par Charlotte de Combault
d'Anteuil, veuve de Bertrand Mahé de la Bourdonnais, gouerneur de l'île
Bourbon et propriétaire de la Ville-Bague (Pouillé de Rennes). Propriété de Gillette Roquet veuve de Gilles
Denouges en 1644, puis de Bertrand Mahé seigneur de la Bourdonnais au XVIIIème siècle ;
![]() la
Maison de l'Hôtellerie ;
la
Maison de l'Hôtellerie ;
![]() le
manoir de la Bardoulais (1751). Il possédait jadis une chapelle privée datée
du XV-XVIème siècle. La chapelle Saint-Jacques de la Bardoulais se trouvait
au bout du jardin de ce manoir. Le 18 septembre 1627, Richard Boulain et
Jacquette Boulain, seigneur et dame de la Bardoulais, y fondèrent deux
messes par semaine, les lundi et vendredi, et dotèrent cette chapellenie de
50 livres de rente. Mais cette fondation fut augmentée plus tard, et en
1752 Jean Michel, chapelain de la Bardoulais, recevait 200 livres par an
pour les messes qu'il y disait « les dimanches et fêtes et autres jours
de la semaine » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de
Saint-Malo). Propriété successive des familles Bardoul (en
1513), Boullain (en 1634), Porée (en 1648 et en 1670), Pouliquen ;
le
manoir de la Bardoulais (1751). Il possédait jadis une chapelle privée datée
du XV-XVIème siècle. La chapelle Saint-Jacques de la Bardoulais se trouvait
au bout du jardin de ce manoir. Le 18 septembre 1627, Richard Boulain et
Jacquette Boulain, seigneur et dame de la Bardoulais, y fondèrent deux
messes par semaine, les lundi et vendredi, et dotèrent cette chapellenie de
50 livres de rente. Mais cette fondation fut augmentée plus tard, et en
1752 Jean Michel, chapelain de la Bardoulais, recevait 200 livres par an
pour les messes qu'il y disait « les dimanches et fêtes et autres jours
de la semaine » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de
Saint-Malo). Propriété successive des familles Bardoul (en
1513), Boullain (en 1634), Porée (en 1648 et en 1670), Pouliquen ;
Nota : La terre de la Bardoulais dont le manoir, demeure des Pouliquen, se cache au bout d'une double rabine de charmes et de chênes. Construit en 1731 (ou 1751 ?), comme l'indique la date sur l'encadrement en plein cintre de la porte principale, il semble que ses deux pavillons en légère saillie, formant ailes, soient d'époque plus récente. La glycine qui mange la façade vient lier fort heureusement ces deux époques. Au sud, en alignement avec la maison, se trouve la chapelle Saint-Jacques, dont la belle façade gothique, à portail surmonté d'un tympan orné d'arcs d'ogive, fut construite au début du XVIème siècle par les Bardou. Son toit et ses murs disparaissent sous une romantique végétation, tout comme les ruines de l'ancien manoir des Bardou, situées au nord de la demeure actuelle et proches parentes des manoirs de la Croix-Giboin. Les Boullain et les Porée y résidèrent jusqu'au XVIIIème siècle, où les descendants de Michel Porée firent construire la nouvelle Bardoulais. (Daniel Derveaux).
![]() l'ancien
manoir du Domaine, situé non loin du village de la Beuglais ;
l'ancien
manoir du Domaine, situé non loin du village de la Beuglais ;
Nota : Ceint d'un haut mur qui lui a valu le nom de manoir du Mur Blanc, le Domaine est une bâtisse proche de la fin du XVIIIème siècle, comme le révèlent les quatre peu décoratifs oeils-de-bœuf de la façade. Malouinière au style sévère par son haut toit, ses lucarnes, sa porte d'entrée à encadrement de granit, elle possède intérieurement un bel escalier de bois, dès le vestibule, et des caves dont les voûtes s'arrondissent en berceau. La grande rabine qui la précédait a disparu et elle-même, déchue de sa destination première, se voit transformée de nos jours en vaste entrepôt de pommes de terre. Monsieur Poirier, propriétaire en 1947, s'est en effet construit une ferme moderne tout auprès. (Daniel Derveaux).
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-MELOIR-DES-ONDES
La seigneurie des Landes : Le P. du Paz a écrit (Histoire généalogique de plusieurs maisons de Bretagne, 487), et tous les généalogistes bretons après lui ont répété que les terres seigneuriales des Landes et de Maupertuis furent apportées vers 1380 à Guillaume Le Bouteiller par sa femme Phelippote Gouyon. De cette assertion il n'y a qu'une partie de vraie : la famille Le Bouteiller acquit bien ainsi la terre de Maupertuis, mais elle n'eut que plus tard, et par suite d'une autre alliance, celle des Landes. Les manoir, terre et seigneurie des Landes, en la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes, appartenaient, en effet, en 1428 à Mahé Levesque, qui en rendit alors aveu au sire de Châteauneuf (Archives du château de Châteauneuf). Seigneur du Molant, chambellan du duc Jean V et veuf depuis 1397 de Seraine du Houx, Mahé Levesque en avait un fils, Guillaume Levesque, qui hérita de ses seigneuries, épousa Sibylle de Montbourcher et mourut dans la force de l'âge au mois d'août 1438 (Archives de Loire-Inférieure, voir Mordelles). La fille de ce dernier seigneur, Marguerite Levesque, épousa Jean d'Ust, seigneur dudit lieu, et lui apporta, entre autres seigneuries, celle des Landes, pour laquelle les deux époux firent aveu au sire de Châteauneuf le 2 novembre 1454 (Archives du château de Châteauneuf). Marguerite Levesque mourut le 20 janvier 1464. Elle laissait plusieurs enfants, parmi lesquels se trouvait Marguerite d'Ust, épouse en 1470 de Jean Le Bouteiller, seigneur de Maupertuis, auquel elle apporta la terre seigneuriale des Landes. Nous connaissons ce Jean IV Le Bouteiller, seigneur de Maupertuis et des Landes, ainsi que ses descendants, qui possédèrent durant tout le XVIème siècle ces deux seigneuries ; inutile donc de reproduire ici leur généalogie, donnée à propos de Maupertuis. René Le Bouteiller fut le dernier à posséder les Landes et Maupertuis ; après sa mort, arrivée à la fin de mai 1620, son frère et héritier, Pierre Le Bouteiller, ne put conserver que Maupertuis ; les Landes furent vendues, manoir, terre et seigneurie, et le tout fut acheté par Luc Séré, sieur de la Pasquerie, qui en 1624 prenait le titre de seigneur des Landes. Le 14 février 1636, le fils de ce dernier, appelé aussi Luc Séré, conjointement avec sa femme Marie Pépin, rendit aveu au sire de Châteauneuf pour les « manoir, terre et seigneurie des Landes » , qu'il possédait « tant de la succession de son père que de ses propres acquests » (Archives du château de Châteauneuf). Ce Luc II Séré, seigneur des Landes, mourut en 1641 et fut inhumé le 11 août ; sa veuve, Marie Pépin, lui survécut jusqu'en 1667. Leur fils, Luc III Séré, seigneur des Landes et secrétaire du roi, épousa, par contrat du 8 décembre 1653, Marguerite Magon, fille du seigneur de la Lande (Généalogie de la maison Magon, 6). Par contrat du 20 novembre 1705, Marguerite Magon, devenue veuve de Luc Séré, vendit de concert avec son fils, François-Joseph Séré, conseiller au Parlement de Paris, à Julien Bourdas, secrétaire du roi, les terre et seigneurie des Landes moyennant 56 000 livres (Archives du château de Châteauneuf). Celui-ci laissa les Landes à Jacques Bourdas, qui épousa Françoise de l'Epinay et mourut le 17 avril 1736, âgé de quarante ans (Abbé Pâris-Jallobert, Registres paroissiaux de Saint-Méloir-des-Ondes, 7). La terre seigneuriale des Landes fut alors vendue judiciairement et achetée en 1739 par Nicolas Nouail, seigneur de la Ville-Gilles, qui rendit aveu en 1751 au marquis de Châteauneuf pour son acquisition (Archives du château de Châteauneuf). En 1772, Jean-François Nouail, seigneur de la Ville-Gilles, possédait les Landes ; il avait épousé Françoise Moreau, qui mourut à Saint-Malo, âgée de trente-six ans, et fut inhumée le 12 avril 1774 dans l'enfeu des Landes en l'église de Saint-Méloir. Lui-même fut le dernier seigneur des Landes et décéda à Saint-Malo le 13 novembre 1790, âgé de soixante-cinq ans ; son corps, apporté à Saint-Méloir, fut inhumé près de celui de sa femme, dans la chapelle qu'il possédait en l'église paroissiale (Abbé Pâris-Jallobert, Registres paroissiaux de Saint-Méloir, 30).
La seigneurie des Landes se composait à l'origine de deux groupes de fiefs relevant l'un et l'autre de la châtellenie de Châteauneuf et s'étendant, le premier en la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes, le second en celle de Cancale (Déclarations de la seigneurie des Landes en 1454 et 1600). Les fiefs en Saint-Méloir étaient au nombre d'une dizaine et se nommaient : les Deniers, les Froments, la Fabrique, la Ville-Gautier, la Ville-Poulet, le Bourg, la Grande-Fontaine, la Roche, le Fief-Grignart et Trélabouët ; ils formaient ensemble une haute justice exercée au bourg de Saint-Méloir dans l'auditoire des Landes (Déclarations de la seigneurie des Landes en 1600 et 1705) ; le gibet de cette juridiction consistait en trois piliers élevés dans le clos de la Justice ou des Vertes-Vies, près la Ville-Blot. Au seigneur des Landes appartenaient, en l'église de Saint-Méloir-des-Ondes, une chapelle prohibitive avec banc et enfeu à droite du sanctuaire, un autre banc devant l'autel du Rosaire et le droit d'armoiries sculptées sur les murailles et peintes dans les verrières ; au XVIIIème siècle, on voyait encore ces écussons, qui portaient les armes des Le Bouteiller : d'argent à la bande fuselée de sable ; en 1600, on voyait même ce blason entouré du collier de l'Ordre du roi dans la maîtresse-vitre du temple (Déclarations de la seigneurie des Landes en 1600 et 1705). Le seigneur des Landes partageait avec celui de Châteauneuf, son suzerain, les coutumes levées sur les marchands à la foire de la Magdeleine en Saint-Méloir ; il avait de plus le droit de prendre seul « une pièce d'ouvrage de chaque espèce de marchandises étalées au champ de foire » ; enfin il prélevait, ce jour-là, trois sols monnaie sur les offrandes déposées à la chapelle de Sainte-Magdeleine (Déclarations de la seigneurie des Landes en 1600). Les fiefs des Deniers et des Froments en Saint-Méloir avaient été quelque temps démembrés de la seigneurie des Landes : Pierre Le Bouteiller les avait vendus vers 1620 au sieur Heurtault, dont la petite-fille les revendit à Luc Séré le 19 février 1675. A la demande du seigneur des Landes, Louis XIV, par lettres patentes datées de février 1680, enregistrées à la Chambre des Comptes de Nantes le 2 août 1681, unit de nouveau ces fiefs à la seigneurie des Landes, le tout formant une haute juridiction (Archives de Loire-Inférieure, B 86 et 378). C'est cette réunion des fiefs de Saint-Méloir qui constitua dès lors la seigneurie des Landes telle qu'elle subsista jusqu'en 1789.
Mais nous avons dit qu'à l'origine cette seigneurie comprenait un second groupe de fiefs s'étendant en Cancale. Ces fiefs des Landes en Cancale — mentionnés dans les aveux de 1454, 1502 et 1600 — furent vraisemblablement distraits de la terre seigneuriale et vendus vers 1620 par Pierre Le Bouteiller. Ils appartenaient quelques années plus tard à Guy de Cleuz, seigneur du Gage en Roz-Landrieux ; saisis par les créanciers de ce seigneur, ils furent vendus judiciairement le 6 juillet 1649 et achetés, ainsi qu'une île en mer nommée l'île des Landes, par François Porée et Jacquette Trublet, sa femme, seigneur et dame des Quatre-Voies en Cancale (Archives du château de Châteauneuf). Ces fiefs formèrent dès lors ce qu'on appela la seigneurie des Landes en Cancale, que possédèrent successivement ensuite : en 1687 Etienne Porée, fils des acquéreurs, et Marie Eon, sa femme ; — Pierre-Servan Porée, fils des précédents, mort avant 1730 et époux de Marie Tréhouart ; — en 1730 Marie-Guyonne Simon, femme d'Henri Tirel, sieur de la Martinière, et fille d'Eugénie Porée, épouse de Jacques Simon. — A la mort de Marie-Guyonne Simon, arrivée le 2 décembre 1761, son fils aîné Louis Tirel, sieur de la Martinière, devint seigneur des Landes ; il épousa Olympe Le Bonhomme et vendit en 1774 la seigneurie des Landes en Cancale à Nicolas-Auguste Magon de la Lande, seigneur du Plessix-Bertrand (Archives de Loire-Inférieure, B 779). Quatre bailliages formaient la seigneurie des Landes en Cancale ; ils se nommaient : le Grand bailliage des Deniers et Froments, le bailliage des Avoines, celui de la Garde et celui de Recouvrée. Ils avaient été vendus en 1649 comme jouissant d'une haute juridiction, mais au siècle dernier ils étaient considérés comme n'ayant qu'une moyenne et basse justice. Entre autres redevances du Grand bailliage des Deniers figuraient des paniers d'huîtres et des harengs frais. L'aveu de 1454 mentionne aussi comme faisant partie de cette seigneurie « des pescheries, garennes et tentes à faucons sises en la paroisse de Saint-Méen (de Cancale) ». Il ne semble pas avoir eu d'autre domaine proche en la seigneurie des Landes en Cancale que l'île des Landes et un moulin à vent (Archives du château de Châteauneuf).
Tout ce que possédait le seigneur des Landes, tant en Saint-Méloir qu'en Cancale, était tenu de la châtellenie ou marquisat de Châteauneuf à simple « debvoir de foy, hommage, rachapt et chambellenage » (Archives du château de Châteauneuf). Il nous reste à parler du domaine proche des Landes en Saint-Méloir, c'est-à-dire de la terre seigneuriale proprement dite des Landes. L'ancien manoir des Landes était assez considérable au XVIème siècle pour contenir une garnison ; en 1590, le capitaine ligueur des Coudrayes s'en était emparé et y tenait le parti du duc de Mercœur (Abbé Pâris-Jallobert, Registres paroissiaux de Saint-Méloir-des-Ondes). Flanqué de pavillons et de tourelles, il occupait une cour fermée de murailles qu'entouraient des « douves levées et fossez ». Dans cette cour se trouvaient un colombier, une orangerie, une remise à carosses et une chapelle fondée en 1664 par Marie Pépin, veuve de Luc Séré. Autour du manoir s'étendaient des bois, des rabines et un étang (Déclarations des Landes en 1600 et 1705). Un moulin à vent et un auditoire au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes complétaient avec la métairie des Landes le domaine proprement dit de ce nom ; mais avant le XIXème siècle on y adjoignit les métairies du Bouillon, de la Ville-Gilles et de la Ville-Séré, qui l'avoisinaient (Déclarations des Landes en 1600 et 1705). A la fin du XIXème siècle la terre des Landes n'est plus qu'une grande ferme où l'on retrouve cependant encore les vestiges de l'ancienne importance seigneuriale du lieu (abbé Guillotin de Corson).
Lors de la Montre de l'archidiaconé de Dinan en l'évêché de Saint-Malo, tenue par noble Guillaume Chauvin, sieur du Bois, chancelier de Bretagne, et Jean Manhugeon, grand maître de l'artillerie, commissaire du Duc, le 5-6 mai 1472, on mentionne plusieurs nobles de St-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) :
![]() Ollivier
de Quebriac, archer en brigandine.
Ollivier
de Quebriac, archer en brigandine.
![]() Pierre
Bardorel, archer en brigandine, injonction d'avoir bonne épée et bon archer.
Pierre
Bardorel, archer en brigandine, injonction d'avoir bonne épée et bon archer.
![]() Etienne
Rogier, par Pierre Boulle, archer en brigandine.
Etienne
Rogier, par Pierre Boulle, archer en brigandine.
![]() François
Lemarchand, archer en brigandine.
François
Lemarchand, archer en brigandine.
![]() ......
Morin, comparu par Jean Morin, archer en brigandine.
......
Morin, comparu par Jean Morin, archer en brigandine.
![]() Briand
de Porcon, jusarmer en brigandine.
Briand
de Porcon, jusarmer en brigandine.
![]() Robert
du Bourdon est à la garde sur la coste de la mer, ainsi que le vice-amiral a
accepté pour excuse.
Robert
du Bourdon est à la garde sur la coste de la mer, ainsi que le vice-amiral a
accepté pour excuse.
![]() On
trouve ensuite par ordre : - Pierre Cohu. - Jean Rogier. - Etienne de Colombier.
- Jean Busson. - Benoist Bouvier. - Jean du Porcon. - Estienne Busson. - Pierre
Picot, sieur de la Barbonais. - Gilles de St Père. - Jean Nouel. - Guillaume
Dubout. - Estienne de Quelemer. - Pierre Jonchée. - Jean Malleters. - Mre Jean
Louvel.
On
trouve ensuite par ordre : - Pierre Cohu. - Jean Rogier. - Etienne de Colombier.
- Jean Busson. - Benoist Bouvier. - Jean du Porcon. - Estienne Busson. - Pierre
Picot, sieur de la Barbonais. - Gilles de St Père. - Jean Nouel. - Guillaume
Dubout. - Estienne de Quelemer. - Pierre Jonchée. - Jean Malleters. - Mre Jean
Louvel.
Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 16 nobles de Saint-Meloir-des-Ondes :
![]() Pierre
BARDOUL de Bardoulhaye (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Pierre
BARDOUL de Bardoulhaye (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() Benest
BONNIER : défaillant ;
Benest
BONNIER : défaillant ;
![]() Estienne
BUSSON (20 livres de revenu) : défaillant ;
Estienne
BUSSON (20 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Estienne
DE COULOUBIERES de Villemartere (60 livres de revenu) : excusé comme
gardant la ville de Saint-Malo ;
Estienne
DE COULOUBIERES de Villemartere (60 livres de revenu) : excusé comme
gardant la ville de Saint-Malo ;
![]() Olive
DE QUEBRIAC de Bulleczin (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
Olive
DE QUEBRIAC de Bulleczin (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;
![]() François
DE PORCON (50 livres de revenu) : défaillant ;
François
DE PORCON (50 livres de revenu) : défaillant ;
![]() François
DE QUELEMER (50 livres de revenu) : excusé comme gardant la ville de Saint-Malo ;
François
DE QUELEMER (50 livres de revenu) : excusé comme gardant la ville de Saint-Malo ;
![]() Jehan
DE SAINT-PERE (20 livres de revenu) : défaillant ;
Jehan
DE SAINT-PERE (20 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Estienne
DU BODOU de la Trehenaye (80 livres de revenu) : défaillant ;
Estienne
DU BODOU de la Trehenaye (80 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Bertrand
JONCHEE : défaillant ;
Bertrand
JONCHEE : défaillant ;
![]() Jehan
LE HUCHETEL de la Jannaye (20 livres de revenu) : défaillant ;
Jehan
LE HUCHETEL de la Jannaye (20 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Jehan
LONEILL (10 livres de revenu) : défaillant ;
Jehan
LONEILL (10 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Messire
Jehan LOUVEL (30 livres de revenu) : défaillant ;
Messire
Jehan LOUVEL (30 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Jehan
MALLETERRE de Ciom (50 livres de revenu) : excusé comme gardant la ville de Saint-Malo ;
Jehan
MALLETERRE de Ciom (50 livres de revenu) : excusé comme gardant la ville de Saint-Malo ;
![]() Estienne
ROGIER (40 livres de revenu) : défaillant ;
Estienne
ROGIER (40 livres de revenu) : défaillant ;
![]() Jehan
ROGIER : défaillant ;
Jehan
ROGIER : défaillant ;
Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 (décembre) sont mentionnés à Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) les nobles suivants : - Guillaume de Chasteaubriand, sr. de Beaufort, tient la maison du clos, noble et 37 journaux 1/2 de terre roturière. - Jean le Bouteiller, escuier, sr. des Landes, tient, outre sa maison, nob. d'ancienneté, 60 journeaux 1/3 roturiers. - Gilles de Porcon, sr. dudit lieu, tient, outre ses terres nobles, 8 journels de roture. - Raoul Hingant et le sr. de la Houssais possèdent la metairie des Portes et 14 journeaux de roture. - Henry de Quebriac, sr. dud. lieu, tient la maison du Flachay et 4 journeaux roturiers. - Estiene Bardoul, sr. de la Bardoulaie, lient led. lieu et 36 journeaux 1/2 en roture. - Henry Malleterre, à la maison de Tron. - Jehan Cohu, tient la Marre-es-Souris et le lieu de la Trehaunais, et outre ces choses nobles, 48 journeaux 2/3 de roture. - Jacques Des Granges, outre les choses nob., 8. Journeaux 1/3 de roture. - Les hoirs de feu Perin des Granges, scavoir : P. des Granges, tient de feu Alain de Porcon et Estienette Morin sa femme et de feu Jehane de Porcon etc. outre le nob., 28 journ. de roture. Jehan le Filleux, outre le lieu nob. de la Villes-Vollans, tient 39 journ. de roture, et ses hoirs les tiennent à présent. - Estiene Picot, a la maison nob. de la Barbotais, et outre, 21 journ. de roture. - Jean Leclerc, a une metairie nob. de Limonay, et outre, 8 journaux en roture. - La metairie de Vautouraude, nob. - Jehane de St Pern, tient une maison nob., et 12 journ. de roture. - Jacques de Beaumont, sr. du Val, outre le nob., 21 journ. de roture. - Guillemete Tirecoq, a la Villegisle nob. et six journ. de roture. - Me Roland Poileuc, a la metairie de Tregenri nob., et 8 journ. de roture. - Olivier Chaton, a le lieu de la Jaunais, nob. , et 20 journ. de roture. - Colin Henry, se dit noble et use comme tel, tient 13 journ. de roture. - Piere, sr. de Belleczin ayant en surnom Laurent, a par sa femme led. lieu nob., et 13 journ. de roture. - Jehan de Quebriac, sa maison et lui, nob. et 21 journ. de roture. - Jehane Gaudin, tient 7 journ. 2/3 non nobles. - Piere du Coudray, tient une maison et 4 journ. 1/2 en roture. - Henry Main, tient la maison de la Pohorie et 10 journ. exempts pour ce que Olivier Main son père servoit à l'église et dempuis 40 ans vont aux armes. - Gilles Barlet, tient sa maison nob. de Langavan, et outre, 20 journ. 1/2. - Raoulet Regnault, tient le manoir nob. du Tertre-Jancson et la metairie des Croix-Gibouin, pourtant que a apporté deux demi feux de rabat. - Hamon Martin, a la maison des Souesnais, nob. et 15 journeaux roturiers. - Jean Billart, tient la Villemaltère et les Vignes, nob. et 22 journ. rot. - Berthelot Chevalier, tient le Pontperin nob., et 61 journ. 1/2 roturiers. - Jehan Bouvier, tient la Ville-Aufray, non nob., et 13 journ. rot. - L'Abbé et Couvent St Michel, un priouré jouxte l'églize. - Gilles le Juif, tient la Chandaveine roturière et 25 journ. rot. - Colas de Pont-Colon, nob. tient une maison et 3 journ. rot. - Catherine Ramelin, a la maison de Vauleraut et 47 journ. rot. - Roland Rouxel, tient la maison de la Coudre et la metairie du Petit-Buot franc et 21 journ. rot. - Guill. de la Haye se dit nob. et use noblement, mais a une maison et 3 journ. de roture. - Raoulet Houel, a la maison de Tron nob. et 30 journ. nob., mais il est roturier de sa persone. - Jean Levesque, a une metairie nob. à Limonnay. - Jean Martin et Pierre Gosselin, tiennent la maison de la Chapelle-Malleterre, usant noblement parce qu'ils ont impetré rabat de 1/2 feu . - Jacques de Lamotte, a la maison de Treleis, et outre le nob. un journel roturier. Nobles demeurans en ladite paroisse : Jean le Bouteiller. Jean Cohu. Pierre de Quebriac. Henry Malleterre. Estiene Bardoul. Piere Lorans. Jean de Quebriac. Bertrand Cheville. faux (Jean Billaut, d'autre main adjousté depuis peu). (H. Des Salles).
© Copyright - Tous droits réservés.