|
Bienvenue ! |
SAINT-POL-DE-LEON SOUS LA REVOLUTION (CHAPITRE 37). |
Retour page d'accueil Retour page "Saint-Pol-de-Léon sous la Révolution" Retour page "Ville de Saint-Pol-de-Léon"
CHAPITRE XXXVII.
SOMMAIRE.
Ordre à tous les fonctionnaires de
célébrer les fêtes décadaires. — Tableau des Fêtes Nationales. —
Questionnaire sur les ci-devant religieuses de la ville et des environs,
ainsi que sur les instituteurs et institutrices primaires. — Mort de Hoche.
— Honneurs rendus à sa mémoire. — Statistique agricole de Saint-Pol-de-Léon
en 1797. — Invitation à la municipalité de remettre au receveur des
domaines nationaux l'argenterie restant encore à Saint-Pol. —
Désignation des effets en argent et en or avec leurs poids. — Prescriptions aux
instituteurs et aux institutrices de mettre entre les mains de leurs
élèves les « Droits » de l'homme et du citoyen.
Le Directoire,
comme nous l'avons fait observer, se plaisait à raviver dans les
esprits les plus odieux souvenirs de la Révolution. Le dimanche avait été
supprimé et remplacé dans le calendrier de 1793 par le décadi, dixième
jour de la semaine républicaine ; c'était jour férié pour les hommes
sinistres, devenus les maîtres de la France. Aux fêtes, si belles, si
touchantes du catholicisme avaient succédé les ignobles bacchanales du
paganisme. Ne fallait-il pas amuser et étourdir le peuple d'une façon
quelconque ? Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple, si sauvage
soit-il, qui n'ait ses jours d'amusement ou de fête, et nos gouvernants
étaient contraints de le reconnaître.
Le 28 brumaire, an VI, — 19 novembre 1797, — une lettre du ministre de l'intérieur, le citoyen Le Tourneur, vient rappeler à la municipalité de Saint-Pol que « tous les fonctionnaires publics et employés du gouvernement doivent célébrer les fêtes décadaires ».
L'administration municipale ordonne, en conséquence, aux citoyens Sévézen et Le Saout, instituteurs primaires, de fermer désormais leurs écoles tous les décadis. C'est à eux à se montrer les plus zélés observateurs des fêtes nationales et ils doivent Le Pape, de Pleybert-Christ, Marie Breton, de Guissény, Marie Pouliquen, de la Trêve-Neuve, en Commana et Jeanne Crentoujours être présents aux cérémonies ordonnées par le gouvernement.
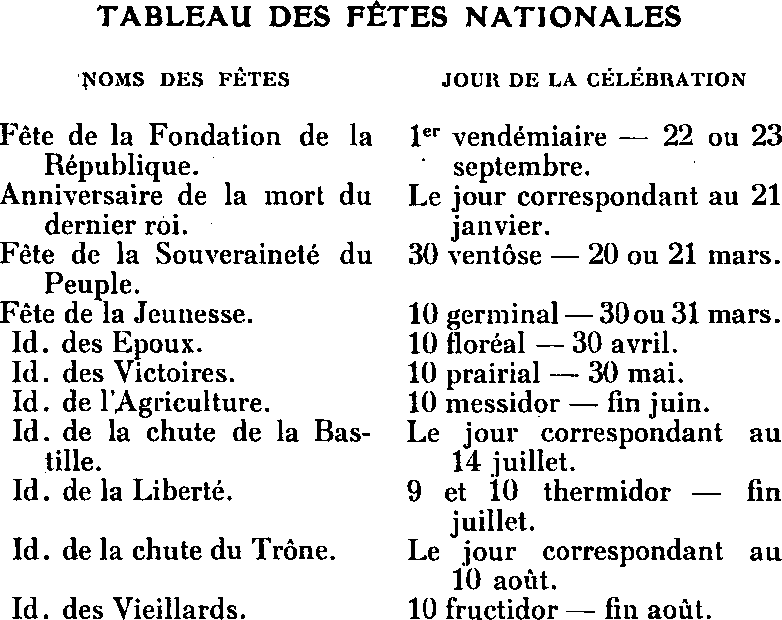
Et voilà par quoi nos solennités religieuses furent alors remplacée. Mais, en ce temps, le burlesque et l'odieux s'alliaient sans difficulté aucune.
Dans le courant de décembre 1797, un questionnaire avait été adressé par le commissaire central du Département à la municipalité de Saint-Pol sur les ci-devant religieuses de la ville et des environs, ainsi que sur les instituteurs et institutrices.
Nous reproduisons les renseignements fournis par le citoyen Guillou, commissaire du Directoire exécutif à Saint-Pol, à ce sujet.
« Il existe à Pol-Léon douze ci-devant religieuses Ursulines, vivant en commun, qui refusèrent en 1791 de nommer une supérieure, et quittèrent à cette époque leur maison.
Dénuées de fortune, elles ont consacré leur temps à l'instruction des petites filles dont les parents leur paient une légère rétribution.
Le nombre des élèves est de 40 à 50, dont 9 pensionnaires.
Le genre d'instruction consiste dans la lecture, récriture, les éléments d'arithmétique et le catéchisme chrétien.
Leur existence dans cette commune est, de l'avis unanime des bons citoyens, utile sous plusieurs rapports ; le témoignage des républicains n'est point équivoque à cet égard.
Je me suis assuré que ces institutrices ne contrarient point les vues du gouvernement, et ne s'occupent que des principes de la saine morale.
Le soin qu'elles prennent d'apprendre à leurs élèves les ouvrages ordinaires aux femmes est singulièrement recommandable.
Notre commune privée de tout autre ressource d'enseignement applaudit au zèle, aux talents et à la surveillance maternelle de ces citoyennes.
Il me serait impossible de peindre les nuances d'opinions politiques des parents de leurs élèves, mais il m'est doux de vous annoncer que les citoyens, dont le patriotisme éprouvé est généralement reconnu, confient leurs enfants à ces institutrices dont les noms suivent, savoir :
Marie-Catherine Goasmoal, Jeanne-Elisabeth Brunet, Jeanne Berthou, Marie-Madeleine Le Gall, Marie-Gabrielle Lareur, Marie-Anne Le Guen, Marie-Josèphe Godivet, Marie Béziné, Marie-Jeanne Baron, Marie Cloarec, Marie-Michelle Bolloré.
Trois ci-devant religieuses ne vivent pas en commun :
Marie-Françoise Nayl, de la communauté de Landerneau, retirée chez ses sœurs dans cette ville, fait des écoles gratuites de simple lecture à un nombre indéterminé de petites filles indigentes.
Marie-Madeleine Le Veyer, de la communauté de Pol-Léon, retirée chez son frère dans cette ville, n'a point d'élèves.
Gilette Kerjean, de la même communauté, retirée chez sa sœur dans cette ville, n'a point d'élèves ».
Plouénan
« Il existe dans la commune de Plouénan trois ci-devant religieuses Ursulines, vivant en commun, qui refusèrent en 1791 de nommer une supérieure et quittèrent leur maison à cette époque.
Elles instruisent 18 jeunes filles dont 12 gratuitement.
Le genre d'instruction est le même que celui établi chez les ci-devant Ursulines de Pol-Léon.
Leur fortune n'est pas brillante, la misère les poursuit, l'humanité les console. Je pourrais leur appliquer ce que je viens de vous dire à l'égard des nôtres.
Quant aux opinions politiques des parents de leurs élèves, vous savez qu'il est difficile de les caractériser.
Les campagnes manquent d'esprit public dont le flambeau dissipe lentement les ténèbres de l'ignorance et des préjugés. La dififérence de l'idiome est un obstacle essentielement contraire au génie de la philosophie et de la Liberté.
Voici les noms des ci-devant religieuses de Plouénan :
Anne Le Roux, de Plouénan, Catherine Le Duff, de Plouescat, Marie-Charlotte Fissot, de Pol-Léon ».
Plougoulm
« Il existe dans cette commune quatre ci-devant religieuses Ursulines, vivant en commun, qui refusèrent en 1791 de nommer une supérieure et quittèrent leur maison, à cette époque.
Elles instruisent 21 jeunes filles de leur arrondissement, dont deux pensionnaires. Leur mode d'enseignement est semblable à celui des autres.
Je vous observe que ces institutrices ont résolu de se retirer dans leurs familles. Quoi qu'il en soit, voici leurs noms :
Marie Le Pape, de Pleybert-Christ, Marie Breton, de Guissény, Marie Pouliquen, de la Trêve-Neuve, en Commana et Jeanne Cren, de Sibiril.
Je ne puis vous signaler les opinions politiques des parents de leurs élèves ; il faudrait vivre avec les cultivateurs pour les apprécier. Le commissaire du canton de Plouénan a peut-être des données satisfaisantes à cet égard » [Note : Plusieurs Ursulines ont continué secrètement la vie de communauté. Un ancien registre, conservé au couvent des Ursulines de Saint-Pol, relate les prises d'habit et les professions faites jusqu'au jour où elles purent reconstituer leur communauté].
Instituteurs de Pol-Léon
« 1° Alain Livolant, instituteur patriote, a 25 jeunes élèves mâles dont les parents sont bons citoyens ;
2° Yves Le Saout, instituteur patriote, a 25 élèves mâles dont les parents sont bons citoyens ;
3° Jean-Guillaume Sévézen , instituteur patriote , a 40 élèves mâles dont les parents sont bons citoyens.
La lecture, l'écriture, le chiffre et l'étude de la grammaire française composent le plan de leur instruction ».
Instituteurs de Plouénan
« Nicolas Béchu et Louis Péron, demeurant au cy-devant presbytère, ont 40 élèves mâles des environs dont 20 pensionnaires.
Ils enseignent la lecture, l'écriture et la langue française.
Je n'ai aucune notion sur les opinions politiques des parents des élèves.
Signé : Guillou ».
Le 15 septembre 1797, le général Lazare Hoche était emporté à la suite d'une courte maladie d'entrailles, n'étant âgé que de 29 ans. Son mal eut tous les caractères d'un empoisonnement, et l'opinion publique attribua sa mort au Directoire qui avait peur de lui.
Fils d'un garde de chenil de Louis XV, Hoche ne dut son élévation qu'à lui-même. Recueilli par une tante, fruitière à Versailles, après la perte de ses parents, il employait le peu d'argent qu'il recevait pour acheter des livres qu'il dévorait. Porté par son inclination à l'art militaire, il s'engagea à seize ans dans le régiment des gardes françaises. A la Révolution, au bout de deux campagnes, il fut nommé général en chef et pacifia la Vendée. Les généraux qui l'y avaient précédé ne s'étaient appliqués qu'à tuer et à détruire. « Hoche, dit l'historien Rohrbacher, eut assez de génie pour distinguer la Vendée catholique et la Vendée royaliste. Il rassura complètement la première, protégea ses prêtres et la fit jouir de la liberté de son culte. Quant à la seconde, il lui fit une guerre habile, mais loyale, de manière à mériter l'estime et la confiance de ses ennemis ».
La guerre s'étant rallumée, lors de la malheureuse descente des émigrés à Quiberon en 1795, Hoche marcha en toute hâte contre les royalistes, les enferma dans la presqu'île, prit d'assaut le fort Penthièvre et les força de capituler, promettant la vie sauve à tous ceux qui mettraient bas les armes. Lorsque, malgré ces promesses, on parla de fusiller tous les prisonniers, « Hoche, affirme l'abbé de Feller, prit leur défense, et représenta avec énergie à la Convention nationale combien il serait cruel et impolitique de détruire six à sept mille familles. Mais ses efforts furent vains ; la Convention ordonna un massacre général » [Note : V. Rohrbacher - T. XXVII, pp. 618-620. Feller, biogr. universelle].
Les émigrés subirent leur sort avec une héroïque résignation. Hoche avait remis au général Le Moine le commandement du Morbihan et s'était dirigé avec ses troupes vers Saint-Malo. L'affreuse besogne avait été accomplie par des soldats étrangers.
A sa mort, arrivée comme nous l'avons dit, le 15 septembre 1797, le gouvernement fît honorer sa mémoire par deux pompes funèbres : l'une sur le Rhin et l'autre à Paris. Hoche fut un des plus brillants généraux de la République. Il se distingua surtout dans la Vendée et il fit une fort belle campagne au delà du Rhin.
La municipalité de Saint-Pol, à l'instar des autres communes de la République, crut devoir aussi solenniser la mémoire du glorieux soldat. Elle arrêta que la fête serait célébrée le 29 vendémiaire, an VI — 19 octobre 1797. Les citoyens Pierre Macé, vitrier, François Le Roux, perruquier, et Jean Pouliquen, menuisier, qui avaient fait des avances et des fournitures de différents objets à l'occasion de la fête funéraire et dont les dépenses montaient à 7 livres, 11 sols, 6 deniers, reçurent de l'administration le 4 nivôse — 25 décembre, — un bon pour percevoir la dite somme [Note : Reg. 30. Fol. 162]
Ce ne sera pas un hors-d'œuvre de reproduire ici la statistique de la situation agricole de Saint-Pol-de-Léon à la fin de 1797. C'est toujours avec intérêt, croyons-nous, qu'on lit ces sortes de détails qui font connaître un pays, ses ressources et l'état de fortune de ses habitants. Saint-Pol, loin de gagner, avait beaucoup perdu par suite de la suppression des communautés religieuses, et les familles ouvrières surtout en avaient extrêmement souffert.
« Situation agricole de Saint-Pol en 1797 »
« Les terres de la commune sont généralement bonnes, excepté sur le territoire de Santec, où elles sont légères et sabloneuses.
Les digues en pignon de genêt, élevées en cette partie pour empêcher le sable de gagner sur les terres labourées, ayant été détruites depuis la Révolution, le sable fait des progrès rapides sur les terres, les détériore de plus en plus, en affaiblit les produits et forcera bientôt à les abandonner.
Il se récolte très peu de froment sur le territoire de Santec, le principal de la récolte est en seigle et en orge.
La plus grande partie de la récolte se consomme dans la commune et dans celles de Roscoff et de l'île de Batz qui viennent s'approvisionner aux marchés de Saint-Pol. — L'excédent de froment qui ne s'y consomme pas se vend ordinairement pour l'approvisionnement de la marine à Brest.
Le quintal de froment se vend de 10 à 12 fr. ; celui de seigle-froment de 8 à 10 fr. et celui d'orge de 6 à 7 fr.
Les jours de marché sont fixés aux primidi et sextidi de chaque décade, et les foires se tiennent le sextidi de la première décade de chaque mois.
Le journal de bonne terre s'afferme de 40 à 45 fr., à la charge en outre d'entretenir les fossés en bon état de réparation.
La durée des baux est de 5, 7 ou 9 ans, commençant au 8 vendémiaire (29 septembre) de chaque année.
Là journée d'un journalier agricole se paie depuis 1 fr. jusqu'à 1 fr. 50. La journée de charroi, comprenant un homme, un cheval et une charrette depuis 6 jusqu'à 9 fr.
Les gages annuels d'un domestique mâle sont de 75 à 120 fr., et ceux d'une domestique femelle de 36 à 75 fr.
Les habitants sont en général très pauvres, surtout la classe des ouvriers qui ne trouvent plus de travail suffisant pour procurer une subsistance honnête à leurs familles depuis la suppression des établissements dits ecclésiastiques qui existaient à Saint-Pol avant la Révolution. — Deux seulement des bâtiments, occupés autrefois par ces établissements, sont encore invendus et seraient propres à l'installation d'une filature et à la fabrication de la toile ; les bâtiments du ci-devant évêché et ceux du ci-devant collège.
La population de la commune est de 5,327 habitants ».
2
pluviôse, an VI, — 21 janvier 1798. — Prescription du serment de haine à la
royauté et à l'anarchie, en mémoire de la mort de Louis XVI.
Quelques jours après, le 7 pluviôse, — 28 janvier, — les Pères conscrits de Saint-Pol se réunissent de nouveau. La séance est présidée par le citoyen Ménez, assisté des citoyens Prud'homme-Keraugon et Kervingant, administrateurs municipaux.
Présent : le citoyen Guillou, commissaire provisoire du Directoire exécutif.
Nous avons eu déjà l'occasion de le faire observer. La Révolution avait des appétits féroces que rien ne pouvait assouvir. Voici ce qui se passa dans cette séance :
« En exécution de la lettre de l'Administration centrale du Finistère, en date du 28 nivôse dernier, portant invitation à l'administration municipale de Paul-Léon de remettre au receveur des domaines nationaux au dit Paul-Léon l'argenterie qui restoit encore en cette commune et d'en prendre un reçu indicatif du poids des matières dont le double doit être envoyé à la dite Administration centrale.
L'administration municipale a remis au citoyen Anne, receveur des domaines nationaux en cette commune, l'argenterie mentionnée en son reçu dont la teneur suit :
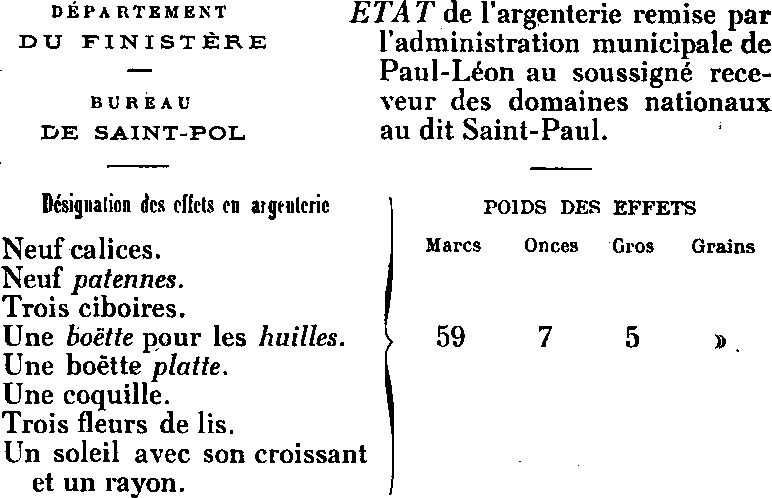
Or :
Une petite croix et trois petites perles, pesant un gros, quatre grains.
Je, soussigné receveur du domaine national à Saint-Pol, reconnois avoir reçu ce jour, conformément à la lettre de l'Administration centrale du Finistère du 28 nivôse dernier — 18 janvier 1798 — les effets d'or et d'argent mentionnés cy-dessus pesant, savoir, l'argenterie 59 marcs, etc., et les effets en or, un gros, 4 grains, et ce d'après les poids du citoyen Le Hir, directeur des postes aux lettres au dit Saint-Pol, les quels effets seront par moi incessamment adressés à l'hôtel monétaire à Paris.
A Saint-Pol ce jour 7 pluviôse, an VI — Signé : Anne » [Note : Reg. 30. Fol. 174].
Là où on trouvait à prendre on prenait sans scrupule. La plupart du temps, le trésor était vide. Aussi bien, nos gouvernants se voyaient-ils dans la nécessité de battre monnaie d'une manière ou d'une autre, et l'Eglise catholique était une proie qui ne leur offrait aucune résistance.
Quelques jours après, le citoyen Guillou qui avait été nommé provisoirement commissaire du Directoire exécutif, en novembre 1797, est remplacé par le citoyen Loussaut, notaire.
Le Directoire, ayant prescrit aux instituteurs et aux institutrices des écoles primaires de mettre entre les mains des élèves les « Droits de l'Homme et du Citoyen », ainsi que la Constitution de l'an III et les livres élémentaires adoptés par la Convention et qui devaient servir de base à l'instruction primaire, les religieuses Ursulines crurent qu'elles ne pouvaient se conformer à cet ordre.
Voici ce qu'elles répondirent le 11 ventôse, an VI — 1er mars 1798 — au citoyen Loussaut, qui les avait invitées à lui fournir la liste de leurs élèves et à mettre entre les mains des enfants qui leur étaient confiées les livres en question.
« Citoyen,
Nous ne nous sommes jamais regardées comme institutrices ; nous
sommes des individus qui nous nous sommes assemblées pour
n'être pas à charge à la République et gagner de quoi vivre de nos ouvrages
et industries. Il est vrai que
le canton nous a confié quelques-unes de
leurs enfants ; il y en a qui paient, plusieurs ne sont pas en état de faire
et ne le font point.
Nous leur apprenons à lire, à écrire, à chiffrer ; nous montrons à tricoter, coudre et autres ouvrages utiles qui conviennent à leur sexe. Nous ne leur enseignons rien de contraire aux principes du gouvernement politique.
Vous nous trouverez toujours soumises et prêtes à fermer nos écoles dès qu'on l'exigera de nous ; nous l'avions déjà fait et nous n'avons repris qu'à la sollicitation des habitants, mais nous les laisserons si tôt qu'on le voudra.
Salut et fraternité ».
Les citoyens Livolant et Sévézen, instituteurs primaires répondirent également au citoyen Loussaut.
Voici la réponse du premier :
« Pour remplir les vues de votre réquisitoire en datte du 11 courant, je me satisfaits infiniment, en vous accusant réception de l'extraît du bulletin des lois de la République, n° 181, concernant les règlements à tenir et à suivre dans les écoles particulières.
Malgré tout le zèle que j'y pourrais apporter, je crains de ne point réussir, comme je le désire. En cela au moins je n'aurais rien à me reprocher. Salut ».
Le citoyen Sévézen répondit en ces termes au commissaire Loussaut :
« Citoyen, le mérite de la présence est de vous accuser la réception d'une copie d'arrêté du Directoire exécutif concernant la surveillance des écoles particulières que vous m'avez transmise. Salut et fraternité ».
Invitées de nouveau deux jours après à se conformer à l'arrêté du Directoire exécutif, les ci-devant sœurs Ursulines répondent au citoyen Loussaut par l'intermédiaire de la citoyenne Brunet, l'une d'elles :
« Citoyen, vous n'ignorez pas que nous ne faisons plus d'écoles. Je vous l'ai déclaré chez vous verbalement. Nous n'avons. plus ici ni écolières ni pensionnaires. En conséquence l'arrêté que vous nous avez fait passer ne nous regarde pas. — Salut et fraternité ».
Ces diverses réponses ne rassurèrent pas la municipalité. Le 24 ventôse, — 14 mars 1798, — les citoyens Claude Ménez, président de l'administration municipale de Pol-Léon et Claude-François Jacquinot, administrateur municipal, en exécution de l'arrêté du Directoire exécutif, concernant la surveillance des écoles particulières, maisons d'éducation et pensionnats, se transportent, accompagnés du citoyen Jean Loussaut, commissaire du Directoire exécutif chez le citoyen Alain Livolant, maître d'école particulière en la ville, à l'effet de savoir « si ce citoyen a soin de mettre entre les mains de ses élèves, comme base de la première instruction, les Droits de l'Homme, la Constitution et les livres élémentaires qui ont été adoptés par la Convention ; — si l'on observe les décadis, — si l'on y célèbre les fêtes républicaines et si l'on s'y honore du nom de citoyen ».
« Le citoyen Livolant interrogé ce touchant, en présence de ses élèves, a déclaré aux commissaires qu'il ne faisait lire par ses élèves que les livres qui leur étaient donnés par leurs parents, qui consistent en livres d'histoires et autres livres anciens, tant français que latins.
Invité et requis de se procurer la Constitution, les Droits de l'Homme et autres livres élémentaires, le citoyen Livolant a fait observer à la commission que, n'étant pas salarié par la République, ses facultés ne lui permettaient pas de faire cette emplette, assurant d'ailleurs qu'il faisait observer les décadis et exhortait ses élèves à célébrer les fêtes républicaines et qu'il enseignait dans ses écoles à lire, à écrire, l'arithmétique et la grammaire française ».
De là la commission se transporta chez le citoyen Sévézen,père.
« Ce dernier déclara n'avoir pas les livres élémentaires mentionnés dans l'arrêté du Directoire exécutif. Il promit néanmoins de se les procurer incessamment, déclarant en outre enseigner à lire d'anciens titres et papiers, l'arithmétique et à écrire ».
Après quoi, la commission se transporta chez le citoyen Yves Le Saout, aussi instituteur, le quel fit la même déclaration que le précédent.
(abbé J. Tanguy).
© Copyright - Tous droits réservés.