|
Bienvenue chez les Samaritains |
SAINTE-MARIE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Redon
La commune de
Sainte-Marie ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINTE-MARIE
Sainte-Marie vient de la dédicace de la paroisse à la Vierge Marie.
Sainte-Marie est un démembrement tardif de la paroisse de Bains. Il existait jadis sur le territoire de Bains une léproserie avec une chapelle dédiée à sainte Madeleine et un cimetière. Le fief de l'Aumônerie appartenait jadis à l'Abbaye de Saint-Sauveur de Redon.
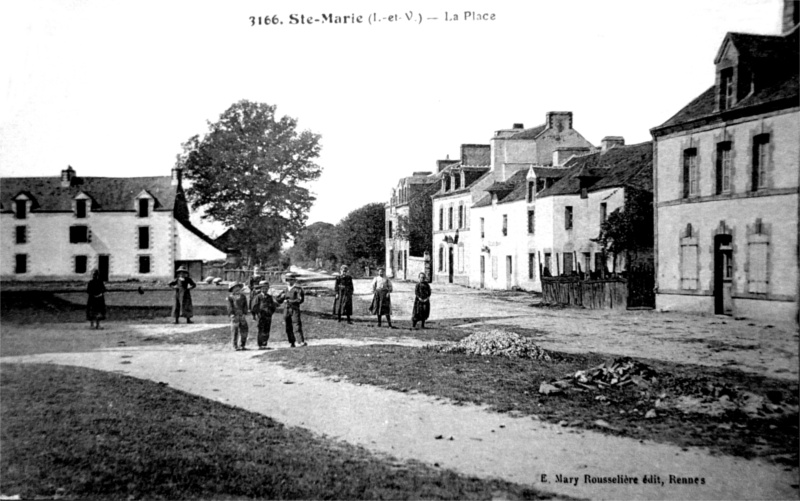
Le Pouillé de Rennes stipule que le territoire de cette paroisse, d'origine récente, a été distrait de celui de Bains. Il existait en cette dernière paroisse une vieille léproserie et une chapelle de Sainte-Magdeleine, tombée en ruine à la fin du siècle dernier. Vers 1820, M. Glo, recteur de Bains, fit construire avec les pierres de cet antique sanctuaire, dans la frairie des Ponts, une chapelle qu'il dédia à saint André. Son intention était simplement de venir en aide aux besoins spirituels de ses paroissiens, fort éloignés du bourg de Bains, mais cette construction fut le principe du démembrement de sa paroisse. En 1845, en effet, les habitants des frairies des Ponts (Pont-de-Renac), de Prin (Haut-de-Prin) et de Germigniac (nota : A propos de ces anciens villages de Prin et de Germigniac, mentionnés dès le IXème siècle, notons ce qui suit, extrait de l'aveu de l'abbaye de Redon en 1580 : « Les frairiens de Prin doibvent au seigneur abbé de Redon, lorsqu'il luy plaist aller chasser audit lieu de Prin, luy et ses serviteurs, un disner appelé mangier, aultrement repas et refection, et, si l'abbé n'y va pas, sont lesdits frairiens tenus poyer telle somme qu'il sera advisé »), demandèrent l'érection d'une nouvelle paroisse. Cette faveur leur fut accordée par ordonnance royale en date du 4 novembre 1845, et par ordonnance épiscopale du 24 du même mois. La nouvelle paroisse fut formée des trois traits de l'Aumônerie, le Pont-de-Renac et le Haut-de-Prin. Mgr Saint-Marc lui donna pour patronne la très Sainte Vierge, et elle prit le nom de Sainte-Marie. Le premier recteur, M. Daniel, bâtit un presbytère et se servit de la chapelle de Saint-André, qui ne tarda pas à devenir insuffisante. Son successeur construisit alors une église à quelque distance de Saint-André, au sommet d'une colline. Un bourg se forma aussitôt à l'ombre du clocher, dans une position charmante au-dessus du cours de la Vilaine. Aujourd'hui, Sainte-Marie est une paroisse pleine d'avenir, et la flèche élancée de son église s'élève au milieu d'anciennes landes bien cultivées maintenant et domine d'immenses marais d'aspect fort pittoresque (Pouillé de Rennes). La paroisse de Sainte-Marie est érigée en commune le 6 novembre 1871 et dépendait jadis de l'ancien évêché de Vannes.

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Sainte-Marie : N... Daniel (1845-1853). Jean-Baptiste Horcholle (1853, décédé en 1869). Jean-Germain Galiçon (1869-1876). Pierre Taillard (à partir de 1876), .....
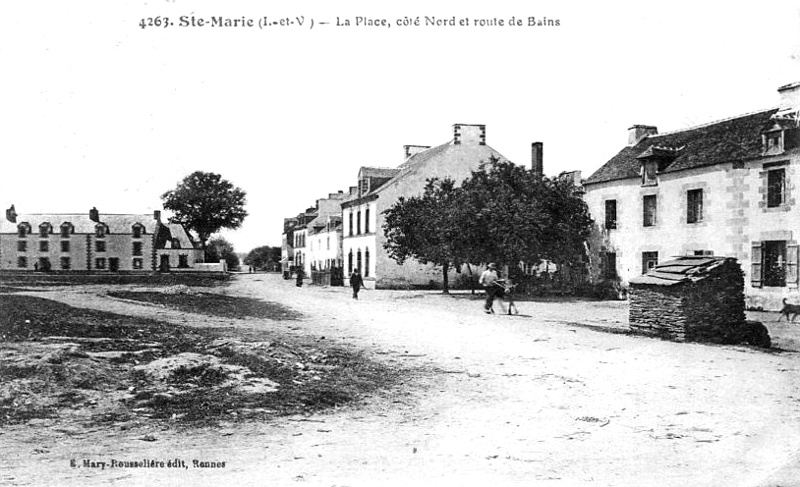
![]()
PATRIMOINE de SAINTE-MARIE
![]() l'église
Sainte-Marie (1855-1859), située au village du Haut-Prin et oeuvre de
l'architecte Edouard Brossay Saint-Marc. Cette église est construite à
l'initiative du recteur M. Horcheul. La nef et le chœur datent de 1855-1865.
La première pierre est posée le 20 juin 1855. L'église est bénite le 18
mai 1866 ;
l'église
Sainte-Marie (1855-1859), située au village du Haut-Prin et oeuvre de
l'architecte Edouard Brossay Saint-Marc. Cette église est construite à
l'initiative du recteur M. Horcheul. La nef et le chœur datent de 1855-1865.
La première pierre est posée le 20 juin 1855. L'église est bénite le 18
mai 1866 ;

![]() la
chapelle Saint-Jean-d'Epileur ou Saint-Jean-Apileur ou d'Espileuc ou des
Pileurs (XIVème siècle), édifiée sur le site de
l'ancienne église de Bains-sur-Oust. Cette chapelle est citée dès 834
dans le Cartulaire de l'abbaye de Redon et
semble tirer son nom de celui de Spiluc, porté par cette région
dès le IXème siècle. En effet, l'ancien nom d'Espileuc ou d'Espileur,
donné jadis à ce sanctuaire, semble être le même que celui de Spiluc, «
pars que dicitur Spiluc », que portait dès 831 cette partie du
territoire de Bains. Il indique donc une haute antiquité. On y faisait des
mariages et même des sépultures au XVIIème siècle. L'édifice est d'une
architecture bien pauvre ; il affecte la forme d'une croix, est garni de
bancs de pierre à l'intérieur et possède trois autels, dont deux sont
d'antiques tables de granit supportées par des consoles grossières. La
chapelle est dédiée à saint Jean-Baptiste, ce qui détruit l'hypothèse qu'on a faite en prétendant voir dans son nom une
forme altérée de Saint-Jean-Apileur ou Avileur, dénomination bretonne de
saint Jean-l'Evangéliste. Enfin, elle s'élève au milieu d'un ancien
cimetière converti en bois taillis, et elle continue à la fin du XIXème
siècle d'être considérée comme frairienne et desservie tous les
dimanches par les prêtres de Sainte-Marie (Pouillé de Rennes) ;
la
chapelle Saint-Jean-d'Epileur ou Saint-Jean-Apileur ou d'Espileuc ou des
Pileurs (XIVème siècle), édifiée sur le site de
l'ancienne église de Bains-sur-Oust. Cette chapelle est citée dès 834
dans le Cartulaire de l'abbaye de Redon et
semble tirer son nom de celui de Spiluc, porté par cette région
dès le IXème siècle. En effet, l'ancien nom d'Espileuc ou d'Espileur,
donné jadis à ce sanctuaire, semble être le même que celui de Spiluc, «
pars que dicitur Spiluc », que portait dès 831 cette partie du
territoire de Bains. Il indique donc une haute antiquité. On y faisait des
mariages et même des sépultures au XVIIème siècle. L'édifice est d'une
architecture bien pauvre ; il affecte la forme d'une croix, est garni de
bancs de pierre à l'intérieur et possède trois autels, dont deux sont
d'antiques tables de granit supportées par des consoles grossières. La
chapelle est dédiée à saint Jean-Baptiste, ce qui détruit l'hypothèse qu'on a faite en prétendant voir dans son nom une
forme altérée de Saint-Jean-Apileur ou Avileur, dénomination bretonne de
saint Jean-l'Evangéliste. Enfin, elle s'élève au milieu d'un ancien
cimetière converti en bois taillis, et elle continue à la fin du XIXème
siècle d'être considérée comme frairienne et desservie tous les
dimanches par les prêtres de Sainte-Marie (Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancienne
chapelle de la Madeleine (vers 1580). L'antique chapelle de Sainte-Magdeleine, bâtie en la
paroisse de Bains (maintenant sur le territoire de Sainte-Marie), semble
bien avoir été fondée par les moines de l'abbaye de Redon pour desservir
une léproserie, utile jadis aux vassaux de ce puissant monastère. En 1580,
cette chapelle s'élevait au milieu d'un petit cimetière qui existe seul
aujourd'hui ; le sanctuaire est, en effet, complètement détruit : un vieil
if, une croix et quelques tombes indiquent son emplacement ; mais les
habitants viennent toujours prier sur ses ruines, et l'on y lit encore sur
la pierre tumulaire d'un dernier chapelain ces simples paroles : Cy gist
le corps de Missire Pierre Dano, prestre de cette paroisse, qui trespassa le
20 mai 1764, âgé de 87 ans. Priez Dieu pour son âme (Pouillé de
Rennes). Son emplacement est signalée par une croix et la dalle
funéraire de Pierre Dano, décédé en 1764 ;
l'ancienne
chapelle de la Madeleine (vers 1580). L'antique chapelle de Sainte-Magdeleine, bâtie en la
paroisse de Bains (maintenant sur le territoire de Sainte-Marie), semble
bien avoir été fondée par les moines de l'abbaye de Redon pour desservir
une léproserie, utile jadis aux vassaux de ce puissant monastère. En 1580,
cette chapelle s'élevait au milieu d'un petit cimetière qui existe seul
aujourd'hui ; le sanctuaire est, en effet, complètement détruit : un vieil
if, une croix et quelques tombes indiquent son emplacement ; mais les
habitants viennent toujours prier sur ses ruines, et l'on y lit encore sur
la pierre tumulaire d'un dernier chapelain ces simples paroles : Cy gist
le corps de Missire Pierre Dano, prestre de cette paroisse, qui trespassa le
20 mai 1764, âgé de 87 ans. Priez Dieu pour son âme (Pouillé de
Rennes). Son emplacement est signalée par une croix et la dalle
funéraire de Pierre Dano, décédé en 1764 ;
![]() l'ancienne
chapelle Saint-Laurent, située autrefois sur la route de Redon à Renac.
Les annotateurs, au XVIIIème siècle, de l'aveu rendu par Hector Scotti,
abbé de Redon, mentionnent dans la frairie des Ponts une chapelle de
Saint-Laurent, distincte de celle du même nom située en Bains dans la
frairie de Binon. Saint-Laurent des Ponts devait se trouver sur les landes,
au bord du chemin de Redon à Renac, aux environs du vieux moulin à vent
appelé moulin de Saint-Laurent. Il ne reste plus rien de cette chapelle
(Pouillé de Rennes) ;
l'ancienne
chapelle Saint-Laurent, située autrefois sur la route de Redon à Renac.
Les annotateurs, au XVIIIème siècle, de l'aveu rendu par Hector Scotti,
abbé de Redon, mentionnent dans la frairie des Ponts une chapelle de
Saint-Laurent, distincte de celle du même nom située en Bains dans la
frairie de Binon. Saint-Laurent des Ponts devait se trouver sur les landes,
au bord du chemin de Redon à Renac, aux environs du vieux moulin à vent
appelé moulin de Saint-Laurent. Il ne reste plus rien de cette chapelle
(Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancienne
chapelle Saint-André. Cette chapelle, construite vers 1820, a été vendue
et sécularisée depuis la fondation de la nouvelle église paroissiale
(abbé Guillotin de Corson) ;
l'ancienne
chapelle Saint-André. Cette chapelle, construite vers 1820, a été vendue
et sécularisée depuis la fondation de la nouvelle église paroissiale
(abbé Guillotin de Corson) ;
![]() les
autres anciennes chapelles, aujourd'hui disparues. Les habitants nous ont
dit qu'il se trouvait autrefois des chapelles au manoir de la Noë et près
du village de la Borgnais, là où la tradition place un ancien village ou
manoir nommé la Maduchaye, complètement disparu maintenant (Pouillé de
Rennes) ;
les
autres anciennes chapelles, aujourd'hui disparues. Les habitants nous ont
dit qu'il se trouvait autrefois des chapelles au manoir de la Noë et près
du village de la Borgnais, là où la tradition place un ancien village ou
manoir nommé la Maduchaye, complètement disparu maintenant (Pouillé de
Rennes) ;
![]() la
croix de la Madeleine ;
la
croix de la Madeleine ;
![]() la
croix du Bois-Mahé (XIXème siècle) ;
la
croix du Bois-Mahé (XIXème siècle) ;
![]() le
manoir de la Buffardais ou Buffardaye (XVIème siècle). Il possédait
autrefois une fuie. Propriété successive des
familles Du Bois Jagu (en 1495 et en 1536), Coué seigneurs du Brossays (en
1556), Glé seigneurs de la Costardaye (en 1580), Du Bois de la Selle ou
Salle (en 1607), Moraud seigneurs du Déron (en 1653 et 1728). —
En 1495, Robert du Bois-Jagu rendit aveu à l'abbé de Redon pour ce manoir,
que possédait en 1536 François du Bois-Jagu. En 1566, Marie de Complude, mère
et tutrice de Pierre Coué, seigneur du Brossay, et veuve de Julien Coué,
rendit également aveu à l'abbé de Redon pour « son hostel et maison
de la Buffardaye, jardin, vignes, colombier, 80 journaux de terre joignant
l'estang de Renac, droit de peschage dans cet estang, bois futayes, taillis,
etc. ». En 1580, Bertrand Glé et Perronnelle du Pan, seigneur et dame
de la Costardaye, tenaient de l'abbé de Redon le manoir de la Buffardaye «
à devoir de foy, hommage et rachapt ». En 1607, Gabriel du Bois de la
Salle, seigneur de la Buffardaye, rendit aveu pour ce manoir, mais il habitait celui des
Févrieux, en Sulniac. Quelque temps après, la famille Moraud devint propriétaire
de la Buffardaye, qui appartenait en 1653 à François Moraud, seigneur du
Deron, et en 1728 à Mme du Deron. Ce ne fut plus alors qu'une maison de
ferme. Il ne reste rien de l'ancien manoir, et la ferme appartient à M. de
Poulpiquet du Halgouët, qui l'acheta, en 1873, d'avec M. et Mme Dominé
(abbé Guillotin de Corson) ;
le
manoir de la Buffardais ou Buffardaye (XVIème siècle). Il possédait
autrefois une fuie. Propriété successive des
familles Du Bois Jagu (en 1495 et en 1536), Coué seigneurs du Brossays (en
1556), Glé seigneurs de la Costardaye (en 1580), Du Bois de la Selle ou
Salle (en 1607), Moraud seigneurs du Déron (en 1653 et 1728). —
En 1495, Robert du Bois-Jagu rendit aveu à l'abbé de Redon pour ce manoir,
que possédait en 1536 François du Bois-Jagu. En 1566, Marie de Complude, mère
et tutrice de Pierre Coué, seigneur du Brossay, et veuve de Julien Coué,
rendit également aveu à l'abbé de Redon pour « son hostel et maison
de la Buffardaye, jardin, vignes, colombier, 80 journaux de terre joignant
l'estang de Renac, droit de peschage dans cet estang, bois futayes, taillis,
etc. ». En 1580, Bertrand Glé et Perronnelle du Pan, seigneur et dame
de la Costardaye, tenaient de l'abbé de Redon le manoir de la Buffardaye «
à devoir de foy, hommage et rachapt ». En 1607, Gabriel du Bois de la
Salle, seigneur de la Buffardaye, rendit aveu pour ce manoir, mais il habitait celui des
Févrieux, en Sulniac. Quelque temps après, la famille Moraud devint propriétaire
de la Buffardaye, qui appartenait en 1653 à François Moraud, seigneur du
Deron, et en 1728 à Mme du Deron. Ce ne fut plus alors qu'une maison de
ferme. Il ne reste rien de l'ancien manoir, et la ferme appartient à M. de
Poulpiquet du Halgouët, qui l'acheta, en 1873, d'avec M. et Mme Dominé
(abbé Guillotin de Corson) ;
![]() la
maison (XVI-XVIIIème siècle), située au lieu-dit La Posnière ;
la
maison (XVI-XVIIIème siècle), située au lieu-dit La Posnière ;
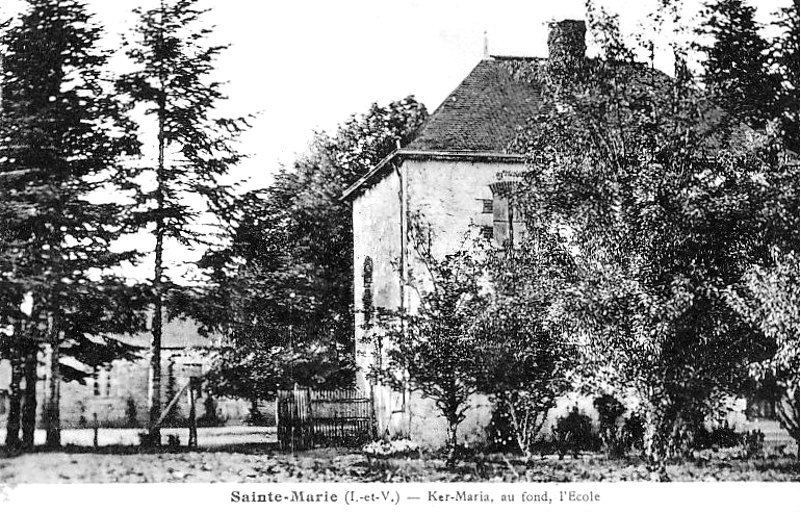
A signaler aussi :
![]() des
restes d'une tombelle ;
des
restes d'une tombelle ;
![]() l'ancien
camp dominant la Vilaine, situé au village du Brûlais ;
l'ancien
camp dominant la Vilaine, situé au village du Brûlais ;
![]() un
tumulus. D'après une légende, quatre évêques venant des quatre points de
l'horizon auraient officié sur ce tumulus durant la nuit de Noël ;
un
tumulus. D'après une légende, quatre évêques venant des quatre points de
l'horizon auraient officié sur ce tumulus durant la nuit de Noël ;
![]() l'ancien
manoir du Dréneuc. Propriété des seigneurs du Dréneuc (en 1536), et des
familles Le Long, Couriolle et Glaumet (en 1580), Marcadé seigneurs du Parc-Anger (en
1653), Picot, Landais seigneurs de la Cadinière (en 1682). —
Il n'y a plus que quelques ruines insignifiantes de ce manoir, possédé en
1536 par le seigneur du Dréneuc, dont la famille se fondit dans celle des
Le Long. Jean Le Long, seigneur du Dréneuc, vendit ce manoir avec « ses
bois, vignes et garennes » à Guillemette Couriolle, veuve de Daniel
Glaumet, et cette dame tenait le Dréneuc féodalement de l'abbé de Redon,
en 1580. Jean Marcadé, seigneur du Parc-Anger, possédait en 1653,
conjointement avec ses soeurs, ce manoir, qui passa entre les mains de
Pierre Landais, seigneur de la Cadinière, en 1682, à cause des enfants
issus de ce dernier et de Jeanne Picot ;
l'ancien
manoir du Dréneuc. Propriété des seigneurs du Dréneuc (en 1536), et des
familles Le Long, Couriolle et Glaumet (en 1580), Marcadé seigneurs du Parc-Anger (en
1653), Picot, Landais seigneurs de la Cadinière (en 1682). —
Il n'y a plus que quelques ruines insignifiantes de ce manoir, possédé en
1536 par le seigneur du Dréneuc, dont la famille se fondit dans celle des
Le Long. Jean Le Long, seigneur du Dréneuc, vendit ce manoir avec « ses
bois, vignes et garennes » à Guillemette Couriolle, veuve de Daniel
Glaumet, et cette dame tenait le Dréneuc féodalement de l'abbé de Redon,
en 1580. Jean Marcadé, seigneur du Parc-Anger, possédait en 1653,
conjointement avec ses soeurs, ce manoir, qui passa entre les mains de
Pierre Landais, seigneur de la Cadinière, en 1682, à cause des enfants
issus de ce dernier et de Jeanne Picot ;
![]() l'ancien
manoir de la Noë. Propriété successive des familles Michel (en 1536),
Bonamy (en 1580), Moraud seigneurs du Déron (en 1653). — Guillaume
Michel possédait ce manoir en 1536, et Anne Bonamy le tenait en 1580 de
l'abbé dé Redon « à devoir de foy, hommage et rachapt ». La Noë
appartint ensuite à François Moraud, seigneur du Déron (1653), et devint
une simple ferme que possède vers 1878 l'administration de l'hôpital de Redon ;
l'ancien
manoir de la Noë. Propriété successive des familles Michel (en 1536),
Bonamy (en 1580), Moraud seigneurs du Déron (en 1653). — Guillaume
Michel possédait ce manoir en 1536, et Anne Bonamy le tenait en 1580 de
l'abbé dé Redon « à devoir de foy, hommage et rachapt ». La Noë
appartint ensuite à François Moraud, seigneur du Déron (1653), et devint
une simple ferme que possède vers 1878 l'administration de l'hôpital de Redon ;
![]() l'ancien
manoir de Rohignac, situé route Sud de Redon et appartenant en 1878 à la
famille Evain. Il conserve une tourelle et
une salle du XVIème siècle. Il possédait jadis une chapelle privée
devenue frairienne et dédiée à saint Nicodème. Une note du XVIIIème siècle
nous apprend que les moines de Redon accordèrent aux frairiens de
Germigniac l'usage de cette chapelle, qui semble, dans l'origine, avoir dépendu
du manoir de Rohignac. Il ne reste plus rien de l'édifice sacré, dans
lequel on mariait en 1688 et 1691 (Pouillé de Rennes) ;
l'ancien
manoir de Rohignac, situé route Sud de Redon et appartenant en 1878 à la
famille Evain. Il conserve une tourelle et
une salle du XVIème siècle. Il possédait jadis une chapelle privée
devenue frairienne et dédiée à saint Nicodème. Une note du XVIIIème siècle
nous apprend que les moines de Redon accordèrent aux frairiens de
Germigniac l'usage de cette chapelle, qui semble, dans l'origine, avoir dépendu
du manoir de Rohignac. Il ne reste plus rien de l'édifice sacré, dans
lequel on mariait en 1688 et 1691 (Pouillé de Rennes) ;
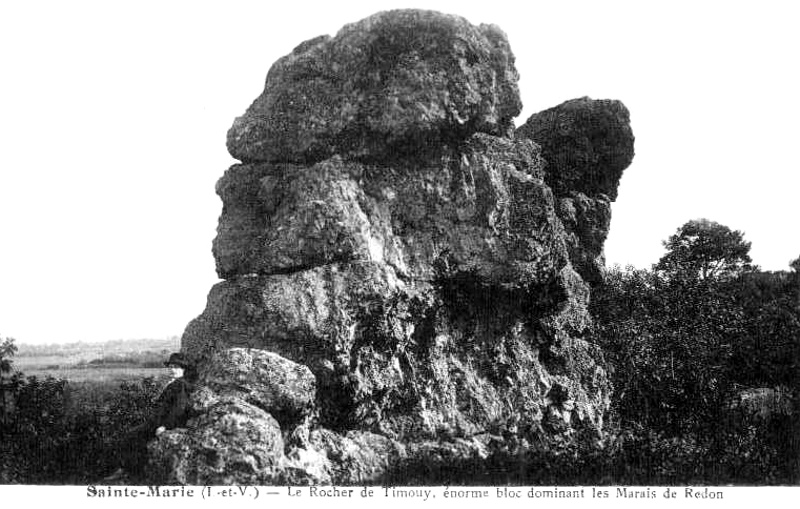
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de SAINTE-MARIE
A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 et du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence d'aucun noble de Sainte-Marie. Le territoire de Sainte-Marie dépendait jadis de la paroisse de Bains (Bains-sur-Oust) :
© Copyright - Tous droits réservés.