|
Bienvenue chez les Javénéens |
JAVENE |
Retour page d'accueil Retour Canton de Fougères
La commune de
Javené ( |
ETYMOLOGIE et HISTOIRE de JAVENE
Javené vient du latin "Jovis" (oratoire dédié à Jupiter).
Javené remonte à l'époque gallo-romaine. En effet, la voie romaine du Mans à Corseul, nommée chemin Charles, traverse la paroisse de Javené au centre. La première mention de Javené date du début du XIIème siècle, lorsque sont cités Estienne de Javené et ses fils. De 1027 jusqu'à la Révolution, Javené reste attaché à la baronnie de Vitré.
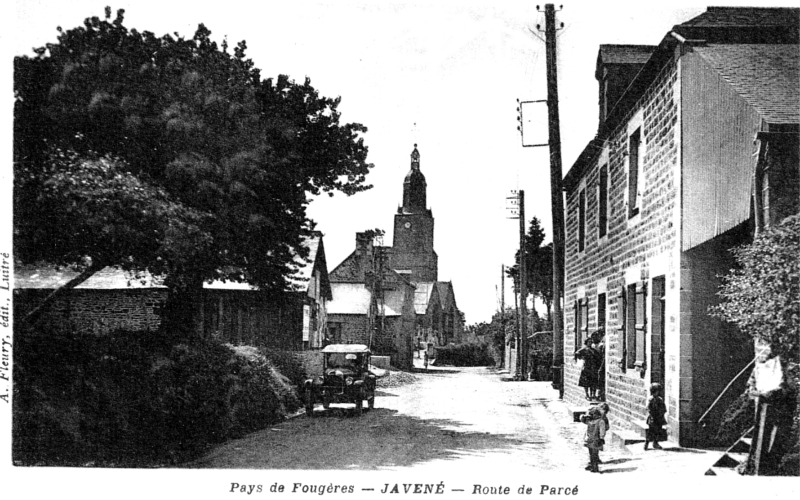
Dans les premières années du XIIème siècle, Etienne de Javené, qui était sans doute le seigneur de cette paroisse, puisqu'il en portait le nom, donna le huitième de ses dîmes aux religieux de Pontlevoy pour l'entretien de leur prieuré d'Igné, donation qui fut plus tard ratifiée par Geoffroy, son fils, et ses autres enfants. « Son exemple trouva des imitateurs dans les autres seigneurs possesseurs de biens eu cette paroisse, si bien que nous voyons un demi-siècle plus tard les religieux de Pontlevoy prétendre à la jouissance de la presque totalité de ses dîmes. Ces prétentions étaient-elles fondées ? Ce qui se passa peu de temps après entre eux et Robert II, seigneur de Vitré (1152-1178), tendrait à faire supposer le contraire. Ce seigneur, en effet, de la terre duquel relevait la paroisse de Javené, ne voulant pas admettre leurs prétentions, consentit, d'accord avec eux, à soumettre les questions qui les divisaient à l'arbitrage de Josse, archevêque de Tours, devant lequel il se fit représenter par Réginald, son chapelain, et Robert, prieur de Notre-Dame. Les représentants des religieux furent les prieurs de Pontlevoy, d'Amboise et d'Igné. Le prélat n'eut pas de peine à les mettre d'accord, et il fut convenu que le seigneur de Vitré abandonnerait aux religieux la moitié des dîmes de la paroisse, dont l'autre moitié lui appartiendrait, et qu'ils feraient bâtir à frais communs une grange qui serait également commune entre eux, les religieux devant rendre au seigneur un bon et fidèle compte de tous les produits qu'ils y auraient rassemblés. Plus tard, en 1207, les dîmes de Javené donnèrent lieu à une autre contestation entre les religieux de Pontlevoy et les chanoines du prieuré d'Allion, de l'Ordre de Gastines. Mais l'affaire, presque immédiatement assoupie et réglée par les bons offices de Robert de Vitré, frère du seigneur et chantre de Paris, n'eut aucune suite » (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères). De bonne heure la cure de Javené fut donnée au Chapitre de Rennes et devint un bénéfice monoculaire présenté par le titulaire de la neuvième prébende. En 1790, Julien Maigné, recteur de Javené, fit la déclaration suivante des revenus de sa cure : le presbytère, avec deux jardins et un champ, estimés valoir 90 livres ; — une maison au bourg, 24 livres ; — la maison et le jardin de la Tremblaye, 90 livres ; — la moitié des grosses dîmes (l'autre moitié appartenant encore aux religieux de Pontlevoy), affermée avec la grange, en 1783, 3 200 livres. C'était donc un revenu brut de 3 404 livres ; mais les charges étaient : la pension d'un vicaire, 350 livres ; — les décimes, 250 livres ; — une rente de 17 livres 8 sols due au Chapitre de Rennes ; — l'entretien, pour moitié, du chanceau, etc. (Pouillé de Rennes). A la même époque, la fabrique de Javené avait 222 livres 13 sols de rente, et les fondations faites à l'église montaient à 240 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

Le manoir seigneurial de la Bécannière existe au XIVème siècle (vers 1443). Au XIXème siècle, le comte Ferdinand de Lariboisière est le principal propriétaire de Javené.
En 1639, la paroisse de Javené est décimée par une épidémie de peste qui fera près de 101 morts. Un cimetière pour les pestiférés sera alors créé à la Lande d'Iné.
Le bourg de Javené est investi par des insurgés suite à la prise de Fougères par les vendéens le 3 novembre 1793. Le 7 avril 1794, le territoire de Javené est le siège d'une lutte entre les chouans de Du Bois Guy et les troupes républicaines. Le 18 juillet 1794, le maire de Javené, Alexis Turoche est assassiné.
On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Javeneio (au XIIème siècle), Javeneyum (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Javené : Guillaume Bernard (en 1480). Jean Chaussière (il fut poursuivi en 1590 comme ligueur par le sénéchal de Rennes, en compagnie des prêtres de sa paroisse également accusés, et nommés Jacques et Guillaume Bigot, Jean Jehannin, Jean Brunel, Jean Gillois et Jean Lespagnol). François Le Porcher (en 1613 ; décédé en 1631). Vincent de Brégel (sieur de la Gambretière, docteur en Sorbonne et chapelain de Saint-Léonard de Fougères, il gouverna de 1631 à 1667). François Prières (1667-1691). Jean Lambert (pourvu en 1691, il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur au lion d'or ; décédé en 1706). Sébastien Andreu (prêtre de Léon, bachelier en théologie, pourvu le 29 avril 1706, il se démit peu après). François-René Pitteu (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 13 août 1706 ; décédé en 1736). Pierre-Joseph Pioger de Chantradeuc (seigneur de Boro, Saint-Perreux, etc., il fut pourvu le 25 novembre 1736 et devint en 1750 recteur de La Bazouge-du-Désert). Yves-François Baudouin (sieur du Houx et prêtre du diocèse, il fut pourvu le 6 février 1751 ; décédé en 1772). Guillaume Renard (pourvu le 17 juillet 1772, il résigna en 1786). Julien-Pierre Maigné (pourvu le 14 janvier 1787, il gouverna jusqu'à la Révolution, demeura caché dans le pays pendant la tourmente et fut réinstallé en 1803 ; décédé le 24 novembre 1834, âgé de quatre-vingt-deux ans). François Bordais (1834-1867). Jean-Marie Gratien (1867-1875). Joseph Bizeul (à partir de 1875), ....
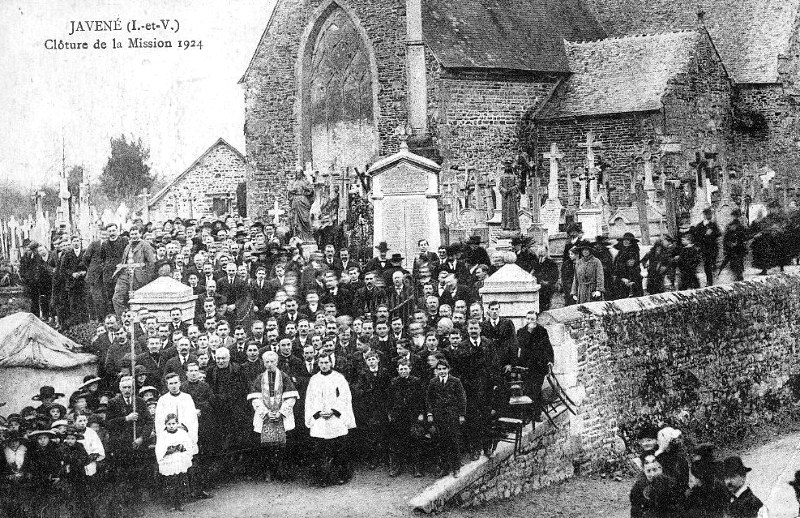
Voir
![]() "
Cahier
de doléances de Javené en 1789
".
"
Cahier
de doléances de Javené en 1789
".
Voir
![]() "
Origines
de la paroisse de Javené
".
"
Origines
de la paroisse de Javené
".
![]()
PATRIMOINE de JAVENE
![]() l'église
Saint-Martin (XVI-XVIIème siècle). Une église primitive est mentionnée
dès le XIIème siècle. Dédiée à saint Martin de Tours, restaurée et
polychromée de nos jours, l'église actuelle de Javené a été construite
à la fin du XVème siècle et dans le courant du XVIème ; on y travaillait
en 1498. Elle se compose d'une nef accompagnée au Nord d'un seul collatéral
; quatre arcades ogivales, supportées par des colonnes de forme octogone, séparent
ces nefs ; sur une sablière de la grande nef, on lit : Lan mil cinq c
ouict... Le Tort... Guill. Le Tort son frere. Sur une autre sablière est
gravé : C. Tullaye me fist faire 1544. Enfin, M. Maupillé a lu sur un
des piliers : J. de la Rue et Marie de la Tousche sa feme ma fisdrent.
La tour carrée qui s'élève au bas des nefs offre aussi cette inscription
au-dessus d'un arc Tudor couronnant la porte : 1554, je fus y pozée.
Dans la fenêtre ouverte plus haut est gravé le millésime 1559, et à
l'intérieur de cette tour et au sommet la date 1561. Cette église n'a
qu'une chapelle au Sud, mais vis-à-vis est une sacristie voûtée, avec des
arêtes et des arcs-doubleaux à nervures prismatiques, qui pourrait bien
avoir été à l'origine quelque chapelle seigneuriale. L'église de Javené
paraît avoir eu autrefois toutes ses fenêtres garnies de verrières, et
les débris qui en ont été conservés sont encore fort intéressants. On
remarque dans une fenêtre l'Annonciation de la Sainte Vierge, l'Adoration
des bergers et l'Adoration des mages ; l'image du Père-Eternel remplit le
sommet de l'ogive dans le tympan. Dans une seconde fenêtre, l'on voit Notre-Seigneur
au jardin des Oliviers priant dans la grotte de Gethsémani et saint Pierre
endormi. Dans une troisième, au Sud, étaient aussi naguère les têtes des
quatre évangélistes, que nous n'y avons pas retrouvées. « Ces sujets,
dit M. Maupillé, sont assez bien traités et d'un bon coloris ; ils
sont sans doute l'oeuvre d'un artiste du milieu du XVIème siècle, de
Pierre Simon peut-être, qui à cette époque fit un grand nombre de vitres
pour les églises de Fougères, et sans doute aussi pour celles des environs
». (M. Maupillé, Notices historiques précitées, 43). La grande baie
du chevet, divisée par trois meneaux et ornée d'un riche tympan, est
malheureusement bouchée ; mais l'ornementation du tympan de la fenêtre de
la chapelle méridionale est remarquable par la grâce de ses contours :
elle reproduit exactement une fleur de pensée, moins le pétale inférieur,
qui est remplacé par l'amortissement trilobé de l'ogive secondaire. Extérieurement,
l'on remarque des portes richement décorées dans le style ogival fleuri,
des fenêtres flamboyantes ouvertes dans les pignons aigus, des contreforts
élancés et terminés en pinacles, et des gargouilles bizarres et
fantastiques. La tour, surmontée d'un clocher en charpente refait de nos
jours, atteint la hauteur de 43 mètres. Au pied de cette tour est un porche
qui semble avoir été primitivement destiné à servir d'ossuaire ; il est
orné à l'Occident de trois panneaux à ogive en accolade ; l'arcade de son
entrée a son archivolte relevée par des choux frisés et d'autres
ornements du XVème siècle. Les murs de cette église conservent extérieurement
les traces d'une litre, mais nous ne savons quel seigneur la fit placer ;
peut-être fut-ce celui de la Bécannière, terre noble appartenant en 1513
à René de la Vieuville. Une plaque de cuivre attachée à une colonne de
la nef indique qu'en 1732 le pape Clément XII accorda des indulgences plénières
aux membres de la confrérie du Saint-Sacrement de Javené. Quant à celle
du Rosaire, elle fut érigée en cette église le 15 août 1674 par le P. Crônier,
dominicain de Bonne-Nouvelle (Pouillé de Rennes). Avant 1520, date de la charpente de la nef,
l'église avait reçu trois adjonctions : au nord, une sacristie voûtée
d'ogives ; au sud, une chapelle accostée d'un porche. Dans les années
1539-1544, la nef est doublée vers le nord par un collatéral. L'église actuelle se compose d'une nef à chevet
droit, accostée au nord d'un collatéral et au sud d'une chapelle. La
porte, ornée d'un arc Tudor porte la date de 1554 : la fenêtre qui la
surmonte est datée de 1559. Deux des sablières de la nef portent la date
de 1554. On voit à l'intérieur de la tour la date de 1561. Les fonts baptismaux
(fonts doubles en granit sculpté) datent du XVème siècle. Le baldaquin
des fonts baptismaux date de 1716. La sacristie, du côté nord, semble
être une ancienne chapelle seigneuriale. La charpente porte une inscription
datée de 1544. Les vitraux de l'Enfance et de la Passion du Christ, situés
dans le collatéral nord et attribués au Fougerais Pierre Symon, datent du
milieu du XVIème siècle : ils ont été restaurés par Alleaume en 1901. Le retable du maître-autel date
de 1729 : il provient de la chapelle du couvent des Récollets de Fougères.
L'autel de la chapelle sud date du XVIIème siècle. Le retable de la
Vierge, oeuvre de Jean Martinet, date de 1625 : on y trouve une Vierge à
l'Enfant en pierre polychrome du XIVème siècle. La chaire à prêcher, qui
date de 1712, est décorée d'un écusson papal qui semble être celui d'Urbain VIII (1644-1655) ;
l'église
Saint-Martin (XVI-XVIIème siècle). Une église primitive est mentionnée
dès le XIIème siècle. Dédiée à saint Martin de Tours, restaurée et
polychromée de nos jours, l'église actuelle de Javené a été construite
à la fin du XVème siècle et dans le courant du XVIème ; on y travaillait
en 1498. Elle se compose d'une nef accompagnée au Nord d'un seul collatéral
; quatre arcades ogivales, supportées par des colonnes de forme octogone, séparent
ces nefs ; sur une sablière de la grande nef, on lit : Lan mil cinq c
ouict... Le Tort... Guill. Le Tort son frere. Sur une autre sablière est
gravé : C. Tullaye me fist faire 1544. Enfin, M. Maupillé a lu sur un
des piliers : J. de la Rue et Marie de la Tousche sa feme ma fisdrent.
La tour carrée qui s'élève au bas des nefs offre aussi cette inscription
au-dessus d'un arc Tudor couronnant la porte : 1554, je fus y pozée.
Dans la fenêtre ouverte plus haut est gravé le millésime 1559, et à
l'intérieur de cette tour et au sommet la date 1561. Cette église n'a
qu'une chapelle au Sud, mais vis-à-vis est une sacristie voûtée, avec des
arêtes et des arcs-doubleaux à nervures prismatiques, qui pourrait bien
avoir été à l'origine quelque chapelle seigneuriale. L'église de Javené
paraît avoir eu autrefois toutes ses fenêtres garnies de verrières, et
les débris qui en ont été conservés sont encore fort intéressants. On
remarque dans une fenêtre l'Annonciation de la Sainte Vierge, l'Adoration
des bergers et l'Adoration des mages ; l'image du Père-Eternel remplit le
sommet de l'ogive dans le tympan. Dans une seconde fenêtre, l'on voit Notre-Seigneur
au jardin des Oliviers priant dans la grotte de Gethsémani et saint Pierre
endormi. Dans une troisième, au Sud, étaient aussi naguère les têtes des
quatre évangélistes, que nous n'y avons pas retrouvées. « Ces sujets,
dit M. Maupillé, sont assez bien traités et d'un bon coloris ; ils
sont sans doute l'oeuvre d'un artiste du milieu du XVIème siècle, de
Pierre Simon peut-être, qui à cette époque fit un grand nombre de vitres
pour les églises de Fougères, et sans doute aussi pour celles des environs
». (M. Maupillé, Notices historiques précitées, 43). La grande baie
du chevet, divisée par trois meneaux et ornée d'un riche tympan, est
malheureusement bouchée ; mais l'ornementation du tympan de la fenêtre de
la chapelle méridionale est remarquable par la grâce de ses contours :
elle reproduit exactement une fleur de pensée, moins le pétale inférieur,
qui est remplacé par l'amortissement trilobé de l'ogive secondaire. Extérieurement,
l'on remarque des portes richement décorées dans le style ogival fleuri,
des fenêtres flamboyantes ouvertes dans les pignons aigus, des contreforts
élancés et terminés en pinacles, et des gargouilles bizarres et
fantastiques. La tour, surmontée d'un clocher en charpente refait de nos
jours, atteint la hauteur de 43 mètres. Au pied de cette tour est un porche
qui semble avoir été primitivement destiné à servir d'ossuaire ; il est
orné à l'Occident de trois panneaux à ogive en accolade ; l'arcade de son
entrée a son archivolte relevée par des choux frisés et d'autres
ornements du XVème siècle. Les murs de cette église conservent extérieurement
les traces d'une litre, mais nous ne savons quel seigneur la fit placer ;
peut-être fut-ce celui de la Bécannière, terre noble appartenant en 1513
à René de la Vieuville. Une plaque de cuivre attachée à une colonne de
la nef indique qu'en 1732 le pape Clément XII accorda des indulgences plénières
aux membres de la confrérie du Saint-Sacrement de Javené. Quant à celle
du Rosaire, elle fut érigée en cette église le 15 août 1674 par le P. Crônier,
dominicain de Bonne-Nouvelle (Pouillé de Rennes). Avant 1520, date de la charpente de la nef,
l'église avait reçu trois adjonctions : au nord, une sacristie voûtée
d'ogives ; au sud, une chapelle accostée d'un porche. Dans les années
1539-1544, la nef est doublée vers le nord par un collatéral. L'église actuelle se compose d'une nef à chevet
droit, accostée au nord d'un collatéral et au sud d'une chapelle. La
porte, ornée d'un arc Tudor porte la date de 1554 : la fenêtre qui la
surmonte est datée de 1559. Deux des sablières de la nef portent la date
de 1554. On voit à l'intérieur de la tour la date de 1561. Les fonts baptismaux
(fonts doubles en granit sculpté) datent du XVème siècle. Le baldaquin
des fonts baptismaux date de 1716. La sacristie, du côté nord, semble
être une ancienne chapelle seigneuriale. La charpente porte une inscription
datée de 1544. Les vitraux de l'Enfance et de la Passion du Christ, situés
dans le collatéral nord et attribués au Fougerais Pierre Symon, datent du
milieu du XVIème siècle : ils ont été restaurés par Alleaume en 1901. Le retable du maître-autel date
de 1729 : il provient de la chapelle du couvent des Récollets de Fougères.
L'autel de la chapelle sud date du XVIIème siècle. Le retable de la
Vierge, oeuvre de Jean Martinet, date de 1625 : on y trouve une Vierge à
l'Enfant en pierre polychrome du XIVème siècle. La chaire à prêcher, qui
date de 1712, est décorée d'un écusson papal qui semble être celui d'Urbain VIII (1644-1655) ;
Nota : Dans son aveu du 25 juillet 1628, Ecuyer César de la Vieuville, seigneur de la Bécannière, en Javené, déclare être « fondateur et patron de l'églize, cimetière et presbitaire de Saint-Martin dud. Javené » ; il énumère toutes ses prééminences. (E, Vitré, liasse 1. Inventaire analytique, cinquième petit cahier). Dans le même cahier, se trouve résumé l'aveu rendu par « noble Uzèbe Baston, sieur de Bonne-Fontaine et du lieu et métairie noble de La Marche » (et la Rivière) en Javené. « A cause de quoy led. Baston a droit et est en bonne pocession de bancq a accoudouer et enfeu prohibitif en l'églize de Javené, au-devant de l'autel de Saint-Sébastien au costé de l'évangile avec les droits de ceinture et lizière au circuit de lad. églize tant dehors que dedans, armes et armoiryes et prières publiques après les seigneurs de la Beccannière ausquels appartiennent toutes premières prééminences en ladite églize ».
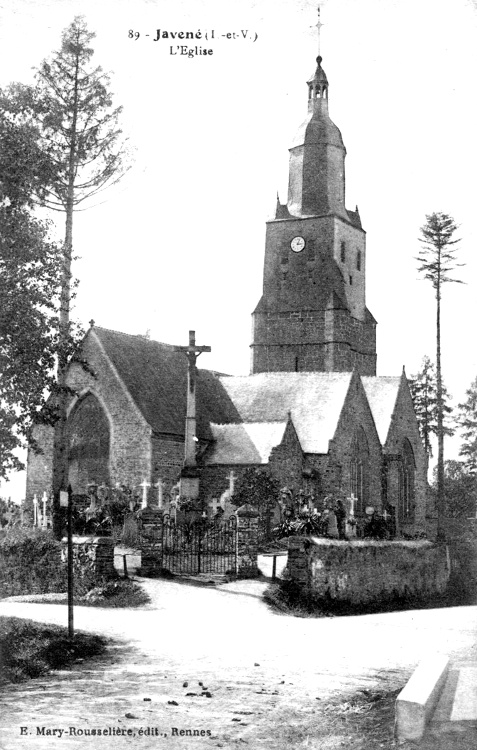
![]() le
manoir de La Tiolais (XVIème siècle), situé au bourg de Javené ;
le
manoir de La Tiolais (XVIème siècle), situé au bourg de Javené ;
![]() le
manoir de La Génière (XVIème siècle) ;
le
manoir de La Génière (XVIème siècle) ;
![]() le
manoir de La Rivière (1580). La chapelle Saint-Julien de la Rivière se
trouvait au bord du Couasnon, au village de la Rivière ; elle est mentionnée
comme chapelle frairienne en 1665, et l'on y faisait alors de nombreux
mariages. Elle fut réconciliée par ordre de l'évêque, le 1er mai 1742,
par le recteur, M. Pioger (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,
17). Fondée de 20 livres de rente et encore desservie en 1781, elle a été
démolie pendant la Révolution (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Guihard (en 1541), Jumelais et Couasnon, Guérin
seigneurs de la Grasserie, Baston sieurs de Bonne-Fontaine (en 1627). Au XVIIIème siècle, le domaine est réuni à
la baronnie de Vitré ;
le
manoir de La Rivière (1580). La chapelle Saint-Julien de la Rivière se
trouvait au bord du Couasnon, au village de la Rivière ; elle est mentionnée
comme chapelle frairienne en 1665, et l'on y faisait alors de nombreux
mariages. Elle fut réconciliée par ordre de l'évêque, le 1er mai 1742,
par le recteur, M. Pioger (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,
17). Fondée de 20 livres de rente et encore desservie en 1781, elle a été
démolie pendant la Révolution (Pouillé de Rennes). Propriété
successive des familles Guihard (en 1541), Jumelais et Couasnon, Guérin
seigneurs de la Grasserie, Baston sieurs de Bonne-Fontaine (en 1627). Au XVIIIème siècle, le domaine est réuni à
la baronnie de Vitré ;
![]() le
manoir de la Grande-Piltière ou Pilletière (XVIIème siècle),
situé route de la Selle-en-Luitré. Propriété successive des familles de
Montbourcher, Poitrine (en 1430), de la Fontaine (en 1514 et en 1546), de Brégel
(en 1669 et en 1710), le Mercier sieurs de Montigny (au XVIIIème siècle) ;
le
manoir de la Grande-Piltière ou Pilletière (XVIIème siècle),
situé route de la Selle-en-Luitré. Propriété successive des familles de
Montbourcher, Poitrine (en 1430), de la Fontaine (en 1514 et en 1546), de Brégel
(en 1669 et en 1710), le Mercier sieurs de Montigny (au XVIIIème siècle) ;
![]() le
château de la Bécannière (XVIIIème siècle). Le domaine de La
Bécannière relève de la seigneurie de Vitré. Le château actuel est
construit à l'emplacement de l'ancien manoir. L'ancien
manoir de la Bécannière est situé route de Vendel. Propriété de Perrine
de Gayne épouse de Jacques de la Vieuxville (en 1452), puis des familles
Vieuxville, Buisson seigneurs de la Ville-Voisin (vers 1653), de
Montbourcher (en 1659), de Brégel, du Pontavice (à la fin du XVIIème siècle),
le Bon seigneurs de l'Eschange (à la fin du XVIIème siècle), Picquet
seigneurs du Bois-Guy (vers 1769), le Chartier ;
le
château de la Bécannière (XVIIIème siècle). Le domaine de La
Bécannière relève de la seigneurie de Vitré. Le château actuel est
construit à l'emplacement de l'ancien manoir. L'ancien
manoir de la Bécannière est situé route de Vendel. Propriété de Perrine
de Gayne épouse de Jacques de la Vieuxville (en 1452), puis des familles
Vieuxville, Buisson seigneurs de la Ville-Voisin (vers 1653), de
Montbourcher (en 1659), de Brégel, du Pontavice (à la fin du XVIIème siècle),
le Bon seigneurs de l'Eschange (à la fin du XVIIème siècle), Picquet
seigneurs du Bois-Guy (vers 1769), le Chartier ;
![]() l'ancien
presbytère (1729), situé rue de la Grande Marche ;
l'ancien
presbytère (1729), situé rue de la Grande Marche ;
![]() 4 moulins
à eau dont le moulin de la Marche, de Galache, de l'Epeluet, de Bécand ;
4 moulins
à eau dont le moulin de la Marche, de Galache, de l'Epeluet, de Bécand ;

A signaler aussi :
![]() la
motte féodale (moyen âge) au lieu-dit "La Motte" ;
la
motte féodale (moyen âge) au lieu-dit "La Motte" ;
![]() l'ancienne
chapelle (ou oratoire) Saint-Roch. Le 3 août 1625, on bénit un cimetière
pour les pestiférés près de la lande d'Igné, car la contagion désolait
alors la paroisse. Ce cimetière est appelé en 1640 le cimetière
Saint-Roch, et nous croyons qu'un petit oratoire y fut élevé en l'honneur
du saint protecteur des malades ; toutefois, depuis longtemps il n'en reste
plus de trace (Pouillé de Rennes) ;
l'ancienne
chapelle (ou oratoire) Saint-Roch. Le 3 août 1625, on bénit un cimetière
pour les pestiférés près de la lande d'Igné, car la contagion désolait
alors la paroisse. Ce cimetière est appelé en 1640 le cimetière
Saint-Roch, et nous croyons qu'un petit oratoire y fut élevé en l'honneur
du saint protecteur des malades ; toutefois, depuis longtemps il n'en reste
plus de trace (Pouillé de Rennes) ;
![]() l'ancien
manoir de la Marche. Il possédait jadis une motte et un droit de haute
justice. Propriété de la famille le Limonnier en 1363, puis de la famille de Lantivy en 1761 ;
l'ancien
manoir de la Marche. Il possédait jadis une motte et un droit de haute
justice. Propriété de la famille le Limonnier en 1363, puis de la famille de Lantivy en 1761 ;
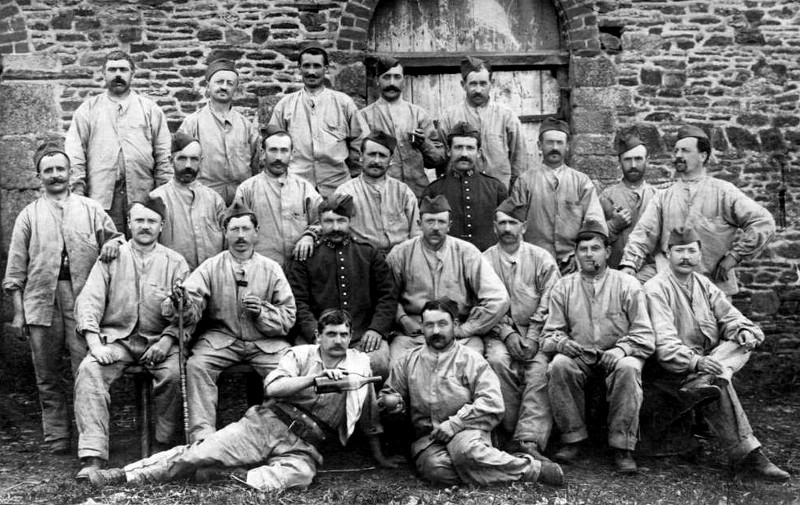
![]()
ANCIENNE NOBLESSE de JAVENE
La paroisse de Javené appartenait à la baronnie de Vitré. Parmi les juridictions seigneuriales s'exerçant dans la paroisse de Javené, citons celles des Haries (Dompierre), du Bois-le-Houx (Luitré), de la Bécannière, de l'Onglée, etc...
Voir
![]() "
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de Javené
".
"
Seigneuries,
domaines seigneuriaux et mouvances de Javené
".
A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Javené" :
- René Redoct : "René Redoct se présente monté et armé en estat d'archer pour Jean Guyhart seigneur de La Ripvière aussi présent estant à pied en robe. Et supplye / des adjoinctz. Remys à demain. Et ordonné audict Guyhart qu'il ayt à soy armez de sa personne. Le landemain saeze jour desdictz moys et an s'est par devant mesdictz seigneurs présenté ledict Jehan Guyhart bien monté et armé en estat d'archer. Et a déclaré suyvant sa précédante déclaration son revenu noble valloir environ quatre vigntz doze livres. Sur quoy il dit avoir une doairière. Et a supplyé estre adjoinct ovecq le seigneur du Pont [Note : Manoir du Pont, en Lécousse] nommé Michel [Boterel] et le seigneur de Furgon [Note : Manoir de Furgon en Fleurigné. Il appartenait alors à Jehan de Furgon] ses voisins. De quoy luy sera faict raison. Et a ledict Guyhard faict le serment".
(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).
(à compléter)
© Copyright - Tous droits réservés.