|
Bienvenue ! |
LES DERNIERS CORSAIRES MALOUINS |
Retour page d'accueil Retour Ville de Saint-Malo
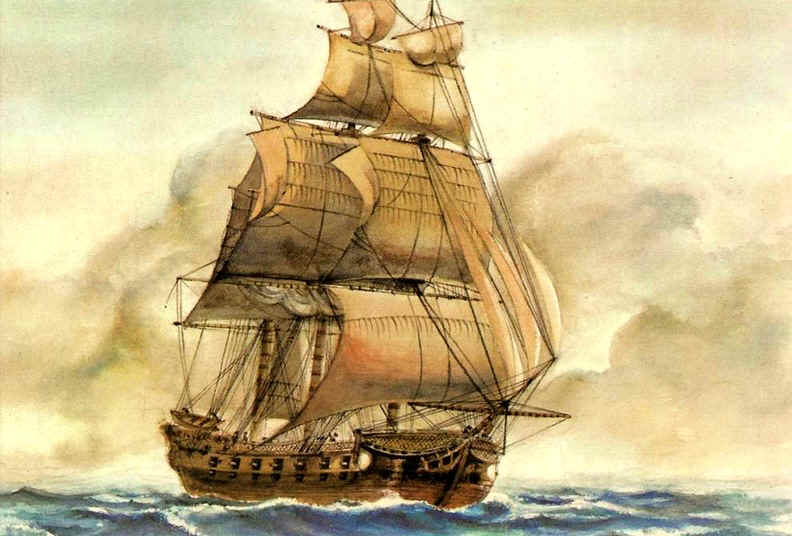
*** INTRODUCTION ***
Au mois de décembre 1789, six malouins influents, porteurs d'une pétition habilement motivée, furent envoyés à Paris. Ils avaient pour mission d'obtenir du pouvoir central la création en Bretagne d'un département ayant Saint-Malo pour chef-lieu. « Cette ville, disait en substance le document rédigé par le Conseil permanent de la commune, est la seconde de la province par son commerce et sa navigation. C'est elle qui fournit le plus de matelots, car son activité maritime dans ses deux branches principales, la pêche et le cabotage, en forme beaucoup et en détruit peu. La population de la cité et des districts environnants les fournit tous. Ils deviennent, en temps de guerre, les défenseurs de la patrie. Saint-Malo envoie à l'Espagne les toiles de Bretagne, expédie pour la côte de Guinée, l'Amérique, les Indes. Le défaut de protection a beaucoup diminué son trafic, mais il peut refleurir sous la sage administration de négociants habiles et rompus aux affaires. Lorsque le nouveau département veillera lui-même sur ses destinées, il ne tardera pas sans doute à recouvrer la splendeur qu'il possédait autrefois et qu'il a perdue parce que son commerce et surtout sa pêche ont été découragés, quelque intéressants qu'ils soient pour la prospérité du royaume, de sa marine et de ses colonies. Les descendants de Jacques Cartier dont on a laissé, envahir les précieuses découvertes, ceux de Duguay-Trouin, méritent de conserver un pavillon sur les mers. Ils ont autant et plus de droits qu'aucune autre ville à ne pas rester oubliés, sans influence dans leur patrie, sans représentants à l'Assemblée nationale » [Note : Bertrand ROBIDOU. Histoire et panorama d'un beau pays, p. 330. — Voir aussi H. SÉE et LESORT. Cahiers des doléances de la Sénéchaussée de Rennes, t. III, p. 30 ; Charges et griefs de la communauté de Saint-Malo, art. 68, et Mémoire des Armateurs en 1782, ibid., p. 32.].
Cette pétition n'eut point, on le sait, le résultat désiré. Mais elle permet de faire une double constatation : A la fin de l'Ancien Régime, le commerce de Saint-Malo avait diminué dans des proportions considérables [Note : Sur le commerce maritime de Saint-Malo aux XVIIème et XVIIIème siècles, il faut lire l'ouvrage magistral de E. W. DAHLGREN, Les Relations commerciales et maritimes entre la France et les côtes de l'Océan Pacifique, et les intéressantes brochures de : FRAIN. Registre d'écuyer Nicolas Bouleuc (1678), Vannes, Lafolye, 1902. — Vitrèenne et Malouine (1690-1733), Vitré, Lécuyer, 1902]. Pourtant cette antique cité revendique encore l'une des premières places parmi les villes importantes de Bretagne.
Vers 1914, la pêche à la morue est certainement en décadence depuis un demi-siècle par suite de la cession de Terre-Neuve à l'Angleterre et de la concurrence étrangère sur le French-Shore et au Grand-Banc [Note : HERVÉ. Le French-Shore. HARVUT. La Pêche à Terre-Neuve. CUNAT. Saint-Malo illustré yar ses marins. « Dans un état de 1772 sur le produit, de la pêche à Terre-Neuve, nous trouvons que 99 navires expédiés rapportèrent 2.289.969 livres 15 sous 4 deniers de morue, 183.069 livres 12 sous 9 deniers d'huiles en barriques, 5.738 livres 9 sous 10 deniers de langues et de maux. — En 1777, 78 bâtiments seulement armèrent pour Terre-Neuve »]. Mais la navigation au long-cours reste toujours assez prospère malgré le défaut de protection dont se plaignent à juste titre les négociants malouins [Note : Il s'agit surtout du traité de 1786 avec l'Angleterre, V. SÉE et LESORT, op. cit., p. 30]. Le commerce des toiles (quintins, noyales, chaussettes de Vitré, toiles de Morlaix, Laval, Cholet), avec les possessions espagnoles du Nouveau-Monde [Note : Ces marchandises passent ordinairement par Cadix. Plusieurs familles malouines ont des représentants dans cette ville. Il y a un consul d'Espagne à Saint-Malo], l'importation des épices et autres denrées coloniales, la traite [Note : La traite des nègres est surtout pratiquée par les Malouins établis à l'île de France. PRENTOUT. L'île de France sous Decaen. SURCOUF. Histoire de Robert Surcouf, p. 66 et suiv. En 1790, l'Assemblée générale de Saint-Malo invoque le veto suspensif du roi contre l'abolition de la traite (Bertrand ROBIBOU, op. cit., p. 286)] occupent un grand nombre de bâtiments et de marins du quartier. Parmi les expéditions les plus importantes de cette époque, il faut citer celle qui fut organisée par M. Grand-Meslé pour aller faire le trafic sur les côtes de Chine. Le roi prêta à cette occasion aux malouins plusieurs grands navires. Un emprunt de cinq millions de livres permit de compléter leur armement [Note : CUNAT dans OGÉE. Dictionnaire historique de Bretagne, p. 812]. Le cabotage assure également des relations fréquentes avec Jersey, l'Angleterre et tous les ports de la côte normande ou bretonne [Note : Selon Ch. CUNAT, dans OGÉE, op. cit., p. 812 et suiv. « En 1777, sans comprendre les 111 navires affectés au grand et petit cabotage et les morutiers, 6 bâtiments allèrent à la Côte de Guinée, 5 à Saint-Domingue, 5 à Cayenne, 30 à la Guadeloupe, 4 à la Martinique, 2 au Bengale, 2 aux îles de France et Bourbon, 2 à Pondichéry. 51 navires étrangers, anglais, russes, hollandais et suédois entrèrent avec cargaison de leur pays, 112 navires français appartenant aux ports de Bordeaux, Bayonne, Rouen, Dunkerque, Lorient arrivèrent avec les produits de ces villes, 20 gabarres de 10 à 40 tonneaux apportèrent des bois de construction. En tout 401 navires ». — « Depuis le traité de Versailles (1783) jusqu'au 31 mai 1790, Saint-Malo aurait expédié au long cours 670 navires et Saint-Servan 217. Au cabotage, la première aurait armé 327 bricks, goélettes ou côtres, la seconde 176. En totalité, pour la ville et le faubourg, 1.390 bâtiments sur lesquels furent employés 35.661 marins et dont les avances d'armement montèrent à la somme de 5.661.371 livres. Il n'est pas question dans ce chiffre des bateaux de pêche ni des navires suédois, prussiens, hollandais, anglais, espagnols qui de tout temps ont afflué dans le port. Leur nombre, sans être aussi grand que celui des nôtres, a néanmoins toujours été considérable. ». Voir Archives municipales de Saint-Malo, LL 154 : Etat des bâtiments armés de 1783 à 1790. — L. BENAERTS a fait sur les Archives de Saint-Servan le relevé exact des entrées et sorties pour le port de Saint-Malo en 1788 (Annales de Bretagne, t. XIV, p. 368). Il a trouvé, sur le registre d'entrée, 994 bâtiments dont 81 seulement dépassent. 100 tonneaux et 207 cinquante. Dans ce nombre il y a 474 navires malouins. Les bâtiments des autres nations atteignent le chiffre de 31 (16 hollandais, 4 danois, 4 suédois, 1 espagnol, 6 allemands). Ils apportent à Saint-Malo les bois de construction du Nord, le fer de Suède, le chanvre et le lin de Russie. Les navires anglais sont certainement beaucoup plus nombreux]. Pour le trafic intérieur Saint-Malo reste l'un des premiers marchés de la Bretagne. Ses entrepôts fournissent notamment les denrées coloniales jusqu'à Saint-Brieuc, Ploermel, Rennes et Vitré.
La déclaration de guerre à l'Angleterre (1er février) et à l'Espagne (7 mars 1793) vint tarir à peu près complètement ces sources de prospérité. Une foule de navires et de bras restent désormais sans autre emploi que la Course.
Dans la séance du 27 mai 1792 l'Assemblée législative avait assez longuement délibéré sur une motion du député Kersaint proposant l'abolition des armements de ce genre. M. Emmery [Note : DE PISTOYE et DUVERDY. Traité des prises maritimes, I, p. 7, appellent M. Emmery Un Malouin. Il était en réalité de Dunkerque. V. MONENTHEUIL, Essai sur la course] dit : « Je suis d'une ville qui a équipé plus de 1.200 corsaires durant la dernière guerre. Ils ont fait plus de mal à l’Angleterre que les deux marines royales de Bourbon réunies. Cependant cette ville ne désire point continuer de telles entreprises. Je vous propose donc de charger le roi de négocier dans les différentes cours l'abolition de la Course et d'ajourner toutes les propositions qui vous seront présentées ». Un ordre du jour en ce sens fut déposé par Vergniaud et rallia tous les suffrages [Note : Moniteur universel, 1er juin 1792].
L'on s'en tint d'ailleurs à ce souhait platonique et un décret de la Convention (31 janvier 1793) autorisa dès le début de la guerre tous les citoyens français à armer en course. Il en fut de même en l'an XI aussitôt après la rupture entre Napoléon et l'Angleterre.
Les Malouins célèbres aux siècles précédents par des expéditions de ce genre [Note : Abbé MANET. Les Malouins célèbres. Ch. CUNAT. Saint-Malo illustré par ses marins. Abbé POULAIN. Duguay-Trouin et la Cité corsaire. Abbé PRAMPAIN. Saint-Malo historique, p. 16, note 1, dit : « Sans savoir exactement le nombre des corsaires armés sous Louis XIV, on est sûr qu'il dépasse le chiffre de 160. Pendant les guerres de Succession d'Autriche et de Sept Ans, Saint-Malo arma pour la course 194 navires, pendant la guerre d'Amérique, 72 ». Ces chiffres paraissent exagérés. Un état des A. N., F2-74, relève seulement, de 1778 à 1782, 37 campagnes de Malouins, 104 prises terries et 34 rançons. Le tout aurait produit 5.382.880 livres] n'attendirent pas longtemps pour profiter de l'autorisation. Ils ne demanderaient pas mieux sans doute, que de continuer paisiblement la pêche et le négoce. Au début de l'an XI, il y a trente, bâtiments, en chantier pour Terre-Neuve. D'autres navires, en nombre à peu près égal, sont déjà partis. Une pétition du 24 frimaire, signée de 16 noms tous connus pour leurs armements en course, est adressée au minisire de la Marine. Elle le supplie de laisser à Saint-Malo, au moins pour quelques mois, les ouvriers du port : charpentiers, perceurs, calfats, réquisitionnés par le Préfet Maritime de Brest depuis 18 jusqu'à 50 ans [Note : Corresp. minist. St.-S. Selon CUNAT (op. cit., p. 819), dans les premiers mois de 1802, 151 navires sortent du port, dont 26 pour les Indes orientales ou occidentales, et le surplus au grand et au petit cabotage]. Mais nécessité fait loi. Les hostilités à peu près continuelles avec l'Angleterre ne leur permettent pas de choisir et d'autre part la neutralisation des navires est trop périlleuse et trop rarement respectée par les belligérants [Note : Lettre de Bleschamps, 29 Pluv., P. j. n° 21].
Aussi, sauf de courts intervalles, — de 1793 à l'an IV et durant la fragile paix d'Amiens, — une foule de bâtiments armés en guerre sortent chaque année de Belle-Grève ou de Solidor pour courir sus aux Anglais.
Des villes comme Dunkerque, Boulogne [Note : Henri MALO. Les Corsaires, cite pour le seul port de Boulogne les noms de 98 capitaines ayant presque tous commandé plusieurs campagnes de 1793 à 1814 (p. 334-379)], Nantes [Note : DE LA NICOLLIÈRE-TEIJEIRO. La Course et les Corsaires du port de Nantes. ll y eut 20 armements en course en 1793 (p. 246 et suiv.) et près de 80 pendant les années 1797-1798 (p. 258). Depuis 1800, les frégates et les péniches, anglaises bloquent étroitement l'embouchure de la Loire. La course devient à peu près impossible (p. 263). — DUCERÉ. Les Corsaires basques et bayonnais sous la République et l'Empire, cite 110 armements de 1793 à 1809. Voir aussi p. j. n° 24 bis. En 1811, Saint-Malo tient le premier rang après Boulogne] ou Bordeaux ont peut-être équipé durant la même période (1793-1815) un nombre plus grand de corsaires. Mais si l'on compare le chiffre des habitants, la proportion reste en faveur de Saint-Malo. Nulle pari la Course n'occupe dans la vie publique et commerciale de la cité une place aussi importante. Nulle part aussi peut-être, elle n'offre à l'imagination éprise des choses du passé une moisson plus ample de hardis coups de main, d'heureuses rencontres, et de revers bien cruellement payés. Enfin, si durant plusieurs siècles des armements de même nature ont donné à la « cité corsaire » son aspect le plus pittoresque, ils présentent à cette époque un intérêt tout spécial parce qu'ils sont plus proches de nous et marquent la fin d'une législation sans doute à jamais disparue.
Personne encore jusqu'ici n'a étudié d'après les sources et dans son ensemble la Course à Saint-Malo pendant la Révolution et le premier Empire. Les indications de Ch. Cunat, dans son article du Dictionnaire historique de Bretagne (OGÉE), sont incomplètes et souvent fausses. Napoléon Gallois passe rapidement en revue tous les ports de la France et de ses colonies. Il n'a pu que rarement consulter les Archives et se contente ordinairement de résumer et de coordonner les renseignements fournis par des publications antérieures et le Moniteur universel. Les deux biographes de Robert Surcouf s'occupent à peu près uniquement de leur héros dont les campagnes les plus intéressantes ont eu l’île de France pour point de départ. Le premier [Note : En écrivant ces lignes je ne connaissais pas l'ouvrage de E. FABRE : Voyages et combats, 2ème série, Le contre-amiral Bouvet. Nos Corsaires. On y trouve une très intéressante histoire des campagnes de J.-M. Cochet et de Louis Quoniam. L'auteur a eu certainement à, sa disposition de riches documents de famille], Louis, Benaerts a consulté les documents originaux pour la période (1803-1814) et publié dans les Annales de Bretagne, t. XIV, p. 386 et ss., un « Tableau des Armements » auquel il reste peu à ajouter. Mais en 15 pages de développement il ne pouvait épuiser le sujet. Il a nécessairement négligé une foule de témoignages intéressants et qui permettent de mieux juger l'activité économique et sociale de la cité malouine au début du XIXème siècle.
Dans cette étude, quatre chapitres intitulés : L'Armement, — La Campagne, — Les Règlements de Compte, — Les Prisonniers — mettront sous les yeux du lecteur les procédés généraux et les résultats de la Course de 1793 à 1814.
I - L'armement des derniers corsaires malouins.
Voir aussi ![]() "Les armateurs des corsaires malouins"
"Les armateurs des corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "Les bâtiments armés des corsaires malouins"
"Les bâtiments armés des corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "Les équipages des corsaires malouins"
"Les équipages des corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "La Lettre de Marque des derniers corsaires malouins"
"La Lettre de Marque des derniers corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "La sortie des derniers corsaires malouins"
"La sortie des derniers corsaires malouins"
II - La Campagne des derniers corsaires malouins.
Voir aussi ![]() "Les parages fréquentés par les Corsaires malouins.
Le point de Croisière"
"Les parages fréquentés par les Corsaires malouins.
Le point de Croisière"
Voir aussi ![]() "La vie à bord des derniers corsaires malouins
lors des campagnes"
"La vie à bord des derniers corsaires malouins
lors des campagnes"
Voir aussi ![]() "Le bateau Neutre doit s'arrêter à la première
sommation d'un corsaire malouin lors des campagnes"
"Le bateau Neutre doit s'arrêter à la première
sommation d'un corsaire malouin lors des campagnes"
Voir aussi ![]() "Rencontre d'un corsaire malouin avec un navire
de commerce ennemi lors des campagnes"
"Rencontre d'un corsaire malouin avec un navire
de commerce ennemi lors des campagnes"
Voir aussi ![]() "Les navires de
guerre anglais face aux corsaires malouins lors des campagnes"
"Les navires de
guerre anglais face aux corsaires malouins lors des campagnes"
Voir aussi ![]() "Les relâches et
le désarmement des corsaires malouins lors des campagnes"
"Les relâches et
le désarmement des corsaires malouins lors des campagnes"
III - Les réglements de Compte des derniers corsaires malouins.
Voir aussi ![]() "Les tribunaux
chargés du Règlement des comptes des corsaires malouins"
"Les tribunaux
chargés du Règlement des comptes des corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "Les liquidations
particulières des prises des corsaires malouins"
"Les liquidations
particulières des prises des corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "Les liquidations
générales des prises des corsaires malouins"
"Les liquidations
générales des prises des corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "Le décompte
des intéressés suite aux prises des corsaires malouins"
"Le décompte
des intéressés suite aux prises des corsaires malouins"
IV - Les Prisonniers des derniers corsaires malouins.
Voir aussi ![]() "Les Prisonniers
anglais des derniers corsaires malouins"
"Les Prisonniers
anglais des derniers corsaires malouins"
Voir aussi ![]() "Les Prisonniers
français des derniers corsaires malouins"
"Les Prisonniers
français des derniers corsaires malouins"
*** CONCLUSIONS ***
Jusqu'à la fin des guerres de la République et de l'Empire, la ville de Saint-Malo est restée ce qu'elle était aux siècles précédents une « cité corsaire » par excellence.
De 1793 à 1814 une soixantaine d'armateurs de la région y ont équipé pour la course 327 navires de toutes les dimensions, mais dont la moyenne reste au-dessous de 100 tonneaux. L'équipage de ces navires, triple au moins de celui des bâtiments du commerce, atteint le chiffre de 17.724 marins dont 1/4 environ d'inscrits maritimes et presque autant d'étrangers. Leur armement a pu coûter de 15 à 20 millions. Ils partent à peu près chaque année de la rade, la plupart au début de l'hiver pour courir sus aux anglais et autres ennemis du pays. Une douzaine seulement d'aventuriers quittent les mers d'Europe et s'en vont chercher fortune aux colonies, surtout à l'Ile de France.
Les corsaires malouins s'emparent d'environ 40 bateaux neutres richement chargés. Les tribunaux en déclarent les 2/3 comme étant en contravention avec les Règlements sur la Police maritime. Plus de 300 navires marchands ennemis les 9/10 anglais, sont aussi amarinés, parfois après de rudes combats et terris dans les ports voisins, depuis Cherbourg jusqu'à Bordeaux. Un nombre à peu près équivalent de prises faites au cours de la campagne retombe immédiatement au pouvoir des navires de guerre anglais qui surveillent attentivement les abords du littoral français. Cent quarante-quatre corsaires sont également capturés et d'ordinaire, lorsqu'ils ne parviennent pas à s'enfuir, la disproportion écrasante des forces ne leur permet pas même un essai de résistance. Les autres désarment pour la plupart à Saint-Malo, au début de la belle saison.
Les Règlements de compte établis par les Tribunaux de commerce indiquent pour le produit net des ventes un total de 45 millions et l'on peut estimer au double, la perte subie par l'ennemi. Cette somme se partage en deux portions à peu près égales pour chacune des périodes 1793 an IX — 1803-1814. Elle porte sur 110 campagnes particulièrement heureuses, les 200 autres n'ayant produit aucun bénéfice. Les équipages en reçoivent un tiers dont la plus grosse part revient à l'Etat-major. Sauf quelques rares aubaines, la moyenne des gains réalisés par les simples matelots ne dépasse guère 6 à 700 francs. Les deux autres tiers reviennent aux intéressés. Mais les frais d'armement, de relâches, etc., absorbent une grande partie des bénéfices. Le profit réel des commerçants malouins ou plutôt d'un petit nombre de privilégiés atteint au maximum 15 à 18 millions très inégalement répartis sur vingt années de guerres continuelles. Les Invalides de la marine encaissent de leur côté environ deux millions pour le sou du franc qui leur est attribué.
Ces médiocres bénéfices furent d'ailleurs bien chèrement payés ! Sans compter plusieurs centaines de morts et de blessés, près de 8.000 captifs eurent à subir durant de longs mois, parfois même durant des années, la vie terrible des prisons anglaises ou des pontons de sinistre mémoire. Beaucoup d'entre eux, sans doute, ne revirent jamais le sol natal.
De tous ces résultats se dégage nettement la conclusion suivante : Malgré la persévérance et les efforts des armateurs malouins, la course est certainement en décadence à l'époque où l'expérience en fut faite en notre pays pour la dernière fois.
On ne saurait la comparer sous aucun rapport à ce qu'elle fut en particulier sous le règne de Louis XIV. Quelques-uns des corsaires du temps de Duguay-Trouin, étaient de véritables vaisseaux de guerre, capables de lutter même avec une frégate anglaise. Ils avaient comme artillerie, tonnage, équipage, une supériorité incontestable sur les bâtiments les mieux armés de la période que nous venons d'étudier. Ils pouvaient à l'occasion coopérer à l'action des flottes royales et rendre à la nation entière de réels services. Les profits étaient aussi bien supérieurs. En 1704, il serait entré à Saint-Malo seulement 81 prises, dont la vente produisit 2.442.050 livres 2 deniers. Un nombre encore plus grand de navires ennemis furent terris dans d'autres ports [Note : CUNAT dans OGÉE, II, p. 82]. Les magnifiques hôtels qui s'échelonnent depuis la porte Saint-Thomas jusqu'au bastion Saint-Philippe, rappellent encore à l'heure actuelle l'opulence des armateurs malouins à cette époque où les directeurs de la Compagnie des Indes orientales s'adressaient officiellement à « Messieurs de Saint-Malo comme étant les plus considérables négociants du royaume (1708) » [Note : DAHLGREEN. Les Relations commerciales entre la France et les côtes de l'Océan Pacifique, p. 208. — L'histoire des 30 millions prêtés en 1709 à Louis XIV par les bourgeois de Saint-Malo ne serait qu'une légende historique (même ouvrage, p. 479). — C'est à Saint-Malo que Louis XV établit après la guerre de 1741 la Commission chargée de traiter de la restitution des prises faites illégalement. A. N. F2, 72 (9 nov. 1748)].
L'absence de monographies ne nous permet pas de préciser les dommages subis par les Anglais, durant les règnes de Louis XV et de Louis XVI. On peut cependant affirmer que le caractère purement comercial des armements en guerre s'accentue de plus en plus. En même temps les bénéfices diminuent dans des proportions considérables. Ils restent encore pourtant, semble-t-il, bien supérieurs aux chiffres atteints de 1793 à 1814. La course n'est plus alors qu'un véritable jeu de hasard. La réussite reste toujours problématique. On risque peu, mais on n'est jamais sûr de gagner. En réalité, sauf la première année, les maigres profits des négociants malouins sont beaucoup trop chèrement payés.
Plusieurs causes expliquent cette décadence qui semble irrémédiable et n'eût fait probablement que s'accentuer si des événements similaires à ceux d'autrefois s'étaient reproduits dans la suite.
La première c'est la perle de nos colonies. Les opérations les plus fructueuses des corsaires malouins aux XVIIème et XVIIIème siècles ont eu pour théâtre les mers d'Amérique et l'Océan Indien. Ils trouvaient, dans nos possessions du Canada, des Antilles et de l'Inde des points d'appui pour leurs croisières, des asiles sûrs en cas de relâche et en même temps des ports de terrissage accessibles à leurs prises. Mais le honteux traité de Paris (1763) vint enlever à la France presque tout son empire colonial. Elle n'en recouvra qu'une faible partie après les luttes glorieuses de la guerre d'Amérique (traité de Versailles 1783). A partir du moment où de nouvelles hostilités s'engagent, l'état précaire de nos derniers établissements à l'étranger s'aggrave. Les Antilles ne sont pas sûres. L'Ile de France elle-même et la Réunion, plusieurs fois bloquées, tombent en 1810 aux mains des Anglais. Les Malouins sont dès lors obligés de resteindre leurs opérations uniquement aux mers d'Europe. Souvent même le faible tonnage et l'approvisionnement insuffisant de leurs navires les forcent à rester dans le voisinage immédiat de la côte. Sauf quelques neutres imprudents, la plupart des bâtiments capturés n'ont qu'une assez faible valeur. Les anglais richement chargés évitent avec le plus grand soin les parages dangereux ou bien instruits par l'expérience, ils se font escorter par des navires de guerre. Il devient en second lieu très difficile à des particuliers de lutter désormais contre les géants de la mer équipés par une nation puissante et qui veut à tout prix s'assurer la prépondérance maritime. Les progrès de l'artillerie, l'accroissement constant du tonnage et de la vitesse des vaisseaux de guerre anglais montés par un équipage d'élite rendent cette disproportion de plus en plus sensible. A quoi bon risquer, quand bien même on le pourrait, plusieurs centaines de mille francs sur un bâtiment isolé qui fatalement tombera un jour ou l’autre au pouvoir de l'ennemi ?
Les Anglais sont en effet les maîtres incontestables de la mer. Après les désastres d'Aboukir (1798) et de Trafalgar (1805), les débris des flottes françaises n'essaient même plus de lutter. Que de précautions l'on prend pour faire sortir la Piémontaise du hâvre de Solidor (1806) ! Le corsaire n'a plus qu'une ressource. C'est de se glisser à travers les mailles du filet tendu le long des côtes. Il fuit aussitôt qu'il aperçoit l'ennemi et profite d'un heureux hasard pour faire et terrir quelques prises. Mais cette nouvelle tactique diminue évidemment beaucoup ses chances de profit.
La course ne devait plus revoir dans la suite les beaux jours d'autrefois. Faut-il s'en affliger outre mesure ?
Tout d'abord, il est, certain que de telles entreprises favorisent singulièrement de part et d'autre les injustices et les cruautés. Elles augmentent l'animosité entre les deux nations en guerre. Nos corsaires ont expié trop durement les pertes subies par le commerce anglais. Le désir du gain, l'anxiété et les désillusions d'une longue attente, parfois le souvenir d'une récente captivité sur les pontons les exposent eux-mêmes à des tentations dangereuses. Toutes exagérations mises à part, le mot de Corbière déjà cité au cours de ce travail exprime une idée juste : « L'histoire des corsaires ne s'écrit pas sur du papier jonquille avec l'encre vaporisée de jasmin et de tubéreuse » [Note : La lecture des Décisions du Conseil des Prises (A. N., FF2, 1-15) ost fort instructive à cet égard. Voir en particulier les dossiers 736, 1425, 1857, 2043. Aucun des corsaires mentionnés dans ces jugements n'est d'ailleurs de St-Malo]. N'y a-t-il pas d'ailleurs quelque chose d'un peu odieux à la guerre ainsi faite, uniquement pour enrichir quelques particuliers, surtout quand il s'agit de neutres capturés pour de simples infractions aux Règlements sur la police maritime ? Ne peut-on souhaiter qu'un jour la propriété privée de l'ennemi soit elle-même, dans la mesure du possible, respectée sur la mer comme elle doit l'être dans les guerres continentales ?
Au point de vue national, la course est une excellente école de marins et l'on peut sur ce point ne pas partager l'opinion sévère de l'amiral Jurien de la Gravière : « Les habitudes de pillage que les matelots contractent à ce métier, le butin qu'ils s'occupent d'amasser, le soin d'éviter la remcontre des bâtiments de guerre et de ne rechercher que celle des bâtiments de commerce, les disposent mal à des luttes honorables. Tout corsaire devient à la longue un pirate. Or rien ne se bat moins bien qu'un forban » [Note : JURIEN DE LA GRAVIÈRE. Souvenirs d'un Amiral, 1860, cité par BOURDE DE LA ROGERIE, op. cit., p. 84]. Les forbans ont montré à l'occasion qu'ils savaient être aussi de rudes et vaillants soldats. Il n'en reste pas moins que le but même de la course est de ruiner le commerce ennemi. Ce résultat pouvait-il être atteint ? Vauban l'avait cru deux cents ans plus tôt. L'expérience des dernières années semble bien y contredire.
Reste le point de vue de la prospérité du pays malouin. Il ne faut pas oublier que les armateurs sont des commerçants soucieux sans doute de l'intérêt de l'Etat, goûtant les beaux faits de guerre, mais ayant aussi le souci de leurs intérêts pécuniers et de ceux de leurs actionnaires. L'espoir raisonné du gain doit dicter leurs sacrifices. L'armement en course est au premier titre une opération commerciale [Note : Ce sont les conclusions de : H. MALO, Les Corsaires, p. 12 ; A. CORRE. Un Corsaire brestois sous Louis XV ; L. ESNOUL. Quelques Corsaires de la République et de l'Empire, Bourde de la Rogerie, Vignols, etc. Voir aussi CLOWES, The royal Navy, VI, 73, pour jugement sur les avantages et les inconvénients de la Course pendant la guerre anglo-américaine, 1812-1815].
Or il arrive qu'un jour cette opération commerciale cesse d'être suffisamment rémunératrice. C'est bien le cas, semble-t-il, pour les Malouins durant la dernière expérience dont nous avons essayé de retracer ici les principaux épisodes. Une telle constatation pourra peut-être adoucir les regrets de ceux qui déplorent trop vivement l'article du traité de Paris (1856) interdisant la course : malgré l'intérêt qui s'attache aux choses du passé, malgré le souvenir d'une prospérité sans doute à jamais disparue, il ne faut point oublier les réalités de l'heure présente.
Triste expédient d'un temps de détresse, la course a d'ailleurs été remplacée par d'autres entreprises beaucoup moins hasardeuses et tout aussi productives. Aussitôt après la chute de l'empire, les armements du commerce prennent un nouvel essor. Sans parler du long-cours ni du cabotage, les Malouins, corsaires pendant la guerre, deviennent pêcheurs pendant la paix [Note : CUNAT dans OGÉE, Dict. de Bretagne, p. 822 et suiv., a dressé des armements malouins pour Terre-Neuve la statistique suivante : (Ordonnance du 8 février 1816 réorganisant les Primes établies pour la première fois en 1785) : 1815 (19), 1817 (54), 1818 (63), 1819 (64). D'après le journal Le Salut, 8 mai 1901, Saint-Malo-Saint-Servan auraient armé pour la pêche : 1900 (92 navires montés par 6.109 hommes), 1901 (88 bâtiments avec 6.362 marins). Enfin, en 1913, le produit des ventes dès 141 morutiers de la région atteindrait le chiffre total de 9.323.000 francs. (Note communiquée par M. Tuloup)]. L'exportation des fruits du sol remplace avec avantage le commerce des toiles de Bretagne, car elle enrichit la région tout entière.
Enfin, par un curieux renversement des choses, l'antique cité malouine, si longtemps abhorrée des Anglais, est devenue pour beaucoup d'entre eux un séjour de prédilection durant la belle saison. Sans doute, son riant aspect dans la ceinture de rochers qui lui sert de parure après avoir été sa défense la prédestinait à ce rôle. Mais pourtant en passant au pied de la Tour Solidor, plusieurs pourraient se dire qu'un de leurs aïeux peut-être y fut jadis enfermé prisonnier des corsaires !
(abbé F. Robidou).
© Copyright - Tous droits réservés.